Quiconque a eu l’occasion de lire régulièrement nos articles, et notamment ceux publiés à plusieurs reprises dans Vita Nova, connaît déjà le point de vue qui sera le fil conducteur des présentes notes : nous faisons allusion à cette idée d’une opposition fondamentale entre deux attitudes distinctes quant à l’esprit, où il faut voir l’origine de deux traditions bien différenciées sur le plan aussi bien historique que suprahistorique.
La première, c’est l’attitude guerrière et royale, la seconde, l’attitude religieuse et sacerdotale. L’une constitue le pôle viril, l’autre, le pôle féminin de l’esprit. L’une a pour symbole le Soleil, le « triomphe », elle correspond à l’idéal d’une spiritualité dont les maîtres-mots sont la force, la victoire, la puissance ordonnatrice, et qui embrasse toutes les activités et tous les individus au sein d’un organisme simultanément temporel et supratemporel (idéal sacré, de l’Imperium), en affirmant la prééminence de tout ce qui est différence et hiérarchie. L’autre attitude a pour symbole la Lune ; comme cette dernière, elle reçoit d’un autre la lumière et l’autorité, elle s’en remet à autrui et véhicule un dualisme réducteur, une incompatibilité entre l’esprit et la puissance, mais aussi une méfiance et un mépris pour toute forme d’affirmation supérieure et virile de la personnalité : ce qui la caractérise, c’est le pathos de l’égalité, de la « crainte de Dieu », du « péché » et de la « rédemption ».
Ce que l’Histoire – jusqu’à nos jours – nous a montré en fait d’opposition entre autorité religieuse et pouvoir « temporel », n’est qu’un écho, une forme plus tardive et plus matérielle en laquelle a dégénéré un conflit qui, dès l’origine, se rapportait à ces deux termes, c’est-à-dire un conflit entre deux autorités, également spirituelles, entre deux courants se référant au même titre, bien que d’une manière opposée, au supramonde. Il y a plus : l’attitude « religieuse », loin de correspondre sans autre forme de procès au spirituel et d’épuiser ce qui relève du domaine suprême de l’esprit, n’est que le produit, relativement récent, d’un processus de dégénérescence qui a frappé une tradition spirituelle plus ancienne et plus éminente, de type précisément « solaire ».
En effet, si nous examinons les institutions des plus grandes civilisations traditionnelles – de la Chine à la Rome antique, de l’Égypte à l’Iran, du Pérou précolombien au vieux monde nordico-scandinave – nous trouvons constamment, sous des traits uniformes, l’idée d’une fusion absolue des deux pouvoirs, royal et spirituel ; au faîte de la hiérarchie, nous ne trouvons pas une église, mais une « royauté divine », non pas l’idéal du saint, mais de celui qui, par sa nature supérieure même, par la force nécessitante du rite en tant que « technique divine », joue, par rapport aux puissances spirituelles (ou « divinités ») le même rôle viril et dominateur qu’un chef en face des forces des hommes. C’est un processus de dévirilisation spirituelle qui, de là, a conduit à la forme religieuse, puis, en augmentant constamment la distance entre l’homme et Dieu, et la servilité du premier vis-à-vis du second au seul bénéfice de la caste sacerdotale, a fini par miner l’unité traditionnelle en donnant lieu à la double antithèse d’une spiritualité antivirile (sacerdotalité) et d’une virilité matérielle (sécularisation de l’idée d’État et de Royauté, matérialisation des aristocraties antiques et sacrées). Si l’on doit surtout aux rameaux aryens les formes lumineuses des anciennes civilisations « solaires », en Occident, c’est surtout à l’élément levantin que l’on doit le triomphe de l’esprit religieux – jusqu’à l’asiatisation du monde gréco-romain, jusqu’à la décadence de l’idée impériale augustéenne, jusqu’à l’arrivée même du christianisme.
Dans les présentes notes, nous nous proposons d’éclairer quelques aspects peu connus de la civilisation médiévale, afin de démontrer qu’elle inclut la tentative (tantôt visible, tantôt cachée) d’une grande réaction, la volonté de reconstruire une tradition universelle dont le but, malgré les apparences formelles et la conception courante du Moyen Age comme un âge « catholique » par excellence, est antichrétien ou, plutôt, dépasse le christianisme.
Le réveil nordico-aryen de la Romanitas
Très vraisemblablement, cette volonté de restauration tira son origine première des races nordico-germaniques, dont l’influence, à l’époque post-byzantine, est un fait universellement acquis. Sur la foi des plus anciens témoignages – y compris, d’un certain point de vue, chez Tacite lui-même -, ces races nous apparaissent comme un type extrêmement proche de celui des Achéens, des paléo-Iraniens, des paléo-Romains, et en général, des Nordico-Aryens, qui se serait conservé, pour ainsi dire, au stade d’une pureté « préhistorique ».
Et le fait que, en raison des traits extérieurs rudes, sans fioritures, grossièrement et âprement sculptés de leur existence et de leurs mœurs, ces races aient pu apparaître comme « barbares » en face d’une civilisation qui, d’une part, avait dégénéré sous le poids de ses structures juridico-admmistratives et, d’autre part, s’était amollie en recherches de raffinements hédonistes, littéraires et citadins, était quasiment synonyme de décadence, ce contraste ne saurait empêcher que ces races aient véhiculé en propre et abrité dans leurs mythes et dans leurs légendes la profonde spiritualité d’une tradition aryenne originelle, dont le support était une existence empreinte de rapports guerriers et virils, de fierté, de liberté, d’honneur et de fidélité.
Par ailleurs, nous constatons que ce n’est pas de l’esprit « religieux », mais précisément de l’esprit « héroïque » qu’émanaient les incarnations des divinités principales que, à l’origine, ces races reconnaissaient et vénéraient. C’est le panthéon lumineux des Ases, en lutte perpétuelle avec les « géants » et les natures élémentaires de la terre. C’est Donnat-Thor, destructeur de Thyr et d’Hymir, le « fort entre les forts », « l’irrésistible », le maître de « l’abri contre la terreur ». C’est Wotan-Odin, le donneur de victoire, le détenteur de la sagesse, l’hôte des héros immortels que les Walkyries choisissent sur les champs de bataille et dont il fait ses propres fils – le Seigneur des bataillons tempétueux, celui dont le symbole est identique à celui de la grandeur romaine et de la « gloire » – hvareno iranienne -, l’Aigle, dont la force nourrit le sang non-humain des dynasties royales. En outre, déjà mêlé aux hommes, nous avons des races héroïques, comme celle de Wälsungen, à laquelle appartiennent Sigmund et Sigurt-Siegfried, et qui lutteront jusqu’au bout contre le Ragnarökkr, contre l’obscurcissement des dieux, symbole des âges sombres qui seront le lot des générations futures ; nous avons les races royales gothiques qui se considèrent comme des âmals, les « purs » ou les « célestes », et qui font remonter leur origine à la symbolique Mitgardhz, la « terre du milieu », située – comme l’Hyperborée du solaire Apollon et l’airynem-vaêjo des Iraniens – dans l’extrême Nord ; nous avons une variété d’autres thèmes et d’autres mythes d’origine aryenne très ancienne, également et toujours empreints de spiritualité guerrière et étrangers a tout relâchement « religieux ».
Si, de l’extérieur, l’irruption des « barbares », a pu sembler destructrice du fait de sa contribution au bouleversement de l’ordonnancement matériel de l’Empire asiatisé, elle signifia par contre, du point de vue intérieur, un apport vivificateur de l’esprit aryen, un nouveau contact galvanisateur avec une force encore à l’état pur, et qui devait donner lieu à une lutte et à une réaction sous le signe, précisément, de cette romanitas et de cet Imperium, qui avaient tiré leur grandeur, dans le monde antique, de leur conformité à un type de spiritualité virile et solaire. Après les premiers siècles de notre ère, les envahisseurs prirent en effet distinctement conscience d’une mission de restauration. Leur « conversion » laissa presque intacts leur ethos et leur intime tradition originelle qui, une fois le symbole de l’ancienne Rome adopté, devait se dresser contre l’usurpation et la volonté d’hégémonie de l’Église, alors qu’en même temps elle entreprenait la formation, spirituelle et matérielle, d’une nouvelle civilisation européenne.
Nous savons que déjà lors du couronnement du roi des Francs, qui avait lieu le jour considéré par l’Antiquité comme celui de la renaissance de l’invincible dieu solaire (natalis solis invicti), on adopta la formule Renovatio Romani Imperii. Après les Francs, ce furent précisément les Germains qui assumèrent, d’une manière encore plus tranchée, cette fonction. La désignation de leur idéal impérial œcuménique ne fut pas « teutonique » mais « romain » – jusque dans les terres les plus lointaines, ils portèrent les enseignes et les devises romaines : basilei et augusti, leurs rois se parèrent du titre de Romanorum reges, et Rome resta toujours la source symbolique de leur Imperium et de leur légitimité.
Le semblable rencontre donc son semblable. Le semblable réveille et intègre son semblable. L’aigle paléonordique d’Odin renoue avec l’aigle romaine des légions et du dieu capitolin. L’esprit antique renaît sous de nouvelles formes. Il se crée un grand courant à la fois formateur et unificateur. L’Église, d’une part, se laisse dominer – elle « romanise » son propre christianisme – pour pouvoir dominer à son tour, pour pouvoir se maintenir à la crête de la vague ; et, d’autre part, elle résiste, elle veut arriver au faîte du pouvoir, elle veut primer sur l’Empire. Si c’est dans la tension que se libèrent des éclairs extrêmement riches de signification, n’en demeure pas moins la réalité que, si le Moyen Âge se présente à nous sous l’aspect d’une grande civilisation « traditionnelle » dans son expression la plus parfaite, cela ne s’est pas produit grâce au christianisme, mais malgré le christianisme, en vertu de l’apport nordique qui ne faisait qu’un avec l’idée antique de la Rome païenne, et détermina une force agissant dans deux directions : sur le plan politique et éthique, au travers du régime féodal, de l’éthique chevaleresque et de l’idéal gibelin ; sur le plan spirituel, d’une manière occulte dans l’aspect « interne » de la chevalerie et même des Croisades, à travers le mythe païen qui renaît autour de l’idée impériale, à travers les veines cachées d’une tradition qui débouchera sur Dante et les « Fidèles d’Amour ».
L’ethos païen de la féodalité
Il va de soi qu’il est inutile de s’attarder sur le caractère antichrétien du régime social et des idéaux éthiques du Moyen Âge, tant il s’agit de choses connues de tous, aux traits par trop évidents.
Le régime féodal caractérise la société médiévale. Un tel régime est directement issu du monde nordico-aryen ; il se base sur les deux principes de l’individualité libre et de la fidélité guerrière, et rien ne lui est plus étranger que le pathos chrétien de la « socialité », de la collectivité, de l’amour. Avant le groupe, on trouve ici l’individu. La plus haute valeur, la vraie mesure de la noblesse, dès la plus ancienne tradition nordique (comme celle paléoromaine), résidait dans le fait d’être libre. La distance, la personnalité, la valeur individuelle étaient des éléments indissolublement liés à toute expression de la vie. L’État, sous son aspect politique temporel — de même que selon l’ancien concept aristocratique romain — se résumait au conseil des chefs, chacun d’eux restant libre et seigneur absolu de sa terre, pater, dux et prêtre de sa propre gens. À partir d’un tel conseil, l’État s’imposait comme idée suprapolitique à travers le roi, puisque celui-ci, dans l’ancienne tradition nordique, ne l’était que par son sang « divin », par le fait de n’être finalement qu’un avatar d’Odin-Wotan lui-même.
Mais, dans le cas d’une entreprise commune de défense ou de conquête, voici qu’une condition nouvelle prenait le pas sur l’autre : il se formait spontanément une hiérarchie rigide, un principe nouveau de fidélité et de discipline guerrière s’affirmait. Un chef – dux, heritigo – était élu, et le libre seigneur se transformait alors en un vassal d’un chef dont l’autorité s’étendait jusqu’au droit de le tuer s’il venait à manquer aux devoirs qu’il avait acceptés. Au terme de l’entreprise, cependant, on revenait à l’état normal et antérieur d’indépendance et d’individualité libre. Le développement qui, de cette constitution paléonordique, débouche sur le régime féodal, peut être avant tout caractérisé par une identification de l’idée sacrale du roi avec l’idée militaire du chef temporaire. Le roi en vient à incarner l’unité du groupe, y compris en temps de paix, du fait du renforcement et de l’extension à la vie civile du principe guerrier de la fides ou fidélité. Autour du roi, il se forme une suite de « compagnons » – fideles ou leudes – libres, mais trouvant dans l’idéal de la fidélité, dans le service de leur seigneur, dans le fait de combattre pour son honneur et pour sa gloire, un privilège et la réalisation d’un mode d’être plus élevé que celui qui, au fond, les aurait abandonnés à eux-mêmes.
La constitution féodale s’élabora au travers de l’application progressive de ce principe. Extérieurement, elle semble altérer l’ancienne constitution aryenne : la propriété terrienne, à l’origine absolue et individuelle, paraît maintenant conditionnée – c’est un beneficium qui implique loyalisme et service. Cependant, elle ne l’altère en profondeur que là où la fidélité ne fut plus conçue comme une voie permettant d’atteindre à une liberté véritable, sous une forme supérieure et déjà supraindividuelle. Quoiqu’il en soit, le régime féodal fut un principe et non pas une réalité pétrifiée ; ce fut l’idée générique d’une loi d’organisation directe qui laissait le champ libre au dynamisme de forces elles-mêmes libres, rangées les unes sous les autres ou les unes à côté des autres, sans moyens termes et sans altérations – vassal en face du suzerain et seigneur en face du seigneur – de manière telle que tout – liberté, honneur, gloire, destin, propriété – pût reposer sur la valeur et sur le facteur personnalité, et non pas, ou quasiment pas, sur un élément collectif ou sur un pouvoir « public ». Ici, on peut dire que le roi lui-même était appelé à perdre et à reconquérir à tout moment ses prérogatives. Probablement, l’homme n’a jamais été traité d’une manière plus sévère et plus insolente, et cependant ce régime fut une école d’indépendance et de virilité, et non pas de servitude ; dans ce cadre, les rapports de fidélité et d’honneur surent offrir un caractère de pureté et d’absoluité auquel, par la suite, on ne devait plus jamais atteindre.
Il n’est pas besoin, arrivé à ce point, de s’étendre beaucoup pour démontrer combien cette institution, qui reste pourtant la plus caractéristique de l’esprit du Moyen Âge, n’a pas grand-chose de commun avec l’idéal social judéo-chrétien. En elle, par contre, réapparaît cette fides qui, avant d’être la deutsche Treue, fut la Fides des Romains ; objet de l’un des plus anciens cultes, elle fit dire à Livius qu’elle caractérisait au plus haut point le Romain en face du « barbare ». Elle nous ramène à l’idéal de la bhakti des Aryens de l’Inde, et rappelle surtout l’ethos païen qui anima les sociétés iraniennes : si, de pair avec le principe de l’autorité et d’une fidélité jusqu’au sacrifice (non seulement dans l’action mais encore dans la pensée) vouée aux souverains déifiés, on affirmait aussi le principe de la fraternité, cette dernière restait totalement étrangère à la sentimentalité féminine et communisante introduite par le christianisme. Les qualités viriles, jusque sur le plan de l’initiation (cf. le mithracisme), avaient une valeur autrement plus élevée que celle de la compassion et de la mansuétude, de sorte qu’une telle fraternité – semblable à celle des pairs et des hommes libres du Moyen Âge – demeurait celle, loyale, claire, fortement individualisée et, pouvons-nous même ajouter, romaine, qui pouvait exister entre des guerriers qu’une commune entreprise rassemblait.
La Tradition secrète de l’Empire
La fides, qui cimentait les unités féodales particulières en vertu d’une espèce de purification, de sublimation dans l’intemporel, faisait naître une fides supérieure, qui renvoyait à une entité placée plus haut, universelle et métapolitique – représentée, comme chacun sait, par l’Empire. L’Empire, surtout tel qu’il s’affirma idéalement avec les Hohenstaufen, se présenta comme une unité de nature aussi spirituelle et œcuménique que l’Église. Comme l’Église, il revendiqua une origine et une finalité supranaturelles et s’offrit comme une voie de « salut » aux hommes. Mais, de même que deux soleils ne peuvent coexister dans un même système planétaire (et cette dualité Empire-Église fut, justement, souvent représentée par l’image des deux soleils), de même le conflit entre ces deux puissances universelles, points culminants de la grande ordinatio ad unum du monde féodal, ne devait pas tarder à faire rage.
Le sens d’un tel conflit échappe fatalement à celui qui, s’arrêtant aux apparences extérieures et à tout ce qui, d’un point de vue plus profond, n’est que simple cause fortuite, ne sait y voir qu’une compétition politique, une rencontre brutale d’orgueils et de volontés d’hégémonie, alors qu’il s’agit d’une lutte à la fois matérielle et spirituelle, due au choc des deux traditions et attitudes opposées dont nous avons parlé au début. À l’idéal universel de type « religieux » de l’Église, s’oppose l’idéal impérial comme volonté occulte de reconstruire l’unité des deux pouvoirs, du royal et du spirituel, du sacral et du viril.
En ce qui concerne ses expressions extérieures, l’idée impériale se limita souvent à ne revendiquer que la maîtrise du corpus et de l’ordo de la Chrétienté ; de ce fait, il est clair qu’en elle on retrouve finalement l’idée nordico-aryenne et païenne de la « royauté divine » qui, conservée par les « barbares », dépasse, au contact des symboles de la romanité antique, les limites d’une race spécifique, c’est-à-dire des traditions des races nordiques particulières, s’universalise, se dresse en face de l’Église comme une réalité œcuménique aussi vraie que l’Église et comme l’âme la plus authentique, le centre d’union et de sublimation le plus adéquat pour cet ethos guerrier et féodal de type païen qui, déjà, transcendait les formes particulières et simplement politiques de la vie à cette époque.
La prétention même de l’Église, l’idéologie anti-impériale qui lui fut propre confirment ce caractère de la lutte. L’idée grégorienne est une idée anti-traditionnelle par excellence : c’est celle de la dualité des pouvoirs et d’une spiritualité anti-virile qui s’affirme supérieure à une virilité guerrière que l’on tente par ailleurs d’abaisser mesquinement à un plan tout-à-fait matériel et politique : c’est l’idée du clerc souverain trônant au-dessus du chef d’un État conçu comme pouvoir purement temporel, par conséquent au-dessus d’un « laïc » qui tire uniquement son autorité du droit naturel et reçoit l’Imperium comme s’il s’agissait d’un beneficium concédé par la caste sacerdotale.
Naturellement, il ne peut s’agir là que d’une prétention nouvelle, prévaricatrice et subversive. Sans même parler des grandes traditions préchrétiennes, l’Église, dans cet empire « converti » qui fut celui de la période byzantine, non seulement restait dépendante de l’État, mais, lors des conciles, les évêques s’en remettaient souvent à l’autorité des princes pour sanctionner et approuver définitivement leurs décisions, y compris en matière de dogme, au point que la consécration des rois, par la suite, ne pouvait se distinguer de façon essentielle de celle des prêtres. Il est ensuite à noter que, si les rois et les empereurs, dès la période franque, prenaient l’engagement de défendre l’Église, cela était bien loin de signifier « subordination à l’Église », mais le contraire. Dans le langage de l’époque, « défendre » avait un sens bien différent de celui qu’il a pris de nos jours.
Assurer la défense de l’Église, ou mainbour, c’était, selon le langage et les idées du temps, exercer sur elle simultanément protection et autorité. Ce que l’on nommait défense était un véritable contrat impliquant la dépendance du protégé, qui était soumis à toutes les obligations que la langue d’alors résumait dans le mot « rides ». Selon le témoignage d’Eginhard, « après les acclamations, le pontife se prosterna devant Charles, selon le rite établi au temps des anciens empereurs » ; et le même Charlemagne, en plus de la défense de l’Église, revendiquait le droit et l’autorité de la « fortifier de l’intérieur selon la vraie foi », tandis que ne manquent pas les prises de position allant dans le même sens, comme celle-ci : Vos gens sancta estis atque regale estis sacerdotium (Étienne III aux Carolingiens) ou encore : Melchisedek noster, merito rex atque sacerdos, complevit laïcus religionis opus.
L’opposition guelfe contre l’Empire est donc une pure et simple révolte qui reprend comme slogan la parole de Gélase Ier : « Après le Christ, aucun homme ne peut être roi et prêtre » et tend à désacraliser l’idée d’Empire, à étouffer la tentative nordico-romaine de la réunification « solaire » des deux pouvoirs et, par conséquent, de la reconstruction d’une autorité supérieure à celle que l’Église, en tant qu’institution religieuse, n’aurait jamais dû revendiquer pour elle-même.
Et chaque fois que l’Histoire ne parle qu’implicitement de cette aspiration supérieure, c’est le mythe qui s’en charge : le mythe qui ne s’oppose pas, ici, à l’Histoire, mais l’intègre et en révèle une dimension plus profonde. Voici donc, à la période franque, que revient souvent pour le roi (et la phrase citée plus haut nous en donne un exemple) le symbole énigmatique de Melchisedek et de sa religion royale : de ce Melchisedek, roi de Salem, prêtre d’une religion d’un rang plus éminent que celui de la religion d’Abraham, et qui doit être considéré comme la figuration biblique de l’idée extrabiblique, païenne et traditionnelle au sens supérieur, du Seigneur universel (le çakravarti hindou), de celui qui réunit en lui de manière solaire les deux pouvoirs et se trouve être le point d’union vivant entre le monde et le supramonde.
Mais cette même signification réapparaît aussi dans de très nombreuses légendes relatives aux empereurs germaniques, où interférent le réel et l’irréel, l’Histoire et le mythe. En plus de Charlemagne, Frédéric Ier et Frédéric II, entrés dans la légende, ne seraient jamais morts. Ils auraient reçu en don du mystérieux « Prêtre Jean », qui n’est autre qu’une figure médiévale du « seigneur universel », les symboles d’une vie éternelle et d’un pouvoir non humain de victoire (la peau de salamandre, l’eau de vie, l’anneau d’or). Ils poursuivraient leur existence au sommet d’une montagne (par exemple l’Odenberg ou le Kyffhaüser), quelquefois en un lieu souterrain. Ici également reviennent les symboles, que nous pouvons définir comme universels, d’une tradition païenne très ancienne.
En effet, c’est sur une montagne ou dans un lieu souterrain qu’aurait trouvé refuge et que se trouverait toujours le roi paléo-iranien Yima, « le Resplendissant, celui qui, parmi les hommes, est semblable au soleil » ; le Walhalla nordique, siège des rois divinisés et des héros immortalisés, fut souvent conçu sous la forme d’une montagne ; et c’est encore sur une montagne, (la Montagne de l’Ancêtre) que, selon les légendes bouddhiques, disparaîtraient les « éveillés » et les « êtres libres et surhumains » – comme souvent les héros grecs divinisés, y compris Alexandre le Grand, dans certaines légendes du monde hellénique.
L’Agartha, nom tibétain de la résidence du « seigneur universel » (qui correspond d’autre part, étymologiquement parlant, à l’Asgard de l’Edda, résidence des Ases et des rois divins primordiaux) serait enfouie au cœur d’une montagne. En général, les montagnes symboliques des légendes médiévales, mais également le Meru hindou, le Kef islamique, le Mont Salvat des légendes du Graal, et même l’Olympe, ne sont que diverses versions d’un thème unique ; au travers du symbole de la « hauteur », ils expriment les états spirituels transcendants et « célestes » (convergence avec le symbolisme des lieux souterrains, c’est-à-dire cachés, si l’on songe à la relation entre coelum, ciel et celare, cacher), qui conféraient, traditionnellement, l’autorité et la fonction absolue, métaphysique, de l’Imperium.
La légende des empereurs jamais morts et ravis sur une montagne nous confirme le fait qu’en ces figures on voulut voir les manifestations de la fonction éternelle, en elle-même immortelle, du domaine spirituel universel qui, d’autre part, selon un thème traditionnel récurrent (cf. l’Edda, le Brahmâna, l’Avesta, etc.) doit se manifester à nouveau à l’occasion d’une crise décisive de l’histoire du monde. En effet, dans les légendes médiévales, on trouve aussi l’idée que les Empereurs du Saint-Empire Romain se réveilleront le jour où feront irruption les hordes de Gog et Magog – symboles du démonisme de la pure collectivité – jadis enfermés par Alexandre le Grand derrière une muraille de fer. Les Empereurs livreront la dernière bataille dont dépendra la floraison nouvelle de « l’Arbre sec » – l’Arbre de la Vie et du Monde, qui n’est autre que la plante dépouillée de Dante mais aussi l’Yggdrasil de l’Edda, dont la mort marquera le Ragnarökkr, l’obscurcissement des dieux.
Il est donc significatif que, parmi ces mythes qui mettent en évidence la relation de l’idéal impérial médiéval avec l’idée « solaire » traditionnelle – mais également le dépassement de la conception « religieuse » de l’esprit et de la limitation politique et laïque de l’empire et de la royauté – il y en a quelques-uns (cf. par exemple le Speculum Theologiae) qui poussent l’opposition à l’Église et au christianisme au point de donner à l’Empereur ressuscité, qui fera refleurir l’Arbre sec, les traits de l’Antéchrist ; naturellement, non pas au sens habituel (puisqu’il restera toujours celui qui combat contre les hordes de Gog et de Magog), mais probablement à titre de symbole d’un type de spiritualité irréductible à celle de l’Église, au point d’être obscurément assimilé, dans la légende, à la figure de l’ennemi du dieu chrétien.
Le ferment gibelin, l’âpre lutte pour la revendication impériale, outre son aspect visible, avait donc un côté invisible. Derrière la lutte politique se cachait une lutte entre deux traditions spirituelles opposées, et, au moment où la victoire semblait sourire à un Frédéric II, déjà les prophéties populaires annonçaient : « Le cèdre du Liban sera coupé. Il n’y aura plus qu’un seul dieu, c’est-à-dire un monarque. Malheur au clergé ! S’il tombe, un ordre nouveau est prêt ».
À suivre
Julius Evola
Revue Vita Nova, 1934
tr. fr. Gérard Boulanger in revue Kalki n°3
Pardès, 1987
Source : Métapédia
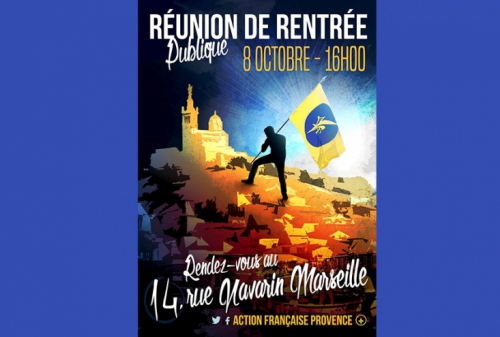
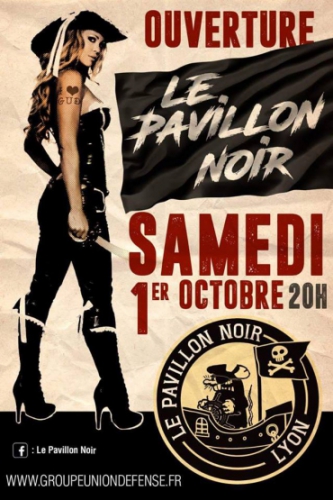
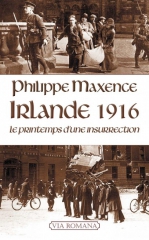 En 2007, Philippe Maxence, éminent connaisseur de l’histoire et de la question irlandaises, publiait Pâques 1916, renaissance de l’Irlande, remarquable étude du Rising, sans doute l’une des meilleures parues en français.
En 2007, Philippe Maxence, éminent connaisseur de l’histoire et de la question irlandaises, publiait Pâques 1916, renaissance de l’Irlande, remarquable étude du Rising, sans doute l’une des meilleures parues en français. "[...] Faut-il rappeler les attaques subies au cours des dernières années, pour ne retenir que quelques figures en vue, par les philosophes Alain Finkielkraut ou Michel Onfray, par le journaliste Eric Zemmour, par le comédien Lorànt Deutsch ou par le romancier Michel Houellebecq? Faut-il rappeler les conditions dans lesquelles s'est déroulé le débat - ou plus exactement l'absence de débat - sur le Mariage pour tous, où il était posé par principe qu'en être partisan était le signe d'un esprit ouvert et moderne et qu'en être l'adversaire était le fait d'une mentalité intolérante et rétrograde.
"[...] Faut-il rappeler les attaques subies au cours des dernières années, pour ne retenir que quelques figures en vue, par les philosophes Alain Finkielkraut ou Michel Onfray, par le journaliste Eric Zemmour, par le comédien Lorànt Deutsch ou par le romancier Michel Houellebecq? Faut-il rappeler les conditions dans lesquelles s'est déroulé le débat - ou plus exactement l'absence de débat - sur le Mariage pour tous, où il était posé par principe qu'en être partisan était le signe d'un esprit ouvert et moderne et qu'en être l'adversaire était le fait d'une mentalité intolérante et rétrograde.