A partir de l'article du sieur Frédéric Lewino sur le Moyen Age, publié dans Le Point pourrait être écrit un « discours de la méthode » de manipulation des médias aujourd'hui. Il s'agit d'un véritable cas d'école.
L'article en question est de la même veine que l'anecdote contée par Régine Pernoud au début de son livre Pour en finir avec le Moyen Age.
Aussi, seule cette source, Régine Pernoud, autrement moins docte, moins érudite et moins célèbre que le journaliste du Point pourrait servir à mettre en lumière l'obscurantisme du frère Fréderic.
Son anecdote la voici :
« Comme cela se passait il y a déjà plusieurs années et que le neveu en question a aujourd'hui atteint l'âge de la majorité selon le Code civil, je croyais que les choses avaient changé depuis. Mais voilà qu'il y a quelques mois (juillet 1975), me promenant avec la petite-fille d'une de mes amies (Amélie, 7 ans), celle-ci me lance joyeusement :
— Tu sais, à l'école, j'apprends le Moyen Age.
— Ah, très bien ! Et comment était-ce, le Moyen Age ? Raconte.
— Alors, il y avait des seigneurs (elle cherche un peu avant de retrouver le mot difficile...) des seigneurs féodaux. Alors ils se faisaient tout le temps la guerre et avec leurs chevaux ils allaient dans les champs des paysans et ils abîmaient tout.
Un cornet de glace a ensuite capté son attention et mis fin à sa description enthousiaste. Cela m'a fait comprendre qu'en 1975 on enseigne l'histoire exactement comme on me l'avait enseignée à moi-même il y a un demi-siècle ou davantage. Ainsi va le progrès.
Et du même coup, cela m'a fait regretter l'éclat de rire — assez peu charitable, reconnaissons-le — que j'avais eu quelques jours auparavant en recevant un coup de téléphone d'une documentaliste de la TV — spécialisée qui plus est dans les émissions historiques !
— Il paraît, disait-elle, que vous avez des diapositives. Est-ce que vous en avez qui représentent le Moyen Age ?
— ? ? ?
— Oui, qui donnent une idée du Moyen Age en général : des tueries, des massacres, des scènes de violence, de famines, d'épidémies...
Je n'avais pu m'empêcher d'éclater de rire, et c'était injuste : visiblement cette documentaliste n'avait pas dépassé le niveau d'Amélie sur le point particulier de l'histoire du Moyen Age. Mais comment l'aurait-elle dépassé ? Où en aurait-elle appris davantage ? »
(En bleu les extraits de l'article)
Les mensonges du Point :
«C'était le règne de Robert le Pieux, le deuxième Capétien, avec ses épidémies, ses famines, ses guerres incessantes. Le paradis...
Oui-da, que la vie était belle en 1016 avec ses famines, ses épidémies, ses guerres. À chaque époque ses peines et ses malheurs. Et quand un noble vieillard prétend que c'était mieux à son époque, c'est qu'il commence à perdre la mémoire. »
La vérité restaurée:
Dans son livre, Pour en finir avec le Moyen Age , page 17, Régine Pernoud (RP) souligne :
« Aussi bien, des érudits en notre siècle ont-ils faits un remploi du terme renaissance. Constatant qu'autour de Charlemagne ont cultivait assidument les auteurs latins et grecs, ils ont parlé de « Renaissance carolingienne », et le terme est communément admis. D'autres plus hardis ont parlé de renaissance du XIIème siècle, voire d'humanisme médiéval.»
[…] « On va ainsi de renaissance en renaissance, ce qui ne manque pas d'être suspect. »
Entre l'an 800 et le XIIème siècle, l'an 1016 est plus ou moins au milieu. Alors elle n'est pas belle la vie en 1016 ? Qui est le noble vieillard ? Qui est l'ignoble ignare ?
Quant aux guerres du Moyen Age, on est loin des millions de morts de 14-18 et des dizaines de millions de 39-45. Mais cette idée n'effleure même pas notre historien du jour.
Les mensonges du Point :
Pas de terrorisme ! Pas de crainte de réchauffement climatique ! Pas de chômage ! Pas de Le Pen !
La vérité restaurée:
- La terreur islamique n'a pas encore fermé l'accès aux lieux saints, il est vrai. Les Turcs ne vont exterminer les chrétiens de Jérusalem qu'en 1078. Mais ces pratiques barbares, de conversion par la force et d'extermination de tous ceux qui ne veulent pas se soumettre, ont commencé dès l'hégire, soit 632 ! La terreur islamique est telle qu'elle seule réussit à assurer l'unité des habitants du pays sous le commandement de Charles Martel en 732 à Poitier.
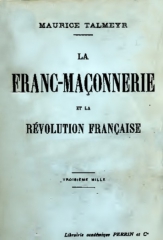 Qui sont les responsables de l’état actuel
Qui sont les responsables de l’état actuel 
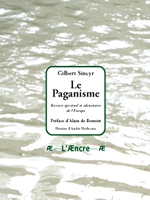 Entretien avec Gilbert Sincyr, auteur du livre Le Paganisme. Recours spirituel et identitaire de l’Europe (préface d’Alain de Benoist) par Fabrice Dutilleul
Entretien avec Gilbert Sincyr, auteur du livre Le Paganisme. Recours spirituel et identitaire de l’Europe (préface d’Alain de Benoist) par Fabrice Dutilleul