Le monde huntingtonnien
Lancée par Samuel P. Huntington voilà quelques années, tout d’abord par la publication d’un article dans Foreign Affairs puis dans par livre traduit en français chez Odile Jacob, la thèse du « choc des civilisations » (Le choc des civilisations, titre de l’ouvrage de Samuel Huntington, est tiré d’une analyse de Bernard Lewis, datant de 1990, sur les racines de la violence musulmane) fait aujourd’hui recette en France d’autant plus après l’attentat multicible de New York, car il faut expliquer au public comment cela a pu être possible, trouver des fondements à l’inexplicable et mettre cela en perspective.
La thèse du livre tient dans sa vision originale du monde d’aujourd’hui et des conflits de demain ; nous sommes confrontés à une nouvelle structure organisationnelle du monde, laquelle n’est plus idéologique, politique, ou économique, mais culturelle et civilisationnelle. Sur cette vision du monde, quelques reproches, dont la liste des “civilisations” reconnues par l’auteur, liste contestable parce qu’implicitement en découle une dynamique relationnelle inter-étatique bien convenable pour les États-Unis. Le monde nous dit Huntington est décomposé en huit entités : occidentale, islamique, hindou, slave-orthodoxe, japonaise, africaine, latino-américaine et confucéenne. Toujours selon l’auteur, les conflits à venir seront inter-civilisationnels, et s’opèreront surtout aux différentes zones de ruptures, aux zones de contacts inter-civilisationnelles. Néanmoins, on constate que seuls les lignes de contact entre le monde islamique et les autres civilisations fait apparaître conflits et affrontements sanglants.
Parmi ces “conflits inter-civilisationnels”, Huntington en recense un particulièrement révélateur de la profondeur et de la puissance de ses arguments : le conflit du Timor. Dans cette partie du monde nous serions, selon l’auteur, à une des zones de contact entre la civilisation islamique et la civilisation occidentale : CQFD. Pourtant, pour peu que l’on connaisse les origines de ce conflit, force est de constater qu’il est plus de nature politique que “civilisationnel”, religieux ou même ethnique. Sur l’île de Timor, tant dans la partie indonésienne que dans la partie orientale, 98% de la population est chrétienne catholique, et d’une ethnie homogène. Seul le fait politique et le sentiment national expliquent ici le conflit, et il suffit de lire les noms de tous les chefs du camp pro-intégrationiste (donc indonésien) comme de leurs partisans pour constater qu’ils sont tous catholiques. L’Islam n’a donc rien à voir dans ce conflit ; il y a d’un côté ceux qui défendent l’idée du rattachement du Timor oriental à l’Indonésie et de l’autre ceux qui veulent l’indépendance. On cherche en vain le motif religieux, civilisationnel…
Nous pourrions développer sur la faiblesse de la thèse huntingtonienne en passant au crible d’autres conflits qualifiés de “civilisationnels” par l’auteur et présentés sur sa carte du monde, pour démontrer l’inanité de ce motif unique, sorte de deus ex machina de son paradigme. Ce tableau montrerait que le motif civilisationnel n’est pas le seul et encore moins le premier des facteurs entrant en ligne de compte pour expliquer les différents conflits à travers le monde où la civilisation islamique entre en contact avec les autres civilisations.
Une grille d'analyse binaire et monocausale
Certes, nous pourrions admettre que si le paradigme civilisationnel est instructif, en ouvrant des possibles et des jeux nouveaux dans le concert des nations, il n’est pas pour autant suffisant ; l’élément géostratégique demeurant nécessaire à une bonne lecture du monde. En elle-même, cette explication des conflits est déjà une politique étrangère, une lecture idéologique du monde ; car ce qui frappe surtout dans la thèse huntingtonnienne, c’est la grille d’analyse proposée : binaire et mono causale.
Tout géopoliticien même commençant, sait que la civilisation n’est pas et ne peut être l’élément unique à même de permettre une analyse méthodique et rationnelle de la réalité mondaine. La géographie, la réalité des nations, les différences ethniques et raciales, la religion, l’idéologie, la politique et l’économie sont autant de facteurs entrant en ligne de compte pour lire le monde et ses mouvements. Certes, il y a une hiérarchie dans ces éléments, mais il appartient de ne pas choisir (?) celle qui nous est présenté par autrui, ce dernier fut-il le maître du monde, l’hyper-puissance mondiale elle-même. Le choix et la hiérarchie d’entre ces éléments ne peuvent et ne doivent être que le résultat de l’analyse politique des rapports de pouvoirs dans les relations internationales, c’est à dire le produit de la réflexion et de l’action de l’homme politique, œuvre géostratégique qu’il établit à partir des intérêts propres de son pays.
Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, les États-Unis et l’Europe, si elles embrassent la même religion chrétienne, n’ont pas pour autant les mêmes intérêts ni les mêmes approches économiques, politiques, culturelles. La “civilisation occidentale” regroupant USA et Europe, ne possède donc pas un “nous”. Comment l’Europe, et en particulier la France, pourraient-elles avoir la même géopolitique que les États-Unis alors qu’un océan les sépare, que leur géographie respective les ouvre à des perspectives de relations internationales différentes, que leur Histoire et leur civilisation bien que parfois concomitantes sont néanmoins distinctes à jamais ? Des accords ou des alliances existent et ont existé, mais elles ne peuvent avoir qu’un caractère contingent.
Par ailleurs, force est de constater que l’approche civilisationnelle du monde se calque sur la grille de lecture qui prévalait avant la chute du mur et la désagrégation de l’URSS, celle qui existait pendant la guerre froide, et qui avait réussi à scinder le monde en deux : le “camp de la liberté” et celui du communisme. Aujourd’hui donc, avec Huntington, encore deux camps exclusifs, cette fois l’Occident et l’Islam (isme). Pauvre vue que celle de ce professeur à Harvard, qui ne peut se départir d’une approche binaire et mono causale des relations internationales.
Cette « analyse » qui récuse formellement tout idéologie, créé en fait un système de représentation tout en symbiose avec celle de son « ennemi », de son double en fait : l’islamisme. “L’Occident” dont nous parle Huntington, cette sphère civilisationnelle dont l’État-Phare serait les États-Unis, n’est que le résultat d’une représentation idéologique du monde ; une idéologie au service et au bénéfice ultime des États-Unis seuls, à moins que l’on accepte la vassalisation de l’Europe et de la France, que l’on approuve ce statut de “dimmitude” accordé par ceux qui détiennent la “puissance globale” à un moment donné de l’histoire du monde.
Avec l’Occidentalisme et l’Islamisme, nous sommes en fait en présence de deux idéologies totalitaires et hégémoniques, idéologies et systèmes de représentation corollaires qui font que quiconque ne choisit pas un des deux camps est immédiatement rejeté dans l’autre. C’est le manichéisme le plus total.
— Vous récusez le Jihad, le concept coranique de guerre, la vision islamique/islamiste du monde ? Vous êtes donc un chien d’infidèle, un matérialiste athée et un rien qu’un consommateur !
— Vous refusez de choisir le camp de la Liberté, de la défense de l’Occident et de ses valeurs (démocratie, droits de l’Homme, la loi du marché) ? Vous faites le jeu de l’Islamisme, vous êtes complice de la Jihad qui s’annonce, vous êtes un ennemi de la Liberté !
Un discours qui mène à la vassalisation définitive de l’Europe
Ces visions du monde binaire, ont le privilège de “fonctionner” à merveille dans le discours politique car ils sont simples, à même d’être entendu par tous, mais ils radicalisent et polarisent aux extrêmes les esprits, poussant à l’affrontement et conduisant à la guerre. Notons qu’en France depuis peu, certains chercheurs en géopolitique ont trouvé le moyen d’avoir de l’audience en reprenant le paradigme de guerre civilisationnelle, souvent même en récusant cette parenté intellectuelle pourtant claire. Mais cette attitude conduit logiquement d’une part à la défense et au soutien inconditionnel de pays au cœur de la déstabilisation moyen-orientale, et enfin à la vassalisation définitive de l’Europe par une puissance étrangère. Cette vassalisation passant aujourd’hui par la mise en place du bouclier anti-missiles NMD, comme elle le fut par l’IDS, la “guerre des étoiles”, ou par le parapluie nucléaire américain, et plus loin encore le Plan Marshall.
Face à ces déterminismes existentiels et géopolitiques, il faut rappeler que la liberté réside en la faculté de choisir dans l’univers des possibles, et que la volonté politique peut ouvrir une troisième voie, que celle-ci pourrait être à même de faire valoir le sens de l’intérêt national. Une vision du monde bipolaire est par elle-même belligène. Rappelons que plus il y aura de camps, plus il y aura de pôles, plus il y aura d’options politico-stratégiques, moins il y aura possibilité de conflits car les antagonismes seront diffus. A contrario, quand les antagonismes seront réduits à deux ou trois parties, l’élan mobilisateur et la cristallisation des polarités seront à même de s’ouvrir sur la guerre totale.
Il reste à nos hommes politiques mais aussi à nos concitoyens d’œuvrer dans le sens d’une politique étrangère française authentiquement nationale, respectueuse de l’identité des autres pays, et défendant une vision du monde originale s’inscrivant dans une tradition historique éprouvée.
► Philippe Raggi, 3 déc. 2001, in : Au fil de l’épée recueil n°30 (supplément à NSE n°53), février 2002.
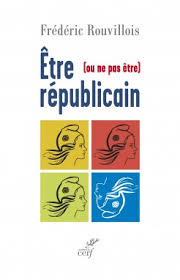 Aujourd’hui, bien que les royalistes sachent se faire entendre, tout le monde, ou presque se dit républicain. Mais peut-être personne ne l’est-il authentiquement...
Aujourd’hui, bien que les royalistes sachent se faire entendre, tout le monde, ou presque se dit républicain. Mais peut-être personne ne l’est-il authentiquement... 
