culture et histoire - Page 1261
-
2000 ans d'histoire: La ville de Sparte
-
La forme politique du Saint Empire Romain Germanique
Extrait de l'ouvrage de Gaëlle Demelemestre, Les deux souverainetés et leur destin, Le tournant Bodin-Althusius, éd. Cerf, 2011, pp. 134-142
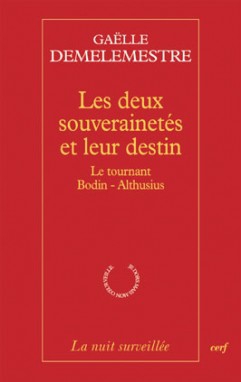 Nous ne sommes pas familiers de la forme impériale développée par le Saint Empire romain germanique réunissant les territoires italiens, bourguignon et germanique à l'origine, émancipant par la suite les deux premiers. Elle s'étend pourtant sur près de neuf siècles, et constitue le grand modèle institutionnel duquel se démarqua l'État souverain. Si Pufendorf a pu le qualifier de « monstre politique », « irregulare aliquod corpus et montro simile », il n'en reste pas moins que sa longévité nous incline à considérer sérieusement la forme institutionnelle de ce pouvoir. Nous en rappellerons brièvement les éléments essentiels, d'un point de vue normatif plus qu'historique. Le titre de Saint Empire romain germanique, das Heilige Römische Reich deutscher Nation, ne commence à être utilisé qu'à la fin du XVe siècle. Mais il n'est encore ni une appellation officielle, ni une seule utilisée pour décrire la situation politique de l'Empire germanique. L'ambition de cette désignation consiste à trouver un critère discriminant d'appartenance des différents peuples germaniques à une structure politique commune.
Nous ne sommes pas familiers de la forme impériale développée par le Saint Empire romain germanique réunissant les territoires italiens, bourguignon et germanique à l'origine, émancipant par la suite les deux premiers. Elle s'étend pourtant sur près de neuf siècles, et constitue le grand modèle institutionnel duquel se démarqua l'État souverain. Si Pufendorf a pu le qualifier de « monstre politique », « irregulare aliquod corpus et montro simile », il n'en reste pas moins que sa longévité nous incline à considérer sérieusement la forme institutionnelle de ce pouvoir. Nous en rappellerons brièvement les éléments essentiels, d'un point de vue normatif plus qu'historique. Le titre de Saint Empire romain germanique, das Heilige Römische Reich deutscher Nation, ne commence à être utilisé qu'à la fin du XVe siècle. Mais il n'est encore ni une appellation officielle, ni une seule utilisée pour décrire la situation politique de l'Empire germanique. L'ambition de cette désignation consiste à trouver un critère discriminant d'appartenance des différents peuples germaniques à une structure politique commune.Son but premier sera donc de distinguer ceux qui appartiennent à la nation allemande de ceux qui sont liés à l'empire sans faire partie de la nation germanique. Il est forgé en réaction à la situation politique contemporaine des territoires germaniques, dont l'appartenance à la structure impériale n'est pas clairement fixée. « La peur de perdre la liberté », suscitée par les incursions nombreuses de souverains non germaniques au sein des territoires germaniques, provoque, à l'origine, un besoin de savoir distinguer les Germains des autres nations.
Une sorte de fièvre obsidionale s'empara d'elle (l'Allemagne). Le vocabulaire des documents officiels reflète cette émotion patriotique. On y trouve de plus en plus souvent après 1430 les mots de deutsche Lande, les « pays allemands ». Ces terres étaient occupées par le peuple allemand, la nation. Une précision était indispensable car au concile, la « nation germanique » englobait les Scandinaves, les Hongrois et les Polonais[...]1
Se caractérisant par la multiplicité des peuples mis en présence, l'Empire germanique court le risque d'un éclatement de sa pertinence s'il ne parvient à trouver un principe d'identification, discriminant ceux qui sont germains et ceux qui ne le sont pas.
Mais lequel trouver si l'Empire se caractérise, par nature, par sa diversité ethnique ?
Le trait qui déterminant l'appartenance à cette nation, c'était la langue, deutsche Zunge. L'Allemagne est donc la patrie de ceux dont l'allemand est la langue maternelle, mais la vocation politique de cette nation s'étend au-delà des frontières de l'Allemagne ; la direction de l'Empire lui appartient. La titulature l'affirme avec de plus en plus de netteté, accolant d'abord en 1441 sacrum imperium et germanica natio, puis utilisant le génitif qui marque la possession, heilig römisches Reich der deutschen Nation ; enfin, en 1486, apparaît la formulation définitive, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Ces mots ne désignent pas la partie de l'empire peuplée d'allemands ; ils proclament haut et fort que l'Empire appartient aux Allemands.2
Ainsi fut trouvé le critère d'identification des peuples allemands – leur langue -, et avancée la spécificité de leur nature – l'aspiration vers la forme politique de l'empire qu'ils revendiquent comme composante de leur identité.
La signification politique de cette appellation emprunte à l'histoire un cadre de référence très connoté. Si elle recouvre une forme d'organisation politique tout à fait particulière, elle se revendique de la plus grande figure institutionnelle qui soit : l'empire. Le terme de Reich, Imperium, décrit « une puissance de commandement (Herrschaftsgewalt) supérieure3 » qui, par son appellation même, transcende quelque chose – ce dont le génitif « nation allemande » ne rend pas compte. Cette expression à première vue tautologique de Herrschaftsgewalt – Herr-schaft pouvant signifier « pouvoir », ou « domination », et Gewalt « autorité » - décrit pourtant assez bien la nature de l'empire : il repose en effet sur une forme d'autorité pouvant œuvrer par l'utilisation du pouvoir. L'expression mêle deux natures d'obligation différentes. L'autorité n'a en effet pas besoin du pouvoir pour s'exercer ; elle échoue si elle doit utiliser le pouvoir de contraindre. L'obligation commandée par une relation de pouvoir, à l'inverse, use de la capacité à contraindre. Le descriptif d'une autorité disposant en plus d'un pouvoir serait alors contradictoire. En fait, la figure impériale conjugue la forme de l'autorité qui légitime l'usage du pouvoir, et la capacité à en user. Ceci lui confère deux ordres de réalité différents : l'autorité ressort de la légitimité qui lui est reconnue d'avoir des actions positives, tandis que la catégorie du pouvoir traduit son mode d'action. Il s'agit d'une forme de pouvoir légitimée par sa nature impériale. Cette duplicité situe le domaine d'exercice du principe impérial au-delà des autres formes de pouvoir existantes, puisqu'il est celui qui les permet, qui les valide, qui les reconnaît. La réalité impériale se constitue donc en regard d'un ordre de réalité qu'elle dépasse, d'une diversité qu'elle subsume. Nanti de ces deux dimensions, le pouvoir impérial est donc par nature supérieur à toutes les autres formes de pouvoir, qu'il n'est pas chargé de nier, mais de reconnaître en les dépassant.
La première caractéristique de l'Empire est de distinguer et d'héberger trois natures d'obligation : celle engendrée par l'autorité de l'empereur, celle découlant de son pouvoir de contraindre, et celle qu'il fait exister en la reconnaissant, incarnée par le pouvoir des membres de l'Empire. Les schèmes de la forme impériale ne pourront en conséquence pas coïncider avec ceux d'une collectivité structurée par un pouvoir souverain. Dès ce début de définition, nous voyons qu'il n'y aura pas dans l'Empire un seul pouvoir homogène s'exerçant sur un territoire défini, mais à l'inverse une multiplicité de pouvoirs coexistant par l'intermédiaire de leur reconnaissance commune de l'autorité impériale. La réalité impériale ne se caractérise donc pas par la cristallisation unitaire du pouvoir politique, mais à l'inverse comme une transversalité, un principe embrassant par nature un divers dont l'autonomie sera plus ou moins respectée, et qu'il aura comme caractéristique d'unir. D'où sa nature paradoxale, et l'émergence d'une gageure prometteuse : l'empire entend rassembler du différent sans l'unifier, en l'unissant par le biais d'un principe subsumant commun, à l'opposé du mouvement premier de la souveraineté d'homogénéisation de la population. La réalité impériale n'a pas besoin de requérir l'homogénéité de ses territoires parce qu'elle incarne l'universel réalisé pratiquement par la diversité particulière des populations ; concernant le Saint Empire germanique sur lequel nous travaillons ici, « il s'agissait bien plus d'un pouvoir universel, transpersonnel, qui se concevait comme détaché d'un territoire particulier ou d'un peuple4 ».
L'Empire germanique est une réalité transversale, qui regroupe dans la période du Moyen Age des territoires italiens, bourguignons et allemands. Il ne recouvre pas un espace précis parce que les membres de l'Empire y sont rattachés par des traités différents, et peuvent en être soustraits. Ainsi, les cantons suisses prendront leur autonomie de l'Empire, en 1389, sans que cela le déstructure. L'Empire n'a ni frontières naturelles, ni frontières conventionnelles. S'il ne se laisse pas définir par une certaine géographie, l'homogénéité de sa population lui fait encore plus défaut, puisqu'il n'a pas comme condition la nécessité de renvoyer à une population homogène de mœurs, de langage ou de coutumes. L'hétérogénéité de ses territoires et de ses populations fait partir de sa réalité. Si le Saint Empire romain germanique reprend une référence à l'Empire romain, c'est justement parce qu'il entend s'inscrire, comme lui, au-delà de frontières et de populations particulières ; il y a dans la forme de l'Empire une aspiration à l'universel, la tentative de dépasser le particulier par quelque chose de plus englobant, de plus universel, supérieur aux simples déterminations phénoménales. La diversité en son sein n'est pas comprise comme un obstacle à la possibilité de l'exercice du pouvoir, mais à l'inverse comme une de ses composantes.
 Mais l'Empire romain auquel on est renvoyé n'est pas celui de César et d'Auguste ; c'est celui de Constantin. Charlemagne inaugure cetteRenovatio Imperii en se faisant couronner par le pape en 800 : l'onction papale seule pouvait assurer la mission sacrée remplie par l'empereur. Par ce geste, Charlemagne entendait reprendre le modèle romain d'une union politique de peuples divers, usant de l'autorité spirituelle pour valider ses décisions. Ce qui réinscrit le mouvement de l'Empire germanique dans la forme de l'Empire romain, et permet à l'empereur de distinguer son pouvoir de celui des autres princes allemands, de le placer dans un rapport de transcendance repris de la référence à l'Empire romain. Il permet de fonder la supériorité du pouvoir de l'empereur et inscrit par là la forme impériale dans le mouvement d'un devenir historique précis, en reprenant le critère de l'universalité et en y adjoignant le critère de protection que son pouvoir devra prendre comme fil conducteur, assumé par l'adjectif heilig.
Mais l'Empire romain auquel on est renvoyé n'est pas celui de César et d'Auguste ; c'est celui de Constantin. Charlemagne inaugure cetteRenovatio Imperii en se faisant couronner par le pape en 800 : l'onction papale seule pouvait assurer la mission sacrée remplie par l'empereur. Par ce geste, Charlemagne entendait reprendre le modèle romain d'une union politique de peuples divers, usant de l'autorité spirituelle pour valider ses décisions. Ce qui réinscrit le mouvement de l'Empire germanique dans la forme de l'Empire romain, et permet à l'empereur de distinguer son pouvoir de celui des autres princes allemands, de le placer dans un rapport de transcendance repris de la référence à l'Empire romain. Il permet de fonder la supériorité du pouvoir de l'empereur et inscrit par là la forme impériale dans le mouvement d'un devenir historique précis, en reprenant le critère de l'universalité et en y adjoignant le critère de protection que son pouvoir devra prendre comme fil conducteur, assumé par l'adjectif heilig.La Heiligkeit de l'Empire signale en effet la liaison que le pouvoir impériale entretiendrait comme par nature avec le pouvoir divin. Cette désignation inscrit la forme d'organisation politique, par lesquelles les territoires germaniques seront unis, dans des registres très différents. La référence à l'Empire romain renvoie à la volonté de gouverner une multitude de peuples sous un même principe ; la caractérisation de ce pouvoir subsumant comme heilig inscrit la quantité de cette fonction dans le cadre de l'universalité, comme principe rassembleur, sacré. Il signale aussi que le pouvoir d'Empire n'est pas compris dans le seul cadre des réalités terrestres, mais qu'il les oriente vers leur destination spirituelle. Cette appellation n'inscrit cependant pas la réalité impériale dans une dépendance envers le pouvoir ecclésiastique. Otton Ier parvient à allier l'autorité spirituel au pouvoir temporel, mais très vite les revendications du pape se font plus précises. La querelle des Investitures de 1074 à 1123, puis le grand interrègne de 1257 à 1273 et la volonté de se séparer de la logique du pouvoir terrestre provoquent sa sécularisation ; mais c'était alors pour mieux légitimer la nécessaire dépendance de ce pouvoir à l'égard de l'autorité pontificale.
Frédéric Hohenstaufen parvient, à la fin du XIIéme siècle, à asseoir sa légitimité en s'appuyant sur les ducs et les princes, cherchant par là à émanciper le pouvoir impérial de l'autorité papale. Les relations entre le pape et l'empereur seront très conflictuelles, mais assez rapidement l'empereur recevra sa légitimité de son élection, et non de son couronnement. La charge impériale ne sera plus alors dépendante de l'onction, mais du choix effectué par les princes électeurs :
Charles Quint fut le dernier – après qu'il fut choisi roi en 1519 et couronné à Aix-la-Chapelle – à se laisser encore oindre Empereur en 1530 à Bologne par le pape. Par la suite, les empereurs prétendront à ce titre par l'élection de la Diète d'empire5.
Mais les deux autorités se heurtent encore violemment. Il était fait usage du célèbre faux de Constantin – la « Donation de Constantin » - pour légitimer les revendications ecclésiastiques6. Frédéric II en inversait déjà la signification, lorsqu'il en déduisait que la compétence impériale ne pouvait être mesurée à l'aune des références spirituelles. Le pouvoir impérial gagnera ensuite rapidement assez de légitimité par l'appui de son mode de désignation – l'élection – pour pouvoir se passer de sa validation par l'autorité papale. Cette évolution se fait cependant progressivement et ne rend pas compte des conflits que les deux pouvoirs, impérial et ecclésiastique, vont nourrir tout au long du Moyen Âge7.
Le titre de Saint Empire romain germanique propose donc un projet d'union, ainsi que les moyens pour y parvenir. C'est l'universalité à laquelle prétendaient ces deux formes de gouvernement sous la même appellation d'empire qui sera retenue : unir dans la différence, trouver un « gouvernement de nations diverses par les mœurs, la vie et la langue8 ». Ce qui permet de retenir comme caractéristique essentielle de l'Empire germanique son aspiration à un gouvernement tendant vers la recherche de l'universalité9. Il faut remarquer que l'agir impérial ne peut pas être comparé à celui du pouvoir divin, comme le fait Bodin ; l'empereur n'est pas le lieutenant de Dieu sur terre. Par contre, c'est l'universalité de l'aspiration divine, le dépassement de la diversité contingente vers une forme de transcendance que la référence auheilig entend signaler. Elle confère la suprématie au pouvoir impérial par rapport à n'importe quel autre monarchie, avant de caractériser la spécificité de ce gouvernement. Il y gagne d'être qualitativement distingué de toutes les autres formes empiriques de pouvoir, ce qui pose son autorité, sa légitimité, et qui constituera la puissance sur laquelle il pourra compter pour être reconnu, quelles que soient les forces qui s'opposeront à ses volontés.[...]
Notes:
1 Francis Rapp, Le Saint Empire romain germanique, Paris, Tallandier, 2000, p. 299
2Ibid
3Barbara Stollberg-Rilinger, Das Heilige Reich Deutscher Nation, Vom ende des Mittelalters bis 1806, Munich, C. H. Beck, 2006, p. 10.
4B. Stollberg-Rilinger, Das Heilige Reich Deutscher Nation, p. 10.
5B. Stollberg-Rilinger, Das Heilige Reich Deutscher Nation, p. 11.
6« Il [Constantin] lui avait en effet paru indigne de posséder la puissance comme empereur terrestre là où trônait le chef de la foi chrétienne, investi par l'empereur du ciel. Sans rien retrancher à la substance de la juridicature, le Siège apostolique avait finalement transmis la dignité impériale aux Germains, à Charlemagne et avait accordé la puissance du glaive à ce dernier par le Couronnement et l'Onction », Ernst Kantorowicz, L'Empereur Frédéric II, Œuvres, Paris, Gallimard, 2000, p. 403.
7Si la caractérisation de l'autorité impériale comme sacrée perd peu à peu sa dépendance à l'égard de l'autorité pontificale, un autre événement provoquera la mise sur le devant de la scène de la religion : la révolution théologique introduite, au XVIéme siècle, par Luther. En justifiant le pouvoir temporel, sans reconnaître de légitimité à une autorité positionnée entre Dieu et les hommes, Luther disqualifie la capacité des pouvoirs ecclésiastiques à exercer une quelconque pression sur les hommes : « Un bon théologien enseigne de la sorte : le vulgaire doit être contraint par la force extérieure du glaive, lorsqu'il a mal agit […], mais les consciences des gens du peuple ne doivent pas être prises au filet de fausses lois […]. Car les consciences ne sont liées que par le précepte venant de Dieu seul, afin que cette tyrannie intermédiaire des pontifes, qui terrorise à faux, tue à l'intérieur des âmes et à l'extérieur fatigue en vain le corps soit tout à fait abolie », Martin Luther, Du serf arbitre, Paris, Gallimard, 2001, p. 104. Cependant, la constitution de l'Empire se caractérise, dès ses origines, par un étroit entrelacement entre les formes spirituelles et temporelle. L'autorité spirituelle avait d'abord son importance pour démarquer l'autorité impériale des autres formes de pouvoir ; même s'il ne fut plus, par la suite, sacré par le pape, l'empereur devait pouvoir incarner l'universalité, telle qu'elle caractérisait analogiquement l'Être divin. Ensuite, s'il fallait retirer aux instances ecclésiastiques les droits qu'elles possédaient et les fonctions qu'elles remplissaient, la question se posait de savoir qui allait les remplacer. Il faudra attendre le traité d'Augsbourg de 1555 pour que le protestantisme soit reconnu comme loi d'empire, au même titre que le catholicisme. Ce traité instaure la loi du cujus regio, ejus religio ; mais les conflits entre les deux religions ne seront réglés pour autant, puisque la Diète elle-même restera bloquée par cette bipartition. Le schisme religieux introduit par Luther permet de prendre la mesure de l'interdépendance entre la politique et la religion de cette époque. Comme le souligne H. Arendt, « Ce fut l'erreur de Luther de penser que son défi lancé à l'autorité temporelle de l'Église et son appel à un jugement individuel sans guide laisserait intactes la tradition et la religion », La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p. 168. En brisant l'un des trois piliers sur lesquels reposait implicitement l'autorité impériale, Luther fragilisait l'ensemble de la structure de l'Empire ; c'était la source de l'autorité impériale qu'il attaquait en contestant les pouvoirs de l'autorité ecclésiastique.
8Charles IV, Bulle d'or, 1356.
9« À cette époque [de Frédéric II], la Germanie en tant qu'imperium symbolisa réellement la grande idée de l'Empire romain, unification de toutes les nations et de toutes les races de l'univers. Elle fut le reflet du grand Empire chrétien universel. Elle fut les deux à la fois et devait le rester, la faveur ou la malignité des choses ayant voulu qu'en Germanie fût préservée cette pluralité des peuples et des races, qui correspond en fait à l'idéal d'une grande communauté des rois et des nations d'Europe. Au contraire de ses voisins de l'Ouest, habiles politiques, l'Allemagne demeura toujours l' ''Empire'' », E. Kantorowicz, L'Empereur Frédéric II, p. 364.
-
Guy Forzy, RIP
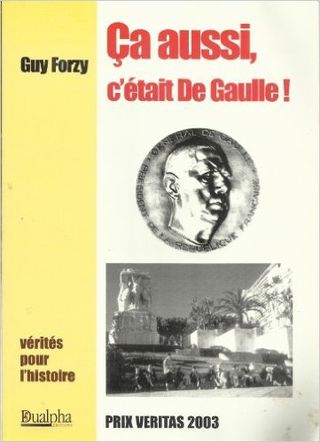 Guy Forzy, figure de la guerre d'Algérie et défenseur des Pieds-noirs, est décédé mardi à l'aube de ses 90 ans. Né le 17 décembre 1925, au Douar Béni-Maïda, Guy Forzy est indissociable de l'histoire des Français d'Algérie. A 18 ans, il interrompt ses études et s'engage dans l'armée du général de Lattre de Tassigny. Il débarquera en Provence et participera à la libération de la France jusqu'aux frontières de l'Allemagne, ce qui lui vaudra la croix de guerre 39/45. En 1955, il s'engage à nouveau comme officier de renseignement dans la région montagneuse du massif de l'Ouarsenis et enchaîne plusieurs missions. Le 24 janvier 1960, il prend part à l'insurrection des barricades d'Alger dont il négocie la reddition et prend la tête du commando Alcazar intégré au 1er Régiment étranger parachutiste en Kabylie.
Guy Forzy, figure de la guerre d'Algérie et défenseur des Pieds-noirs, est décédé mardi à l'aube de ses 90 ans. Né le 17 décembre 1925, au Douar Béni-Maïda, Guy Forzy est indissociable de l'histoire des Français d'Algérie. A 18 ans, il interrompt ses études et s'engage dans l'armée du général de Lattre de Tassigny. Il débarquera en Provence et participera à la libération de la France jusqu'aux frontières de l'Allemagne, ce qui lui vaudra la croix de guerre 39/45. En 1955, il s'engage à nouveau comme officier de renseignement dans la région montagneuse du massif de l'Ouarsenis et enchaîne plusieurs missions. Le 24 janvier 1960, il prend part à l'insurrection des barricades d'Alger dont il négocie la reddition et prend la tête du commando Alcazar intégré au 1er Régiment étranger parachutiste en Kabylie.Expulsé d'Algérie et assigné à résidence, il s'installe comme agriculteur dans le Gers. Il fonde l'Union des comités de défense des agriculteurs rapatriés (Ucdar). En 1975, il crée, avec Jacques Roseau, une association de défense du monde pieds-noirs et des Harkis, le Recours-France (Rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés). En 1984, à l'occasion du 50e anniversaire du débarquement en Provence, il crée Mémoire de la France d'Outre-mer. Il devient ensuite, sous le gouvernement de Jacques Chirac, délégué interministériel aux rapatriés de 1995 à 1997. Commandeur de la Légion d'honneur, il a écrit plusieurs livres sur la vie et la guerre d'Algérie. Parmi lesquels Ça aussi c'était De Gaulle !, publié en 1999, en réaction à l'ouvrage d'Alain Peyrefitte. Guy Forzy entreprit à son tour de décortiquer la vie et l'action de Charles De Gaulle, de la Première Guerre mondiale (où, alors lieutenant, il fut le seul officier à se rendre à l'ennemi durant la bataille de Verdun) à la Seconde (où toute son action ne fut guidée que par l'ambition personnelle, les complots, la trahison et l'imposture), puis son retour programmé au moment des « événements d'Algérie » : il déploya alors tous son talent dans les reniements sur fond de rancoeurs. Guy Forzy ne laisse rien dans l'ombre : cette somme est une véritable volée de bois vert à la légende du « Grand Homme ».
Ses obsèques seront célébrées samedi, à 11 h 15, à Fleurance.
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2015/12/guy-forzy-rip.html
-
Les Brigandes - Seigneur, je ne veux pas devenir Charlie
-
Le traité de Versailles (1919) | 2000 ans d’histoire | France Inter
-
Vient de paraître : La confrontation Révolution Contre-révolution
Vient de paraître ! Profitez-en !
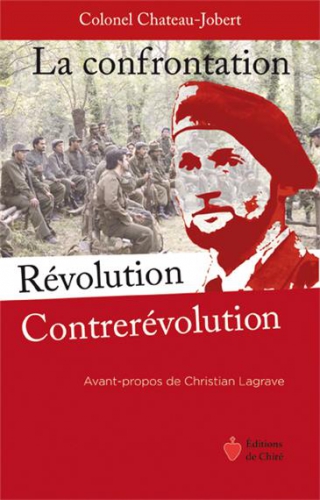 Il suffit de constater les effrayants progrès de la Révolution dans le monde pour affirmer que, dans certains pays - dont la France - les hommes vivent leurs dernières années de liberté. Italie, France, Argentine et même Espagne sont peut-être vouées à la "libération" qu'ont connue les Hongrois et les Tchèques ; à celle, aussi, du Vietnam, Cambodge et Laos où les hommes ont été si bien "libérés" qu'ils y ont perdu jusqu'au droit de conserver leur nom !
Il suffit de constater les effrayants progrès de la Révolution dans le monde pour affirmer que, dans certains pays - dont la France - les hommes vivent leurs dernières années de liberté. Italie, France, Argentine et même Espagne sont peut-être vouées à la "libération" qu'ont connue les Hongrois et les Tchèques ; à celle, aussi, du Vietnam, Cambodge et Laos où les hommes ont été si bien "libérés" qu'ils y ont perdu jusqu'au droit de conserver leur nom !
La faute initiale en reviendra à ces gouvernants naïfs ou traîtres qui se proclament "libéraux" et qui permettent aux pires ennemis du pays de manoeuvrer à leur guise au nom même du libéralisme dont les premiers se réclament.
Quand un gouvernement n'a aucune force parce qu'il n'a aucune vérité à brandir et à faire respecter impérativement, les forces révolutionnaires les plus néfastes sont sûres de triompher... à moins que le peuple ne soit prêt à défendre lui-même sa patrie. L' exemple du Portugal est là, et on tremblerait moins pour lui si le peuple avait été préparé à cette confrontation Révolution-Contrerévolution dont il est l'enjeu.
Nous refusons la loi de la Révolution. Nous rejetons le libéralisme autant que le marxisme, le premier étant directement responsable de ce qui nous attend. Mais notre prise de position n'est pas sectaire : nous savons le respect dû à toutes mesures prises par un gouvernement quand elles ne sont pas contraires à la morale. Le gouvernement prépare, dit-il, la défense du territoire ; nous la prévoyons aussi, mais également la résistance possible contre toutes les agressions révolutionnaires et contre la Terreur déclarée "nécessaire" par les marxistes.
Cet ouvrage s'appuie sur le respect le plus scrupuleux des vrais droits et devoirs des hommes, et il a le plus grand souci de la dignité de la personne humaine, même quand il s'agit d' "ennemis" ; idée que l'on aurait bien du mal à trouver chez les marxistes.
Oui, c'est un livre qui ose parler d'employer des armes, mais quand il s'agit de se défendre, et dans le seul cas où il n'y a plus d'autre moyen pour empêcher certains d'assassiner les autres.
C'est un livre basé sur la charité : il faut sauver les hommes et défendre les valeurs chrétiennes de notre civilisation car, hors d'elles, parler de justice et de liberté n'est que du bluff.http://www.chire.fr/A-198137-vient-de-paraitre-la-confrontation-revolution-contre-revolution.aspx
-
La guerre de Sécession – première guerre de l’époque moderne
A l’occasion de la réédition du “Blanc Soleil des vaincus” chez Via Romana, nous publions l’éditorial de Dominique Venner du hors série numéro 3 de la Nouvelle Revue d’Histoire consacré à la guerre de Sécession et paru en 2011.
Depuis que les Etats-Unis d’Amérique ont imposée l’hégémonie mondiale du dollar, le mythe de la démocratie à l’américaine a été quasiment divinisé dans l’hémisphère « occidental », ce qu’Aristote s’était bien gardé de faire pour la démocratie antique. La démocratie américaine n’est pourtant rien d’autre qu’une oligarchie, comme le sont la plupart des systèmes politiques. Grâce peut-être au permanent sourire commercial de ses dirigeants, elle semble néanmoins parée de toutes les vertus en dépit de comportements peu vertueux. À cette « démocratie », associée de nos jours au libéralisme économique si fortement malmené par ses financiers, on prête des mérites exceptionnels. On affirme par exemple qu’elle est synonyme de paix et que jamais deux démocraties ne se font la guerre.
Voilà une affirmation que dément catégoriquement la guerre de Sécession américaine (1861-1865). Ce ne fut pas une guerre civile comme le voudrait l’interprétation des vainqueurs, mais une « guerre entre les États », suivant l’expression plus exacte des Sudistes, une guerre entre deux nations que tout opposait depuis longtemps, une guerre de conquête de la plus faible par la plus forte, la plus impérialiste et la plus peuplée.
La Confédération des États sudistes était aussi démocratique que l’Union des États nordistes. C’est même au Sud, en Virginie, que s’enracinait la matrice de la démocratie américaine dans sa version originelle. Les combattants de l’indépendance de 1776 (George Washington) et les pères de la Constitution de 1787 (Thomas Jefferson) étaient des Virginiens, des hommes du Vieux Sud, comme le furent beaucoup de présidents des Etats-Unis avant que ne s’ouvre la fracture entre la nation sudiste et la nation nordiste.
La guerre de Sécession fut bel et bien une guerre de conquête, une guerre impitoyable, conduite par la démocratie nordiste contre la démocratie sudiste. Une guerre conclue par la domination implacable de la première sur la seconde.
Cette guerre fut la plus sanglante de toute l’histoire américaine. C’est là un privilège démocratique. Les pertes furent supérieures d’un tiers à celles de l’Amérique durant la Seconde Guerre mondiale, pour une population sept fois moins nombreuse. La démocratie sudiste, moins peuplée que la Suisse d’aujourd’hui, succomba finalement sous le nombre et sous l’écrasante supériorité matérielle de la démocratie nordiste, après avoir remporté d’innombrables batailles. Sa défaite n’entraîna pas seulement la destruction de son indépendance politique et économique, mais celle aussi de sa civilisation. Dans les années qui suivirent sa capitulation, le Sud fut soumis au pillage, à la vindicte et à la loi martiale du Nord.
À bien des égards, la guerre de Sécession annonce par son ampleur celle de 1914-1918. Ce fut la première guerre « démocratique », plus encore que les guerres napoléoniennes. À la différence des armées de l’Ancien Régime, celles de la guerre de Sécession étaient le produit de « levées en masse ». Ce fut la première guerre où l’un des enjeux fut l’opinion publique, car de celle-ci dépendait la volonté de vaincre plutôt que de trouver un compromis. Ce fut la première où l’acharnement des combattants et la généralisation de nouvelle armes meurtrières, multiplièrent les pertes dans des proportions jamais vues. Dans l’histoire moderne, ce fut aussi la première guerre totale prenant en otage toute une population (celle du Sud) en exerçant sur elle la terreur de destructions massives n’épargnant pas les civils, en détruisant leur habitat et en les affamant. Ce fut la première guerre de l’époque moderne où, pour obtenir la mobilisation « démocratique » des masses et donc celle de l’opinion, on fabriqua un ennemi haïssable et diabolisé, contre qui tout était permis, comme l’ont si bien montré le général Sherman en Georgie et quelques autres. C’est aussi la première grande guerre idéologique, plus encore que celles de la Révolution française, où la défaite d’une des deux nations s’est accompagnée d’une sourde résistance conduisant parfois à la revanche des vaincus par la voie royale de la littérature et du septième art.
http://www.dominiquevenner.fr/2015/12/la-guerre-de-secession-premiere-guerre-de-lepoque-moderne/
-
Le Christianisme face au règne de l'argent
-
Le cardinal Mazarin (deux parties) | 2000 ans d’histoire | France Inter
-
Conférence sur « L’homme catholique dans la société »
« L’homme catholique dans la société », conférence de François de Carennac du 9 décembre 2015 à Angers :
Le but est de comprendre ce qu’est un homme complet. L’homme est le père, le décideur et le politique. Un être, qui comme la femme, avec ses différences, est fait de vertus naturelles et surnaturelles. La relation homme femme, à travers Adam et Ève, la complémentarité et l’attirance ne sont point omises dans cette intervention.
Également, il est important de savoir comment faire de vrais hommes, de vrais catholiques et une vraie société.
Il faut s’imposer contre la télévision des Charlie qui fabrique un Jean-Fragile aux couilles molles. Et un tour rapide de l’histoire et de l’actualité nous montrent que l’image de l’homme en Europe est passée de Saint-Louis à Conchita Wurst.Dieu premier servi ! Impossible de ne pas traiter le sujet tant l’homme est porté vers le sacré et le beau. La foi, son intelligence et sa bonne application, est de première importance. La prière, l’étude et l’action sont les trois mots d’ordre. La retraite de Saint-Ignace du catho-zehef y est fortement recommandée ; préalable à toute sainte croisade contre le monde moderne.
Le seul chemin face à la décrépitude de l’église vaticane des modernos, qui ont trahi leur rôle, est celui de la Tradition véritable. D’où la volonté d’apostolat qui entre en jeu.Au passage, le « contrat social » de ce bouffon de Rousseau se fait déchirer et foutre à la poubelle (#PapierRecyclable) face à la réalité naturelle et sociétale ; comme si Charles Maurras débarquait à nouveau dans ta té-ci pour remettre les cerveaux atrophiés à l’endroit à coup de francisque. Soit on applique le principe de subsidiarité soit on applique l’absurdité sociale (non-valeurs de la république obligatoires).
En gros ce qu’il faut retenir, c’est que tout ira pour le mieux lorsque les chrétiens seront à nouveau le sel de la terre !
Deus Vult Pays de la Loire.
http://reconquetefrancaise.fr/conference-sur-lhomme-catholique-dans-la-societe/