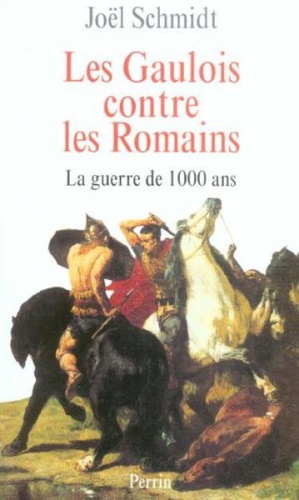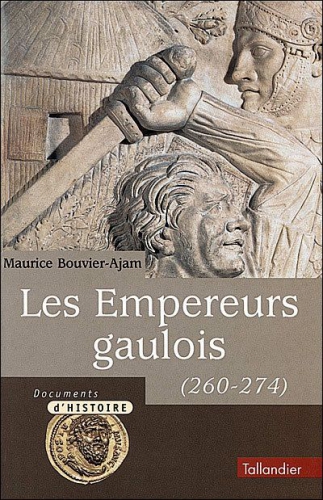Chantal Delsol, professeur de philosophie politique à l’Université de Marne-la-Vallée et auteur de plusieurs ouvrages dont deux sont particulièrement importants et intéressants (« L’état subsidiaire » et « Le principe de subsidiarité » publiés aux PUF) est une très brillante élève du professeur Julien Freund (dont l’ouvrage le plus important « L’essence du politique », va être réédité aux éditions Dalloz) ; elle est la principale philosophe du fédéralisme en France et elle vient de publier aux PUF un petit essai très dense intitulé « La république : une question française » dans lequel elle fait une analyse philosophique de la république à la française.
Une république nobiliaire
Une des thèses essentielles de cet ouvrage est que le régime politique français n’est pas réellement une démocratie mais qu’il s’apparente à une république nobiliaire, c’est-à-dire à un régime dans lequel une élite (choisie par les partis politiques dans le cas présent) convaincue de détenir la vérité en matière de connaissance du bien commun impose une politique conforme à cette conception du bien commun sans se soumettre directement aux desiderata du peuple (lequel peuple est suspect de mauvaises pensées et d’égarements auxquels l’élite n’est bien entendu pas sujette). La république française bien qu’élective (le peuple a un seul droit : celui de choisir au sein de l’élite éclairée l’équipe dirigeante du moment) serait ainsi en fait un despotisme qui se veut éclairé.
Cette élite dirigeante (qui vit à Paris, loin du peuple réel, en particulier de ce peuple provincial qui sent le moisi et qui reste attaché à un passé et à des traditions sans intérêt) est l’héritière et le vecteur de l’idéologie de la révolution française dont les ingrédients sont : l’égalitarisme, l’individualisme et leur corollaire, l’universalisme. Le but de cette élite est de conduire le peuple français sur la voie de l’universalisme, c’est-à-dire sur la voie de l’indifférenciation ; le peuple français a ainsi pour vocation de montrer l’exemple au reste de l’humanité en oubliant les miasmes de son héritage culturel et historique particulier et en s’efforçant de devenir l’avant-garde d’un peuple mondial indifférencié d’un bout à l’autre de la planète.
Ainsi, le peuple français a l’insigne honneur d’être un peuple expérimental et avant-gardiste comme le fût le peuple soviétique dans un passé récent.
Pour illustrer ce propos, donnons la parole à un membre éminent de notre noblesse d’état, Michel Barat grand maître de la Grande Loge de France qui écrivait dans le Figaro Magazine du 4 mai 2002 : « La République, pour moi, constitue un idéal de la raison. J’entends sa signification dans son sens originel de « chose publique », c’est-à-dire ce qui concerne tous et chacun sans jamais être le fait d’un seul. Une République tend vers un idéal universel, supérieur même à la nation, elle exige une vertu citoyenne sans confondre patriotisme et nationalisme. Le bien public ne saurait se réduire en un bien particulier, fût-il celui de la nation. La République ne constitue pas une communauté particulière, mais participe ainsi de la République universelle par la singularité de son uvre et de sa culture. Ainsi, à mes yeux, la République peut et doit avoir de la grandeur. Mais c’est bien de grandeur d’âme dont il s’agit. Il me semble impossible qu’il puisse y avoir une République sans une morale républicaine dont le coeur consiste à préférer l’universel au particulier. Si une République doit trouver son assise dans la démocratie, elle ne se confond pas avec elle. La démocratie est un régime politique qui fait du peuple l’origine du pouvoir, elle implique tout simplement que les citoyens choisissent ses gouvernants. Il m’apparaît clairement que dans un Etat républicain moderne, la démocratie est une exigence quant à l’origine du pouvoir : les gouvernants doivent être librement choisis au suffrage universel. Le vote de chacun, quelles que puissent être les communautés auxquelles il appartient, vaut autant que celui d’un autre appartenant à des communautés différentes. Il y a bien là une ascèse qui fait préférer la singularité de la personne à la particularité de la communauté et l’universalité des principes à la singularité de la personne. Un gouvernement simplement démocratique est donc un gouvernement de l’opinion. Un gouvernement républicain est celui d’un gouvernement qui trouve son assise dans l’opinion, mais qui transcende cette opinion en volonté publique. Une démocratie qui oublierait l’idée de République pourrait engendrer des régimes monstrueux la détruisant. L’opinion n’est nullement républicaine quand elle préfère les intérêts des communautés au bien public. Le communautarisme conduit à l’obscurantisme et à la barbarie. Plus qu’une forme de gouvernement, la République est une morale, une philosophie pratique de construction de l’homme comme citoyen. Elle exige de tous et de chacun l’effort de formation, l’ascèse quasi spirituelle par laquelle, dépassant nos particularismes, nous élevons notre singularité en universalité. La République, en construisant la cité, construit un citoyen pièce maîtresse de l’univers ».
Un nationalisme sans nation
Ce texte est une illustration presque parfaite de la pensée de l’élite républicaine pour laquelle :
– l’idéal (idéologie serait plus adéquat) est supérieur à la nation et à la personne ;
– le bien public ne doit pas se limiter à la nation mais doit concerner l’univers ; – l’universel prévaut sur le particulier ;
– la démocratie doit être surplombée par une caste républicaine chargée d’empêcher les divagations du peuple et dimposer les orientations politiques (la volonté publique qui est transcendantale !!!)
– les communautés dorigine doivent être dépassées ;
– le but de la république n’est pas de chercher à réaliser le bien commun d’un peuple particulier mais de construire l’homme nouveau universel et indifférencié. On retrouve là un thème développé dans le passé par le bolchevisme (qui fût un autre héritier de la révolution française ; ce qui explique la difficulté à critiquer le communisme qu’ont toujours eue les républicains français) ;
– il faut faire une distinction entre patrie (ce que les intellectuels néo-républicains, tels Taguieff ou Schnapper, appellent la nation civique par opposition à la nation ethnique) qui fait l’objet du patriotisme constitutionnel (J. Habermas) et nation (en l’occurrence la nation concrète avec sa culture, son histoire et ses traditions).
La patrie de Barat, comme celle de tous les républicains, est une patrie abstraite susceptible de rassembler l’humanité entière (pour les républicains, la France peut devenir la patrie de tout homme qui veut devenir français et le peuple autochtone n’a rien à dire à ce sujet ; dans son livre récemment publié, Raffarin écrit que le devoir de la France est d’accueillir les étrangers : il ne nous consultera jamais sur ce point !). Chevènement n’utilise jamais le mot de nation, mais les mots de république et moins souvent de patrie (ils sont pour lui synonymes) ; par contre certains républicains, tel Taguieff, pensent qu’il ne faut pas abandonner le mot « nation » aux hérauts de la nation ethnique et qu’il faut par conséquent l’utiliser en y incorporant le sens de la nation civique républicaine. Il y a là une source d’incompréhension et de quiproquo, ainsi qu’une velléité de terrorisme sémantique.
La république et sa crise d’identité
La république française connaît une crise d’identité depuis une dizaine dannées ; cette crise est liée à la construction européenne qui provoque une confrontation avec des systèmes politiques dont la philosophie est très différente de celle qui prévaut à Paris ; au développement de la volonté d’émancipation des communautés ethniques périphériques ; à la montée en puissance d’un populisme identitaire en rupture avec la pensée unique parisienne. Le malaise est si important dans les élites républicaines qu’on a le sentiment qu’elles sont sur la défensive (cela se traduit entre autres par une agressivité totalitaire à l’encontre de tous les mouvements défendant une cause identitaire en rupture avec l’universalisme de rigueur) et qu’elles ne savent plus comment maîtriser les votes incorrects et la montée de l’abstention et des particularismes. Face à cette situation, les républicains ont tendance à devenir hystériques et à mettre en place une propagande digne des régimes totalitaires.
Chantal Delsol écrit : « La république n’accepte donc le débat démocratique qu’à l’intérieur des présupposés qui sont les siens. Et parce que ces présupposés sont assez précis et dessinent une figure du bien commun clairement déterminée, le champ du débat demeure toujours limité, voire exigu, en tout cas par rapport aux démocraties occidentales voisines. Dans la république française, la démocratie ne peut fonctionner seulement tant que les différents courants de pensée acceptent les présupposés républicains, et par là elle ne fonctionne jamais que sous une forme atténuée, puisque l’éventail des figures permises du bien commun est restreint. Si, pour des raisons diverses, un nombre significatif de citoyens récusent certains présupposés républicains et veulent exprimer cette récusation au nom de la démocratie, alors la république se trouve déstabilisée et sommée de donner une réponse à cette contradiction. Soit il lui faudra remettre en cause ses propres principes au nom de la démocratie, ce qui lui paraît impensable parce que ses valeurs sont sacralisées ; soit elle cherchera les moyens d’empêcher ces courants de s’exprimer, au nom de ses principes. La difficulté, dans ce deuxième cas, est qu’elle ne peut pas condamner ouvertement la démocratie pluraliste, faute de se voir rejetée dans le camp des ennemis de la liberté. La réponse à ce dilemme s’annonce tortueuse ».
Et elle poursuit : « S’il le faut, c’est donc contre la démocratie elle-même qu’il faudrait sauver la voie républicaine. Dans les anciennes républiques nobiliaires, le peuple était considéré comme inapte pour se représenter le destin commun. Aujourdhui, on continue de justifier le monopole d’une élite à décider du destin commun, non seulement par la différence de compétences, mais par la différence morale : le peuple n’est plus simplement inculte, il est archaïque, ou séparateur. L’aristocratie vertueuse, désireuse d’élever le peuple, s’est transformée en une idéocratie éclairée, dépositaire d’une idée du Bien sui generis, seule capable de juger si la décision populaire est ou non valable, et repoussant sans cesse un peuple encore barbare qui argue de la démocratie pour imposer sa barbarie. Si bien que l’application de la peine de mort dans certains états américains peut apparaître comme le résultat d’une démocratie démagogique, dominée par un peuple barbare, ce qui n’empêche pas l’élite républicaine de s’appuyer sur l’opinion populaire quand cela sert son point de vue. Ainsi, le peuple a tort ou raison selon qu’il sert ou non la pensée dominante. Forte de son bon droit, la république devient le bras armé d’un ordre moral qui soutient et dirige la politique. L’opinion populaire ne lui agrée que si elle garantit sa vision du monde. Autrement dit, elle se sert de la démocratie comme moyen, tant qu’elle demeure utilisable ».
Pour une démocratie fédérale
Chantal Delsol plaide en faveur d’une démocratie, c’est-à-dire en faveur de la prise en compte de l’opinion majoritaire sans filtre républicain (celui de l’élite éclairée autoproclamée).
De plus, elle considère, en bonne disciple d’Althusius, que les décisions doivent être prises au plus bas niveau possible, au plus près des gens et à ce titre elle refuse le centralisme étatique français. Pour elle, le fédéralisme est un complément de la démocratie ; le fédéralisme complète et achève le régime démocratique en permettant une expression et une satisfaction des besoins locaux indépendamment les uns des autres.
Par ailleurs, le fédéralisme permet aux minorités de maintenir et de faire vivre leurs particularités, ce qui confirme l’esprit de la démocratie en ce qu’elle est le régime politique qui privilégie la pluralité (contrairement à la république à la française qui recherche l’unité et l’indifférenciation).
Il faut dire à ce sujet que les régionalistes qui cherchent à concilier la république et le fédéralisme (ou l’autonomie) au nom d’un prétendu fédéralisme girondin commettent une erreur fondamentale (certains font ce mauvais calcul depuis trente années !), car il n’y a aucun linéament philosophique dans l’héritage de la révolution française qui puisse fonder une évolution fédérale de la France.
Mona Ozouf, historienne spécialiste de la période révolutionnaire, écrivait dans le « Monde des débats » de janvier 2001 : « A l’origine, girondins et jacobins n’étaient que deux factions qui se disputaient le pouvoir. ( ) Les girondins ont tous été jacobins à un moment quelconque, si on entend par là l’appartenance au Club de la rue Saint-Honoré ; jacobins aussi si on définit le jacobinisme par le patriotisme exclusif et le rêve fiévreux dune France guerrière rédemptrice de l’humanité ; jacobins encore, au moins jusqu’au procès du roi, par leurs provocants défis à la royauté ; jacobins toujours par leur obsession du complot. ( ) Les girondins avaient-ils voulu fédéraliser la France ? Ce qui donne de la consistance à la charge, c’est la révolte qui, après le coup de force du 2 juin 1793, dresse une trentaine de départements contre la Convention : celle-ci vient d’exclure et de promettre à la mort vingt-deux députés girondins. L’insurrection est pourtant vite réprimée, circonscrite à quelques grandes villes, et on y chercherait en vain un esprit de dissidence régionale : les départements ne s’étaient associés que par haine de Paris, des exactions jacobines et des hommes en qui elles s’incarnaient. Ils n’étaient animés d’aucun projet séparatiste, ne récusaient pas l’existence d’un centre national. Girondins et jacobins étaient convaincus que l’esprit de la révolution réside dans la force de s’arracher à l’horizon villageois. Ni chez les uns, ni chez les autres, il n’y avait de tendresse pour les libertés locales ».
La démocratie fédérale et la république à la française sont rigoureusement incompatibles ; s’engager sur la voie du fédéralisme et de la démocratie la plus directe possible, exige de changer de cap et de tourner le dos à ce système confiscateur des aspirations populaires et négateur de toutes les particularités. L’universalisme abstrait, l’obsession de l’unité, la recherche de l’indifférenciation, le centralisme technocratique et le gouvernement par une élite simplement élective sont les opposés du particularisme concret, de l’approbation de la diversité, de l’amour des différences, du polycentrisme politique et du gouvernement de la majorité du peuple par elle-même.
La république et les identités
Il est devenu habituel dans les milieux médiatique et politique de condamner, au nom du républicanisme individualiste et universaliste, tout ce qui fait référence aux identités collectives. Seule l’identité individuelle a le droit de cité et encore !.. à condition seulement qu’elle soit associée a un cosmopolitisme sans faille.
Toute affirmation d’identité communautaire (ethnique, nationale, régionale…) est dénoncée comme une offense et même une menace envers la république.
Pour les républicains, l’identité de la France doit être une identité idéologique et non pas une identité ethno-culturelle. Le peuple français est conçu par nos élites dirigeantes comme un peuple avant-gardiste, pionnier du civisme planétaire ; les Français (qu’ils soient franciens, bretons ou provençaux) sont ainsi appelés à se détourner de leur passé et à transcender leurs appartenances communautaires. Chantal Delsol écrit à ce sujet : « La république française entretient à la fois et de façon liée, une vision mystique du citoyen et une vision idéologique de l’éducation à la citoyenneté. Elle a tendance à croire, ou croit communément, que le citoyen est un homme nouveau, un homme doté d’une seconde nature, par l’arrachement au particulier et l’accession à l’universel, deux termes dont elle radicalise la séparation. Par l’éducation républicaine, l’enfant devrait être littéralement arraché à ses appartenances, au monde frelaté et provincial du particulier L’école est censée purifier l’enfant du particulier pour le faire accéder à l’universel. Comme si les humains que nous sommes pouvaient s’abstraire de la particularité, de l’inscription dans le concret En voulant purifier l’individu de toute particularité, la république ne le rend pas libre de penser par lui-même : elle le rend républicain. En voulant le désinscrire, elle l’inscrit dans une pensée officielle ».
Le 19 septembre 2002, le maire socialiste de Rennes, au cours d’un colloque intitulé « Identité et démocratie » a insisté « sur les valeurs qui transcendent l’identité, dont le respect de l’autre » ; quant à Josselin de Rohan (président du Conseil régional de Bretagne), il mit en garde son auditoire : « l’exaltation de l’identité peut être très éloignée de la démocratie. La démocratie, c’est avant tout la reconnaissance de l’autre ». Dans ces deux discours républicains (l’un de « droite » et l’autre de « gauche »), on retrouve la même idée : l’autre est plus important que le proche (celui qui partage avec vous son identité).
C’est une bonne illustration de la démonstration faite par Chantal Delsol : la classe politique et médiatique, toutes nuances confondues, partage la même vision républicaine, unitaire et universaliste.
Il est intéressant de remarquer qu’au cours de ce même colloque, l’homme politique irlandais John Hume (Prix Nobel de la paix) affirmait quant à lui : « La différence est l’essence de l’humanité » ; ce qui est une position bien éloignée de celle de Rohan et Hervé : méfiance à l’encontre de l’identité d’un côté, approbation des différences de l’autre
Bruno Guillard, 01/10/2002
SOURCE : Bulletin du MRB, 10/2002
La république : une question française, Chantal Delsol, PUF 2002, 15 euros.