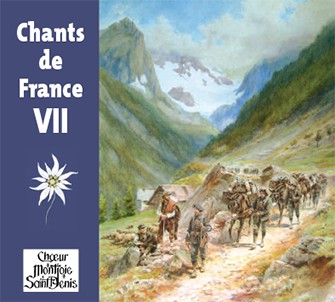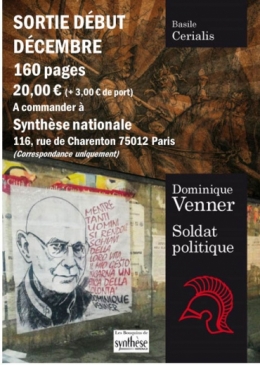Ce petit bréviaire des sept stratégies de manipulation à l'usage des "nuls" est inspiré par les "Dix stratégies de la manipulation" (et les multiples variantes) qui sont en accès libre sur internet. Bien que ce texte soit un « hoax » (canular) attribué à tord au philosophe et idéologue américain Noam Chomsky, les méthodes énoncées sont intéressantes car elles semblent être appliquées dans les sociétés humaines avec une remarquable permanence depuis l'antiquité. Elles auraient cependant pu servir d'introduction à deux de ses livres : "La fabrication du consentement" et "Armes silencieuses pour guerres tranquilles" qui sont de violentes critiques de la manipulation de(s) masse(s).
1) La stratégie de la distraction
Elément primordial du contrôle social, la stratégie de la distraction consiste à détourner l’attention du public des mutations importantes décidées par les élites politiques et économiques (comme la transition énergétique par exemple…) grâce à un flot de distractions et d’informations insignifiantes. Elle est d’inspiration romaine et antique : "panem et circenses" (du pain et des jeux). Le football, les jeux en réseau et certaines émissions de télévision en sont les versions modernes.
2) Créer des problèmes puis offrir des solutions (stratégie du pourrissement)
Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». Elle consiste à créer une "problématique sociale" d’où naîtra une demande populaire. En clair, on crée d’abord un problème (ou on laisse se détériorer une situation) pour susciter une réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter.
Un directeur de cabinet ministériel disait : «on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fera pas parce que la population n'est pas mûre». Par exemple : les prisons sont saturées mais construire des prisons donne une mauvaise image (encore plus pour un gouvernement "de gauche"). Quelques reportages bien tournés montrant la promiscuité intolérable des prisonniers suscitera une réaction d'indignation de la population qui applaudira à l'annonce de nouvelles constructions "humanitaires". On pourra aussi laisser se développer "un désordre social inacceptable", comme la violence urbaine, afin que la "vox populi, vox dei " soit demandeur de moyens supplémentaires pour les forces de l'ordre.
Le public est souvent myope. Il n'accepte le changement que lorsqu'il y est contraint ou ému et, lorsqu'il le demande, il est souvent bien tard.
3) La stratégie de la gradation (ou des paliers successifs)
Découlant du point précédant, la stratégie de la gradation permet de faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en « dégradé », sur une durée de plusieurs années. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles peuvent être accepter par une population où chacun défend son pré carré, ses habitudes et "ses avantages acquis".
4) La stratégie du différé
Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme "douloureuse mais nécessaire", en obtenant l’accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice immédiat. D’abord, parce que l’effort n’est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que "tout ira mieux demain", et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s’habituer à l’idée du changement, et pour l’accepter le moment venu.
5) Infantiliser le public
La plupart des publicités et des discours utilisent des arguments et un ton particulièrement infantilisants, comme si le public était un enfant. Lui faire croire par exemple que, sans énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et sans nucléaire, il va pouvoir vivre de partage, d'amour, de vent et de soleil grâce à la "transition énergétique" est une présentation séduisante pour des immatures. Certains y croit, comme on croit au Père-Noël. «Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, elle aura une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d’une personne de 12 ans ".
6) Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion
Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs… comme la peur des radiations, des OGM , des "petites ondes" et plus généralement de l'industrie et de la science.
7) Désinformer pour maintenir le public dans la culpabilité, l'ignorance et la bêtise
Comme ce fut le cas pendant des siècles lorsque la connaissance était tenue par la noblesse le clergé. Le public, les journalistes et la plupart des élus sont aujourd'hui incapables de comprendre les technologies et les méthodes de désinformation. C'est flagrant dans la manière de présenter le concept flou de "transition énergétique" que chacun comprend à sa façon (moins de fossiles pour l'un, sortir du nucléaire pour un autre, manger bio ou local pour un troisième, ...). De plus en plus de rouages décisionnels de l'Etat et de grandes organisations sont investis par des idéologues d'un monde "idéalisé", sans industrie, sans nucléaire et sans émission de quoi que ce soit (gaz à effet de serre, ondes,…) qui utilisent les médias pour soutenir une idéologie décorrélée des réalités.
Respirer même va devenir culpabilisant, car on aggrave ainsi notre "empreinte carbone" en rejetant du CO2 qui est un.. gaz à effet de serre.
Vous êtes maintenant "affranchis". En écoutant (ou en lisant) les médias dans les prochains jours, saurez-vous reconnaître une des sept stratégies de manipulation ?
Michel Gay
source Metamag
http://www.voxnr.com/cc/dh_autres/EuEyZFVpEEhYeasKVY.shtml