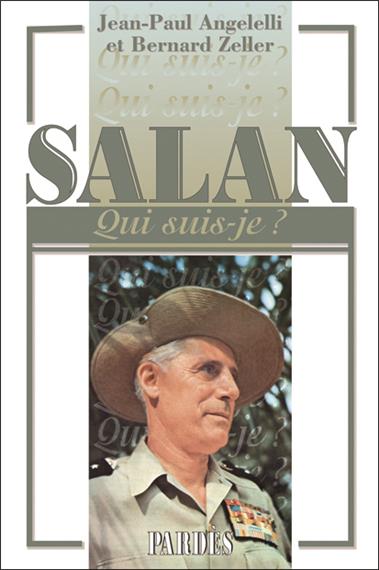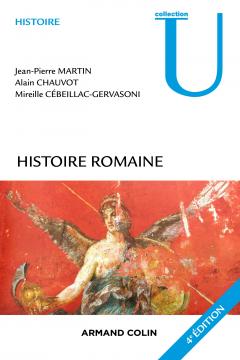La victoire progressiste, cependant, n’est pas encore totale aujourd’hui. Quoique fortement fragilisés, certains socles de la société traditionnelle subsistent encore. Le premier est la famille. Les progressistes s’emploient dès lors à détruire ce qu’il en reste et à promouvoir tout ce qui peut lui nuire : ils soutiennent le divorce et les comportements « libres » ; ils étendent le plus possible les possibilités d’avortement ; ils insistent sur le fait que la femme n’a pas forcément vocation à être mère ; ils cherchent à subvertir la répartition traditionnelle des rôles entre homme et femme, dans la famille comme dans la société ; ils promeuvent l’homosexualité, la bisexualité, les changements de sexe ; ils légalisent la « famille » homosexuelle (mariage, adoption, PMA et bientôt GPA ; ils envisagent même une évolution transhumaniste, qui pourrait par exemple conduire à autoriser certaines manipulations génétiques. De façon générale il s’agit pour les progressistes de se débarrasser des mœurs traditionnelles.
Lire la suite