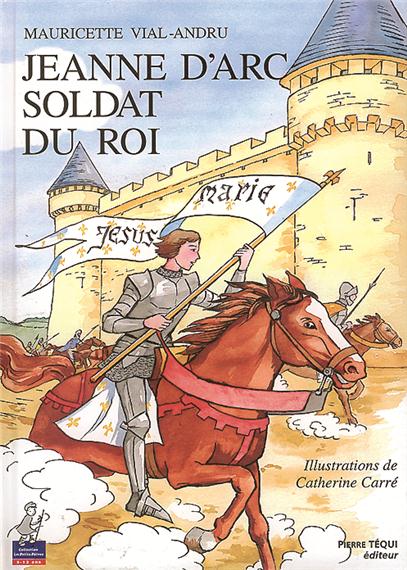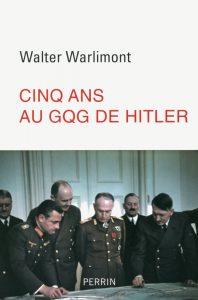Les propositions de paix séparée présentées par Benoît XV puis par l’empereur Charles d’Autriche par l’intermédiaire des princes Sixte et Xavier de Bourbon-Parme ayant été repoussées, la Première Guerre mondiale, décidée plusieurs années avant 1914 par les promoteurs du Gouvernement mondial réunis à la Fondation Carnegie (cf. revue American Opinion, article de Willam P. Hoar, janv. 1976), devait être poursuivie jusqu’à la réalisation de tous les buts préfixés, c’est-à-dire une paix maçonnique accompagnée d’une nouvelle configuration de l’Europe d’où les empires centraux seraient dépecés, car étant la continuation de l’unité dans la diversité que la civilisation européenne avait fondée dans le lumineux Moyen Âge, en opposition radicale aux forces antichrétiennes coalisées et tendues vers un imperium mundi soutenu par la volonté de pouvoir de cénacles restreints. Nous constatons là comment la gestion des contraires est l’essence de la stratégie maçonnique : thèse, guerre ; antithèse : pacifisme ; synthèse : gouvernement mondial ! La Maison de Habsbourg avait joué en Europe centrale et en Italie le rôle de la Maison de Bourbon, et il fallait qu’elle disparaisse. Les temps étaient mûrs pour la Maison d’Autriche.