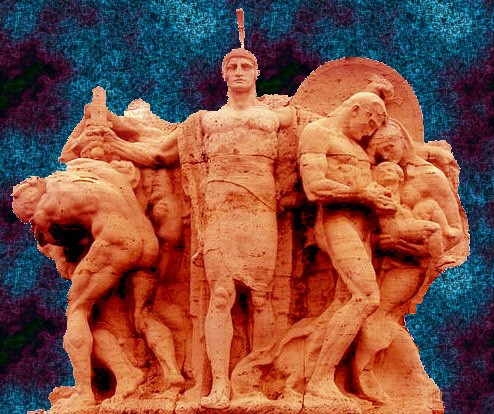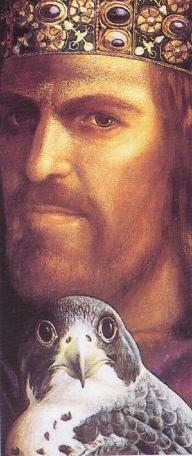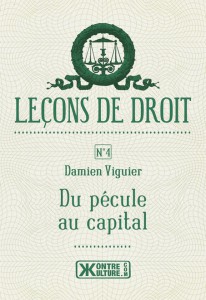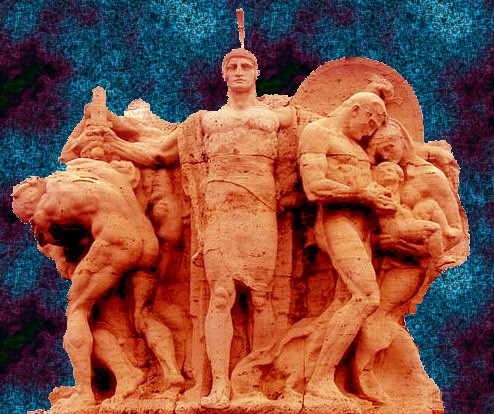
Evola critique avec force, et aussi avec beaucoup de justesse, l’idéologie du progrès, mais c’est pour lui opposer une vision qui en constitue le symétrique inverse, puisqu’elle revient à interpréter l’histoire des derniers millénaires, non comme mouvement progressif perpétuellement ascendant, mais comme mouvement constamment et inéluctablement descendant, comme déclin toujours plus accentué. Dans les 2 cas, la nécessité historique est conservée : l’homme subit le cours de l’histoire au lieu de pouvoir la diriger. Je ne partage pas cette conception. Pour moi, l’existence de l’homme est intrinsèquement sociale-historique : ce qui distingue l’espèce humaine des espèces animales, c’est qu’elle devient historiquement. Je pense en outre que, par-delà les processus historiques ponctuels, l’histoire est toujours ouverte, ce qui la rend imprévisible.