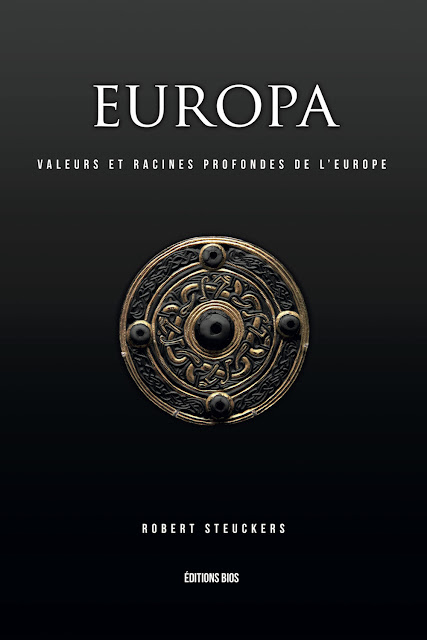Eléments
Eléments
n°170
en kiosque : 6,90 €
Depuis l’affaire du Barbe-Bleue de Hollywood, avec le délicat hashtag « Balance ton porc ! », on assiste au grand retour des précieuses ridicules et des dames quakeresses, des Trissotines et des Torquemadettes, des mères Fouettard.e.s qui traquent les « dérapages » et les comportements « inappropriés ».
La police de la pensée est dépassée, on en est à la police des arrière-pensées. Le soupçon vaut accusation, l’accusation vaut condamnation.
On ne distingue plus la véritable agression sexuelle de la blague de mauvais goût ou de la drague lourdingue. Montée de la subjectivité (le « ressenti ») : si le harcèlement commence quand on se sent harcelé, n’importe quoi peut devenir du harcèlement. Le viol et le chantage sexuel se retrouvent ainsi banalisés.
Multiplier les amendes morales, purger la société des impuretés du désir, instaurer la « transparence » de la vie intime : la censure au nom de la morale, cela n’a rien de bien nouveau. On sait depuis Robespierre que la Terreur est une « émanation de la vertu ». Cinquante ans après Mai 68, il n’est plus question de « jouir sans entraves », mais au contraire d’entraver le désir, de rendre les relations entre les hommes et les femmes insupportables, de dégoûter chaque sexe de l’autre.
Mais il s’agit aussi d’abolir la nature humaine. L’homme est carnivore, donc prédateur, donc carnassier, donc agresseur, donc violeur en puissance. L’idéal serait qu’il devienne herbivore. On assiste à la condamnation des hommes, non seulement parce qu’ils sont des hommes, mais parce qu’ils s’obstinent, en manifestant leur attirance pour l’autre sexe, à témoigner du fait que l’espèce humaine est sexuée et qu’il y a en elle du masculin et du féminin. Ce sont ces notions de masculin et de féminin qu’il faut déconstruire, dissoudre, liquéfier au nom de l’hybridation qui aboutira, simultanément, au métissage universel et à l’androgynat généralisé.
Le seul moyen pour les hommes de ne pas être dénoncés comme des « porcs » serait donc d’accepter la suppression de la différence sexuelle, tout comme le seul moyen d’échapper au racisme serait d’accepter la suppression des différences ethniques. L’homme de demain ne sera d’aucun peuple ni d’aucun sexe.
Cette tendance à la neutralisation, qui va de pair avec l’allergie à la diversité, on la retrouve désormais partout : il s’agit de gommer les différences, de lisser les aspérités, d’instaurer partout la grisaille uniforme, de rendre les êtres et les choses interchangeables.
Il y a au fond trois féminismes : celui qui défend les femmes et rappelle que les valeurs féminines ne sont pas moins respectables que les valeurs masculines – c’est le seul qui soit à la fois légitime et nécessaire –, celui qui veut mettre les hommes plus bas que terre parce que la Terre doit être « délivrée du mâle », et celui qui décrète que tout compte fait il n’y a ni hommes ni femmes : le sexe n’est rien, le « genre » est tout. Le mélange des trois aboutit à des contradictions. De même qu’il est difficile de défendre à la fois la parité et la « non-mixité », il est assez contradictoire de dire que les hommes sont des « porcs », que les femmes sont des « hommes comme les autres » et que le masculin n’est qu’une illusion.
Le 9 décembre 2017, autour de l’église de la Madeleine, un million de Français en larmes assistaient aux funérailles d’un chanteur populaire qui se faisait appeler Johnny. Un mâle blanc hétérosexuel de plus de cinquante ans qui chantait : « Allumez le feu ! » Reste à trouver les allumettes.