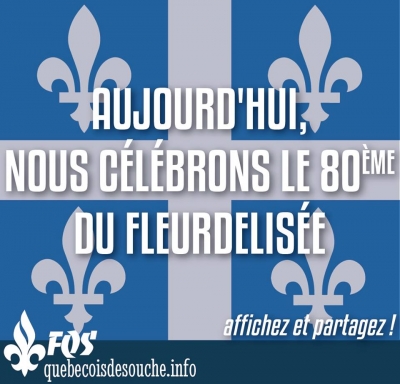culture et histoire - Page 928
-
Olivier Levasseur - La Buse
-
Règlement de conte
Georges Feltin-Tracol
A-t-on atteint les limites de la sottise humaine ou bien celle-ci est-elle illimitée ? L’affaire Harvey Weinstein n’a fait qu’accélérer la diffusion du venin gynocratique dans toutes les sociétés occidentales ultra-modernes, en particulier chez les Anglo-Saxons. Ses répercussions quotidiennes auraient ravi Pierre Gripari qui publiait en 1982 une Patrouille du conte. L’histoire raconte le travail d’agents qui rectifient les contes dans un sens politiquement correct. L’Ogre du Petit Poucet devient ainsi végétarien.
À la fin du mois de novembre 2017, une mère de famille, Sarah Hall, de Newcastle en Grande-Bretagne s’indigne de la scolarité de son fils de 6 ans. Y a-t-il trop de professeurs absents ? Sont-ils trop sévères ou bien trop laxistes ? La nourriture est-elle mauvaise à la cantine ? Non, ses griefs sont bien plus graves. Cette Sarah Hall se scandalise que son fils apprenne en classe le conte de La Belle au bois dormant, un bel exemple selon elle de harcèlement sexuel. En effet, le baiser que donne le Prince charmant à la belle endormie afin de la réveiller soulève le problème du consentement.
Plus généralement, des féministes hystériques condamnent maintenant les héroïnes de conte parce qu’elles sont blanches, passives (sic), minces et hétérosexuelles. Ces malades préféreraient que Blanche-Neige se mette en couple avec Gretel et aient plein d’enfants grâce à la GPA. Ce délire atteint aussi l’opéra. En Italie, la fin tragique de Carmen vient d’être modifiée. Elle ne meurt plus (triste exemple de « féminicide »), mais tue Don José, ce qui est une apologie de la violence faite aux hommes et par conséquent une incitation à commettre un homicide ! Mais bon ! passons, voulez-vous ? On attend avec impatience d’autres changements. La Grand-Mère du Petit Poucet n’est plus avalée par le Loup, horrible acte de spécisme, mais se marie avec lui !
Un révisionnisme sordide s’insinue dans nos esprits. Il importe de le rejeter par toutes nos forces. Il est inacceptable que le patrimoine littéraire de notre civilisation européenne soit ainsi édulcoré, violé, profané. Sinon pourquoi ne pas inciter le Prince charmant à épouser la Belle au bois dormant, Blanche-Neige et Cendrillon en même temps ?
Bonjour chez vous !
• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n°62, diffusée sur Radio-Libertés, le 19 janvier 2018.
-
Jean-Philippe Chauvin : Retour sur l’insurrection royaliste à Paris.
-
Le Pen, les Mémoires : l'entretien avec Guillaume de Thieulloy, son éditeur, publié dans Présent
C’est aux éditions Muller que Jean-Marie Le Pen publie ses Mémoires à paraître le 1er mars, extrêmement attendus et juste avant un congrès où le Front national changera peut-être de nom. A la tête de Muller, quelqu’un que l’on ne présente plus : Guillaume de Thieulloy, le directeur de publication du Salon beige, de Nouvelles de France, de l’Observatoire de la christianophobie et des 4 Vérités. Il a fallu le torturer car le secret est bien gardé, mais nous sommes arrivés à en savoir un peu plus.
Comment avez-vous réussi ce gros coup d’édition ? Tous les éditeurs parisiens devaient être sur les rangs ?
C’est aussi ce que j’aurais pensé spontanément. Mais manifestement, ce n’était pas le cas. Autant que je sache, Jean-Marie Le Pen et son entourage se sont heurtés à plusieurs refus. Ce qui est certain, c’est que ce gros coup m’est « tombé dessus », sans que je l’aie cherché. Mais je ne vais pas jouer les saintes nitouches, j’avoue que cela m’a bien plu de faire un peu la nique à des confrères plus prestigieux que moi.
Quand doit sortir le premier tome ? A combien d’exemplaires doit-il être diffusé ? Combien prévoyez-vous de volumes et concernant quelles époques ?
Le premier tome doit sortir début mars. A priori, la mise en place en librairie devrait être de l’ordre de 40 000 exemplaires. Ce premier tome couvre la période qui va jusqu’en 1972, date de la fondation du Front national (NDLR : Marine Le Pen avait quatre ans). Je n’ai pas encore vu le deuxième tome, mais je dois avouer que ce premier m’a semblé presque plus intéressant que les récits de combats politiques qui vont suivre : l’enfance d’un pupille de la nation, la Résistance, la décolonisation, la Corpo de droit et le poujadisme, les combats pour l’Algérie française, la campagne de Tixier-Vignancour, Mai 68… Tout cela fait un demi-siècle de vie française contemporaine vue par un acteur de premier plan. Franchement, je ne comprends pas qu’il ne se soit pas trouvé un seul « grand éditeur » pour publier ce livre.
Quelle anecdote vous a le plus marqué ?
Je ne voudrais pas déflorer le contenu, mais, pour moi, la plus grande surprise a été de lire le récit de l’enfance d’un fils, puis d’un orphelin de marin pêcheur. On a peine à imaginer qu’il y a 80 ans, des Français vivaient dans de telles conditions. Je ne dis pas cela pour faire pleurer dans les chaumières, mais cela relativise un tantinet l’image, complaisamment colportée par certains médias, du milliardaire exploitant cyniquement la misère du « populo »… Je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup d’hommes politiques qui aient une telle expérience de la vie dudit « populo ».
On sait que la parole de Jean-Marie Le Pen est très libre. Avez-vous posé certaines limites en tant qu’éditeur ?
Non, les seules limites que j’avais fixées – mais qui n’ont posé aucun problème – étaient les limites de la loi. Pour le reste, je suis suffisamment attaché à ma liberté pour laisser aux autres leur propre liberté et, naturellement, la responsabilité de ce qu’ils écrivent !
Avec le recul du temps, est-ce que Jean-Marie Le Pen a pris des distances avec ces « bons mots » qui ont parfois été contre-productifs pour le combat de ses idées ?Nous n’en avons pas parlé. Et ce premier volume s’arrête précisément à la fondation du FN, donc bien avant les fameux « bons mots ». Comme beaucoup d’amis de Présent (je pense, en particulier, à Bernard Antony), je ne suis pas de ceux qui trouvaient que ces mots étaient particulièrement bons. Quant à savoir quel rôle ils ont joué dans la progression des idées de Jean-Marie Le Pen, j’avoue que je serais bien incapable de le dire, même s’il est bien évident qu’ils ont été utilisés pour « diaboliser » et pour installer ce « cordon sanitaire » qui permet à la gauche – alliée, rappelons-le, aux communistes aux cent millions de morts depuis 1917 ! – de gouverner la France, alors que cette dernière est majoritairement à droite. Ceci étant, j’ai l’impression qu’avec ou sans « bons mots », le machiavélique Mitterrand aurait trouvé le moyen de mettre ce coin entre la « droite parlementaire » et la « droite nationale ».
Est-ce que la mémoire de Jean-Marie Le Pen est aussi performante que celle de Trump selon ses derniers examens médicaux ?
Je ne saurais mieux vous répondre qu’en vous invitant à lire ce premier tome : vous verrez un homme politique qui a traversé des décennies de combats de toute sorte et qui en parle avec force détails, et dans une langue magnifique. J’imagine qu’il s’est aidé de notes et sans doute du souvenir de ses proches, mais le résultat fait honneur à sa mémoire ! Je laisse les médecins faire un bilan de santé comparé de Trump et Le Pen ; moi, je me contente de lire les deux – bien que leurs styles respectifs soient aussi différents que l’imparfait du subjonctif est éloigné du langage des « twittonautes » – avec l’admiration d’un simple observateur pour des acteurs à la carrière si bien remplie…
Propos recueillis par Caroline Parmentier
Article paru dans Présent daté du samedi 20 janvier 2018
-
De la dite "Libération" à l'occupation cosmopolite de la France
-
Une aimable prensé pour nos frères québécois
FQS : CLIQUEZ ICI
-
L’EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS (XVIᵉ – XXᵉ SIÈCLE) | AU CŒUR DE L’HISTOIRE | EUROPE 1
-
21 janvier 1793
 Bernard Plouvier
Bernard PlouvierLe 21 janvier 1793 fut guillotiné un homme intelligent, très cultivé – à son époque, il était l’un des rares Français à écrire sans truffer ses textes d’une multitude de fautes d’orthographe, en plus d’être un grand connaisseur des choses maritimes, de l’histoire antique et moderne, de la géographie physique et humaine –, par ailleurs bon bricoleur, excellent mari et père, pieux au-delà du raisonnable et même fort peu dépensier, contrairement à son épouse : Louis XVI, passé du statut de roi de France et de Navarre (1774) à celui de roi des Français (1791), après avoir été gratifié du titre de « restaurateur des libertés » (1790).
De nos jours, il est encore des Français pour se lamenter le sort de « notre bon roi ». Or, s’il avait indéniablement été un homme bon, il s’est révélé, à l’usage, un souverain lamentable. Doté de toutes les qualités qui font l’excellent bourgeois – et il n’y a nulle honte à être un honnête bourgeois –, il n’avait aucune des qualités requises pour être un chef d’État.
Il avait parfaitement mérité le sort que lui réserva la Convention Nationale. Cet excellent homme était un faible, un irrésolu, incapable de diriger une Nation, incapable de réprimer l’agitation de quelques privilégiés (1787-1788), puis celle de quelques dizaines d’intrigants, œuvrant pour flatter les ambitions de son très vil et très lâche cousin Louis-Philippe d’Orléans (1788-1792), enfin incapable de calmer, par quelques exécutions ou l’envoi au bagne (« aux galères »), l’embrouillamini créé à dessein, en 1789-1791, par quelques centaines d’excités avides de sensations fortes, de publicité, de places et de richesses.
Quand l’on est insuffisant pour la fonction que l’on occupe, pour la tâche échue par naissance ou par élection, la sagesse commande de se retirer en faveur d’un plus apte. C’est une « leçon de l’histoire » que certains de nos contemporains feraient bien de méditer.
Car s’il est facile de « colérer le peuple », il est beaucoup plus malaisé de lui faire réintégrer sa tanière… « colérer » est un néologisme emprunté à un expert : Maximilien Robespierre, qui, comme Messieurs Danton, Marat et bien d’autres, avait usurpé la particule avant de se faire appeler « citoyen ».
Un chef, de famille ou d’État, ne doit avoir pour buts que de conserver et accroître le Bien commun, de permettre à chacun de ses administrés ou de ses ouailles d’exercer ses talents au mieux des intérêts collectifs et de refréner ses pulsions morbides ou franchement dangereuses. Si le chef est incapable, le groupe humain qu’il est censé protéger autant que diriger se dissout.
Napoléon Ier l’a dit : « Il n’y a pas de mauvais régiments. Il n’y a que de mauvais colonels ». C’est une phrase profonde, vérifiée à toute époque et pour toute collectivité. L’exemple de Louis XVI doit être, non pas lamenté, encore moins glorifié, mais sérieusement médité.
-
Le phénomène Louis XVI et la République

Faut-il s'étonner ? Il y a plus de deux siècles que Louis XVI a été guillotiné. Deux siècles que les événements révolutionnaires ont bouleversé notre histoire. Et il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de parti royaliste dans les assemblées. De ce point de vue - c'est Pierre Boutang qui l'a dit - les royalistes sont un « néant de force ».
Alors faut-il s'étonner que chaque début janvier se mettent en place les longues listes de messes et de manifestations qui vont commémorer la mort, le 21 janvier 1793, de ce roi malheureux ? Et tirer pour aujourd’hui les leçons de cet événement qui pèse sur nous.
Cette année encore, les annonces sont très nombreuses et l'on sait que, presque partout, les églises, qui n'en ont plus trop l'habitude, seront pleines et ferventes.
Faut-il s'en étonner ?
En 1877, dans son Journal d'un écrivain, Dostoïevski, déjà, avait observé et signalé « la ténuité des racines qui unissent la République au sol français ». C'était l'époque du royalisme électoral et parlementaire, qui fut majoritaire, un temps, à l'Assemblée nationale. La République n'avait été instituée – « la moins républicaine possible » - qu'en attente de la monarchie. Mais à la mort du comte de Chambord, le royalisme parlementaire avait vécu, avalé par le jeu des partis et par le régime d'opinion. Comme échouera, ensuite, le stratagème du pape Léon XIII, qui crut, avec le Ralliement, faire de la France une république chrétienne, puisque la grande majorité des Français était catholique... Ce Pontife, en politique, fut un naïf. Il récolta la guerre que la République mena à l'Eglise de France au commencement du siècle suivant, le XXe. Le royalisme se réfugia dans quelques salons surannés ou dans de nobles et nostalgiques fidélités.
Les racines qui unissent la République au sol français étaient-elles pour autant devenues moins ténues ?
En l'année 1900, le souvenir de la défaite de 1870, de l'Empereur prisonnier, des Allemands sur les hauteurs de Montmartre, était toujours omniprésent, mêlé à l’obsédant souci des provinces perdues. Alors que se profilait la terrible menace d'une nouvelle guerre, l'on vit soudain se lever du marais du camp patriote, la forte résurgence d'un royalisme français, jeune, intellectuel, doctrinal et combatif, qui bousculait le royalisme endormi et le vouait au patriotisme le plus exigeant. Ce que fut la place de l'Action Française d'alors, son autorité intellectuelle et morale, son emprise sur la jeunesse, sur l'Intelligence française, sur la catégorie des Français actifs, avant la Grande Guerre et dans l'entre-deux guerres, nous avons de la peine à le mesurer aujourd'hui, malgré les livres et les travaux universitaires. Le royalisme français avait opéré une étonnante renaissance qui attestait de cette ténuité inchangée des racines qui unissent la République au sol français, telle que Dostoïevski l’avait observée.
Le royalisme français restauré ou refondé par l'Action Française a traversé le XXe siècle et deux guerres mondiales, la première gagnée par miracle, la seconde perdue dans des conditions – l’effondrement que l’on sait - qui, comme l'a dit Boutang, ont failli tuer la Patrie.
Nous voici, un siècle plus tard. La République est-elle devenue plus assurée de son enracinement dans le sol français ?
Deux rendez-vous historiques ont au contraire confirmé sa ténuité : tout d’abord, le millénaire capétien en 1987, au cours duquel le Comte de Paris assura l’avenir de la Maison de France en titrant ses deux petits-fils, les princes Jean et Eudes, duc de Vendôme et duc d’Angoulême ; cette année-là le comte de Paris et le président de la République, François Mitterrand, commémorèrent ensemble, côte à côte dans la cathédrale de Reims, le baptême de Clovis en 987. Ces événements porteurs de puissants symboles eurent un grand écho. Deux ans plus tard, vint 1989. L’on devait célébrer le bicentenaire de la Révolution française. Tâche ardue. Qui fut ratée. Le comité des célébrations fut d’abord confié à Edgar Faure qui décéda avant l’heure. Puis à Pierre Joxe qui courut à l’échec. Grâce à quelques initiatives heureuses et fortes – Jean Raspail, Jean-Marc Varaut, Marcel Jullian – le bicentenaire tourna à la critique de la Révolution, se mua en un vaste courant de sympathie pour ses victimes, à commencer par le roi, la reine, le dauphin, martyrs de la Terreur.
Près de trente ans encore ont passé, sous les mandats délétères de François Mitterrand (second septennat) de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. On sait la situation de la France et le discrédit du régime au terme de leurs mandats.
Or voici que le 8 juillet 2015, dans l'hebdomadaire Le 1, le ministre de l’économie de François Hollande, sans que quiconque le reprenne ou le sanctionne, écrivit ceci, qui mérite d’être relu :
« Il nous manque un roi. La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La Terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif : le roi n'est plus là ! On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures : ce sont les moments napoléonien et gaulliste, notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace. On le voit bien avec l'interrogation permanente sur la figure présidentielle, qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. Pourtant, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction. Tout s'est construit sur ce malentendu. »
Chacun sait que l’auteur de ce constat radical – qui ne fait que confirmer les réflexions anciennes de Dostoïevski - est Emmanuel Macron, élu entre-temps, contre toute attente, président de la République française.
Faut-il s’étonner s’il y a beaucoup de Français à travers le pays pour se souvenir de la mort du roi Louis XVI, dans les jours qui viennent ?
Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien suivant ...
-
LE MERCENARIAT CHEZ LES CELTES
A part la conquête de nouveaux territoires, les Celtes exerçaient leurs talents militaires pour le service mercenaire. Son développement rapide à partir du IVè siècle av. J.-C. constitue un phénomène important pour l’histoire et la civilisation du monde laténien.
L’existence des mercenaires celtiques fait apparition dans les sources anciennes peu après la prise de Rome par les Sénons. On peut parler pour le IVè s. d’une alliance entre les Gaulois et Denys l’Ancien de Syracuse. Les visées adriatiques de ce tyran sont bien connues. Il faut donc supposer que le recrutement des Celtes était lié à Ancône qui a été fondé par Syracuse au début du IVè s. L’installation des Sénons dans les Marches d’une part les mettait en contact direct avec la Grande Grèce et la Sicile et d’autre part, ce nouveau territoire celtique devenait un pôle d’attraction pour les éléments aventureux transalpins. Les textes évoquent la présence gauloise en Apulie et parlent aussi de troupes celtiques à la solde de Denys l’Ancien qui participent aux conflits de Sparte et de Thèbes. Notamment, en 396/8 av. j.-c., 2 000 mercenaires gaulois et hispaniques envoyés par le tyran de Syracuse aident les Spartiates dans l’isth
Denys le Jeune et plus tard Agathoclès ont employé des mercenaires celtes qui ont aussi été enrôlés par les Carthaginois, jouant ainsi un rôle varié dans les guerres gréco-puniques du IVè s. av. J.-C. en Sicile.
Le service mercenaire a donc bien élargi la périphérie des déplacements celtiques. Il faut noter qu’en 307 av. J.-C. Agathoclès a amené ses troupes celtiques en Afrique, en terre carthaginoise.
Le mercenariat celtique prend à partir de la mort d’Alexandre le Grand une ampleur extraordinaire : les Celtes combattant dans les armées diverses du monde hellénistique se comptent par milliers. Cette nouvelle phase est donc étroitement liée aux offensives contre les Macédoniens et les Grecs qui débutent par les invasions des années 280-270 av. J.-C. L’événement décisif date cependant de la fin de 278 ou début de 277, quand Antigonos Gonatas, revenu d’Asie Mineure en Europe, détruit par la ruse une armée celtique en Thrace, près de Lysimacheia. La victoire doit être considérée comme le coup de grâce porté à la tentative d’invasion celtique contre le monde méditerranéen. Elle ouvre cependant en même temps la porte des armées hellénistiques à ces guerriers redoutables, réputés partout. Antigonos, le vainqueur, ne tarde pas à prendre le reste de l’armée celtique battue à sa solde. Sous le commandement de Kidérios, elle l’aide à s’emparer de la Macédoine. Ainsi se prolonge la présence des Celtes en terre grecque : Antigonos Gonatas envoie ses Gaulois contre Pyrrhos qui en avait également à son service. Le roi d’Epire les a laissé violer les tombes royales macédoniennes à Aigai (très probablement identique à Vergina actuelle où les fouilles grecques ont constaté le pillage du tumulus présumé de Philippe II), puis ils l’accompagnèrent dans le Péloponnèse et étaient auprès de lui, à Argos, lorsqu’il périt.
La Thrace devient à cette époque-là un réservoir important de mercenaires : Antigonos Gonatas envoie en 277/6 av. J.-C. 4 000 Gaulois à Ptolémée II Philadelphie qui était en guerre avec son frère Magas. La victoire est suivie d’une révolte des Celtes qui périrent enfermés dans une île du Nil.