L’interview que donna Attali dans l’Express, et qui est reproduit sur le site www.denistouret.fr/ideologues/Attali.html, outre la grande charité pour les gentils qui s’y révèle, présente une richesse de contenu remarquable par sa franchise. Pour lui, l’épisode du désert est crucial. Le peuple hébreu, coupable d’avoir adoré le veau d’or, doit errer dans le désert du Sinaï. Il reçoit malgré tout la manne, qui est fade, sans saveur, ce qui signifie qu’il devra dorénavant travailler pour obtenir des richesses, signe d’élection (contrairement au christianisme, pour qui c’est plutôt la pauvreté). Quant à la Renaissance, une longue citation s’impose :
« Pour moi, les preuves que je recense sont tellement accablantes que la thèse de Max Weber ne tient pas la route : malgré son immense culture, il n'a rien compris, ni au judaïsme, ni au rôle que celui-ci a joué, ni aux sources de l'ordre marchand. Mais Sombart n'est pas mieux : il fait démarrer le capitalisme au XVIe siècle par l'initiative de juifs polonais immigrés en Angleterre ! Il ne leur prête un rôle que dans le capitalisme de spéculation, alors que l'important est ailleurs, dans le rôle très ancien joué par les juifs dans la mise en place de l'éthique en général, dans celle de l'économie en particulier, et dans le financement de l'investissement à partir du Xe siècle. Il oublie beaucoup d'autres choses, comme le rôle de la papauté, qui préserve les banquiers juifs dont elle a besoin; l'importance des banquiers lombards, qui sont en réalité souvent des juifs plus ou moins masqués ; leur rôle dans le formidable développement de l'Espagne, dans les deux berceaux majeurs du capitalisme que furent les Pays-Bas et l'Angleterre et dans les colonies. Il ne dit rien non plus de leur participation au développement industriel, au XIXe siècle, en particulier dans les industries de la communication, de l'automobile, de l'aviation. Peu de gens savent que l'agence Havas et l'agence Reuter au XIXe siècle sont des créations juives, au même titre que la Deutsche Bank, Paribas ou les principales banques d'affaires américaines. Et encore bien d'autres destins fascinants en France, en Allemagne ou en Russie. De tout cela, je donne d'innombrables et spectaculaires exemples. »
Et plus loin :
« Marx, lui, avait compris que le judaïsme était à l'origine de la pensée économique moderne, mais il assimile totalement judaïsme et capitalisme, pour lui deux ennemis à combattre, et il écrit des pages clairement antisémites sur lesquelles a toujours pesé un tabou. »
4 mai 2011 Claude Bourrinet
plus ou moins philo - Page 36
-
À propos de "L’idéologie du travail (A. de Benoist)"
-
À la recherche du moindre mal
Qu'est-ce que le moindre mal ? Et faut-il le rechercher en politique ? Saint Thomas d'Aquin se posait déjà la question au XIIIe siècle. Et donnait aussi la réponse.
Faut-il voter pour le moindre mal ? Ainsi posée, la question nous renvoie à de très anciennes spéculations sur le moindre mal en politique. Saint Thomas d'Aquin lui-même y avait réfléchi. Il me semble que les principes de sa réflexion sont encore valables aujourd'hui.
Je devrais dire, d'abord, qu'il existe une théorie politique thomiste, que Thomas a commenté les trois premiers livres de la Politique d'Aristote (signe de l'importance qu'il attachait au sujet), qu'il a rédigé, pour un Prince Lusignan, un Traité du gouvernement (De regno) dédié justement « au Roi de Chypres » (ce Lusignan en question) et qu'il a rédigé - pour la Somme théologique - un Traité des Lois qui reste un grand classique universellement reconnu.
C'est dans le De regno qu'il parle du « moindre mal » (minus malum). Il est question sous sa plume des différentes formes de régimes politiques justes (la royauté, l'aristocratie ou la République). Avec son réalisme habituel, il insiste sur le fait que chacun a ses défauts, que l'on trouve des inconvénients, et à la monarchie, et à l'oligarchie, et à la démocratie (le pire des régimes, disait Churchill plus récemment, à l'exception de tous les autres). Dans ces conditions, ajoute-t-il, il importe de choisir le modèle d'où s'ensuit le moindre mal.
Je vous cite en latin la formule de saint Thomas dans le De regno, elle est irréprochable : « Cum autem inter duos ex quorum utroque periculum imminet, illud potissime eligendum est ex quo sequitur minus malum » (chap. 6 éd. Marietti n. 764). Chaque mot est à peser. Voici ma traduction : « Entre deux possibilités qui comportent, chacune, leur danger, il vaut bien mieux choisir celle de laquelle va s'ensuivre un moindre mal ». Saint Thomas parle du choix entre différentes constitutions, la monarchique ou la démocratique. Aucune de ces constitutions n'est mauvaise en soi. De même, le vote en lui-même n'est pas un mal. Chacun des deux candidats représente un certain nombre de périls. Il importe de choisir celui qui est le moins dangereux. C'est du bon sens. Uniquement du bon sens.
Il reste vrai qu'il n'est jamais permis de faire le mal pour que s'ensuive un bien : Non est possible facere malum ut eveniant bona. Mais justement : mettre un bulletin dans une urne, pour participer, au quantième de ce que représente sa petite personne, à la vie politique de son pays, cela n'est pas un mal. Reste à faire le choix le moins mauvais.
Saint Thomas va plus loin encore, à propos du moindre mal, dans le commentaire du psaume XVIII, paragraphe 5 : sur le verset, Lex Domini immaculata convertens animas, Thomas souligne que c'est la loi du Seigneur qui est immaculée et que la loi humaine ne l'est pas. La loi humaine, en effet, peut tolérer le moindre mal, « sicut usuram et prostibulum ». Thomas donne deux exemples : l'usure, non pas le crédit, mais cette manière de jouer sur la pauvreté des gens en leur prêtant au lance-pierre avant de leur faire rendre gorge avec des taux d'intérêt... usuraires. Quant à prostibulum, il ne s'agit pas du plus vieux métier du monde, mais de la structure qui abrite ces activités, que saint Louis de France fit installer, sur les conseils de Thomas au... bord de l'eau, d'où le nom qui lui est resté. Certains contesteront l'historicité de ce fait, qui est pourtant dans le domaine public, mais l'on ne pourra pas contester ma référence au Commentaire du psaume XVIII. Or je ne sache pas que le lupanar soit... un moindre bien.
Pourquoi l'autorité politique est-elle en droit (d'après saint Thomas) de se salir les mains ? Parce qu'elle doit toujours rechercher la fin bonne qui est proportionnelle à son activité politique. Quelle est cette fin bonne ? La paix civile, la paix sociale, « l'état tranquille de la cité » comme dit saint Thomas dans son Traité des Lois : « La loi humaine ne peut pas réprimer tous les maux. Elle réprime seulement les maux qui peuvent troubler l'état tranquille de la cité (pacificum statum civitatis) » (S. th. Iallae Q.99) Drôle de leçon de réalisme politique, à sept siècles de distance ! Le but de la politique n'est pas de réaliser le bien moral, mais d'assurer les conditions sociales de sa réalisation par chaque personne.
Joël Prieur monde & vie 5 mai 2012 -
Clément Rosset ou l’éloge du réel par Pierre LE VIGAN
Clément Rosset est un philosophe matérialiste. Il rabote. Il ne cesse de couper dans la matière philosophique pour en ôter tout ce qui ne serait pas strictement philosophique. Il expulse hors du champ philosophique ce qui relèverait de la morale, ou de l’histoire, ou de la psychologie. Résultat : une philosophie réduite à un pur constat de l’exister, au pur mystère du jeu des êtres, des bêtes et des choses du monde dans le monde. Il semble que pour Clément Rosset, être philosophe soit travailler à réduire le nombre de questions que l’on se pose, et cela parce que c’est sans doute le meilleur moyen de réduire le nombre de réponses.
La philosophie de Rosset peut se résumer en deux aspects : 1° comment voir le monde, 2° comment s’accommoder du monde. Voir le monde tel qu’il est, tel est son point de départ, qui est aussi son point d’arrivée. Entre les deux, de quoi s’agit-il ? Il s’agit de ne parler que de ce qui est, et de cerner l’existant au plus près et au plus juste. Par voie de conséquence, il s’agit de ne plus parler de ce qui n’est pas. C’est-à-dire de ce qui n’est pas vraiment : de ne plus parler du monde idéal, des excuses aux imperfections du monde et des hommes, de l’au-delà, etc. Lire Rosset, c’est apprendre à parler de moins en moins. Un éloge de la concision et du silence : le silence comme forme radicale de la concision.
Le point de départ est que l’homme est condamné à être. Il est condamné à être dés maintenant ce qu’il est dés maintenant. Il n’y a aucune place pour la distinction entre ce qui est de toujours et ce qui ne serait « que » de maintenant. L’être n’est pas un « être des étants » qui siégerait « au-dessus » des étants et ré-instaurerait une coupure métaphysique entre être et étant. Il n’y a donc pas d’étant qui serait autre chose que « être ». Il n’y a pas d’être qui serait l’être des étants. Parménide écrit : « ce qui existe existe, ce qui n’existe pas n’existe pas ». L’être est l’événement d’être lui-même. L’être, de ce fait, n’existe pas. Le monde est, ce qui n’est pas la même chose que de dire « l’être est ». L’être est verbe, et il n’est que cela. Il n’est pas un substantif. Il faut d’ailleurs se méfier des substantifs : ils finissent par être des substituts. La seule chose que l’on peut dire de l’être est qu’il est le monde tel que jamais la connaissance ne le rattrapera. « Le simple fait d’être n’est-il pas à lui seul l’événement le plus inattendu auquel il nous soit donné d’assister ? (1) »
Clément Rosset voit résolument le monde comme un, au sens d’un seul. Ce monde Un n’est pas unique pour autant. Il est « un seul à la fois ». Quand il est là, il est pleinement là, et totalement là. Il n’y a place que pour lui; il prend toute sa place, et donc il prend toute la place. Ici et maintenant, on trouvera ainsi tout le réel, mais rien que du réel. « Ne cherchez pas le réel ailleurs qu’ici et maintenant », écrit Clément Rosset. Ailleurs, en l’occurrence, on trouvera bien des choses. Mais pas du réel. Des succédanés. Alors, si, précisément, nous cherchons autre chose que le réel, allons voir ailleurs. Nous y trouverons ce que nous cherchons : rien. Si nous préférons nous raconter des histoires plutôt que trouver du réel c’est notre problème. Mais encore faut-il le savoir.
Il n’y a qu’un seul monde, et ni un ni plusieurs arrière-mondes. Clément Rosset critique une idée courante : celle d’un réel doté d’un double, l’idée comme quoi le sens du réel ne se trouverait pas dans celui-ci mais à coté. Doublant le réel, un autre réel remettrait le réel « dans sa vraie perspective ». Un arrière-réel plus intelligent, mieux éduqué que le réel simplement réel. Le réel idéel – qu’il conviendrait de s’employer à rendre idéal – expliquerait le sens présent et le devenir du réel observable, que l’on pourrait qualifier de réel vulgaire ou simple réel réellement existant (R.R.E.) – un réel en quelque sorte trop simple pour être vrai. Le réel idéel donnerait la loi explicative du R.R.E. Telle est la théorie de la réminiscence : le réel d’ici et de maintenant s’expliquerait par un réel voilé, par un réel déjà-vécu, par un déjà-là, une sorte d’être qui précéderait les étants. L’immédiat – l’immédiatement perçu – est ainsi dévalorisé. Rosset critique, autrement dit, l’idée de l’idiotie du réel, cette idée qui est la définition même du romantisme. Pour Rosset le réel réellement existant n’a pas besoin d’être « éclairé » par un « vrai réel », un double, qui l’expliquerait « de l’extérieur ». À l’extérieur du réel, il n’y a rien. Et le rien n’a évidemment rien à dire sur ce qui est, et qui lui n’est pas rien. En résumé, tout double paraît à Rosset une fuite devant la réalité, qu’il s’agisse concernant ce double d’un arrière-monde, d’un autre monde, ou d’une essence dissociée d’une existence (2).
Pour Clément Rosset, la question de l’unicité du réel, donc de sa non-dualité, est la question proprement philosophique, qui ne se superpose ni à la question morale, ni à la question de l’histoire, et de son sens éventuel. L’unicité du réel se trouve exprimée par Parménide mais aussi par Lucrèce indiquant en substance que le monde se compose de ce monde-ci, et de mondes non réels mais possibles dont nous ne pouvons rien dire. Cette question de l’unicité du réel aboutit à s’interroger sur les histoires homériques elles-mêmes, dans lesquelles les dieux agissent dans l’histoire des hommes. Le monde visible des hommes n’est-il pas dans ces histoires le reflet du monde réel des dieux ? Or, à partir du moment où le réel visible est supposé « agi » par un réel invisible, la suspicion sur le visible s’installe. L’idée du « peu de réalité » (André Breton) du réel visible s’insinue. C’est un tort.
Certes, la dévalorisation du Réel Réellement Existant n’est pas inéluctable. Ainsi, le réel peut être, chez Hegel, un double de l’Unique réel, qui récapitule tous les instants passés dans l’instant présent. Le réel d’ici et maintenant est ainsi en quelque sorte « anobli » mais reste un double. C’est ainsi un « monde renversé ». C’est encore ce que Gérard de Nerval désigne par un « état de grâce » (3). La plupart des philosophes ont défendu cette idée simple : le réel et son double sont proches, voire identiques (voir plus haut). Une fois encore, Hegel représente bien cette conception portée au stade supérieur de cohérence interne.
Mais cette identité du réel et de son double est en fait impossible. Deux choses identiques ne seraient pas deux. Comme l’écrit Montaigne, « la ressemblance ne fait pas tant un comme la différence fait autre ». Au vrai l’identification d’une chose nécessite que soit posée à côté une autre chose qui ne soit pas exactement la même. C’est pourquoi un réel sans double est proprement non identifiable. Ce qui caractérise le réel est qu’il est toujours totalement là et prend toute la place. C.F. Ramuz dit : « Un bonheur c’est tout le bonheur; deux, c’est comme s’il n’existait plus ». Clément Rosset remarque justement que l’on peut en dire autant du réel. Ainsi, plus un objet est réel, plus il est unique, donc moins il est identifiable. Si le réel est vraiment là, il n’y a plus de distance par rapport à lui, et donc plus d’identification possible. Prenons un exemple : on peut identifier un nuage parce qu’il y a plusieurs nuages, et même plusieurs formes identifiées de nuages. Mais d’une forme inédite, on ne peut rien dire si ce n’est qu’elle est un monstre. On ne peut la « décrire » que comme une chose qui ne ressemble précisément à aucune autre, comme les « choses » de H. P. Lovecraft.
Ce qui angoisse, par exemple le néant, est souvent – loin d’être irréel – on ne peut plus réel. Car le néant, contrairement aux autres « objets du monde » n’a pas de double. Et il est d’autant plus réel qu’il est unique. D’où la thèse de Clément Rosset comme quoi la plus réelle des choses, c’est la mort, dans la mesure où c’est aussi la plus unique des choses. En ce sens, le réel ne peut avoir d’histoire. Une histoire du réel supposerait en effet que l’on puisse se placer d’un point de vue autre que le réel. Or, si le réel est tout le réel, il est non identifiable et non historicisable. Le matérialisme en tant que prise en compte sans conditions du réel est en ce sens inévitablement non-historique (d’où selon Rosset le non-sens du « matérialisme historique » de Marx).
Rosset, c’est le réel sans double. Mais c’est un peu plus compliqué que cela (4). Le double est en effet pensable dans certaines conditions, quand il prend l’une des trois formes suivantes : l’ombre, le reflet, l’écho.
Le double peut ainsi être une ombre, et en ce sens être les confins, la banlieue d’un existant, quelque chose comme l’util (l’outil) chez Heidegger, une chose « à portée de la main », un prolongement de soi, un double qui n’est pas une illusion mais un « à côté de soi », un « avec soi » dans la contrée de soi. C’est le double de proximité. Ce n’est donc pas une illusion, mais c’est la trace et la marque d’un existant. Tout vivant a son ombre ou meurt. Les fantômes n’ont pas d’ombre, car ils sont déjà morts. Ou n’ont jamais pu naître. Telles les créatures évoquées par Ravel : ogres, lutins, diables, follets (5). Ainsi sont-elles des ombres sans être l’ombre de quiconque (6). L’ombre comme vrai double d’un vrai existant, ainsi que l’est le rêve peut être plus inquiétante. Platon évoquait cette « espèce de désirs qui est terrible, sauvage, et sans égard pour les lois (7) ».
Si l’ombre est vrai double d’un vrai existant (d’un « étant dans le monde » dirait Heidegger), le reflet, ou encore le miroir (mieux : le reflet en tant que ce qui empêche de passer à travers le miroir), est double sans objet. Double d’un objet certes mais sans objet. Exemple : la passion. On n’aime jamais (tout à fait) qui on croit aimer. Et on ne s’aime pas non plus pleinement à travers l’autre (l’amour n’est pas qu’effet de miroir). L’amour n’est jamais pur reflet ni pure altérité. Il est entre. C’est d’ailleurs tout son « intérêt » (un intérêt sans rapport avec le sens économique de ce terme, car en ce registre tout peut se donner, tout peut se perdre, rien n’est négociable). C’est là qu’est sa profondeur, précisément sans fond, car il est entre. C’est pourquoi on ne peut vivre sans ombre mais on peut vivre avec ou sans un reflet. Sauf qu’existe le risque de devenir ce reflet. Hanté et transformé par ce reflet, – pétrifié aussi par ce reflet -, reflet de soi perdu ou de l’autre perdu. Comme écrit Rosset, « dans cet autre coté du miroir où s’aventure Alice, on ne fait pas que de bonnes rencontres (p. 62) ».
L’écho est l’autre – le troisième – réel comme double, vrai réel vraiment double d’un authentique réel, qui atteste de la présence dans le monde le plus fortement. C’est le moins autiste des doubles. Et pourtant l’écho est tautologique. « Où es-tu ? » dit l’un, « où es-tu ? » répond l’écho. Même si la tautologie est parfois plus subtile, comme dans le judaïsme. « Qui es-tu ? » questionne Moïse. « Je suis celui qui suis » répond l’écho (écho-Dieu ou écho de Dieu). Pourquoi cet écho est-il en même temps le plus vivant des doubles ? Parce qu’il est dans le monde. Plus encore, il rend présent le monde. Il est le monde en sa présence. Il est la pure présence du monde. « Il est vrai (…) que l’écho, qui ne sait que nous renvoyer à nous-mêmes, possède un pouvoir de nous conforter dans notre identité et notre réalité supérieur à celui dont disposent l’ombre et le reflet » note Rosset (p. 71). L’écho nous échappe, il est du monde avant d’être de nous, il nous défie d’être au monde, d’y être plus encore, d’y être toujours plus. « Double sans maître » dit Rosset. Ce n’est pas assez dire. C’est, plus encore, l’écho qui ambitionne d’être notre maître. C’est lui qui nous intime l’ordre d’assumer tout le bruit que nous faisons en société, même si nous ne faisons pas beaucoup de bruit. C’est lui qui nous demande d’être, plus encore, dans le spectacle de la société du spectacle. L’écho, c’est la mise en abîme perpétuelle : à perpétuité. C’est l’effet vache qui rit – sans le rire. Disons-le tout net : l’écho est de tous temps, mais il est aussi bien de notre temps (comme on dit : bien de chez nous).
L’allégresse est aussi un savoir sur le réel
« Rien n’aura eu lieu » notait Mallarmé. Cela résume en quelque sorte le matérialisme intégral et anhistorique de Rosset. Revenons sur cette question : le réel est l’inconditionné même, le non-mesurable. Le réel est précis, exact – il est exactement là – en tant qu’il n’est pas mesurable, ce qui supposerait un Autre du réel, fusse une duplication, une copie certifiée conforme (dieu, l’être, avec ou sans majuscule…), l’audace étant parfois poussée loin, quand la copie se prétend l’original, attribuant au réel visible et palpable le statut de simple copie. Mais que le réel soit là, qu’il occupe toute la place n’enlève pas à l’homme une liberté : celle de prendre le temps de savourer, du réel, c’est-à-dire du monde, l’inépuisable simplicité. Ainsi, trois principes se rejoignent : le principe de l’unicité du monde (pas d’arrière-monde), le principe de lucidité (voir le monde tel qu’il est), le principe de cruauté (ne pas se cacher la cruauté du monde). La vérité crue doit être crue. Ce dernier principe est bien résumé par Ernesto Sâbato : « Je désire être sec et ne rien enjoliver ». Le réel est cela, et seulement cela.
Un des problèmes qui se posent, c’est que l’essentiel de la philosophie part du postulat qu’il y aurait plus à dire de mondes dont nous ne pouvons rien dire que de ce monde-ci. La réalité immédiate est ainsi dévalorisée au profit de mondes dont l’existence est improuvable. C’est le « principe de réalité insuffisante » : raisonner à partir du réel serait insuffisant, voire vulgaire. Le succès de ce principe vient d’une crainte bien compréhensible devant la cruauté du monde. Que la réalité soit triste est triste. Que cette réalité soit de surcroît vraie est cruel. Que le remède contre l’angoisse humaine soit la révélation de la vérité, comme le suggère Lucrèce, apparaît ainsi problématique. Car en effet la vérité fait mal. Souvent. On peut même se demander si la pratique de la vie ne nécessite pas au contraire un minimum d’aveuglement (souvent un maximum d’aveuglement d’ailleurs). Cette cruauté de la vie se manifeste fort bien dans l’amour. Celui-ci commence, rappelle Rosset, par un baiser comme envie de mordre, et se termine, « si l’itinéraire amoureux va jusqu’à son terme – avec l’écartèlement et la mise en miettes (8) ».
Un autre motif de scepticisme, ou bien de paresse est que le réel n’est pas façonné par l’homme en fonction de l’énergie qu’il investit dans le monde. En effet, il faut de l’énergie pour accepter le réel tel qu’il est, mais il en faut aussi pour inventer (ce que fait le fou) un autre réel. L’énergie n’est pas un critère de vérité (non plus que le travail. Le réel n’a décidément pas de morale, ce qui n’interdit pas à l’homme d’en avoir mais en son nom propre).
Le monde selon Rosset ne comporte donc ni double ni arrière-monde. Il est réel en tant qu’il est présent à nous ici et maintenant. Il change mais il ne se transforme pas, ou si l’on préfère il bouge mais ne change pas. Il n’est jamais pareil mais c’est toujours le même. Dans la Lettre sur les chimpanzés. Plaidoyer pour une humanité totale (Gallimard, 1965 et 1999), Clément Rosset critique – avant Pierre-André Taguieff – le bougisme qui s’est tant développé depuis et cite à son propos quelques exemples particulièrement pittoresques. « Mais nous bougeons, mais nous avançons ! » écrivait Teilhard de Chardin dans L’avenir de l’homme. L’humanité de demain, c’est l’humanité « réconciliée avec elle-même », disait-on alors. C’est la christosphère. « En haut – et en avant ! » disait le père Bergougnioux. « Le dénouement se précipite » prophétisait encore Teilhard de Chardin (9). Toutes ces propositions n’avaient d’égale que la totale gratuite de leur affirmation. Du moins cet éloge du mouvement était-il un progressisme. Alors que nous en sommes à l’éloge du « mouvement pour le mouvement », et du nouveau pour le nouveau.
En tant qu’il est donné, le réel est inévitablement tragique. Le tragique c’est penser le pire (sans s’y complaire, ce qui est coquetterie d’esthète). C’est donc penser que l’homme peut être le pire ennemi de lui-même. Le monde réel est peut-être le meilleur possible (Leibniz) ou le pire (Schopenhauer). Cela importe peu. Il peut être le meilleur tout en étant mauvais, et le pire sans être si mauvais. Le donné et le tragique désignent la même chose : ce qui ne dépend pas de nous, le fatum. L’existence, et notamment l’existence de l’homme, est l’indéterminé même. Le monde dans lequel l’homme est jeté n’est ni absurde, ni rationnel, ni raisonnable. Il est tout simplement incompréhensible. Ce monde tragique, plein des « soucis de tous les jours et de toutes les nuits (10) » ne dit mot de la peine et de la détresse des hommes. Au delà de la mince écorce des bruits du monde règne le silence. C’est le caractère angoissant de ce silence qui explique la tentation du bavardage moral. Mais c’est là encore une tentation de refus du réel.
Accepter le réel, c’est accepter un monde sans morale. Parce que l’objectif de la morale c’est de faire parler le monde. C’est de le sommer de nous livrer sa signification. Si le monde parle, et l’exigence morale le veut, c’est pour nous en dire plus sur lui, pour se justifier. Si le monde a quelque chose à nous dire c’est qu’on peut y comprendre quelque chose et aussi qu’il est « perfectible » comme disait George Sand. Si le monde n’est pas parfait, et/ou si un monde parfait n’est pas réel, cela prouve, nous dit la morale, l’existence de contre-forces au bien et à la perfectibilité. Là où il y a douleur, il doit y avoir péché. Il doit donc y avoir pénitence. « Verglas assassin, Mitterrand complice » proclamait le groupe humoristique Jalons des années 1980. Cela n’est pas si mal représenter l’esprit du temps. Conséquence : voir le monde tel qu’il est est devenu l’indécence suprême. Voir les choses comme elles sont est devenu très obscène.
Le principe de base de Rosset est de voir le monde tel qu’il est. Sécheresse du constat. Mais comment peut-on s’accommoder de ce monde ? En l’accueillant comme un don. En remplaçant l’espérance d’un autre monde par l’étonnement devant ce monde-ci. C’est le monde d’ici et de maintenant qu’il faut respecter – sinon diviniser comme le souhaitait Nietzsche (La volonté de puissance, « Les trois siècles» ). Il faut tout ramener au réel et se contenter du réel. « Ne plus se raconter d’histoires » comme disait Louis Althusser. Abandonner tout espoir, toute illusion et gagner par là le sens de la précision des choses. Avoir le souci de l’exactitude. Préférer, comme Samuel Butler, le mensonge à l’imprécision (qui est souvent un mensonge plus grand). Ne pas tricher. Ou tricher en grand. Pour que, au moins, cela se voit.
Il y a bien des mondes dans le monde
Du point de vue de l’homme, deux conditions minima suffisent à faire un monde : le tragique et l’artifice. À l’unicité / simplicité du regard de Plotin, opposons la diversité des regards. Le réel n’est pas monolithique. Il comporte des aspérités, des zones convexes et d’autres concaves, des angles morts : il y a bien des mondes dans le monde. Condamné à l’existence, l’homme est contraint à coller au plus près à sa propre présence. Il revient à chacun d’avoir un monde, de trouver ou de construire (son) monde. « Ne faire qu’un avec sa propre course. » Mais deux modes de présence au monde sont possibles, et ils sont contradictoires. La nausée est un de ces modes de présence au monde. Mais elle est inconfortable. Elle est même justement le sentiment de l’inconfort de tout ce qui est. À l’inverse, la jubilation est confort total et plein. Elle est le sentiment que tout ce qui est est réjouissant. Le point de vue jubilatoire est que tout, dans le monde, et tout, du monde, est à déguster.
Le dyonisiaque est ici le contraire du romantisme : il se réjouit de ce monde-ci. La nausée et la jubilation ont un point commun : elles concernent le réel, et elles concernent le présent du réel. Finalement, rien de moins névrotique que la nausée ou la jubilation (d’où le fait qu’elles ne sont pas sans risque puisque nous n’aurons garde d’oublier que la névrose protège). Entre les deux – nausée ou jubilation – n’existe que la différence de l’artifice, la posture, la « disposition à ». Tant la nausée que la jubilation relèvent d’une certaine rigueur, à laquelle s’oppose le goût de l’irréel. À l’extrême, le goût de l’irréel mène à la folie. Mais dans sa version douce, c’est une simple névrose. Et donc une protection. En effet, le goût de l’irréel peut-être un petit divertissement domestique qui protège de la paranoïa, vraie folie en tant qu’elle est – comme disait les Grecs – « excès de raison ». Si la folie est une tricherie avec le réel en tant qu’elle est un artifice majeur, fréquentes sont les petites tricheries comme le dédoublement, et le mélange de bonne et de mauvaise conscience qui va avec. Autrement dit, fréquente est la fausse conscience. Celle qui consiste à tricher en petit. Quitte à tricher, il faut tricher en grand. Facile à dire certes.
Précisons alors : qu’est-ce que la fausse conscience ? La fausse conscience est la conscience dédoublée. C’est celle du bourreau qui dit : « Achevons-le vite. Je déteste voir souffrir ». S’accommoder du monde, c’est aussi s’accommoder d’être toujours moins « moral » qu’on ne le souhaiterait. Mais aussi, c’est être ce que l’on est; c’est pour l’homme accepter d’être comme l’animal en un sens et ne pas être comme l’animal en un autre sens. De fait, ce n’est pas en tant qu’il raisonne, en tant qu’il a des stratégies (de chasse, de conquête, de séduction…), en tant qu’il est prédateur mais aussi altruiste, en tant qu’il est pudique, ce n’est pas en ce sens que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il est un être d’excès que l’homme se distingue de l’animal. C’est en tant qu’il recherche l’ivresse, en tant qu’il est un être de pathos, en tant qu’il ne se contente pas du présent, en tant qu’il est lubrique, pervers, et parfois même zoophile que l’homme se distingue de l’animal. Au fond, en tant qu’il est animal, l’homme est rassurant, réaliste, prévisible. C’est en tant qu’il n’est pas seulement animal que l’homme cherche à s’évader hors du réel. Que l’homme est inquiétant. L’animalité de l’homme (ce qu’il en subsiste), c’est au contraire sa garantie de ne pas décoller complètement du réel.
Une autre digression hors du réel est l’excès de bons sentiments : un excès parmi d’autres, comme l’abus d’alcool, avec lequel il entretient d’ailleurs quelque parenté. « Frémir de bons sentiments, c’est (la même chose) que bouillir de rage » rappelle Clément Rosset. On sait que la seule morale repérable selon Kant est celle de la bonne volonté. C’est le contraire d’une morale des moyens. Les conséquences des actes sont en effet susceptibles d’interprétations diverses : on peut massacrer allègrement afin d’éliminer le méchant adversaire et donc toute source de conflit futur. En d’autres termes, on peut massacrer par pacifisme foncier. C’est une histoire de ce genre que relate le film Bulletin spécial : un groupe de savants menace de faire sauter la planète… si le Pentagone ne renonce pas à ses essais nucléaires (11).
D’une manière générale, le souci de l’avenir est généralement meurtrier. Pour assurer aux Allemands une paix de mille ans, Hitler a estimé plus prudent d’éliminer le danger slave et de chercher à dominer le monde. Un principe de précaution en quelque sorte. Bilan : une atroce guerre mondiale. Avec l’Allemagne parmi ses principales victimes. Pour assurer la construction du socialisme dans des conditions paisibles, Staline a estimé « raisonnable » de liquider les restes de la bourgeoisie russe. Bilan : la déportation de masse et l’échec économique. Moins de riches sans doute, mais des pauvres encore plus pauvres. En résumé, trop de sollicitude amène souvent à de copieux massacres – et au moins à de sinistres gâchis.
Mettre les passions au régime
C’est ainsi qu’il faut aborder la question des passions. Trop souvent l’amour est considéré comme la passion-type. Nous verrons qu’il n’en est rien. L’avarice, la haine, la tyrannie domestique, l’ambition, le goût de la collection sont des passions bien plus assurées. La passion est une souffrance : c’est la souffrance d’un objet qui fait défaut. « Ma faim qui d’aucuns fruits ici ne se régale » écrit Mallarmé (12). La passion en ce sens est proche de l’hystérie : elle entretient le malheur du manque. Mais l’hystérie s’acharne sur le réel, elle lui en veut, mais elle l’affirme, quitte à l’affirmer déformé. C’est le distort de Binswanger comme forme manquée de la présence au monde. L’hystérie entretient ainsi quelque lien avec la paranoïa. La passion, par contre, tend à ignorer le réel qui, bien évidemment, se dérobe. Elle entretient ainsi quelque lien avec la mélancolie, qui peut lui succéder – la passion étant, bien sûr, toujours déçue. La passion est ainsi une façon de tenter de fuir le réel.
S’accommoder du réel, c’est ne pas vouloir un autre réel absolument meilleur, donc absolument autre, ce qui aboutit inexorablement à dévaloriser le réel d’ici et de maintenant. S’accommoder du réel c’est aussi accorder sa place à l’artifice. Reconnaître l’artifice, c’est reconnaître un lien « naturel » entre l’homme et celui-ci. L’artifice doit servir à l’homme à introduire une distance artificielle entre lui et lui. C’est Lucrèce qui propose comme remède à la douleur d’être homme la mise à distance par rapport à la vision de notre propre finitude, de notre propre mort, et donc la mise en œuvre d’une certaine dose d’inconscience et d’auto-amnistie (oubli) de ce que nous savons (13).
Il nous faut prendre acte de ce qu’il y a une aisance naturelle de l’homme dans l’artifice. Il n’y a pas une intériorité de l’homme qui s’opposerait à une extériorité socialement exposée. (Dans le bla-bla moderne, l’intériorité de l’homme est souvent appelé spiritualité). L’homme est tout de surface c’est-à-dire tout d’exposition – ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas de profondeur. En effet, le moi, c’est la faculté de se souvenir. Or, il n’y a pas de moi autre que le moi social car ce dont on se souvient c’est de soi parmi les autres, c’est d’émotions dont les autres sont partie prenante. Un moi non social ne peut pas être un moi réel. L’identité personnelle est sociale ou n’est pas. Bien connaître quelqu’un c’est bien connaître son comportement, le rôle qui est le sien, et l’interprétation qu’il a choisit de celui-ci. C’est connaître ce qu’il donne à voir. L’homme qui se connaît a renoncé, comme Don Quichotte, aux illusions de l’individualité.
A contrario, quand le moi social n’existe plus, que se passe-t-il ? Un sentiment de légèreté s’installe, le stress social disparaît – car le stress est le contraire du vide. Reste donc le vide. Ce qui s’installe est un sentiment qui caractérise la psychose mélancolique, remarque Clément Rosset (14). Ce qui est perdu dans cette psychose, c’est ce qui existait de façon certaine : l’identité sociale. Si l’identité sociale est la seule attestée, c’est que s’exposer aux autres est non seulement la seule façon d’exister mais aussi la seule façon de se connaître. Les renseignements que l’on possède sur soi même, on les a au travers du miroir que sont les autres. Ce sont des renseignements de seconde main. Peut-être. Mais ce sont les seuls fiables. À l’illusion du « libre-arbitre » qui permettrait le « maintien de soi » (Paul Ricoeur), on peut préférer, comme plus réelle, la constatation que c’est le sentiment (si possible joyeux) du lien social qui garantit au mieux l’identité personnelle.
Si on accepte l’autosuffisance du tragique et de l’artifice pour faire un monde, on doit logiquement se désintéresser des causes premières tout comme des fins ultimes. On se retrouve logiquement hors d’un mouvement qui, remplaçant la religion par le rationalisme, a accru le champ de l’explicabilité du monde. Loin d’être opposés, la religion et le rationalisme ont partie liée dans la mesure où « la superstition demande des causes » (C. Rosset), tandis que la vraie raison se contente de constater que nombre de choses sont sans causes, ou bien relèvent d’une « anti-cause » comme le hasard.
Reconnaître le caractère hasardeux du monde, son caractère indéterminé, c’est considérer le hasard comme la négation même de tout destin, de toute contingence, de toute nécessité. La nature s’oppose ainsi au hasard dans la mesure où elle est constituée, déjà-là, non hasardeuse. Ainsi, l’idée de nature suppose des interventions, pas forcément humaines, tandis que le hasard postule la vanité même de toute intervention. La « nature » est ainsi l’anti-hasard. Non qu’il n’y ait de hasards dans la nature. Mais s’il y a des hasards, il s’agit de hasards contingents, de marges d’indétermination qui concernent des lois, des processus repérables et repérés. Le hasard contingent s’oppose ainsi au hasard « pur », que l’on pourrait appeler hasard purement hasardeux, et qui est le hasard constituant, désignant la nature même de la présence de toute chose au monde, et de la présence du monde, un hasard originel en amont de tous les hasards contingents, et au fond un hasard antérieur à la constitution même de toute « origine ». L’idée de hasard, même quand elle est appelée fors par Lucrèce, est en ce sens le contraire de l’idée de nature.
Aussi, la seule « nature », pour Rosset, c’est la mort. C’est-à-dire que la seule constante, la seule détermination purement assurée, c’est la mort. Parce que, au fond, la seule chose pas du tout hasardeuse c’est la mort. Conclusion de Rosset : ce qui existe, ce qui existe vraiment, ne peut être appelé que « la mort ». La vie n’en est qu’un dérivé. Rosset défend ainsi un point de vue qui – on le remarquera – pourrait facilement être inversé. L’aurait-il choisi… par pur hasard ? Nous le croirions si la psychologie la plus élémentaire ne nous indiquait qu’il n’y a pas de hasard dans son affirmation. Ou plus précisément qu’il y a dans cette affirmation de Rosset pas autre chose qu’un hasard constituant. Celui de sa vision du monde.
Une vision du monde tragique
En conséquence de cette vision du monde tragique, l’homme est perpétuellement en état de perdition. De perdition et non de perte car il ne peut rien avoir perdu, n’ayant jamais rien possédé. La perdition, ou angoisse, ou nausée, ou mélancolie, tous ces états sont, non des synonymes, mais des approches convergentes de la condition de l’homme. Mais les nuances ne sont pas minces. Si on a en vue la perdition, on est dans le registre de la pensée tragique. Si on a en vue la perte, on est dans le registre d’une pensée pessimiste, soit fondamentalement dans une pensée historique, mélancolique si l’on veut, mais historique. La perte est en effet quelque chose d’identifiable, qui renvoie à la nature des choses (qui postule la croyance en une « nature »), et non à un hasard primordial. La mort est ainsi une perte.
La perception des choses est toute différente dans la pensée tragique. La vie elle-même y est perdition. La pensée tragique n’est pas désespérée, elle est désespérante. C’est plus grave, mais c’est aussi un principe plus « actif ». Actif dans le registre corrosif. Quand Rosset définit (paradoxalement) la vie comme étant la mort, cela veut dire qu’elle est mouvement même vers la mort (c’est un point de vue qu’avait exprimé par exemple Pierre Drieu La Rochelle). La vie est mort en tant qu’elle se consume. Mais là encore, le point de vue final n’est-il pas inversable ? À savoir que la mort est preuve même de la vie et que seule la vie est réelle ? Puisque le hasard, et donc l’arbitraire est possible, puisqu’ils sont même la seule chose possible, pourquoi ne pas défendre l’idée que la mort n’est qu’une parenthèse dans la vie, que toute vie concourt à la poursuite de la vie, c’est-à-dire poursuite d’elle-même, le conatus de persister en soi qu’évoque Spinoza, que la vie est un grand flux, que le mouvement du vivant est le mouvement même de tout ce qui est ? « On ne meurt pas puisqu’il y a les autres » disait Aragon. Position d’ailleurs tragique, elle aussi, voire la plus « tragique », car, au fond, quoi de plus désespérant qu’un mouvement que rien ne pourra jamais arrêter ?
Que tout soit « vie » ou que tout soit « mort », l’absence de croyance en la « nature » et en ses « lois » a pour corollaire le scepticisme vis-à-vis de la notion de « l’être ». Cette notion apparaît pour Rosset un nouvel avatar de la théorie du « monde-reflet ». Rosset rejette cette notion car si le monde est monde de l’être, il est monotone – et en ce sens il est déjà mort, car l’être, par définition, ne survient jamais, il est toujours déjà-là. À l’inverse, si le monde d’ici est le monde du non-être, il se passe au moins quelque chose par la représentation tragique du rien. Il est ainsi légitime d’opposer un monde de l’être, dans lequel on s’ennuie, et un monde du non-être dans lequel l’artifice peut avoir sa place. Avec le non-être, il y a place (au moins) pour le théâtre. Choix délibérément factice de Rosset (mais nous avons vu la légitimité, voire la « naturalité », du point de vue de l’homme, de cette facticité/artificialité. La nature de l’homme est sa culture).
Si l’artifice est ce qui rend le monde supportable, chacun l’accommode à sa façon. Accepter le monde, c’est accepter la différence des autres, tous singuliers puisqu’il n’y a pas de nature donc pas de nature humaine. Si la nature de l’homme c’est sa culture donc c’est l’artifice. L’homme est mû par le besoin de reconnaissance. Mais la reconnaissance de soi par soi se heurte à la difficulté de saisir ce qui est dans une extrême proximité. La reconnaissance de soi passe par la reconnaissance des autres par soi et de soi par les autres. Il apparaît alors que c’est en tant qu’ils sont ressemblants que les autres sont dérangeants pour l’identité. De là se pose la question des conditions de la tolérance. Cette question ne se pose pas principalement pour des raisons morales. Elle se pose pour des raisons de confort. Un monde sans tolérance est en effet invivable : pour soi et pour les autres. Et on tolère tout simplement ce qui ne dérange pas trop.
Les philosophies qui ne se contentent pas du réel sont portées à l’intolérance. Au nom d’un mieux-être, au nom d’un devenir « plus et mieux », au nom de l’idée de la perfectibilité infinie du monde et des sociétés humaines, il est normal d’être excédé par les imperfections, les résistances au changement, les effets imprévus de décisions pourtant bien inspirées (hétérotélie). L’optimisme tend naturellement à être intolérant – et impatient – envers ce qui paraît le contredire. La pensée tragique est au contraire la condition nécessaire à la tolérance. Seule une indifférence aux « essences » du monde permet de ne pas faire un drame des différences, des marginalités, des dissidences. Seule une conception qui ne déifie rien dans le monde, et surtout pas l’homme ni l’avenir de l’homme, peut être tolérante car justement cette conception ne demande pas trop à l’homme.
Toutes les pensées qui mettent l’homme dans un rapport privilégié avec Dieu, de ressemblance avec et/ou de rédemption par, toutes ces pensées tendent à être intolérantes. Des nuances existent certes. Ainsi, le christianisme peut renoncer à la conversion de certains hommes en qui il ne voit pas des semblables. « Maigre tolérance, dira-t-on, qui n’a pas empêché un certain nombre des ces “ hommes ” sans “ nature ” de périr dans les flammes et la langue arrachée. Sans doute : mais c’est paradoxalement une insouciance, plus qu’une intolérance, à l’égard de ces hommes qui rend possibles de telles pratiques. Tuer un “ homme ” qui, malgré toutes les bienveillantes sollicitations dont il a été l’objet, refuse de reconnaître en lui une nature divine, c’est attenter à aucune nature, tuer rien; bien de la bonté, en un sens, qu’on en ait tant fait pour lui (15). » En effet, c’est du libéralisme, de l’ouverture d’esprit que de savoir reconnaître en l’autre un étranger. « Ce que le chrétien exterminait dans l’autodafé, c’était rien; ce qu’un idéologue moderne traduit en son tribunal, c’est l’autre – soit un semblable rétif, mais semblable tout de même, en vertu de l’idée de nature (idem). » En définitive, c’était par ouverture d’esprit que les chrétiens finissaient par exterminer des gens qui, en résistant à la conversion, avaient décidément prouvé leur étrangeté. Et en d’autres termes, l’intolérance moderne est d’autant plus forte qu’elle admet, et même qu’elle veut que l’autre soit semblable. Il est alors inexcusable de ne pas être… pareil. L’« ouverture d’esprit » qui veut que les étrangers puissent devenir comme nous c’est justement cela l’intolérance.
Nous voyons que la cohérence de la pensée de Rosset est forte : matérialisme, regard sans illusion, et sans arrière-monde, acceptation de l’artifice. Les choses sont toutes là, et même déjà-là, présentes, offertes au regard, à la surface du monde et non moins profondes pour autant. Le monde est donné mais insaisissable, sans nature mais inchangeable, inchangeable mais toujours mouvant. Invivable à beaucoup de points de vue, mais de toute façon déjà-mort. Cette vision serait désespérante si elle n’était pas d’emblée désespérée. C’est une vision qui relativise la portée du libre arbitre. Il y a, bien plus qu’un libre arbitre, des compromis entre soi et le monde, entre soi et la maladie (16).
On peut imaginer que Rosset aimerait à se résumer par la phrase suivante : « Je dis les choses comme elles sont ». Mais cela ne serait pas tout dire. Rosset voit les choses noires. Il les voit très exactement comme Louis-Ferdinand Céline : « Dans l’histoire des temps, la vie n’est qu’une ivresse, la vérité c’est la mort (Semmelweis) ». Céline écrivait encore : « L’heure trop triste vient toujours où le Bonheur, cette confiance absurde et superbe dans la vie, fait place à la Vérité dans le coeur humain. Parmi tous nos frères, n’est-ce point notre rôle de regarder en face cette terrible Vérité, le plus utilement, le plus sagement ? Et c’est peut-être cette calme intimité avec leur plus grand secret que l’orgueil des hommes nous pardonne le moins (idem) ». À l’origine de la philosophie de Rosset, il y a cette vision de Louis-Ferdinand Céline, et l’étonnement devant « cette confiance absurde et superbe dans la vie ». Le paradoxe est là : le tragique n’empêche pas la jubilation.
Il y a un mystère du réel puisqu’il est non identifiable, un mystère sans doute proche du mystère de l’allégresse, de la joie, de la félicité sans cause. En tout cas sans autre cause que la coïncidence avec le réel. Car l’allégresse n’est pas seulement un état, une « humeur », c’est un savoir du réel et sur le réel, comme l’est aussi l’ennui, la tristesse, l’acédie, le spleen de Baudelaire. L’amour, parfois mis au dessus de tout, est (et n’est qu’) une allégresse conditionnée. Rosset écrit : « L’amour n’est rien d’autre – rien de plus – qu’un peu de joie s’étant déposé, par hasard, sur un objet quelconque (17) ». C’est pourquoi l’amour est un savoir inférieur à l’allégresse, plus fréquent, plus historique et moins réel.
Il reste enfin à savoir la chose suivante. Si la jubilation possible n’est que temporaire, si, de la vie il ne faut pas trop attendre, une autre chose est sûre : de « ce qui n’est pas la vie » il ne faut rien attendre du tout.
Pierre Le Vigan http://www.europemaxima.com/
Notes
1 : Clément Rosset, Le monde et ses remèdes, P.U.F., 1964 et 2000.
2 : Clément Rosset, Le réel et son double. Essai sur l’illusion, Gallimard, 1984.
3 : Idem, p. 83.
4 : Clément Rosset, Impressions fugitives. L’ombre, le reflet, l’écho, Minuit, 2004.
5 : Maurice Ravel, Trois chansons pour cœur mixte sans accompagnement, 1914-15.
6 : Tanizaki Junichirö, Éloge de l’ombre, Publications orientalistes de France, 1977, 1re éd. 1933
7 : Platon, La République, livre IX.
8 : Clément Rosset, Le principe de cruauté, Minuit, 1988.
9 : Teilhard de Chardin, « La grande monade », dans Propos sur le bonheur.
10 : Céline, Nord.
11 : Clément Rossel, Le principe de cruauté, Minuit, 1988, p. 80.
12 : Mallarmé, Poésies.
13 : Clément Rosset, Le régime des passions et autres textes, Minuit, 2001.
14 : Clément Rosset, Loin de moi. Étude sur l’identité, Minuit, 1999, p. 72.
15 : Clément Rosset, Logique du pire. Éléments pour une philosophie tragique, P.U.F., 1971 et 1993.
16 : Clément Rosset, Route de nuit. Épisodes cliniques. L’infini, Gallimard, 1999.
17 : Clément Rosset, L’objet singulier, Minuit, 1995, p. 105.
• Texte paru en partie dans Éléments, n° 106, septembre 2002, et remanié pour Europe Maxima. -
Regards nouveaux sur Nietzsche
« Le renversement de Nietzsche, loin de renverser la réversion, revient donc en fait avant la réversibilité, et réinstalle le monde sur un mode héraclitéen, irréversible, fermement tenu dans un Logos. […] Et la transmutation des valeurs, demandant des capacités contradictoires capables de cohabiter sans se détruire, instaure une "multiplicité formidable" dans laquelle hiérarchie et distance sont nécessaires afin que le Tout soit du tout différent que du chaos pur. Voilà pourquoi seul celui qui croît comme un arbre, "non pas à un seul endroit, mais partout", celui seul qui perçoit "l'effet des mots rayonnnants à droite, à gauche et sur l'ensemble", seul celui qui peut être à la fois "philosophe, rhinocéros, ours des cavernes, fantôme", peut déceler ce qu'a d'inconvenant "l'homme abstrait, plante séparée du sol", et sentir l'importance du perspectivisme : "C'est le côté perspectif qui donne le caractère de l'apparence". […] Si donc chez Nietsche, l'apparence n'a de sens que dans son couple bien tenu (et dans la maximum d'opposition) avec la vérité, si la méchanceté n'a de sens que par la plus grande ble simple que dans son travail avec l'extrême complexe, et le Tout que par le plus infime détail — alors le concept de la Sophistique est bien aussi le sens non universel, mais commun, de la multiplicioté. […] Effet du renversement : en croyant renverser la racine de l'idéalisme, Nietzsche a redécouvert une pensée très ancienne de la multiplicité commune […]. » A. Villani, La Sophistique grecque et le renversement nietzschéen du platonisme, in : Les Études Philosophiques n°3/1995, PUF.
Il y a cent ans paraissait l'ouvrage le plus célèbre de Nietzsche, celui qui sera le plus lu et que toute personne moyennement cultivée citera ou évoquera spontanément : Ainsi parlait Zarathoustra. On sait d'emblée que le philosophe allemand a une réputation qui sent le soufre, que ses vigoureuses tirades anti-chrétiennes risquent de faire chavirer toutes les certitudes, que son rejet, qualifié d'aristocratique, de toute espèce de moralisme, fait de sa pensée une gâterie, une ivresse, une drogue pour un très petit nombre. Tous les fantasmes sont permis quand il est question de Nietzsche ; chacun semble avoir son petit Nietzsche-à-soi, chacun tire de l'itinéraire du philosophe de Sils-Maria une opinion chérie qu'il exhibera comme un badge coloré, avec la certitude coquine de choquer quelques bien-pensants. Et, en effet, en cent ans, on a dit tout et n'importe quoi à propos de Nietzsche, tout et le contraire de tout.Cet amateurisme et ce désordre, cette absence de professionnalisme et ce subjectivisme facile, qu'a subis l'œuvre de Nietzsche au cours du siècle écoulé, ont été désastreux : rien n'a pu être construit au départ de Nietzsche ; il reste de son travail pionnier que des critiques fulgurantes et féroces, des déconstructions et des destructions ; il reste l'âcre fumée qu'une horde de pillards laisse derrière elle. Cent après la parution du Zarathoustra, il est donc temps de dresser un bilan philosophique du nietzschéisme, de désigner, dans l'œuvre qu'il nous laisse, les matériaux d'une reconstruction, les matériaux qui serviront à construire un nouveau temple pour la pensée voire qui inspireront les bâtisseurs de cités nouvelles, puisque la faillite des idéologies dominantes, assises sur les "anciennes tables de la loi" postule de repenser et de reconstruire le politique sur d'autres fondements.
Ici, il ne sera pas question de dire définitivement ce qu'il convient de penser à la suite de Nietzsche, ni de donner une fois pour toutes la clef de l'énigme nietzschéenne. Modestement, il s'agira de donner un fil conducteur pour comprendre globalement la signification du message nietzschéen et de voir clair dans le réseau des interprétations philosophiques contemporaines de ce même message. Dans ce réseau, il s'agira de débusquer les interprétations abusives, stérilement subjectivistes bien qu'intellectuellement séduisantes, et de mettre en évidence celles qui recèlent des potentialités pour demain.
Cet indispensable travail de tri doit se faire au départ d'une documentation existante, à partir de ce qu'une poignée de chercheurs patients ont découvert. Vu le regain d'intérêt pour l'œuvre de Nietzsche, vu l'accumulation des travaux universitaires consacrés à sa philosophie, l'on devra, pour cette démarche, poser un choix dans l'abondante littérature qui est à notre disposition. Notre étude sera donc partielle, non exhaustive ; son ambition est d'amorcer une classification des nietzschéismes dans le but précis de rendre la philosophie nietzschéenne constructive. De ne pas l'abandonner à son stade premier, celui de l'hypercriticisme, dont nous ne nierons pas, pourtant, l'impérieuse nécessité.
Un soupçon idéologique
Le premier écueil que rencontre actuellement le nietzschéisme, dans le "grand public" (pour autant que cette expression ait un sens dans le domaine de la philosophie), c'est un soupçon d'ordre politico-idéologique. En effet, le nietzschéisme, pour l'intelligence qui se qualifie de "progressiste", est un système de pensée qui conduit à l'avènement du fascisme ou du national-socialisme. Très récemment encore (en juin 1981), Rudolf Augstein, l'éditeur de l'hebdomadaire ouest-allemand Der Spiegel, dans un article à sa mode, c'est-à-dire à l'emporte-pièce, déclarait sans ambages que si Nietzsche était le penseur, alors Hitler était l'homme d'action qui mettait cette pensée en pratique (Denker Nietzsche-Täter Hitler). Le journaliste en voulait pour preuve les falsifications de certains des manuscrits de Nietzsche par sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche qui, un jour, au soir de sa vie, avait été serré la pince du Führer ! On avouera qu'au regard de la masse de manuscrits laissés par Nietzsche et de la quantité de livres publiés avant sa folie et que la sœur zélée n'a jamais pu modifier, l'argument est un peu mince. Augstein s'inquiétait tout simplement du retour à Nietzsche qu'opère une jeune génération de philosophes allemands et de l'abondon progressif mais sensible du corpus doctrinal de l'École de Francfort de Horkheimer et Adorno, dont la faillite se constate par le désorientement d'Habermas, celui qui gérait l'héritage des "francfortistes".
Pour les Allemands éduqués dans le sillage de la dénazification, les "francfortistes" représentent en effet une caste de gourous infaillibles, intangibles, un aréopage de grands prêtres dont il serait impie de mettre les paroles (souvent sybillines) en doute. Pourtant les faits sont là : le "francfortisme" a lassé ; son refus permanent de toute affirmation, de toute pensée qui affirme, joyeusement ou puissamment, tel ou tel fait, de toute philosophie qui dit le beau et pose la créativité comme hiérarchiquement supérieure à la critique ou à la négation, n'a mené qu'à l'impasse. On est bien forcé d'admettre que la négativité ne saurait être un but en soi, qu'on ne peut régresser à l'infini dans le processus permanent de négation. Pour Habermas, bien situé dans l'aire philosophique du francfortisme, le "réel", tel qu'il est, est mauvais, dans le sens où il ne contient pas d'emblée tout le "bon" ou tout le "bien" existant dans l'idée.
Devant ce réel imparfait, il convient de maximiser le bon, de moraliser à outrance afin de minimiser les charges de mal incrustées dans ce réel marqué d'incomplétude. Ainsi, la réalité imparfaite appelle la révolution salvatrice ; mais cette révolution risque d'affirmer un autre réel, de déterminer un réel également imparfait (tantôt moins imparfait tantôt plus imparfait). Donc Habermas rejette les grandes révolutions globales, initiatrices d'ères nouvelles affirmatives, pour leur préférer les micro-révolutions parcellaires et sectorielles qui inaugurent ipso facto un âge de corrections permamentes, d'injections à petites doses de "bien" dans le tissu socio-politique inévitablement marqué du sceau du "mal". Mais le monde de la philosophie ne pouvait indéfiniment se contenter de ce bricolage constant, de cette morne réduction à un réformisme sans envergure, à cette socio-technologie (social engeneering) sans épaisseur.
Devant le soupçon de nazisme qui pèse en permanence sur le nietzschéisme, devant l'impossibilité de maintenir la philosophie au niveau d'une négation permanente et de maintenir la mouvance kaléidoscopique du réel sous la férule de ces micro-révolutions qui, finalement, ne résolvent rien, il faut renvoyer dos à dos les thèses qui posent comme incontournable le "pré-nazisme" du nietzschéisme, rejetter le mirage de la négativité permanente et s'interroger sur l'avènement d'un ordre global, d'un consensus généralisé, qui puisse englober et sublimer les multiples et diverses affirmations qui fusent en permanence depuis le tissu épais du social et du politique, tissu déposé par les vicissitudes historiques.
Nietzsche et la pensée de gauche en Allemagne, au début du siècle
Le nietzschéisme a certes connu des interprétations nazies ; des philosophes plus ou moins impliqués dans l'aventure nazie ont fait référence à Nietzsche. Inutile de nier ou de minimiser ces faits, surtout pour prendre expressément le contre-pied de la démonstration d'Augstein. Mais, en dépit d'Augstein et de ses bricolages idéologiques favoris, en dépit de la bigoterie francfortiste qui afflige l'Allemagne de ces deux ou trois dernières décennies, en dépit de l'hiérocratie fondée en RFA par le Saint-Pierre du francfortisme, Horkheimer, Nietzsche, nous le savons désormais grâce à de nouvelles recherches historiques, n'a pas seulement préparé les munitions idéologiques de l'hitlérisme, il a aussi influencé considérablement le socialisme de son époque. Une étude du Professeur britannique R. Hinton Thomas, de l'Université de Warwick, nous illustre avec brio ce télescopage, cette cross-fertilization entre nietzschéisme et socialisme, entre le nietzschéisme et une pensée contestatrice classée à "gauche". Son livre Nietzsche in German politics and society, 1890-1918 [Manchester University Press, 1983, 146 p.] nous informe de l'impact de Nietzsche dans la pensée qui animait les cercles sociaux-démocrates de l'Allemagne impériale à la Belle Époque, de même que dans les milieux anarchistes et féministes et dans le mouvement de jeunesse qui a produit, en fin de compte, davantage d'ennemis résolus du Troisième Reich que de cadres de la NSDAP. Contrairement aux affirmations désormais "classiques" des progressistes, R. Hinton Thomas démontre que l'influence de Nietzsche ne s'est pas du tout limitée aux cercles de droite, aux cénacles conservateurs ou militaristes mais que toute une idéologie libertaire, dans le sillage de la social-démocratie allemande, s'est mise à l'école de sa pensée. Le professeur britannique nous rappelle les grandes étapes de l'histoire du socialisme allemand : en 1875, sous l'impulsion d'August Bebel, les socialistes adoptent le programme dit de Gotha, qui prétendait réaliser ses objectifs dans le cadre strict de la légalité. En 1878, le pouvoir impose les lois anti-socialistes qui freinent les activités du mouvement. En 1890, avec le programme d'Erfurt, les socialistes choisissent un ton plus dur, conforme à l'idéologie marxiste.
Par la suite, la sociale-démocratie oscillera entre le légalisme strict, devenu "révisionnisme" ou "réformisme" parce qu'il acceptait la société capitaliste / libérale, ne souhaitait que la modifier sans bouleversement majeur, et le révolutionnisme, partisan d'un chambardement généralisé par le biais de la violence révolutionnaire. Cette seconde tendance demeurera minoritaire. Mais c'est elle, rappelle R. Hinton Thomas, qui puisera dans le message nietzschéen.
Une fraction du parti, sous la direction de Bruno Wille, critiquera avec véhémence l'impuissance du réformisme social-démocrate et se donnera le nom de Die Jungen (Les Jeunes). Ce groupe évoquera la démocratie de base, parlera de consultation générale au sein du parti et, vu l'échec de sa démarche, finira par rejeter la forme d'organisation rigide que connaissait la social-démocratie. Wille et ses amis brocarderont le conformisme stérile des fonctionnaires du parti, petits et grands, et désigneront à la moquerie du public la "cage" que constitue la SPD. Le corset étouffant du parti dompte les volontés, disent-ils, et empêche toute manifestation créatrice de celles-ci. L'accent est mis sur le volontarisme, sur les aspects volontaristes que devrait revêtir le socialisme. Ipso facto, cette insistance sur la volonté entre en contradiction avec le déterminisme matérialiste du marxisme, considéré désormais comme un système "esclavagiste" (Knechtschaft).
Kurt Eisner, écrivain et futur Président de la République rouge de Bavière (1919), consacrera son premier livre à la philosophie de Nietzsche (1). Il critiquera la « mégalomanie et l'égocentrisme » de l'auteur d'Ainsi parlait Zarathoustra mais retiendra son idéal aristocratique. L'aristocratisme qu'enseigne Nietzsche, dit Eisner, doit être mis au service du peuple et ne pas être simplement un but en soi. Cet aristocratisme des chefs ouvriers, combiné à une conscience socialiste, permettra d'aristocratiser les masses.
Gustav Landauer (1870-1919), créateur d'un anarchisme nietzschéen avant de devenir, lui aussi, l'un des animateurs principaux de la République Rouge de Bavière en 1919, insistera sur le volontarisme de Nietzsche comme source d'inspiration fructueuse pour les militants politiques. Son individualisme anarchiste initial deviendra, au cours de son itinéraire politique, un personnalisme communautaire populiste, curieusement proche, du moins dans le vocabulaire, des théories völkisch-nationalistes de ses ennemis politiques. Pour ce mélange de socialisme très vaguement marxisant, d'idéologie völkisch-communautaire et de thèmes anarchisants et personnalistes (où le peuple est vu comme une personne), Landauer mourera, les armes à la main, dans les rues de Munich qu'enlevaient, une à une, les soldats des Corps Francs, classés à "l'extrême-droite".
Contrairement à une croyance tenace, aujourd'hui largement répandue, les droites et le conservatisme se méfiaient fortement du nietzschéisme à la fin du siècle dernier et au début de ce XXe. R. Hinton Thomas s'est montré attentif à ce phénomène. Il a repéré le motif essentiel de cette méfiance : Nietzsche ne s'affirme pas allemand (ce qui irrite les pangermanistes), méprise l'action politique, ne s'enthousiasme pas pour le nationalisme et ses mythes et se montre particulièrement acerbe à l'égard de Wagner, prophète et idole des nationalistes. Si, aujourd'hui, l'on classe abruptement Nietzsche parmi les penseurs de l'idéologie de droite ou des fascismes, cela ne correspond qu'à un classement hâtif et partiel, négligeant une appréciable quantité de sources.
Six stratégies interprétatives de Nietzsche
Outre l'aspect politique de Nietzsche, outre les éléments de sa pensée qui peuvent, en bon nombre de circonstances, être politisés, le philosophe Reinhard Löw distingue six stratégies interprétatives de l'œuvre nietzschéenne dans son livre Nietzsche, Sophist und Erzieher : Philosophische Untersuchungen zum systematischen Ort von Friedrich Nietzsches Denken [Acta Humaniora der Verlag Chemie GmbH, Weinheim, 1984, XII+222 p.]. Pour Löw, la philosophie de Nietzsche présente une masse, assez impressionnante, de contradictions (Wiedersprüche). La première stratégie interprétative, écrit Löw, est de dire que les contradictions, présentes dans l'œuvre de Nietzsche, révèlent une pensée inconséquente, sans sérieux, sans concentration, produit d'une folie qui se développe sournoisement, dès 1881. La seconde série d'interprétations se base sur une philologie exacte du discours nietzschéen. Dire, comme Ernst Bertram, l'un de ses premiers exégètes, que Nietzsche est fondamentalement ambigu, contradictoire, procède d'une insuffisante analyse du contenu précis des termes, vocables et expressions utilisées par Nietzsche pour exprimer sa pensée (cf. Walter Kaufmann). La troisième batterie d'interprétations affirme que les contradictions de Nietzsche sont dues à leur succession chronologique : 3, 4 ou 5 phases se seraient succédé, hermétiques les unes par rapport aux autres.
Pour certains interprètes, les phases premières sont capitales et les phases ultimes sont négligeables ; pour d'autres, c'est l'inverse. Ainsi, Heidegger et Baeumler, dans les années 30 et 40, estimeront que c'est dans la phase dernière, dite de la "volonté de puissance", que se situe in toto le "vrai" Nietzsche. Löw estime que cette manière de procéder est insatisfaisante : trop d'interprètes situent plusieurs phases dans un laps de temps trop court, passent outre le fait que Nietzsche n'a jamais cherché à réfuter la moindre de ses affirmations, le moindre de ses aphorismes, même si, en apparence, sa pensée avait changé. Cette méthode est de nature "historique-biographique", pense Löw, et demeure impropre à cerner la teneur philosophique globale de l'œuvre de Nietzsche.
La quatrième stratégie interprétative, elle, prend les contradictions au sérieux. Mais elle les classe en catégories bien séparées : on analyse alors séparément les divers thèmes nietzschéens comme la volonté de puissance, l'éternel retour, la Vie, le surhomme, le perspectivisme, la transvaluation des valeurs (Umwertung aller Werte), etc. Le "système" nietzschéen ressemblerait ainsi à un tas de cailloux empilés le long d'une route. Les liens entre les thèmes sont dès lors perçus comme fortuits. Nietzsche, dans cette optique, n'aurait pas été capable de construire un "système" comme Hegel. Nietzsche ne ferait que suggérer par répétition ; son œuvre serait truffée de "manques", d'insuffisances philosophiques.
Pour Landmann et Müller-Lauter, cette absence de système reflète la modernité : les fragments nietzschéens indiquent que le monde moderne est lui-même fragmenté. Les déchirures de Nietzsche sont ainsi nos propres déchirures. Löw rejette également cette quatrième stratégie car elle laisse supposer que Nietzsche était incapable de se rendre compte des contradictions apparentes qu'il énonçait ; que Nietzsche, même s'il les avait reconnues, n'a pas été capable de les résoudre. Enfin, elle ne retient pas l'hypothèse que Nietzsche voulait réellement que son travail soit tel.
La cinquième stratégie consiste, dit Löw, à prendre le taureau par les cornes. Les contradictions indiqueraient la "méthode de la pensée de Nietzsche". Quand Nietzsche énonçait successivement ses diverses "contradictions", il posait consciemment un "modèle d'antinomie" qui fait que certains énoncés de Nietzsche combattent et contredisent d'autres énoncés de Nietzsche. En conséquence, on peut les examiner de multiples manières, à la mode du psychologue ou de l'historien, du philologue ou du philosophe. Pour Jaspers, ces contradictions mettent tous les systèmes, toutes les métaphysiques et toutes les morales en pièces : elles ouvrent donc la voie à la "philosophie de l'existence", en touchant indirectement à tout ce qui se trouverait au-delà des formes, des lois et du disible.
Pour Gilles Deleuze, l'un des principaux porte-paroles de l'école nietzschéenne française contemporaine, Nietzsche est l'anti-dialecticien par excellence. Ses contradictions ne sont pas l'expression d'un processus rationnel mais expriment un jeu a-rationnel, anarchique qui réduit en poussières toutes les métaphysiques et tous les systèmes. Les textes de Nietzsche ne signifieraient rien, si ce n'est qu'il n'y a rien à signifier. Cette "psychanalyse sauvage" omet, signale Blondel, que Nietzsche voulait constamment quelque chose : c'est-à-dire créer une nouvelle culture, un homme nouveau.
Dans la sphère de l'actuel renouveau nietzschéen en Allemagne Fédérale, Friedrich Kaulbach rejoint quelque peu l'école française (deleuzienne) contemporaine en disant que Nietzsche est un philosophe "expérimental" qui joue avec les perspectives que l'on peut avoir sur le monde. Ces perspectives sont nombreuses, elles dépendent des idiosyncrasies des philosophes. Dès lors, au départ de l'œuvre de Nietzsche, on peut aboutir à des résultats divers, très différents les uns des autres ; résultats qui n'apparaîtront contradictoires qu'au regard d'une logique formelle ; en réalité, ces contradictions ne relèvent que de différences de degrés. Le Philosophe A aboutit à autre chose que le Philosophe B parce que sa perspective varie de x degrés par rapport à l'angle de perception de B. Vu ces différences de perspectives, vu ces divers et différents regards portés à partir de lieux divers et différents, l'homme créant (créateur) garde une pleine souveraineté. Il peut adopter aujourd'hui telle perspective et demain une autre. Son objectif est de construire un monde qui a une signification plus signifiante pour lui. Friedrich Kaulbach, dans son livre (2), Sprachen der ewigen Wiederkunft : Die Denksituation des Philosophen Nietzsche und ihre Sprachstile [Königshausen & Neumann, Würzburg, 1985, 76 p.], distingue, chez Nietzsche, un langage de la puissance plastique, un langage de la critique démasquante, un langage expérimental, une autarcie de la raison perspectiviste, qui, toutes les quatre, doivent, en se combinant de toutes les façons possibles, contribuer à forger un instrument pour dépasser le nihilisme (le fixisme des traditions philosophiques substantialistes) et affirmer le devenir, l'éternel retour du même. Le rôle du maître, dans cette interprétation de Kaulbach, c'est de pouvoir se servir de ce langage nouveau, combinatoire, que l'on peut nommer le langage dyonisiaque.
Mais Löw ne se contente pas de l'interprétation de Kaulbach, même si elle est très séduisante. Et il ne se satisfait pas non plus de la sixième stratégie interprétative : celle qui table sur quelques assertions de Nietzsche, où le philosophe affirme que sa philosophie est une œuvre d'art. Pour Nietzsche, en effet, la beauté était le signe le plus tangible de la puissance parce qu'elle indiquait précisément un domptage des contradictions, un apaisement des tensions. Quand un système philosophique s'effondre, qu'en reste-t-il ? Ses dimensions artistiques, répondait Nietzsche. Le penseur le plus fécond, dans cette perspective du Nietzsche-artiste, doit agir en créateur, comme le sculpteur qui projette sa vision, sa perspective en ouvrageant une matière, en lui donnant forme.
Nietzsche : sophiste et éducateur
Pour Löw, Nietzsche est sophiste ET éducateur. Sa volonté de devenir un éducateur, comme les sophistes, est l'élément déterminant de toute sa démarche philosophique. Ses contradictions, problème sur lequel six écoles d'interprétations se sont penchées (comme nous venons de le voir), constituent, aux yeux de Löw, des obstacles à franchir, à surmonter (überwinden) pour affiner l'instrument éducateur que veut être sa philosophie. Une phrase du Nachlaß apparaît particulièrement importante et féconde à Löw : « Der große Erzieher wie die Natur : er muß Hindernisse thürmen, damit sie überwunden werden » (Le grand éducateur [doit être] comme la nature : il doit empiler des obstacles, afin que ceux-ci soient surmontés).
Le plus grand obstacle est Nietzsche lui-même, avec son style héraclitéien, décrété "obscur" par les premiers critiques de l'œuvre. Pour Nietzsche, le choix d'un style héraclitéien est au contraire ce qu'il y a de plus transparent dans son travail philosophique : il indique un refus de voir ses aphorismes lus par la populace (Pöbel) et par les "partis de toutes sortes". Nietzsche souhaitait n'être ni utile ni agréable… Cette attitude témoigne d'un rejet de tous les "catéchistes", de tous ceux qui veulent penser sans obstacles, de ceux qui veulent cheminer sans aléas, sans impondérables sur une allée soigneusement tracée d'avance. Le monde idéal, supra-sensible, de Platon devient, pour Nietzsche, la caricature de cet univers hypothétique sans obstacles, sans lutte, sans relief. Mais Nietzsche sait que sa critique du platonisme repose sur une caricature, que son image du platonisme n'est sans doute pas tout Platon mais qu'elle vise et cherche à pulvériser les catéchismes platonisants, qui règnent en despotes aux périodes creuses où il n'y a rien de cette immaturité potentiellement créatrice (le monde homérique, la vieille république romaine, l'épopée napoléonienne, la libération de la Grèce à laquelle participa Lord Byron, etc.) ni de cette force pondérée et virile (l'admiration de Nietzsche pour Adalbert Stifter).
L'éducateur Nietzsche crée une paideia [formation] pour tous ceux qui viendront et ne voudront jamais imiter, répéter comme des perroquets, potasser de façon insipide ce que leurs prédécesseurs ont pensé, écrit, dit ou inventé. L'objectif de Nietzsche est donc précis : il faut forger cette paideia de l'avenir qui nous évitera le nihilisme. Nietzsche, aux yeux de Löw, n'est donc pas le fondateur d'une stratégie philosophique omni-destructrice comme il l'est pour Deleuze ni le maître du nouveau langage dyonisiaque qui permet d'adopter successivement diverses perspectives comme pour Kaulbach. Nietzsche est "sophiste" pour Löw, parce qu'il se sert très souvent de la méthode des sophistes, mais il est simultanément un "éducateur", éloigné des préoccupations strictement utilitaires des "sophistes", car il veut que les génies puissent s'exprimer sans être encombrés des étouffoirs de ceux, trop nombreux, qui "pensent" sur le mode de l'imitation.
Le génie est créateur : il fait irruption de manière inattendue en dépit des "discours stupides sur le génie". Nietzsche se donne une responsabilité tout au long de son œuvre : il ne se complait pas dans ses contradictions mais les perçoit comme des épreuves, comme des défis aux "répétitifs". Et si aucune philosophie ne doit se muer en "isme", ne doit servir de prétexte à des adeptes du "psittacisme" savant, celle de Nietzsche, aux yeux mêmes de Nietzsche, ne saurait être stupidement imitée. Nietzsche se pose contre Nietzsche, avertit ses lecteurs contre lui-même (cf. Ainsi parlait Zarathoustra). Löw extrait ainsi Nietzsche de la sphère d'hypercriticisme, poussé parfois jusqu'à l'affirmation joyeuse d'un anarchisme omni-dissolvant, où certaines écoles (dont la deleuzienne) voulaient l'enfermer.
Le recours à la "physiologie"
Löw interprète donc Nietzsche comme un philosophe dans la plus pure tradition philosophique, en dépit d'un langage aphoristique tout à fait en dehors des conventions. Helmut Pfotenhauer, dans un ouvrage concis : Die Kunst als Physiologie, Nietzsches ästhetische Theorie und literarische Produktion [J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1985, 312 p.] aborde, lui, l'héritage légué par Nietzsche sous l'angle de la physiologie. Ce terme, qui a une connotation naturaliste évidente, se trouve dans l'expression nietzschéenne Kunst als Physiologie, l'art comme physiologie. Il faut dès lors s'interroger sur le vocable "physiologie", qui revient si souvent dans les propos de Nietzsche. Honoré de Balzac, le grand écrivain français du XIXe, à qui l'on doit aussi une Physiologie du mariage, disait à propos de ce néologisme d'alors : « La physiologie était autrefois la science exclusivement occupée à nous raconter le mécanisme du coccyx, les progrès du fœtus ou ceux du ver solitaire […] Aujourd'hui, la physiologie est l'art de parler et d'écrire incorrectement de n'importe quoi […] ».
Au XIXe siècle donc, le terme physiologie apparaît pour désigner une certaine littérature populaire, qui n'est pas sans qualités, ou le style "causant" des feuilletons des grands quotidiens. La "physiologie" sert à décrire, avec goût et esprit, les phénomènes de la vie quotidienne, à les classer, à les typer : on trouve ainsi une physiologie du flaneur, de la grisette, de l'honnête femme ou du touriste anglais qui arpente les boulevards parisiens. La physiologie, dans ce sens, doit beaucoup aux sciences naturelles et aux classifications d'un Bouffon ou d'un Linné. Balzac, pour sa Comédie humaine, trace un parallèle entre le monde animal et la société des hommes. On parle même de "zoologie politique"…Baudelaire, E.T.A. Hoffmann, Poe, Flaubert (qui, selon Sainte-Beuve, maniait la plume comme d'autres manient le scalpel) adoptent, à des degrés divers, ce style descriptif, qui enregistre les perceptions sensuelles et leur confère une belle dimension esthétique.
La physiologie offre de nouveaux modèles à la réflexion philosophique, permet de nouvelles spéculations : tous les domaines de la vie sont "historicisés" et relativisés, ce qui jette d'office l'observateur philosophique dans un tourbillon de nouveautés, d'innovations, véritable dynamique affolante où la vitesse rend ivre et où les points de repères fixes s'évanouissent un à un. Nietzsche ne jetait qu'un regard distrait et distant sur ces entreprises littéraires et scientifiques, ainsi que sur toutes ces tentatives de scruter les phénomènes spirituels à la lumière des révélations scientifiques et de les organiser théoriquement. Il se bornait à constater que le style des "physiologistes" envahissait l'université et que le vocabulaire de son époque se truffait de termes issus des sciences naturelles. Devant cette distraction, cet intérêt apparamment minime, une question se pose : pourquoi Nietzsche a-t-il eu recours au vocable "physiologie", qui n'avait rien de précis et avait été souvent utilisé à mauvais escient ?
L'innocence du devenir
Pour Pfotenhauer, Nietzsche n'avait nullement l'intention de valoriser le discours pseudo-scientifique ou pseudo-esthétique des "physiologistes" communs, vulgaires. Il ne cherchait nullement à avaliser leurs contradictions, à accepter leurs incohérences, à partager leurs sensations de plaisir ou de déplaisir. Son intention était, écrit Pfotenhauer, de défier directement l'esthétique établie. L'expression "physiologie de l'art" constitue une contre-façon de "philosophie de l'art", dans la mesure où l'art, selon les critères traditionnels, s'évalue philosophiquement et non physiologiquement. Cette parodie se veut un rejet de toutes les conceptions philosophico-esthétiques des décennies précédentes.
Pour Nietzsche, la productivité artistique devient production et expression de notre phusis. Par l'art, la nature devient plus intensément active en nous. Mais Nietzsche, en utilisant consciemment le terme "physiologie" sait qu'il commet une emphase, une exagération didactique ; il sait qu'il fête avec ivresse la splendide exubérance des forces vitales, tout en boudant le prétention scientifique à vouloir neutraliser les processus vitaux par une stratégie de valorisation des moyennes.
En d'autres termes, cela signifie que Nietzsche rejette et réfute la prétention des sciences à réduire leurs investigations aux moyennes, à l'exclusion du Kunstvoll-Singuläres, du singulier-révélant-une-profusion-d'art. Aux yeux de Nietzsche, le darwinisme privilégie la moyenne au détriment des exceptions, attitude, stratégie, qu'il ne saurait accepter. Dans cette optique non darwiniste, Nietzsche pose la physiologie comme un moyen de personnaliser les grandes questions vitales par le truchement d'un style de pensée et d'écriture unique.
"Dieu est mort", retient-on de Nietzsche, et, avec Dieu, tous les grands systèmes ontologiques, métaphysiques, toutes les philosophies de l'esprit et de l'histoire. Il ne resterait alors que l'innocence du devenir, qu'il ne faudra pas figer dans une quelconque "unité supérieure de l'Être". Mais cette reconnaissance de l'innocence du devenir comporte des risques : dans le fleuve du vivant, dans le flot de mutations qu'il implique, les personnalités, le singulier, l'originalité, les génies créateurs courent le danger de se noyer, de n'être plus que des moments fragmentaires, contingents et négligeables.
Comment peut-on alors, sans garanties de préservation de sens, en étant livré aux rythmes naturels du devenir et de l'écoulement perpétuel, s'accepter joyeusement, dire "oui" à la Vie ? Ne devrait-on pas admettre le bien-fondé de la réponse de Silène au Roi Midas : cette vie terrestre, éphémère, vaut-elle la peine d'être vécue ? N'aurait-il pas mieux valu ne jamais naître ? L'idéal ne serait-il pas de mourir au plus vite ? Nous repérons, dans ces questions que Nietzsche a dû se poser, l'influence de Schopenhauer. La haine à l'endroit de la vie, qui découle de ce pessimisme fondamental, sera jugée très insatisfaisante par Nietzsche. Il en refusera rapidement les conséquences et verra que la nécessité première, à son époque de désorientement spirituel, c'est de réévaluer la vie. Tel est, selon Pfotenhauer, le sens de l'Umwerthung.
Les écrits de Nietzsche, publiés ou rédigés dans les années 1880, sont le reflet de ce désir. La Volonté de Puissance (Wille zur Macht) accomplit cette transvaluation. Elle est à la fois objet de connaissance et attitude du sujet connaissant. Les processus vitaux doivent être perçus sous l'aspect d'une créativité constante. Avec la différentiation, avec l'abondance, avec la transgression de toutes les limites, de tous les conditionnements mutilants, on se moule dans les caractéristiques divines de la Vie et l'on participe immédiatement à leur apothéose. Celui qui nomme, désigne et reconnaît, sans ressentiment d'ordre métaphysique, la créativité du devenir, se mue lui-même en une incarnation de ce devenir, de cette profusion de vitalité. Le devenir doit s'exprimer immédiatement dans toute sa mobilité, sa fluctuance : l'immobiliser, le figer dans une ontologie constitue une mutilation qui coupe simultanément les ailes de toute créativité. Le devenir n'est pas un flot indifférent et improductif : il charrie des étincelles de créativité. Le philosophe de l'éternel retour, lui, donne la parole à la vie divine-créatrice par l'intermédiaire d'images et de courtes mais fulgurantes ébauches philosophiques.
Le philosophe est alors "artiste de grand style" : il représente la force organisante qui fait face au chaos et au déclin. La physiologie, dans le sens philosophique que Nietzsche lui accorde, permet donc de conférer un langage aux processus vitaux, de donner expression aux forces qui agissent en eux. La physiologie permet à Nietzsche d'affronter notre nature humaine. Elle établit l'équilibre entre la phusis et le logos. Elle autorise la découverte d'un langage exprimant les aléas inhérents aux processus vitaux et maintient, en s'interdisant toute "ethnologisation du mythe", une "distance intellectuelle" par rapport au fourmillement de faits contradictoires qui émanent précisément du devenir. Le mythe, chez Nietzsche, en effet, n'a aucune connotation d'ordre ethnologique : il est, écrit Pfotenhauer, "science du concret" et expression de la tragédie qui se joue dans l'homme, être qui, parfois, affronte la tension entre sa fragilité (Hinfälligkeit) physique et son éventuelle souveraineté héroïque. Ce recours au mythe n'a rien d'irrationnel comme aime à l'affirmer la vulgate philosophante dérivée d'une schématisation de la pensée des Lumières.
Affirmer le devenir et créer des valeurs nouvelles
La double stratégie nietzschéenne, celle du recours au mythe, comme science du concret, et celle du recours à la physiologie, comme programme d'investigation du devenir, se situe à l'intersection entre la critique des valeurs, la lutte contre les principes "faux" (c'est-à-dire les principes qui nient la vie et engendrent la décadence) et le contre-mouvement que constitue l'art placé sous le signe de la volonté de puissance. Pour critiquer les valeurs usées et pour, en même temps, affirmer une transvaluation créatrice de valeurs nouvelles, la démarche du physiologiste sera une recherche constante d'indices concrets, une recherche incessante de l'élémentaire qui sous-tend n'importe quelle démarche philosophique. La biologie, l'ethnologie, la mythologie, les explorations des mondes religieux, l'histoire, bref, les domaines les plus divers peuvent concourir à saisir le flot du devenir sans devoir le figer dans des concepts-corsets, trop étroits pour contenir de façon satisfaisante l'ampleur des faits de monde.
L'abondance des lectures de Nietzsche sert précisément à affiner le regard du philosophe, à le rendre plus attentif au monde, moins stérile, sec et sybillin dans ses discours. Beaucoup reprocheront à Nietzsche de n'être resté que dilettante en bon nombre de domaines, de ne pas avoir déployé une systématique satisfaisante. Mais Nietzsche amorce une logique nouvelle, plus plastique, plus en prise avec la diversité du devenir. La philosophie nietzschéenne jette les bases d'une saisie moins timide, plus audacieuse des faits de monde. Le philosophe peut désormais appréhender des faits de monde contradictoires sans buter stérilement devant ces contradictions.
Cette audace de la méthode nietzschéenne a effrayé quelques lecteurs. Parmi eux : l'écrivain Thomas Mann. L'inclusion d'éléments venus de toutes sortes de disciplines nouvelles dans le discours philosophique, notamment issus de la mythologie et de l'ethnologie, a fait croire à une volonté de retourner à des origines préhistoriques, non marquées par l'esprit et l'intellect. Pour Thomas Mann, les interprétations de Ludwig Klages, auteur de Der Geist als Widersacher der Seele (L'esprit comme ennemi de l'âme), et d'Alfred Bäumler, le spécialiste de Bachofen qui donna corps à la théorie du matriarcat, constituent des reculs inquiétants, des marches arrières vers l'univers trouble des instincts non dominés.
L'attitude de T. Mann témoigne de la grande peur des nostalgiques du XVIIIe rationaliste ou des spéculations a-historiques de la scolastique médiévale. La diversité, postulée par l'élémentaire, ne permet plus les démonstrations pures, limpides, proprettes des discours nés sous les Lumières. Elle ne permet plus les raisonnements en circuit fermé, ni les simplifications idéologico-morales, les blue-prints que Burke reprochait à la Révolution française. Les beaux édifices que constituent les systèmes philosophiques, dont l'hégélien, ne résistent pas à l'assaut constant, répété, des faits historiques, psychologiques, etc.
Pfotenhauer explore systématiquement le contenu de la bibliothèque de Nietzsche et y repère, dans les livres lus et annotés, les arguments "vitalistes" tirés de livres de vulgarisation scientifique comme ceux de Guyau, Lange, von Nägeli, Rütimeyer, von Baer, Roux, Rolph, Espinas, Galton (l'eugéniste anglais), Otto Liebmann. Les thèmes qui mobilisent l'attention de Nietzsche sont essentiellement ceux de l'adaptation aux influences extérieures, l'augmentation des potentialités au sein même des espèces vivantes, l'abondance des forces vitales, la "pléonexie" de la nature, l'eugénisme correcteur, l'Urzeugung (génération spontanée).
La philosophie de Nietzsche s'élabore ainsi au départ de lectures très diverses, des spéculations scientifiques ou parascientifiques de son temps aux prises de positions littéraires et aux modes culturelles et artistiques. Chez les Frères de Goncourt et chez Flaubert, il découvre un engouement décadent pour les petits faits, couplé à un manque de "force" navrant. Il critique l'équilibre jugulant d'un certain classicisme répétitif et imitateur et loue la profusion du baroque.
Cette exploration tous azimuths a pour objectif de connaître tous les coins et recoins du monde du devenir. Cette sarabande colossale de faits interdit désormais au philosophe tout quiétisme. Une telle attitude quiétiste engendre le déclin par faiblesse à saisir la multiplicité du réel. La créativité constante qui germe et fulgure à partir de ce flot qu'est le devenir doit acquérir plus de valeur aux yeux du philosophe que la volonté de conservation. Ipso facto, le goût pour l'incertitude (face aux productions incessantes du devenir) remplace la recherche de certitude (qui implique toujours une sorte de fixisme) : tel est bien le fondement de l'Umwerthung, attitude et processus fondateur d'une "nouvelle hiérarchisation des valeurs".
L'homme qui intériorise cette disposition mentale annonce et prépare le fameux "surhomme", à propos duquel on a dit tant de stupidités, quitte à le faire passer pour une sorte de "mutant" de mauvais roman de science-fiction. En acceptant les innombrables différences que recèle et produit le devenir, en méprisant les limitations stérilisantes et les fixismes, l'homme créatif met de son côté les impulsions de la vie, écrit Pfotenhauer. Il ne réagit plus avec angoisse devant les rythmes du devenir et des dissolutions multiples.
Le nihilisme européen, c'est précisément le fruit de cette attitude frileuse devant les fulgurances du devenir. C'est cette volonté de trouver des certitudes consolatrices dans des concepts qui encarcannent le réel. L'objectif de Nietzsche n'est donc pas d'inaugurer une ère où l'on pensera sur le mode de l'anarchie, sans souci de rien. Nietzsche veut au contraire, en s'appuyant sur une symptomatologie du déclin (c'est là que son exploration tous azimuths des domaines scientifiques, littéraires et artistiques se révèle particulièrement nécessaire), développer une critique du monde qui lui est contemporain. Mais cette critique, qui refuse le monde tel qu'il est parce qu'il est marqué par la décadence, se veut formatrice et affirmatrice : elle est volonté de forger, de créer de nouvelles formes.
À la critique classique, qui oppose à la multiplicité du devenir des concepts fixes, des préceptes moraux rigides sans épaisseur factuelle, se substitue, chez Nietzsche, une critique innovatrice qui dit "oui" aux formes que fait surgir le devenir. Cette critique n'est pas fixiste : elle est, elle aussi, un mouvement qui épouse, plastiquement, les fluctuations du devenir. La nouvelle critique qu'inaugure Nietzsche n'est pas un retour irrationnel à une unité première, à un stade primitif a-historique et informel, mais une stratégie de la pensée qui se laisse porter par le flot du devenir et affirme son amour, son acceptance joyeuse, pour les joyaux puissamment esthétiques ou esthétiquement puissants que produit ce flot. Ainsi au mouvement descendant du déclin (et il "descend" parce qu'il se ferme à la profusion de faits que génère le devenir, perdant ainsi sans cesse de l'épaisseur), Nietzsche oppose un mouvement ascendant qui vise à privilégier les plus belles fulgurances du devenir qui, elles, donnent sans cesse épaisseur au monde et à la pensée.
Un retour à Nietzsche est indispensable
Ce tour d'horizon nietzschéen nous a permis de réfuter la thèse facile du "pré-nazisme" de Nietzsche : si Nietzsche peut parfois être considéré comme un annonciateur du nazisme parce qu'il a eu des exégètes nazis, il doit aussi être perçu comme le philosophe qui a "épicé" copieusement le corpus doctrinal des adversaires du nazisme. Nietzsche est donc partout à la fois : il est simultanément dans deux camps politiques, à une époque cruciale de l'histoire allemande.
Ignorer qu'il a inspiré Eisner et Landauer serait aussi idiot que d'ignorer ses exégètes de l'époque nazie, Baeumler et Heidegger. Si les hommes de gauche ont mis l'accent sur son volontarisme pour critiquer le déterminisme de leur cher marxisme ou pour brocarder l'absence de punch du réformisme social-démocrate, les hommes de droite (ou dits de droite) insisteront davantage sur son recours (physiologiste ?) à l'élémentaire ou sur son perspectivisme, qui, dans un certain sens, permet de justifier le nationalisme.
Une chose est certaine, cette omniprésence de Nietzsche dans le champ des argumentaires politiques prouve le bien-fondé de notre seconde intention, annoncée en ce début d'article : réfuter le fétiche contemporain de la négativité permanente, propre tant aux réformismes sociaux-démocrates, qui galvaudent le sens de l'État, qu'aux socio-technologies (social engeneering) du libéralisme avancé ou qu'au reflux vers les "petits faits" que constitue le néo-libéralisme.
Nietzsche annonce en fait un humanisme nouveau qui insiste sur la pluralité des belles fulgurances et ne pourra plus se baser sur des petits concepts étriqués et proprets, sur des slogans rapides ou des blue-prints hâtives : la démarche éducatrice de la philosophie se réfèrera aux fluctuations du devenir, aux grandes gestes historiques, aux grandes œuvres d'art, ainsi qu'aux domaines les plus divers du savoir humain. L'intelligence ne sera plus dominée alors par de timides manipulateurs de concepts ou de principes rigides, chétifs et inopérants devant le rude assaut des aléas, devant les impondérables.
Pour Reinhard Löw comme pour Friedrich Kaulbach, Nietzsche est un maître et un éducateur, qui utilise un ou plusieurs langages pour déconstruire les argumentaires usuels des philosophes, opérer une monstration didactique des mécanismes de la décadence, annoncer une ère nouvelle marquée par une "affirmativité" créatrice. Löw réfute l'idée d'un Nietzsche annonciateur de l'insignifiance de tout, du monde, de la philosophie et du devenir : Nietzsche, au contraire crée, fonde, pose des bases nouvelles, se positionne comme tremplin vers une pensée radicalement neuve. Une pensée qui voit les contradictions du devenir comme des obstacles enrichissants, non comme des anomalies perverses. Le philosophe, le grand artiste et l'hypothétique "surhomme" participent donc à un agon fructueux, à une émulation perpétuelle.
Les thèses allemandes les plus récentes sur Nietzsche renouent donc avec un Nietzsche affirmateur et créateur, qui engloberait sans doute certains simplismes politiques affirmateurs, la naïveté héroïque des premiers enthousiastes de sa pensée mais, en même temps, les dépasserait résolument, en les assagissant, en leur conférant une solide et inébranlable maturité, grâce à une recherche philologique minutieuse et une nouvelle démarche "physiologiste", patiente et systématique comme le travail de l'entomologiste. Nietzsche, dit Löw, doit être joué contre Nietzsche comme les faits doivent être joués contre les faits. La logique spontanée de l'humanité et de l'humanisme de demain doit être celle de ce jeu à risque, de ce jeu esthétique et créateur, où l'artiste utilise des matériaux divers.
Il est donc impossible d'enfermer Nietzsche dans une et une seule logique politicienne (celle du nazisme ou du pré-nazisme). Il est impossible de creuser davantage la veine stérile et épuisée de la négativité méthodologique. Si demain une sérénité doit voir le jour, elle devra, comme l'ont démontré Löw et Pfotenhauer, se référer à cette agonalité créatrice et affirmative, ne laissant aucun domaine de l'esprit à l'écart, comme la physiologie pluridisciplinaire de Nietzsche.
► Robert Steuckers, Orientations n°9, 1987. http://www.archiveseroe.eu
◘ Notes :
(1) Psychopathia spiritualis : F. Nietzsche und die Apostel der Zukunft, Leipzig, s.d. Ce texte était préalablement paru sous forme de "feuilleton" dans la revue Die Gesellschaft en 1891.
(2) F. Kaulbach a également exprimé son point de vue sur Nietzsche dans une série d'articles et d'essais, dont voici les références (toutes chez le même éditeur, Königshausen & Neumann, Würzburg) : • Die Tugend der Gerechtigkeit und das philosophische Erkennen, in : R. Berlinger & W. Schrader (Hrsg.), Nietzsche Kontrovers, Bd. I, 1981.
• Ästhetische und philosophische Erkenntnis beim frühen Nietzsche, in : M. Djuric & J. Simon (Hrsg.), Zur Aktualität Nietzsches, Bd. I, 1984.
• Nietzsches Kritik an der Wissensmoral und die Quelle der philosophischen Erkenntnis : die Autarkie der perspektivischen Vernunft in der Philosophie, in : R. Berlinger & W. Schrader (Hrsg.), Nietzsche Kontrovers, Bd. IV, 1984.
• Autarkie der pespektivischen Vernunft bei Kant und Nietzsche, in : J. Simon (Hrsg.), Nietzsche und die philosophische Tradition, Bd. II, 1985.
• Das Drama in der Auseinandersetzung zwischen Kunst und Wissensmoral in Nietzsches Geburt der Tragödie, in : M. Djuric & J. Simon (Hrsg.), Kunst und Wissenschaft bei Nietzsche, 1986. -
Un guide pour les philosophies de la Vie
 • Analyse : Karl Albert, Lebensphilosophie : Von den Anfängen bei Nietzsche bis zu ihrer Kritik bei Lukács, Alber Verlag/Reihe Kolleg Philosophie, Freiburg/München, 208 p.Karl Albert, professeur de philosophie à Wuppertal dans la région de la Ruhr, nous offre un excellent petit ouvrage sur la Lebensphilosophie allemande, très didactique et qui convient parfaitement pour les étudiants de première année. Il passe en revue les œuvres de Schlegel, Schopenhauer, Guyau, Nietzsche, Ditlhey (cf. l’article de ce numéro sur Simmel), Bergson, Simmel, Lessing, Klages, Messer, Spengler, Keyserling, Ortega y Gasset, Scheler, Misch, Lersch et Bollnow. Dans son introduction, il explique clairement sa démarche : « Toutes les créations originales de la philosophie et de la littérature, qui ont émergé dans la première décennie du XXe siècle, portaient l’accent de la “Vie”. C’était comme une ivresse, une ivresse juvénile, que nous avons tous partagée ». Les thématiques de la jeunesse, du printemps éternel, des paysages régénérants, de la danse, de la nudité, indique une voix qui n’est plus celle de la froide logique mais de la bio-logique, appelée à remplacer les sécheresses et les hypocrisies des “Lumières”, du positivisme et de l’académisme. Pour Karl Albert, les prémisses de la Lebensphilosophie se situent déjà tout entiers dans les œuvres de l’Allemand Friedrich Schlegel et du Français Jean-Marie Guyau.Didactique, soucieux de transmettre à ses étudiants, Albert esquisse les étapes successives de la démarche de Schlegel, adversaire du système de Hegel, vecteur de “négativité”, induisant le philosophe dans l’erreur car il remplace la réalité divine et vivante par un mensonge métaphysique. En trois étapes, Schlegel va tenter de sortir la pensée allemande et européenne de cette impasse et de ce labyrinthe :
• Analyse : Karl Albert, Lebensphilosophie : Von den Anfängen bei Nietzsche bis zu ihrer Kritik bei Lukács, Alber Verlag/Reihe Kolleg Philosophie, Freiburg/München, 208 p.Karl Albert, professeur de philosophie à Wuppertal dans la région de la Ruhr, nous offre un excellent petit ouvrage sur la Lebensphilosophie allemande, très didactique et qui convient parfaitement pour les étudiants de première année. Il passe en revue les œuvres de Schlegel, Schopenhauer, Guyau, Nietzsche, Ditlhey (cf. l’article de ce numéro sur Simmel), Bergson, Simmel, Lessing, Klages, Messer, Spengler, Keyserling, Ortega y Gasset, Scheler, Misch, Lersch et Bollnow. Dans son introduction, il explique clairement sa démarche : « Toutes les créations originales de la philosophie et de la littérature, qui ont émergé dans la première décennie du XXe siècle, portaient l’accent de la “Vie”. C’était comme une ivresse, une ivresse juvénile, que nous avons tous partagée ». Les thématiques de la jeunesse, du printemps éternel, des paysages régénérants, de la danse, de la nudité, indique une voix qui n’est plus celle de la froide logique mais de la bio-logique, appelée à remplacer les sécheresses et les hypocrisies des “Lumières”, du positivisme et de l’académisme. Pour Karl Albert, les prémisses de la Lebensphilosophie se situent déjà tout entiers dans les œuvres de l’Allemand Friedrich Schlegel et du Français Jean-Marie Guyau.Didactique, soucieux de transmettre à ses étudiants, Albert esquisse les étapes successives de la démarche de Schlegel, adversaire du système de Hegel, vecteur de “négativité”, induisant le philosophe dans l’erreur car il remplace la réalité divine et vivante par un mensonge métaphysique. En trois étapes, Schlegel va tenter de sortir la pensée allemande et européenne de cette impasse et de ce labyrinthe :-
Opposer au Geist hégélien la Vie proprement dite.
-
Montrer que la philosophie traditionnelle indienne est une apologie et une acceptation sereines voire joyeuses de la Vie.
-
Hisser au niveau de la réflexion philosophique les rapports entre l’homme et la femme, dans la sexualité et dans le mariage.
La base du travail philosophique ne saurait être une spéculation infinie sur un concept éthéré mais, au contraire, la vie spirituelle intérieure de l’homme, voyageant entre le ciel du sublime et la pesanteur de la matérialité. Dès lors, le philosophe peut commencer sa démarche à partir du moindre fait de vie et non pas au départ des seules spéculations académiques, imposées a priori au cherchant. Sanskritologue patenté, de même que son frère, Schlegel lisait la philosophie et la mythologie indiennes dans le texte. Il y retrouve un panthéisme, chassé d’Occident depuis l’avènement du christianisme. Ses réflexions sur les rapports entre sexes - sans nul doute inspirées par la tradition tantrique - contribue à forger en Occident une nouvelle vision de la femme, émancipatrice et équitable, revalorisant le rôle de la sensualité dans l’élaboration d’une philosophie équilibrée entre raison, sens, cordialité, matérialité, etc.Jean-Marie Guyau (1854-1888), natif de Laval dans le Maine, auteur notamment d’Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction (1885), aura un impact certain sur Nietzsche. Pour Guyau, la Vie a vocation à l’expansion, non au sur-place, et cette expansion n’a pas à être régulée - et contrariée - par un “impératif catégorique“ de kantienne mémoire, démarche non naturelle. L’aire infinie du déploiement merveilleux du cosmos est le site où vit et agit l’homme : le lieu de la “sympathie universelle”, où convergent et fusionnent esthétique, morale et religion. L’art, selon Guyau, est le véhicule que l’homme accompli utilise pour naviguer dans l’océan infini de cette “sympathie universelle”, sans contrarier les forces à l’œuvre dans l’univers. Sous les contradictions apparentes du monde des hommes, se profile une harmonie fondamentale, l’Être. Guyau, comme plus tard Deleuze - que l’on prend, nous dit Badiou, à tort pour un penseur d’une pluralité absolue et désordonnée - développe une ontologie vitaliste, qui ne nie nullement l’unité fondamentale de l’univers.La philosophie de la Vie n’est donc pas le socle des particularismes maniaques, repliés sur eux-mêmes, mais l’écho en Europe, d’une vision tantrique, où tout est entremêlé, où tout est relié à tout, sans segmentations et catégorisations inutiles et aberrantes. Avec Schlegel et Guyau, les bases d’une formidable alternative ont été jetées, mais elle n’a pas encore réussi à percer, à développer des modèles sociaux et politiques solides et viables.
► Robert Steuckers, Vouloir n° 146-148, 1999.http://robertsteuckers.blogspot.fr/ -
-
« Soyons des rêveurs éveillés, ces hommes dangereux » par Daniel COLOGNE
Ainsi s’achève Requiem pour la Contre-Révolution (1), dont l’auteur Rodolphe Badinand (2) me fait l’honneur d’être le co-dédicataire. Il ne m’en voudra donc pas si j’inverse l’adjectif indéfini et l’adjectif démonstratif. L’appel clôturant ce remarquable recueil d’« essais impérieux » est en réalité rédigé comme suit : « Pour le Système et ses sbires, nous incarnons le plus grand des périls parce que nous croyons en nos rêves ». Rodolphe Badinand cite alors Thomas Edgar Lawrence : « Les rêveurs de jour sont des hommes dangereux, car ils peuvent jouer leur rêve les yeux ouverts et le rendre possible ». L’auteur conclut : « Soyons ces rêveurs éveillés… » (p. 163).
Qui sommes-nous donc et quel est ce « Système » que Rodolphe Badinand nous invite à faire trembler ? Disons d’abord ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des « anti-Lumières », comme nous désignent nos ennemis. Nous ne sommes pas les nostalgiques d’un temps révolu, les passéistes assoupis dans la langueur des regrets éternels. Nous coupons le cordon ombilical avec la Contre-Révolution, dont nous saluons néanmoins le double mérite : son courage d’être entré en résistance contre des « valeurs mortifères », et notamment les « idéologies égalitaires », mais aussi la « valeur didactique » de « son échec » (p. 42).
Nous sommes les partisans d’une recomposition du monde fondée, non sur l’abstraction droit-de-l’hommiste, mais sur le socle concret du « droit des hommes (c’est moi qui souligne) à s’enraciner dans leur terroir et leurs communautés d’appartenance multiples et variées » (p. 163).
Cette refondation planétaire postule une reconstruction de l’Europe selon un « principe fédérateur d’essence supérieure » (p. 162), dont l’absence pertinemment épinglée par un monarque polynésien fut le cause de la Première Guerre mondiale. En citant Tupon IV, roi des Tonga, Rodolphe Badinand témoigne de ce qu’est la véritable ouverture à l’Autre, la capacité d’être authentiquement à l’écoute de la sagesse, d’où qu’elle vienne : tout le contraire de la mensongère « tolérance » du Système, où l’égalitarisme de façade masque l’impitoyable volonté d’épuiser les hommes et les peuples dans une course infernale le long de « la ligne droite individu – État jacobin – État mondial – humanité » (p. 163).
Un exemple de « principe fédérateur » est l’idée impériale telle que la concrétise l’institution pluriséculaire du Saint-Empire romain germanique. « Au Moyen Âge, l’empire sacré et sanctifié ne pouvait que promouvoir l’idéal chrétien. Il aurait été inconcevable qu’il s’édifiât contre la majorité religieuse du moment » (p. 119). À notre époque de déchristianisation, il ne faut évidemment pas aspirer à reproduire la structure médiévale, mais il convient de lui substituer un symbolisme cosmique où l’Empire serait une image du Soleil central autour duquel tourneraient, à des vitesses différentes, comme les planètes du système solaire astronomique, les nations (patries historiques) et les régions (patries charnelles). Ainsi l’Europe pourrait-elle revendiquer le titre de « patrie idéale », répondre à l’exigence d’universalité inscrite au cœur de toute pensée métapolitique.
Rodolphe Badinand distingue judicieusement l’impérialité et les impérialismes. « Contrairement au Saint-Empire, les Premier et Second Empires français n’ont reposé que sur les épaules d’une personnalité charismatique » (p. 116). Son procès des bonapartistes n’a d’égal que son rejet de l’hitlérisme, « version teutonne du jacobinisme français » (p. 121).
Dans la ligne d’Alain de Benoist, Rodophe Badinand considère aussi comme de « faux empires » les empires coloniaux anglais, français, hollandais, portugais ou espagnol. Il tient « le mal colonial » (p. 127) pour une des étapes importantes de la « décomposition de la France » (p. 125).
Érudit français, Rodophe Badinand consacre tout naturellement de nombreuses pages à l’histoire de son pays. Recensant l’ouvrage d’un historien de l’Université de Jérusalem, il rappelle « les prétentions capétiennes à la Couronne du Saint-Empire romain germanique » (p. 95), qui aurait pu devenir, entre les règnes de François Ier et Louis XIV, un « Saint-Empire romain de la Nation Française » (p. 96). C’est l’un des textes courts du recueil, qui alternent avec des essais plus longs, de même que se succèdent, dans un ensemble ipso facto de lecture agréable, de brefs comptes-rendus de livres, de vigoureuses interventions conférencières et de profonds essais où la réflexion toujours nuancée se déploie dans un style souvent chatoyant.
La coutume gastronomique encadre le plat de résistance de hors-d’œuvre et de desserts. Ici, l’essai le plus consistant, qui donne d’ailleurs son titre au florilège, est opportunément placé en tête. Une quarantaine de pages d’une rare densité intellectuelle nous convie ainsi à réfléchir sur la Contre-Révolution « impasse intellectuelle majeure » (p. 13).
L’Église catholique fut la première à s’opposer à la révolution de 1789 et elle le fit avec d’autant plus de force qu’un an à peine après la prise de la Bastille, fut votée la Constitution civile du clergé (1790), la « plus grave erreur » (p. 19) de la révolution suivant l’auteur.
Celui-ci examine, tout au long des deux siècles écoulés, la « lente translation vers la Modernité » (p. 24) qui affecte la catholicisme et dont Jacques Maritain (1882 – 1973) offre un exemple symbolique.
Le royalisme également a succombé, au fil des décennies, à la contagion de l’esprit moderniste. Ce dernier « contamina les doctrines monarchiques avec la même vigueur qu’il se développait au sein du catholicisme » (p. 28). Des mouvements royalistes de gauche naquirent ainsi dans toute l’Europe méridionale : le Parti populaire monarchique portugais, le carlisme espagnol qui « se transforma en un mouvement socialiste autogestionnaire » (p. 30), et en France les « maurrassiens » de la Nouvelle Action Française de Bertrand Renouvin.
« Avec ces trois exemples, écrit Rodolphe Badinand, nous devons nous interroger si la Contre-Révolution et la Révolution ne seraient pas l’avers et le revers d’une même médaille appelée la Modernité » (Ibid.).
Avant de revenir sur cette importante citation, où l’on voit émerger sous la plume de l’auteur le questionnement fondamental, épinglons encore cette vision non conformiste des régimes de Salazar, Franco et Pétain, où Rodolphe Badinand voit les germes de l’élan économique-industriel d’après-guerre, via l’arrivée au pouvoir des technocrates. Le phénomène lui semble particulièrement sensible dans la France de Vichy, après « la nomination de l’amiral Darlan à la vice-présidence du Conseil des ministres » (p. 31).
Y aurait-il eu donc un « apport contre-révolutionnaire au libéralisme » (p. 32) ? Oui, répond sans hésitation l’auteur qui va jusqu’à établir un parallélisme entre la « main invisible » du marché et les « voies insondables » de la Providence. Les fondements chrétiens de la Contre-Révolution sont ici mis en cause et il en découle que la dérive potentielle des contre-révolutionnaires était prévisible dès la fin du XVIIIe siècle.
Rodolphe Badinand rappelle opportunément que « les trois futures sommités de la contre-révolution intellectuelle étaient vus par leurs contemporains comme des libéraux : Edmund Burke était un parlementaire Whig, défenseur des droits du Parlement anglais et de la Révolution américaine; Joseph de Maistre était, à la cour de Savoie, jugé comme un franc-maçon francophile et Louis de Bonald fut, en 1789-1790, le maire libéral de Millau » (p. 41).
Quant à la Révolution conservatrice, que ses adversaires ont baptisée « Nouvelle Droite », elle intègre certes un héritage contre-révolutionnaire, mais elle se réfère aussi au socialisme proudhonien, aux non-conformistes des années Trente si bien étudiés par Pierre Loubet del Bayle, et au situationnisme de Guy Debord dénonçant « la société du spectacle ». Rodophe Badinand conclut son analyse de ce courant par cette hypothèse de recherche que les historiens des idées politiques devraient creuser : « Ce syncrétisme semblerait marquer la fin historique de la Contre-Révolution en tant que mouvement de pensée » (p. 36).
Rodolphe Badinand s’interroge de manière inattendue : « L’écologie : le dernier surgeon contre-révolutionnaire ? » (p. 38). L’auteur fait un rapprochement insoupçonné entre, d’une part les écrits d’un Edouard Goldsmith ou d’un Bernard Charbonneau, et d’autre part, le roman balzacien Le Médecin de Campagne, sorte d’Arcadie où «chacun mène une existence équilibrée et où la nature maîtrisée, mais non agressée par le machinisme, donne des fruits à tous les villageois » (p. 39). Au même titre que la Nouvelle Droite et la Révolution conservatrice, l’écologie dépasse « les vieux clivages, devenus obsolètes » (voir le slogan « Ni Droite, ni Gauche » d’Antoine Waechter) et ne se laisse pas enfermer dans le binôme Révolution – Contre-Révolution. Sa vision du monde dynamique rompt avec le passéisme ruraliste exaltant une société champêtre « stable, immuable et édénique » (Ibid.).
Partageant avec les écologistes certaines légitimes préoccupations environnementales, Rodolphe Badinand avertit : « Si le réchauffement planétaire se poursuit et s’accentue, dans quelques centaines d’années, la banquise aura peut-être disparu, faisant de l’océan polaire un domaine maritime de première importance » (p. 123). La maîtrise de l’Arctique s’impose à l’auteur comme une des plus impérieuses nécessités pour le futur Empire européen. Cet enjeu tant stratégique que symbolique est d’autant moins négligeable que les anciennes mythologies indo-européennes, y compris celle de l’Hellade méditerranéenne et celle de l’Inde védique, mentionnent le Septentrion comme l’origine, sinon de l’humanité, du moins d’une de ses plus importants rameaux. L’Europe se devra donc d’être présente sur tout le pourtour de l’océan Arctique comportant aussi des rivages asiatiques et nord-américains.
« Face à la marée montante des peuples du Sud, le regroupement intercontinental des descendants de Boréens ne se justifie que par le désir de survivre au XXIe siècle. Cela mérite au moins un débat que seul l’avenir tranchera » (p. 73).
Rodolphe Badinand nous convie à effectuer deux démarches simultanées : retrouver le chemin de notre « plus longue mémoire »’ et imaginer notre futur lointain.
« Les contre-révolutionnaires souhaitaient conserver intact le passé. Leur démarche les obligea souvent à faire de l’avenir table rase. Entre la négation du passé, propagée par la Modernité, et le refus du futur, pratiqué par la Contre-Révolution, existe une troisième voie : l’archéo-futurisme » (p. 44). L’auteur se réfère à Guillaume Faye, qui a longtemps partagé avec Alain de Benoist, quoique dans un autre registre, le magistère intellectuel de notre famille de pensée. Né vers 1972, issu de la génération suivante, Rodolphe Badinand peut prétendre à la succession de ces deux maîtres à penser, selon l’expression consacrée et en l’occurrence toute relative si l’on pense à ces figures hors normes que sont René Guénon (1886 – 1951) et Julius Evola (1898 – 1974).
À propos de ces deux immenses éveilleurs, il est temps de se demander dans quelle mesure ils ont été piégés par le binôme Révolution – Contre-Révolution. C’est à force de critiquer le progressisme moderne rectilinéaire que l’on dérive peu à peu, au départ d’une conception cyclique de l’histoire, vers un décadentisme « traditionnel » tout aussi rectilinéaire.
Progressisme et décadentisme apparaissent alors comme les deux faces de la même médaille, de même que s’impose la nécessité, pour la Nouvelle Droite et la Révolution conservatrice, de faire venir leurs adversaires sur leur terrain (c’est Rodolphe Badinand qui souligne). « Qu’elles cessent donc de débattre des idées adverses pour imposer la discussion sur leurs idées » (p. 43). Qu’elles arrêtent de disserter sur les inconvénients du progressisme et sur l’absurdité d’un « sens de l’Histoire », et qu’elles valorisent les avantages et la solidité de leur conception cyclique du devenir humain, qui est une respiration à plusieurs vitesses, et qui ne peut en aucun cas dégénérer en un décadentisme vertigineux.
Osons nous dresser avec Rodolphe Badinand contre l’exorbitante prétention de la démocratie moderne à être le point oméga de l’aventure humaine. Adoptée le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comporte en son article XI une restriction à la liberté d’expression que l’auteur reprend in extenso : « sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » (p. 18).Rodolphe Badinand commente : il s’agit d’« une phrase si vague qu’elle permet toutes les interprétations possibles et justifie toutes les polices de la pensée. Or le totalitarisme commence quand on empêche certaines opinions de s’exprimer sur la place publique… » (Ibid.). La Modernité est donc bien la « matrice des totalitarismes ». Sous le couvert de la démocratie et du « droit-de-l’hommisme » sévit un terrorisme intellectuel s’appuyant sur des lois liberticides et rétablissant le délit d’opinion, dont sont passibles tous ceux qui contestent les fondements du Système. Un de ces fondements concerne les origines de l’espèce humaine. C’est la thèse africano-centriste selon laquelle l’Afrique serait l’unique berceau de l’humanité, le seul foyer primordial à partir duquel le primate se serait transformé en homo sapiens.
En optant pour une vision « boréocentrique » de l’histoire, Rodolphe Badinand ne craint pas de s’exposer à la vindicte de la « bien-pensance » qui pourrait lui faire grief « d’une supercherie scientifique à relent raciste » (p. 69).
Pourtant, ses « Notes dissidentes sur la nation de tradition Primordiale », autre chapitre très fouillé et hyper-documenté, révèle une approche pluraliste du problème. Logique et conséquent, Rodolphe Badinand se refuse à trancher la question de l’antériorité en faveur de l’un ou l’autre « ensemble ethnique ». « N’y aurait-il pas finalement une succession aléatoire de Traditions primordiales pour chaque entité ethnique matricielle ? Et si c’était le cas, qui bénéficierait de l’antériorité ? On le voit : ce type de questionnement débouche sur une absence de réponse d’ordre humain. Cependant, s’interroger sans cesse est le meilleur moyen de maintenir son esprit libre et éveillé. L’interrogation permanente produit des antidotes aux toxines du conformisme médiatique » (p.71).
Nous voici aux antipodes du dogmatisme des traditionalistes qui, même lorsqu’ils se définissent comme « intégraux » et se réclament d’Evola ou de Guénon, demeurent fréquemment incapables d’auto-critique, inaptes à soulever eux-mêmes des objections à leur discours, fascinés par « le pessimisme foncier de la doctrine des âges, souvent porteur de désespoir ou d’inaction totale » (p. 59).
Rodolphe Badinand est un authentique « penseur libre » aussi éloigné de la fallacieuse « libre-pensée » que de son primaire retournement traditionaliste, aussi étranger à la linéarité évolutive qu’à la descente sans frein de l’Âge d’or à l’Âge de fer. La « spiritualité primordiale » ne serait-elle pas plutôt d’inspiration astrologique, c’est-à-dire fondée sur l’alternance de courbes ascendantes et descendantes, tributaires des angles tantôt harmonieux tantôt dissonants formés entre eux par les astres ?
Diverses formes d’astrologie caractérisent en tout cas les aires culturelles où Rodolphe Badinand discerne, en s’appuyant sur de récentes recherches anthropologiques, paléontologiques et archéologiques, l’empreinte des Boréens, ancêtres des Indo-Européens, grand peuple migrateur de la plus haute préhistoire « ne rechignant jamais les rencontres avec les tribus indigènes » (p. 68).
Celles-ci possèdent peut-être leur propre foyer d’irradiation culturelle, leur « tradition primordiale » indissociable de leur « spécificités ethno-spirituelles » (p. 71). Dans la Grèce antique, parallèlement à l’exaltation mythologique du « séjour des dieux » localisé au Nord et gardé à l’Occident par les Hespérides, à l’entrée du fameux jardin aux « pommes d’or » que cueillit Héraklès et qui subjuguèrent la farouche Atalante, le scrupuleux Hérodote évoquait la possibilité de l’existence d’Hypernotiens, équivalents de nos Hyperboréens, matrice des peuple du Sud avec lesquelles nous sommes appelés à fonder une « fraternité qualitative » (p. 60).
En effet, « la tradition risque d’avoir sa signification détournée et de devenir à son corps défendant un auxiliaire du fraternitarisme mondial » (c’est Rodolphe Badinand qui souligne) assimilable à « un oecuménisme pervers » (Ibid.). Sous le couvert de celui-ci peut de développer une forme spirituelle d’impérialisme et de domination mondiale à laquelle les Boréens étaient totalement réfractaires lorsqu’ils quittèrent leurs terres arctiques d’origine pour essaimer sur d’autres continents et fonder peut-être les cultures méso-américaines, l’Égypte pharaonique, la Chine du Céleste Empire.
Les historiens de notre famille de pensée saluent en Dominique Venner un guide incontournable dont Rodolphe Badinand se solidarise dans la critique de « la conception guénonienne d’une seule tradition hermétique et universelle, qui serait commune à tous les peuples et à tous les temps, ayant pour origine une révélation provenant d’un “ ultramonde ” non identifié » (p. 60). À la suite du directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, l’auteur subodore dans le « traditionalisme intégral » un « syncrétisme équivoque » et une critique de la modernité ne débouchant « que sur un constat d’impuissance » (Ibid.), « l’attente millénariste de la catastrophe » (p. 61).
Par delà les fausses alternatives Tradition – Modernité et Révolution – Contre-Révolution, la brillante anthologie de Rodophe Badinand, compilant des textes écrits ces dix dernières années dans L’Âtre, Cartouches, Roquefavour, Éléments et L’Esprit européen, suggère de remonter aux sources vives de cet « esprit européen » et de réfléchir à son adaptation au monde de demain et d’après-demain. « Il y a du travail pour cent ans », écrivit un jour Robert Steuckers. Rodolphe Badinand est un des pionniers de ce siècle de renouveau de l’intelligence européenne, de cette ère de rayonnement retrouvé et de renaissance métapolitique, de cette nouvelle étape de l’aventure humaine où les Européens et fiers de l’être sauront être à l’écoute des sagesses fleuries sous d’autres latitudes, pour construire enfin une Terre harmonieuse et pacifiée.
Daniel Cologne Europe Maxima.
Notes
1 : Rodolphe Badinand, Requiem pour la Contre-Révolution et autres essais impérieux, Éditions Alexipharmaque, coll. « Les Réflexives », 2008.
2 : Rodolphe Badinand, est un journaliste proche de la Nouvelle Droite. Il a été secrétaire de rédaction de la revue Roquefavour. Il a également tenu la rubrique trimestrielle « Les Chronique païennes » dans L’Âtre. Il a aussi écrit pour Cartouches, Rivarol, Éléments et L’Esprit Européen (la revue, puis le site). Il collabore aujourd’hui au site européaniste non-conformiste d’expression française -
La genèse de la postmodernité
Conférence prononcée à l'école des cadres du GRECE ("Cercle Héraclite"), juin 1989
Ex: http://vouloir.hautetfort.com/
La post-modernité. On en parle beaucoup sans trop savoir ce que c'est. Le mot fascine et mobilise quantité de curiosités, tant dans notre microcosme “néo-droitiste/ gréciste” (le néologisme est d'Anne-Marie Duranton-Crabol) (1) que dans d'autres.
Le fait de nous être nommés “Nouvelle Droite” ou d'avoir accepté cette étiquette qu'on nous collait sur le dos, signale au moins une chose : le terme “nouveau” indique une volonté de rénovation, donc un rejet radical du vieux monde, des idéologies dominantes et, partant, des modes de gestion pratiques, économiques et juridiques qu'elles ont produits. Dans ces idéologies dominantes, nous avons répété et dénoncé les linéaments d'universalisme, la prétention à déployer une rationalité qui serait unique et exclusive, ses implications pratiques de facture jacobine et centralisatrice, les stratégies homogénéisantes de tous ordres, les ratés dus aux impossibilités physiques et psychologiques de construire pour l'éternité, pour les siècles des siècles, une cité rationnelle et mécanique, d'asseoir sans heurts et sans violence un droit individualiste, etc.
Les avatars récents de la philosophie universitaire, éloignés — à cause de leur jargon obscur au premier abord — des bricolages idéologiques usuels, du tam-tam médiatique et des équilibrismes politiciens, nous suggèrent précisément des stratégies de défense contre cette essence universaliste des idéologies dominantes, contre le monothéisme des valeurs qui caractérise l'Occident tant dans son illustration conservatrice et religieuse — la New Right fondamentaliste l'a montré aux États-Unis — que dans son illustration illuministe, rationaliste et laïque. L'erreur du mouvement néo-droitiste, dans son ensemble, c'est de ne pas s'être mis plus tôt à l'écoute de ces nouveaux discours, de ne pas en avoir vulgarisé le noyau profond et d'avoir ainsi, dans une certaine mesure, raté une bonne opportunité dans la bataille métapolitique.
“Konservative Revolution” et École de Francfort
Il nous faut confesser cette erreur tactique, sans pour autant sombrer dans l'amertume et le pessimisme et brûler ce que nous avons adoré. En effet, notre recours direct à Nietzsche — sans passer par les interprétations modernes de son œuvre — au monde allemand de la tradition romantique, aux philosophies et sociologies organicistes/vitalistes et à la Konservative Revolution du temps de Weimar, a fait vibrer une corde sensible : celle de l'intérêt pour l'histoire, la narration, l'esthétique, la nostalgie fructueuse des origines et des archétypes (ici, en l'occurrence, les origines immédiates d'une nouvelle tradition philosophique). L'effort n'a pas été vain : en se dégageant du carcan rationaliste/positiviste, l'espace linguistique francophone s'est enrichi d'apports germaniques — organicistes et vitalistes — considérables, tout comme, dans la sphère même des idéologies dominantes, il apprenait à maîtriser simultanément les textes de base de l'École de Francfort (Adorno, Horkheimer) et les démonstrations audacieuses de Habermas, parce qu'il a parfois fallu 40 ou 50 ans pour trouver des traductions françaises sur le marché du livre.
Explorer les univers de Wagner, de Jünger, de Thomas Mann, de Moeller van den Bruck, de Heidegger, de Carl Schmitt (2), a donné, à notre courant de pensée, des assises historiques solidissimes et, à terme, une maîtrise sans a priori des origines philosophiques de toutes les pensées identitaires, maîtrise que ne pourront jamais détenir ceux qui ont amorcé leurs démarches dans le cadre des universalismes/rationalismes occidentaux ou ceux qui restent paralysés par la crainte d'égratigner, d'une façon ou d'une autre, les vaches sacrées de ces universalismes/rationalismes. Une plus ou moins bonne maîtrise des origines, découlant de notre méthode archéologique, nous assure une position de force. Mais cette position est corollaire d'une faiblesse : celle de ne pas être plongé dans la systématique contemporaine, de ne pas être sur la même longueur d'onde que les pionniers de l'exploration philosophique, de ne pas être en même temps qu'eux à l'avant-garde des innovations conceptuelles. D'où notre flanc se prête assez facilement à la critique de nos adversaires qui disent, sans avoir tout à fait tort : “vous êtes des passéistes, germanolâtres de surcroît”.
Comment éviter cette critique et, surtout, comment dépasser les blocages, les facilités, les paresses qui suscitent ce type de critique ? Se référer à la tradition romantique, avec son recours aux identités, opérer une quête du Graal entre les arabesques de la Konservative Revolution (KR), sont des atouts majeurs autant qu'enrichissants dans notre démarche. Si enrichissants qu'on ne peut en faire l'économie. Les prémisses du romantisme/vitalisme philosophique (mis en exergue par Gusdorf) (3), les fulgurances littéraires de leur trajectoire, la carrière inépuisable qu'est la KR, avec son esthétisme et sa radicalité, s'avèrent indispensables — sans pour autant être suffisants — afin de marquer l'étape suivante dans le développement de notre vision du monde. Jettons maintenant un coup d'œil sur le fond-de-monde où s'opèrent ce glissement, cette rénovation du substrat philosophique romantique/vitaliste, cette rénovation de l'héritage de la KR. En Allemagne, matrice initiale de ce substrat, l'après-guerre a imposé un oubli obligatoire de tout romantisme/vitalisme et conforté une vénération officielle, quasiment imposée, de la tradition adverse, celle de l'Aufklärung, revue et corrigée par l'École de Francfort. Hors de cette tradition, toute pensée est désormais suspecte en Allemagne aujourd'hui.
Devant la mise au pas de la philosophie en RFA, la bouée de sauvetage est française
Mais le perpétuel rabâchage des idéologèmes francfortistes et des traditions hégéliennes, marxistes et freudiennes a conduit la pensée allemande à une impasse. On assiste depuis peu à un retour à Nietzsche, à Schopenhauer (notamment à l'occasion du 200ème anniversaire de sa naissance en 1988), aux divers vitalismes. Mais ce simple retour, malgré la bouffée d'air qu'il apporte, demeure intellectuellement insuffisant. Les défis contemporains exigent un aggiornamento, pas seulement un approfondissement. Mais, si tout aggiornamento d'un tel ordre postule une réinterprétation de l'œuvre de Nietzsche et une nouvelle exploration de “l'irrationalisme” prénietzschéen, il postule aussi et surtout un nouveau plongeon dans les eaux tumultueuses de la KR. Or un tel geste rencontrerait des interdits dans la RFA d'aujourd'hui. Les philosophes rénovateurs allemands, pour sortir de l'impasse et contourner ces interdits, ces Denkverbote francfortistes, font le détour par Paris. Ainsi, les animateurs des éditions Merve de Berlin, Gerd Bergfleth, à qui l'on doit de splendides exégèses de Bataille, Bernd Mattheus et Axel Matthes (4) sollicitent les critiques de Baudrillard, la démarche de Lyotard, les audaces de Virilio, le nietzschéisme particulier de Deleuze, etc. La bouée de sauvetage, dans l'océan soft du (post-)francfortisme, dans cette mer de bigoterie rationaliste/illuministe, est de fabrication française. Et l'on rencontre ici un curieux paradoxe : les Français, qui sont fatigués des platitudes néo-illuministes, recherchent des médicaments dans la vieille pharmacie fermée qu'est la KR ; les Allemands, qui ne peuvent plus respirer dans l'atmosphère poussiéreuse de l'Aufklärung revue et corrigée, trouvent leurs potions thérapeutiques dans les officines parisiennes d'avant-garde.
Dès lors, pourquoi ceux qui veulent rénover le débat en France, ne conjugueraient-ils pas Nietzsche, la KR, la “droite révolutionnaire” française (révélée par Sternhell, stigmatisée par Bernard-Henri Lévy dans L'idéologie française, Grasset, 1981), Péguy, l'héritage des non-conformistes des années 30 (5), Heidegger, leurs philosophes contemporains (Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Baudrillard, Maffesoli, Virilio), pour en faire une synthèse révolutionnaire ?
La présence de ces recherches nouvelles désamorcerait ipso facto les critiques qui mettent en avant le “passéisme” et la “germanolâtrie” de ceux et celles qui refusent d'adorer encore et toujours les vieilles lunes de l'âge des Lumières. De plus, cette présence autorise d'emblée une participation active et directe dans le débat philosophique contemporain, auquel une intervention néo-droitiste, portée par le souci pédagogique qui lui est propre, aurait sans doute conféré un langage moins hermétique. L'hermétisme du langage a été, de toute évidence, l'obstacle à l'incorporation des philosophes français contemporains dans un projet de nature métapolitique.
Dépasser l'humanisme, penser le pluriel
Il conviendrait donc, pour reprendre pleinement pied dans l'arène philosophique contemporaine ; de concilier 2 langages : d'une part, celui, didactique, narratif et historique qu'avait fait sien la ND dans les colonnes du Figaro Magazine, de Magazine-Hebdo ou d'Éléments et, d'autre part, un langage pionnier, prospectif, innovateur, celui des corpus deleuzien, foucaldien, etc. J'entends déjà les objections : Deleuze et Foucault s'inscrivent dans le cadre de la gauche intellectuelle, militent dans les réseaux “anti-racistes”, se font les apologistes des marginalités les plus bizarres, etc. Entre les opinions personnelles amplifiées par les médias, les engouements légitimes pour telle ou telle marginalité, et une épistémologie, exprimée dans un vocabulaire spécialisé et ardu, il faut savoir faire la distinction.
L'idée du dépassement de l'humanisme mécaniciste/rationaliste et la vision du surhumanisme nietzschéen (6) ont pourtant plus d'un point commun, preuve que les intuitions et les aphorismes de Nietzsche, les visions et les proclamations des autres auteurs de la tradition “surhumaniste”, se sont capillarisées dans les circuits intellectuels européens et ne pourront plus jamais en être délogés, en dépit des efforts lancinants de leurs adversaires, accrochés déséspérément à leurs vieilles chimères. Si la ND a ouvertement démasqué les hypocrisies des discours dominants, signalé les simulacres et déchiré les voiles, des philosophes comme Deleuze ont habilement camouflé leur travail de sape, si bien qu'il peut apparaître inattendu d'apprendre que, pour lui, le mouvement des droits de l'homme cherche naïvement à « reconstituer des transcendances ou des universaux ». Mais pour le philosophe de la “polytonalité” et des “multiplicités” — qui a pensé le pluriel de façon radicalement autre que la ND, mais a néanmoins aussi pensé le pluriel — est-ce si étonnant ?
Classer les courants post-modemes
Mais ces réflexions sur le destin de la ND et sur les philosophes français pourraient s'éterniser à l'infini, si l'on ne définit pas clairement un cadre historique et chronologique où elle s'inscriront, si l'on ne panoramise pas les faits post-modernes de philosophie et les virtualités qui en découlent. Il est en effet nécessaire de se doter d'un canevas didactique, afin de ne pas glosser dans le désordre et la confusion. Toutes les introductions à la pensée et aux philosophies postmodernes commencent par en souligner l'hétérogénéité, la diversité, l'absence de dénominateur commun : toutes caractéristiques qui, de prime abord, interdisent la clarté... Une chatte n'y retrouverait pas ses jeunes... Heureusement, un homme quasi providentiel est venu mettre de l'ordre dans ce désordre : Wolfgang Welsch, auteur d'un ouvrage “panoramique” sur la question, d'où ressort, limpide, une vision de l'histoire intellectuelle post-moderne (Unsere postmoderne Moderne, Acta Humaniora, Weinheim, 1987 ; en abrégé pour la suite du présent exposé : UPM).
Car c'est de cela qu'il s'agit : d'abord, montrer comment, progressivement, la philosophie s'est dégagée de la cangue rationaliste/moderniste/universaliste pour aborder le réel de façon moins étriquée, et, ensuite, indiquer à quel stade ce long cheminement est parvenu aujourd'hui, à quelles résistances têtues ce dégagement se heurte encore. Conseillant vivement une lecture de l'ouvrage de Welsch dans un article de Criticón, Armin Mohler, l'auteur de Die Konservative Revolution in Deutschland 1919-1933, explique combien proche de notre anti-universalisme est l'interprétation welschienne de la post-modemité. De plus, la chronologie et la vision “panoramique” de Welsch, dévoilent l'évolution des idées, un peu comme on montre un processus biologique ou chimique en accéléré dans les documentaires scientifiques.
Posthistoire, postmodernité, société postindustrielle, une seule et même chose ?
Premier souci de Welsch : se débarrasser d'une confusion usuelle, celle qui dit que “posthistoire”, postmodernité et société postindustrielle sont une seule et même chose. Pour la posthistoire, décrite par Baudrillard, plus aucune innovation n'est possible et toutes les virtualités historiques ont été déjà jouées ; le diagnostic suggère la passivité, I'amertume, le cynisme et la grisaille.
Le mouvement du monde serait arrivé à un stade final, que Baudrillard nomme “l'hypertélie”, où les possibilités se neutraliseraient mutuellement dans “l'indifférence”, transformant notre civilisation en une gigantesque machinerie (la “mégamachine” de Rudolf Bahro ?) à homogénéiser toutes les “différences” produites par la vie. De ce fait, la texture du monde, qui consiste à produire des “différences”, se mue en un mode de production d'indifférence. En d'autres mots, la dialectique de la différenciation renverse ses potentialités en produisant de l'indifférence. Tout s'est déjà passé : inutile de rêver à une utopie, un monde meilleur, des lendemains qui chantent. Il ne se produit plus qu'une chose : le clonage infini et/ou la prolifération cancériforme du même, sans nouveauté, dans une “obésité obscène”. Notre époque, celle du “transpolitique”, ne travaille plus ses contradictions internes (ne cherche ni ne crée plus de solutions), mais s'engloutit dans l'extase de son propre narcissisme.
Le bilan de Baudrillard est sombre, noir. Son amertume, pense Welsch, est le signe de son hypermodernisme et non celui d'une éventuelle postmodernité. La faillite des utopies désole Baudrillard, alors qu'elle fait sourire les postmodernes. Baudrillard déplore l'évanouissement des utopies et accuse la postmodernité de ne plus avoir de dimension utopique. La postmodernité, elle, est active, optimiste, bigarrée, offensive ; elle n'est pas utopique, mais elle n'est pas non plus résignée et ne se lamente pas. Toute lamentation quant à la disparition des projets utopiques/modernes est la preuve d'un attachement sentimental et désillusionné aux affects qui soustendent la modernité.
Postmodemité et société postindustrielle
Pour réfuter les arguments de ceux qui posent l'équation “postmodernité = société postindustrielle”, Welsch commence par rappeler le moment où, en sociologie, le terme “postmoderne” est apparu pour la première fois. C'était en 1968, dans un ouvrage d'Amitai Etzioni : The Active Society : A Theory of Societal and Political Processes (New York). Pour Etzioni, la postmodernité ne signifie ni résignation devant l'effondrement des grandes utopies sociales, ni répétition du même à l'infini, sur le mode de la “mégamachine”. La postmodernité, au contraire, signifie dynamisme, créativité et action. Sur bon nombre de plans, l'analyse d'Etzioni rejoint les diagnostics de David Riesman (La foule solitaire, Arthaud, 1964 ; l'éd. am. date de 1958), d'Alain Touraine et surtout de Daniel Bell (Les contradictions culturelles du capitalisme, PUF, 1979 ; éd. am.: 1976). Mais, en dernière instance, les conclusions d'Etzioni et de Bell sont foncièrement différentes. Pour Bell, théoricien majeur de la société postindustrielle, le grand projet technocratique — faire le bonheur des masses par quantitativisme — demeure en place, même si l'on observe un passage des technologies machinistes aux technologies intellectuelles (informatique, p.ex.). Pour Etzioni, en revanche, les technologies les plus récentes relativisent le vieux projet technocratique. Pour Bell, nous sommes entrés dans un “stade final”, où il s'agit de mettre de l'ordre dans la société de masse, issue du “grand projet” technocratique. Pour Etzioni, nous glissons hors de la passivité technocratique pour entrer dans un âge “actif”, dans une société qui s'auto-définit et se transforme sans cesse.
Affronter efficacement le monde contemporain, pour Etzioni et Welsch, c'est savoir manier une pluralité de rationalités, de systèmes de valeurs, de projets sociaux et non se contenter d'une rationalité unique, d'un monothéisme des valeurs stérilisant et d'ériger en fétiche un et un seul modèle social. C'est face à cette offensive silencieuse d'un néo-pluralisme que Bell se trouve confronté à un dilemme qu'il ne peut résoudre : il sait que le projet technocratique, monolitihique dans son essence, ne peut satisfaire à long terme les aspirations démocratiques humaines, puisque celles-ci sont diverses ; mais, par ailleurs, on ne peut raisonnablement se débarrasser des acquis de l'ère technocratique, pense Bell, inquiet devant les nouveautés qui s'annoncent. Et face à ce complexe technocratique, composé de linéaments positifs et négatifs, indissociables et totalement imbriqués les uns dans les autres, s'est instaurée une sphère culturelle que Bell qualifie de “subversive”, car elle est hostile au projet technocratique et le sape. Le conflit majeur, qui risque de détruire la société capitaliste selon Bell, est celui qui oppose la sphère technique à la sphère culturelle. Cette opposition est, somme toute, assez manichéenne et ne perçoit pas qu'innovations sicentifiques/techniques et innovations culturelles/artistiques/littéraires surgissent d'un même fond de monde, d'une même révolution qui s'opère dans les mentalités. Arnold Gehlen, lui, avait bien vu que la culture (au sens où l'entend Bell), même hyper-critique à l'endroit de la mégamachine, n'était qu'épiphénomène et créatrice de gadgets, d'opportunités marchandes. La société marchande, la mégamachine bancaire et industrielle, récupèrent les velléités contestatrices et les transforment en marchandises consommables.
La postmodernité n'est ni le schéma catastrophiste de Bell ni le pessimisme de Gehlen et Baudrillard. Elle admet le caractère “radicalement disjonctif” des sociétés contemporaines. Elle admet, en d'autres mots, que les rationalités économiques, industrielles, politiques, culturelles et sociales sont différentes, parfois divergentes, et peuvent, très logiquement, mener à des conflits épineux. Mais la postmodernité, contrairement à la posthistoire ou à la société postindustrielle de Bell, n'évacue pas le conflit ni ne le déplore et accepte sa présence dans le monde, sans moralisme inutile.
Quelle modernité réfute la postmodernité ?
Si la postmodernité (PM) n'est ni la posthistoire ni la société postindustrielle, qu'est-elle et quelle modernité remplace-t-elle ? Les textes aussi nombreux que divers qui tentent de cerner l'essence de la PM, ne sont pas unanimes à désigner et définir cette modernité, qui, en toute logique, est chronologiquement antérieure à la PM. Plusieurs “modernités” sont concernées, nous explique Welsch ; d'abord celle de la Neuzeit (l'âge moderne, les Lumières, la “dialectique de la Raison”, etc.) ; Habermas s'insurge contre la PM, précisément parce qu'elle s'oppose au “grand projet de l'Aufklärung”, dans ses dimensions scientifiques comme dans ses dimensions morales. Karl Heinz Bohrer (7), pour sa part, estime que la PM réagit contre la modernité esthétique du XIXe. Pour Charles Jencks, le grand historien américain des mouvements en architecture (8), la PM (architecturale) est une réaction au rationalisme utilitariste et fonctionnaliste (Mies van der Rohe, École de Chicago) de l'architecture du XXe siècle. Mais Welsch préfère s'en tenir aux définitions de Jean-François Lyotard : la modernité, que dépasse la PM, a commencé avec le programme cartésien visant à soumettre la nature (les faits organiques) à un “projet géométrique”, pour se poursuivre, à un niveau philosophique et moral, dans les “grands récits” du XVIIIe et du XIXe (l'émancipation de l'Homme, la téléologie hégélienne de l'Esprit, etc.).
La définition de Lyotard
Cette perspective de Lyotard, qui enferme dans le concept “moderne” le cartésianisme, le newtonisme, les mécanicismes des XVIIe et XVIIIe siècles, les Lumières, l'hégélianisme et le marxisme, a été fructueuse ; on lui a donné des ancêtres, notamment l'augustinisme politique, cherchant à “construire” une Cité parfaite et attribué un dénominateur commun : le projet d'élaborer une mathesis universalis, de disséquer la nature (Bacon) et d'épouser le “pathos du renouveau radical”. Chez Descartes, la métaphore de la ville illustre parfaitement l'enjeu du projet de mathesis universalis et du pathos du renouveau ; les villes anciennes, dit Descartes, sont des enchevêtrements non coordonnés ; l'architecte moderne doit tout détruire, même les éléments qui, isolés, sont beaux, pour reconstruire tout selon un plan rationnel, afin de créer une cohérence rationnelle parfaite et à biffer les imperfections organiques. Résultat : l'uniformité atone des villes de béton contemporaines. La modernité à évacuer, dans les perspectives de Lyotard, de Welsch et des architectes postmodernes, c'est celle qui a prétendu, jadis, gommer toutes les particularités au bénéfice d'une méthode, d'un projet, d'une histoire (récapitulative de touteS les histoireS locales et particulières).
Une opposition deux fois centenaire au projet de “mathesis universalis”
Le cartésianisme universaliste a eu ses adversaires dès le XVIIIe siècle. Vico rejette l'image mobilisatrice du progrès au profit d'une conception cyclique de l'histoire ; vers 1750, année-clef, Rousseau, dans son Discours sur les Sciences et les Arts, critique le programme scientifique du cartésianisme et Baumgarten, dans son Aesthetica, réclame une « compensation esthétique » à la sécheresse rationaliste. Depuis, les critiques se sont succédé : Schlegel en appelle à une révolution esthétique ; Baudelaire, Nietzsche et Gottfried Benn, chacun à leur manière, célèbrent l'art comme « espace de survie dans des conditions invivables », comme réponse à l'aridité cartésienne/rationaliste/technocratique. Mais, les réponses de la Gegen-Neuzeit, de la contre-modernité qui se déploie de 1750 à nos jours, se veulent également exclusives, radicales et universelles. Le schéma unitaire et monolithique, sous-jacent à la modernité cartésienne n'est pas éliminé. Au contraire, les courants de la Gegen-Neuzeit ne font qu'ajouter un zeste d'esthétique à un monde qui ne cesse d'amplifier, d'accroître et de dynamiser les forces relevant de la Neuzeit cartésienne. Chez Vico et Rousseau, le salut ne peut provenir que d'un et un seul renversement radical de perspective ; ils ne comprennent pas que leur solution de rechange n'est qu'une possibilité parmi plusieurs possibilités et ils affirment détenir la clef de la seule voie de salut.
Le “saut qualitatif” de la physique du XXe siècle
La nécessité qui s'impose est donc de procéder à un “saut qualitatif”, de ne pas répondre au programme de la modernité par un programme aussi global et aussi fermé sur lui-même. Vico, Rousseau, les Romantiques, ont certes deviné intuitivement les pistes qu'il s'agissait d'emprunter pour échapper à l'enfermement de la modernité/Neuzeit, mais ils n'ont pas su exprimer leur volonté par un programme aussi radical et complet, aussi scientifique et concret, aussi clair et pragmatique, que celui de la dite modernité.
Leurs revendications apparaissaient trop littéraires, pas assez scientifiques (malgré l'impact des médecines romantiques, des recherches sur les maladies psychosomatiques, etc.). La réaction contre la Neuzeit semblait n'être qu'une réaction passionnelle et émotive contre les sciences pratiques et physiques, déterminées par les méthodes mécanicistes de Newton et de Descartes. Cela changera dès le début du XXe siècle. Grâce aux travaux des plus éminents phycisiens, les concepts de pluralité et de particularité ne sont plus catalogués comme des manies littéraires mais deviennent, dans le champ scientifique luimême, des valeurs dominantes et incontournables. Partant des domaines des sciences physiques et biologiques, ces concepts glisseront petit à petit dans les domaines des sciences humaines, de la sociologie et de la philosophie.
La Neuzeit s'était prétendue scientifique : or voilà que le domaine scientifique, impulsé au départ par la modernité cartésienne, révise radicalement les a priori de la Neuzeit et adopte d'autres assises épistémologiques. Plus question de raisonner à partir de totalités fermées sur elle-mêmes, homogènes et universelles. Ouvertures, hétérogénéités et particularités expliquent désormais la trame complexe et multiple de l'univers. La théorie restreinte de la relativité chez Einstein induit les philosophes à admettre qu'il n'y a plus aucun concept de totalité qui soit acceptable ; il ne reste plus que des relations entre des systèmes indépendants les uns des autres dans la simultanéité ; l'action du temps, de surcroît, rend ces simultanéités caduques et éphémères. Heisenberg démontre, par sa théorie de la Unschärferelation (relation d'incertitude), que les grandeurs définies dans un même système de relations ne peuvent jamais être déterminées de façon figée et simultanée. Finalement, Gödel, par son axiome d'incomplétude, ruine définitivement le rêve de la modernité et des universalismes, celui de construire une mathesis universalis, puisque toute connaissance est limitée, par définition.
Une pluralité de modèles et de paradigmes
Cette révolution dans les sciences physiques se poursuit toujours actuellement : la théorie des fractales de Mandelbrot (fonctions discontinues en tous points), la théorie des catastrophes chez Thom, la théorie des structures dissipatives chez Prigogine, la théorie du chaos synergétique de Haken, etc., confirment que déterminisme et continuité n'ont de validité que dans des domaines limités, lesquels n'ont entre eux que des rapports de discontinuité et d'antagonisme. D'où le réel n'est pas agencé selon un modèle unique mais selon des modèles différents ; il est structuré de manière conflictuelle et dramatique ; nous dirions “tragique”, parce qu'il ne laisse plus de place désormais aux visions iréniques, bonheurisantes et paradisiaques que nous avaient proposées les sotériologies religieuses et laïques.
Il n'est plus possible de proposer sérieusement un programme valable pour tous les hommes en tous les lieux de la planète, puisque nous nous acheminons, sous l'impulsion de l'épistémologie physique en marche depuis le début du siècle, vers l'acception d'une pluralité de modèles et de paradigmes, en concurrence les uns avec les autres : les solutions simples, univoques, monopolistiques, universalistes, figées et exclusives relèvent dorénavant du rêve, non plus du possible. La philosophie postmoderne prend donc le relais des sciences physiques contemporaines et tente de transposer dans les consciences et dans le quotidien ce pluralisme méthodologique.
Postmodernité anonyme et postmodernité diffuse
Comme les “méta-récits”, critiqués par Lyotard, étaient monopolistiques et universalistes dans leur essence et dans leur projet, la physique du XXe siècle leur ôte le socle sur lequel ils reposaient. Mais, tout comme les réactions du XVIIIe et du XIXe, les réactions contemporaines à l'encontre des reliquats des méta-récits sont diverses et souvent imprécises. Pour Welsch, la stratégie postmoderne qui prend le relais de l'épistémologie scientifique est précise et solide. Face à cette précision et cette solidité, se positionnent d'autres stratégies postmodernes, nous explique Welsch, qui n'en ont ni la rigueur ni la force ; celle de la postmodernité anonyme qui englobe les théories et travaux qui ne se définissent pas proprement comme postmodernes mais se moulent, consciemment ou inconsciemment, sur l'épistémologie pluraliste induite par les sciences physiques ; la palette est large : on peut y inclure Wittgenstein, Kuhn (9), Feyerabend (10), l'herméneutique de Gadamer, le “post-structuralisme” de Derrida et de Deleuze, etc. Ensuite, il y a la postmodernité diffuse ; c'est celle que vulgarisent la grande presse et les “feuilletonistes”, qui profitent de l'effondrement de la modernité rigide pour parler de postmodernité sans avoir trop conscience de ses enjeux épistémologiques réels. C'est la postmodernité du pot-pourri, d'un Disneyland intellectuel ; c'est un irrationalisme contemporain qui ne va pas à l'essentiel comme n'allait pas à l'essentiel une quantité de romantiques réagissant contre le cartésianisme.
Pour Welsch, la postmodernité précise, scientifique, consciente de la rupture signalée par les sciences physiques, s'avérera efficiente, tandis que la PM anonyme demeurera imprécise et la PM diffuse, contre-productive. Seule la PM précise emporte son adhésion, car elle est systématique, cohérente, porteuse d'avenir. Pour Welsch, la “modernité du XXe siècle”, c'est la scientificité qui annonce la postmodernité, qui consomme la rupture avec la rigidité monopolistique et universaliste de la modernité/Neuzeit. La postmodernité qui prend le relais de la “modernité du XXe siècle” est ouverte à l'innovation, n'est pas strictement réactive à la mode rousseauiste ou romantique.
Or, on pourrait formuler une objection : les technologies modernes, phénomènes du XXe siècle, contribuent à uniformiser la planète , restant du coup dans la même logique que celle de la Neuzeit. Face à cet état de choses, il convient d'adopter le langage suivant, dit Welsch : quand les technologies s'avèrent uniformisantes, elles sont au service d'une logique politique issue de la Neuzeit et sont ipso facto contestées par les postmodernes conséquents ; quand, en revanche, elles fonctionnent dans le sens d'une pluralité, elles participent à la dissolution des pesanteurs modernes et sont dès lors acceptées par les postmodernes. Ce n'est pas une technologie en soi qui est bonne ou mauvaise, c'est la logique au service de laquelle elle fonctionne qui est soit obsolète soit grosse d'avenir. Welsch expose cette problématique de sang froid, sans dire — même si c'est implicite — qu'il est grand temps de se débarrasser des logiques politiques issues de la Neuzeit... La logique de la discontinuité, du tragique et de la dissipativité prigoginienne, etc., est passée de la science à la philosophie ; il faut maintenant qu'elle passe de la philosophie à la politique et au quotidien. Pour cela, il y aura bien des résistances à briser.
Un parallèle évident avec la “Nouvelle Droite”
Ce que propose Welsch dans son livre (UPM), et qui enchante Armin Mohler, c'est une chronologie de l'histoire intellectuelle occidentale et européenne, dans laquelle notre mouvement de pensée peut tout entier s'imbriquer. Dans divers articles de Nouvelle École, Giorgio Locchi a suggéré, lui aussi, une chronologie, marquée de « périodes axiales » (Jaspers, Mohler, etc.) (11), où les grandes idées motrices, dont le christianisme, passent par le stade initial du mythe, pour aboutir, via un stade idéologique, à un stade scientifique. L'incapacité du christianisme à accéder à un stade scientifique cohérent annonce l'avènement d'un autre mythe, incarné par de multiples linéaments diffusés et véhiculés par la musique européenne, par le romantisme et par Wagner, mythe qui devra se muer en idéologie et en science.
L'effondrement des fascismes quiritaires, au cœur aventureux, a provoqué, explique Locchi (12), la disparition du stade “idéologique”, tandis que la percée de nature scientifique poursuivait son chemin de Heisenberg à Prigogine, Haken, etc. Le surhumanisme — Locchi utilise ce vocable pour désigner les réactions idéologiques et littéraires contre la modernité — a donc son mythe, wagnérien et nietzschéen, et sa science, la physique contemporaine, mais pas son articulation politique. Si l'on procède à la fusion des chronologies suggérées par Locchi et par Welsch, on obtient un instrument critique d'orientation, qui est de grande valeur pour comprendre la dynamique de notre siècle, sans devoir retomber dans une paraphrase stérile des fascismes.
Or, pour les derniers défenseurs de la modernité, dont Habermas (chez qui Welsch perçoit tout de même d'importantes concessions à la postmodernité, parce que Habermas ne peut renoncer aux acquis de la science physique moderne, née pendant la Neuzeit, et parce que sa théorie de “l'agir communicationnel” implique tout de même un relâchement des rigidités monopolistiques), est “fascisme” ou “fascistoïde” tout ce qui critique la modernité et ses avatars ou s'en distancie. Georg Lukacs, dans Die Zerstörung der Vernunft, stigmatise comme “irrationalismes” toutes les philosophies, sociologies et nouveautés littéraires qui s'opposent au déterminisme rationaliste et matérialiste du grand récit marxiste (né des grands récits hégélien et anglo-libéral).
Notre vision du monde doit s'asseoir dans l'avenir sur 2 chronologies : celle de Locchi et celle de Welsch, tout en maîtrisant correctement celles, adverses, de l'École de Francfort et d'Habermas (cf. Horkheimer et Adorno, La dialectique de la Raison), ainsi que celle du marxisme particulier de Lukacs. Une attention spéciale doit également être réservée aux chronologies néolibérales (cf. Alain Laurent, L'individu et ses ennemis, LP/Pluriel, 1987), hostiles aux dimensions holistes de tous ordres. Le débat idéologique est certes la confrontation d'idées et de thématiques idéologiques différentes ; il est aussi et surtout confrontation entre des chronologies différentes, des visions de l'histoire où sont mises en exergue des valeurs précises, au moment où elles font irruption dans l'histoire : dans le cas de l'historiographie libérale/néo-marxiste, c'est le triomphe des stratégies de mathesis universalis, assorties d'un déterminisme physicaliste ; pour les néo-libéraux, c'est l'avènement de l'individu et des méthodologies individualistes en sociologie et en économie. Pour nous, ce sont les étapes d'une pensée plurielle, où l'ouverture d'esprit est due à la reconnaissance des innombrables possibilités en jachère dans la nature et dans l'histoire ; autant de différences, d'ordre somatique ou d'ordre culturel, autant de virtualités.
De l'épistémologie mécaniciste à l'épistémologie botaniciste
Si nous récapitulons l'histoire intellectuelle de l'Europe occidentale et germanique, nous constatons, entre 1750 et le milieu du XIXe siècle, l'émergence d'une quantité de réactions dans le désordre, contre les projets de mathesis universalis, contre la “volonté géométrique” de la modernité. À la logique mécanique et géométrique, le Sturm und Drang allemand, le romantisme, le Kant de la Critique de la faculté de juger, Schiller, Burke, les doctrinaires allemands de la vision organique de la politique et de l'histoire opposent une autre logique, une logique botaniciste, qui pose une analogie entre l'arbre (ou la plante vivante) et l'État (ou la Nation) au lieu de poser l'analogie cartésienne/newtonienne entre l'État et un système d'horlogerie, entre les lois du politique et les lois régissant les mouvements de la matière morte (13). La rupture épistémologique de la fin du XVIIIe, qui enclenche l'émergence de la pensée organiciste et vitaliste, amorce une pluralité, dans le sens où, désormais, 2 logiques, l'une organiciste/vitaliste, l'autre rationaliste/ mécaniciste, vont se juxtaposer. Mais la physique, perçue comme socle ultime du réel, demeure ancrée dans ses présupposés newtoniens ; aucune alternative sérieuse ne peut encore remplacer, sur le plan scientifique, les assises newtoniennes et cartésiennes de la physique. Georges Gusdorf, dans ses études sur le “savoir romantique”, montre comment le passage à une pensée “glandulaire” après l'impasse d'une pensée “cérébro-spinale”, a suscité un intérêt pour la biologie, la cénesthésie (14), la psychologie et les maladies psycho-somatiques, l'anthropocosmomorphisme de Carus et Oken (15), etc. Dénominateur commun de cette démarche : tout être vivant, homme, animal ou plante, possède un noyau identitaire propre, non interchangeable, unique ; au départ des noyaux identitaires, lieux d'irradiation du monde, un pluriversum, un monde pluriel, surgit, qui ne se laisse plus violenter par des schémas géométriques.
L'irruption de Nietzsche
À la fin du XIXe siècle, la scène philosophique européenne connaît l'irruption de Nietzsche. Celui-ci, se situant à la charnière entre la rupture épistémologique romantique/organiciste/vitaliste, magistralement étudiée par Gusdorf, et la rupture épistémologique provoquée par les découvertes de la physique au début du XXe, rejette les grands récits de l'Aufklärung et se moque, en stigmatisant le wagnérisme, des insuffisances des réponses romantiques. Mais son œuvre ne brise pas encore totalement le semblant d'évidence que revêtent les positivismes/rationalismes, détenteurs de la seule théorie physique qui tienne à l'époque. D'où, de la part des chrétiens et des positivistes, le reproche d'incohérence et de contradiction adressé à l'œuvre de Nietzsche ; pour ces perspectives, Nietzsche est fou ou Nietzsche est un philosophe incomplet ; il nous lègue une logique anarchique qui permet de tout casser (au marteau, pour reprendre son expression). Ce sont notamment les interprétations de Deleuze et de Kaulbach (16). Pour Reinhard Löw, cette interprétation du message nietzschéen est insuffisante, car s'il est vrai que Nietzsche souhaite “casser” au marteau certaines idoles philosophiques, son entreprise de démolition vise essentiellement les «psittacismes», c'est-à-dire les discours qui répètent le schéma eschatologique et providentialiste chrétien, en lui conférant des oripeaux idéalistes (chez Hegel) ou matérialistes (chez les marxistes et quelques darwiniens). L'avènement de l'esprit, du prolétariat, d'un homme moins “singe”, ne sont que des novismes calqués sur un même schéma. Schéma qu'il s'agit de dissoudre, afin qu'il ne puisse plus produire de “récits” aliénants parce que répétitifs et non innovateurs. La positivité de Nietzsche, différente de sa négativité de philosophe au marteau, consiste, écrit Löw (17), à nous éduquer, afin que nous ne continuions pas, à l'infini, à ajouter des psittacismes aux psittacismes qui nous ont précédés.
La logique du XIXe a donc été, dans une première phase, de rompre le psittacisme more geometrico du projet cartésien de mathesis universalis, puis, avec Nietzsche, de signaler le danger permanent du psittacisme pour, enfin, découvrir, avec les physiciens du début du XXe, que la trame la plus profonde du réel n'autorise, en fin de compte, aucune forme de psittacisme et que le mythe de la continuité linéaire est une illusion humaine. La post-modernité (la “précise” selon la classification de Welsch) prend acte de cette évolution et veut en être l'héritière. Mais franchir le cap d'une telle prise de conscience est dur : entre les fulgurances aphoristiques de Nietzsche et la révolution intellectuelle impulsée par la physique du XXe siècle, la littérature et la poésie de la fin du XIXe siècle a effectué un travail de deuil, le deuil des “totalités perdues”, des référentiels évanouis, sur fond d'angoisse et de nostalgie. Chez Musil, représentant emblématique de cette angoisse, on découvre le constat que la modernité, arrivée à terme au moment de la “Belle époque”, n'est pas le paradis escompté ; c'est, au contraire, le règne de la mort froide, de la rigidité cadavérique, laquelle s'abat sur une humanité victime d'une “épidémie géométrique”.
L'apport de Lyotard
Revenons à Welsch, disciple de Lyotard, philosophe français contemporain qui, en 1979, publie aux éditions de Minuit La condition postmoderne. Que pense Welsch de cet ouvrage qui indique clairement la thématique philosophique qu'il entend cerner ? Il en pense du bien, mais non exagérément. Le livre pose les bonnes questions, dit-il, mais ne les explicite guère. Pour Welsch, il faut “savoir faire quelque chose du livre”, en tirer l'essentiel, profiter de la perspective qu'il nous ouvre. Quant au reste de l'œuvre de Lyotard, il abonde dans le sens d'une postmodernité précise, héritière de la physique du XXe siècle. Chez Lyotard, la postmodernité n'apparaît pas comme un irrationalisme mais comme une rupture par rapport à la modernité qui critique la raison de la modernité avec les armes de la raison ; comme une rupture qui ne rejette pas la raison pour la remplacer par des instances diverses, posées arbitrairement comme moteur du monde et des choses. C'est ici que les démarches de Lyotard et de Welsch se distinguent de celle d'un Bergfleth, qui remplace la raison et la rationalité moderne/francfortiste par l'éros, la cruauté, la passion, l'amour, etc. tels que les envisagent Artaud, Bataille, Klages, etc.
Du point de vue plus directement (méta)politique, Lyotard nous enseigne que les totalités, et, partant, les universalismes, sont toujours les produits absoluisés de sentiments ou d'intérêts particuliers ; que ce que le groupe ou l'individu x proclame comme universel est l'absoluisation de ses intérêts particuliers. D'où être démocrate et tolérant, c'est refuser cette logique d'absoluisation, porté par un prosélytisme sourd aux particularités des autres. Refuser les totalités et les universalismes, c'est aller davantage au fond des choses, c'est respecter les particularités des peuples, des classes, des individus. Penser le pluriel, c'est être davantage “démocrate” que ceux qui uniformisent à outrance. Le monde est plurivers ; il est un pluriversum et ne saurait être saisi dans toute son amplitude par une et une seule logique.
L'apport de Gianni Vattimo
Gianni Vattimo, dans La fin de la modernité (Seuil, 1987), nous explique que la modernité, c'est le “novisme”, démarche dont s'était moqué Nietzsche, père de l'ère postmoderne. Le “novisme” est produit de l'historicisme ; il est répétition du même vieux schéma linéaire métaphysique et chrétien sous un travestissement tantôt idéaliste, tantôt matérialiste. À ces novismes d'essence providentialiste. Nietzsche a successivement répondu par 2 stratégies ; d'abord, celle qui consistait à affirmer des valeurs éternelles transcendant l'histoire, transcendant les prétentions des historicismes qui croyaient pouvoir les dépasser ou les contourner ; ensuite, en affirmant l'éternel retour, démenti définitif aux providentialismes. La postmodernité est donc l'absence de providentialisme, la disparition des réflexes mentaux et idéologiques dérivés des providentialismes métaphysiques et chrétiens. Après Nietzsche, Heidegger prend le relais, explique Vattimo, et nous enseigne de ne pas dépasser (überwinden) la modernité laïque/ métaphysique/providentialiste, mais de la contourner (verwinden) ; en effet, l'idée d'un dépassement garde quelque chose d'eschatologique, donc de métaphysique/chrétien/moderne. L'idée d'un contournement suggère au contraire le passage tranquille à une autre perspective, qui est plurielle et non plus monolithique, herméneutique (dans le sens où elle “interprète” le réel au départ de données diverses, dont les logiques intrinsèques sont hétérogènes sinon contradictoires) et non plus dogmatique. Le futurisme, en dépit de ses apparences “novistes”, est un phénomène postmoderne, affirme Vattimo, parce qu'il entremêle différents langages et codes, permettant ainsi une ouverture sur plusieurs univers culturels, développe une multiplicité de perspectives sans chercher à les synthétiser, à les soumettre à un idéal (violent ?) de conciliation. La modernité, chez Vattimo, n'est pas rejetée, elle est absorbée comme composante d'une postmodemité marquée du signe du pluriel.
L'apport de Michel Foucault
L'apport de Foucault à la pensée contemporaine, c'est surtout la suggestion d'une histoire intellectuelle nouvelle, d'une chronologie de la pensée qui bouleverse les conformismes. Foucault voit la succession de diverses ruptures dans l'histoire intellectuelle européenne depuis la Renaissance ; au XVIIe, l'Europe passe de la tradition au classicisme ; au XIXe, du classicisme au modernisme (et ici le terme “moderne” prend une autre acception que chez Welsch et Lyotard, où la notion de “modernité” recouvre plus ou moins la notion foucaldienne de “classicisme”). Il est très intéressant de noter, dit Welsch, que Foucault oppose la “doctrine des ordres” de Pascal au projet de mathesis universalis de Descartes. Chez Pascal, en effet, l'ordre de l'Amour, l'ordre de l'Esprit et l'ordre de la Chair ont chacun leur propre “rationalité” ; la logique de la foi n'est pas la logique de la raison ni la logique de l'action. D'où la pensée de Pascal postule des “différences” et non une unique mathesis universalis ; elle est donc foncièrement différente de la tradition monolithique de Descartes qui a eu le dessus en France. Foucault nous indique que Pascal représente une potentialité de la pensée française qui est demeurée inexploitée.
Outre Pascal, Gaston Bachelard influence Foucault dans son élaboration d'une histoire intellectuelle de l'Occident. Pour Bachelard, l'évolution des sciences et du savoir ne procède pas de façon continue (linéaire), mais plutôt par crises et par “coupures épistémologiques”, par fulgurances. Chacune de ces coupures ou fulgurances provoque un renversement du système du savoir ; elles induisent de brèves “périodes axiales”, où les institutions, les coutumes, les pratiques politiques doivent (ou devraient) s'adapter aux innovations scientifiques. Foucault a retenu cette vision rupturaliste de Bachelard, où des “différences” fulgurent dans l'histoire, et sa pensée est ainsi passée d'une phase structuraliste à une phase potentialiste (18). Le structural structuralisme, avec Lévy-Strauss, avait tenté de trouver Le Code universel, l'invariant immuable (lui se cachait quelque part derrière la prolixité des faits et des phénomènes. En cela, le structuralisme était en quelque sorte le couronnement de la modernité. Foucault, dans la première partie de son œuvre, a souscrit à ce projet structuraliste, pour découvrir, finalement, que rien ne peut biffer, supplanter, régir ou surplomber l'hétérogénéité fondamentale des choses. Aucune “différence” ne se laisse reconduire à une unité quelconque qui serait LA dernière instance. Une telle unité, hypothétique, baptisée tantôt mathesis universalis, tantôt “Code”, participe d'une logique de l'en l'enfermement, refus têtu et obstiné du divers et du pluriel.
L'apport de Gilles Deleuze
Gilles Deleuze entend affirmer une philosophie de la “libre différence”. Son interprétation de Nietzsche (19) révèle clairement cette intention : « ... car il appartient essentiellement à l'affirmation d'être elle-même multiple, pluraliste, et à la négation d'être une, ou lourdement moniste » (p. 21). « Et dans l'affirmation du multiple, il y a la joie pratique du divers. La joie surgit, comme le seul mobile à philosopher. La valorisation des sentiments négatifs ou des passions tristes, voilà la mystification sur laquelle le nihilisme fonde son pouvoir » (p. 30). Affirmer, c'est donc démolir gaillardement les rigidités lourdement monistes au marteau, c'est briser à jamais la prétention des unités, des totalités, des instances décrétées immuables par les “faibles”. Une “différence” n'indique pas une unité sous-jacente mais au contraire des autres différences. D'où, pour Deleuze comme pour Foucault, il n'y a pas de Code mais bien un chaos informel, qu'il s'agit d'accepter joyeusement. Ce chaos prend, chez Deleuze, le visage du rhizome. Métaphore organiciste, le rhizome [filament racinaire en réseau] se distingue de l'arbre des traditions romantiques, dans le sens où il ne constitue pas une sorte d'unité séparée d'autres unités semblables ; le rhizome est un grouillement en croissance ou en décroissance perpétuelle, qui s'empare des chaînes évolutives étrangères et suscite des liaisons transversales entre des lignes de développement divergentes ; c'est un fondu enchaîné, un dégradé de couleur qui se mixe à un autre dégradé. Deleuze, bon connaisseur de Leibniz, prend congé ici de la philosophie des monades pour affirmer une philosophie nomade ; une philosophie des rhizomes nomades qui produisent des différences non systématiques et inattendues, qui fragmentent et ouvrent, abandonnent et relient, différencient et synthétisent simultanément (UPM, p. 142).
L'apport de Jacques Derrida
L'apport de Derrida démarre avec un texte de 1968, « La fin de l'Homme », repris dans une anthologie intitulée Marges de la philosophie. Derrida y explique que la pluralité est la clef de l'au-delà de la métaphysique. La pluralité, c'est savoir parler plusieurs langages à la fois, solliciter conjointement plusieurs textes. Le parallèle est aisé à tracer avec la “physiologie” de Nietzsche, qui prend acte des multiplicités du monde sans vouloir les réduire à un dénominateur commun mutilant (20). Le réel, ce sont des pistes qui traversent des champs différents, ce sont des enchevêtrements. Différentiste et non rupturaliste, Derrida voit la trame du monde comme un processus de différAnce, de dissémination, producteur de différEnces. Derrida nous impose cette subtilité lexicographique (le A et le E) non sans raison. La différAnce implique un principe actif de différentiation par dissémination, tandis que parler de différEnce(s) peut laisser suggérer que le monde, le réel, soit une juxtaposition sans dynamisme et sans interaction de différEnces non enchevêtrées. Derrida veut ainsi échapper à une pensée musa musaïque où les différEnces seraient exposées les unes à côté des autres comme des pièces dans une vitrine de musée. Mais le souci de montrer l'enchevêtrement de toutes choses — avec, pour corollaire leur non-réductibilité à quelqu'unum que ce soit — conduit Derrida à affirmer que la différAnce productrice de différEnces finit par produire une panade d'indifférEnce, comparable à l'hypertélie obèse de Baudrillard. Dans cette panade peuvent s'engouffrer les vulgarisateurs de la “PM diffuse”, critiquée par Welsch (cf. supra).
Mais même si Derrida se rétracte quelque peu avec sa théorie de la « panade d'indifférEnce » (qui a forcément des relents d'universalisme, puisque les différEnces y sont malaxées), même si, par ailleurs, il évoque la “mystique juive” pour se mettre au diapason de la farce qu'est le “réarmement théologique” du “nouveau philosophe” BHL, nous n'oublions pas qu'il a dit un jour qu'« est chimère tout projet de langage universel ». Mieux : il a posé l'équation Apocalypse = mort = vérité. L'Apocalypse, prélude à un monde meilleur, est la mort parce qu'elle prétend être la vérité et que la vérité n'est qu'un euphémisme pour désigner la mort. La vérité, c'est le vœu, l'utopie, de la présence accomplie, du présentisme où tout devenir est enrayé, stoppé, où la différAnce cesse d'être productrice de différEnces. Pour Derrida, comme pour Pierre Chassard, analyste néo-droitiste de la pensée nietzschéenne (21), il faut déconstruire le complexe “apocalypse”, le providentialisme producteur de psittacismes, dérivé des vulgates platonicienne et chrétienne.
Postmodernité “soft” et postmodernité “hard”
On peut dire que Lyotard et Derrida partagent une conception commune : pour l'un comme pour l'autre, la postmodernité n'est pas une époque nouvelle, ce n'est pas l'avènement d'une espèce de parousie de nouvelle mouture, survenue après une rupture/catastrophe, mais le passage, le contournement (Heidegger/Vattimo) inéluctable qui nous mène vers une attitude de l'esprit et des sentiments, qui a toujours déjà été là, qui a toujours été virtualité, mais qui, aujourd'hui, se généralise, malgré les tentatives “réactionnaires” que sont le “réarmement théologique”, assorti de son culte de la “Loi” et corroboré par les démarches anti-68 de Ferry et Renaut. La postmodernité, ce sont des ouvertures aux pluralités, aux diversifications.
Peut-on parler de postmodernité soft et de postmodernité hard ? La distinction peut paraître oiseuse voire mutilante mais, par commodité, on pourrait qualifier de soft la PM différentiste de Deleuze et de Derrida, avec sa pensée nomade et son indifférence finale, et de hard la PM rupturiste de Lyotard. Dans ce cas, cette double qualification désignerait, d'une part, un différentialisme qui s'enliserait dans l'indifférence, dans la purée, la panade du “tout vaut tout” et retournerait subrepticement au Code, un Code non plus intégrateur, rassembleur et totalisant, mais un Code négatif, discret, non intégrant et non agonal. Pour un Lyotard, une rupture signale toujours l'incommensurabilité d'une différEnce, même si cette différEnce n'est pas éternelle, immuable. Les ruptures signalent toujours une densité particulière, laquelle se recompose sans cesse par télescopage avec des faits nouveaux. L'hypertélie de Baudrillard n'estelle pas analogue, sur certains points, avec la chute dans l'indifférence (Derrida) et la nomadisation deleuzienne ? La fin est là, nous explique Baudrillard dans Amérique (Grasset, 1986), comme quand la différAnce, à être trop féconde, ne produit plus que de l'indifférEnce, de la métastabilité.
Une dynamique de la transgression
[Leibniz, philosophe des monades, a été réinterprété récemment par G. Deleuze. Celui-ci voit en lui le philosophe des “plis” et des “replis”, lesquels recèleraient des potentialités en jachère, prêtes à intervenir sur la trame du réel puis à se retirer ou se disperser]
Contre l'ennui sécrété par la juxtaposition de métastabilités ou par le règne d'une grande et unique métastabilité, il faut instrumentaliser une logique transversale, qui brise les homogénéités fermées et force leurs séquelles à se recomposer de manières diverses et infinies. Sur le plan idéologique et politique, c'est pour une logique de la transgression qu'il faut opter, une logique qui refuse de tenir compte des enfermements imposés par les idéologies dominantes et par les pratiques politiciennes ; Marco Tarchi, leader de la ND italienne, a théorisé la « dynamique de la transgression » (22), laquelle part du constat de l'hétérogénéité fondamentale des discours politiques ; en effet, existe-t-il une gauche et une droite ou des gauches et des droites ? Toutes ces strates ne se combinent-elles pas à l'infini et n'est-on pas alors en droit de constater que la seule réalité qui soit en dernière instance, c'est un magma de desiderata complexes. La logique de la transgression va droit à ce magma et contourne les facilités dogmatiques, les totems idéologiques et partisans qui résument quelques bribes de ce magma et érigent leurs résumés en vérités intangibles et pérennes. La logique et la dynamique de la transgression postulent de ne rejeter aucun fait de monde, de combiner sans cesse des logiques décrétées antagonistes, d'agir en conciliant des desiderata divergents, sans pour autant mutiler et déforcer ces desiderata. La dynamique de la transgression prend le relais de la vision de la coincidentia oppositorum de Maître Eckhardt et de Nicolas de Cues.
Des traductions politiques du défi postmoderne sont-elles possibles ?
Notre mouvement de pensée, en constatant que le chaos synergétique des physiciens modernes s'est transposé du domaine des sciences naturelles au domaine de la philosophie, doit se donner pour tâche de faire passer le message de la physique moderne dans l'opinion puis dans la sphère du politique. Ce serait répondre à sa vocation métapolitique. Passer dans le domaine du politique et de la politique, c'est travailler à substituer au droit individualiste moderne un droit adapté aux différences humaines, que celles-ci soient d'ordre social, ethnique, régional, etc. ; c'est travailler à ruiner les idéologies économiques modernes et à leur substituer une économie basée sur la « dynamique des structures » (François Perroux) ; c'est travailler à l'avènement de nouvelles formes de représentation politique, où les multiples facettes de l'agir humain seront mieux représentées (modèles : le Sénat des régions et des professions de De Gaulle ; les projets analogues du Professeur Willms, etc.).
Le travail à accomplir est énorme, mais lorsque l'on constate que les linéaments de notre vision tragique du monde et de l'univers sont présents partout, il n'y a nulle raison de désespérer...♦ Wolfgang Welsch, Unsere postmoderne Moderne, VCH – Acta Humantora, Weinheim, 1987, 344 p.► Robert Steuckers, Vouloir n°54/55, 1989.
◘ Notes :- (1) Anne-Marie Duranton-Crabol, Visages de la Nouvelle Droite : Le G.R.E.C.E. et son histoire, Presses de la Fondation Nationale des sciences politiques, Paris, 1988.
- (2) Cf. Nouvelle École n°30, 31-32 (Wagner), n°40 (Jünger), n°41 (Thomas Mann), n°35 (Moeller van den Bruck), n°37 (Heidegger), n°44 (Carl Schmitt). Cf. Éléments n°40 (Jünger).
- (3) Georges Gusdorf, Fondements du savoir romantique, Payot, 1982. G.G., L'homme romantique, Payot, 1984. G.G., Le savoir romantique de la nature, Payot 1985.
- (4) Éditions Mme, Crellestrasse 22, Postfach 327, D1000 Berlin 62.
- Parmi les livres du trio non-conformiste Matthes, Mattheus et Berglleth, citons : Gerd Bergfleth et alii, Zur Kritik der palavernden Aufklärung, 1984 (cf. recension in Vouloir n°27) ; Gerd Bergfleth, Theorie der Verschwendung : Einführung in Georges Batailles Antiökonomie, 1985, 2ème éd. Bernd Mattheus & Axel Matthes (Hrsg.), Ich gestatte mir die Revolte, 1985. Bernd Mattheus, heftige stille, andere notizen, 1986. La somme de Mattheus sur Bataille est en 2 volumes : 1) Georges Bataille : Eine Thanatographie, Band I : Chronik 1897-1939 ; 2) Band II : Chronik 1940-1951. Tous ces volumes sont disponibles chez Matthes u. Seitz Verlag, Mauerkircher Strasse 10, Postfach 860528, D-8000 München 86.
- (5) J.-L. Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30 : Une tentative de renouvellement de la pensée politique française, Seuil, 1969.
- (6) Pour Nietzsche, il faut aller au-delà de l'homme (moyen) ; cette quête, cette transgression de la moyenne, c'est le propre du “surhomme” et, partant, de ce que l'on pourrait appeler le “surhumanisme”. Dans les circuits néo-droitistes, chez Giorgio Locchi et Guillaume Faye, le terme “surhumanisme” a été utilisé dans ce sens, dans cette volonté de dégager l'homme de sa définition rationaliste/illuministe trop étriquée eu égard à l'abondante diversité du réel.
- (7) Kart Heinz Bohrer, Die Ästhetik des Schreckens : Die pessimistische Romantik und Ernst Jüngers Frühwerk, Ullstein, Frankfurt a.M., 1983 (2° éd.). Les linéaments de la PM se dessinent déjà, pour l’auteur, dans les visions littéraires de Jünger et dans son refus de l'anthropologie modeme/bourgeoise.
- (8) Pour saisir toute la diversité de la PM architecturale, on se référera au livre de Charles Jencks, Die Postmoderne : Der nette Klassizismus in Kunst und Architektur, Klett-Cotta, 1987. La version anglaise de cette ouvrage est parue simultanément : Post-Modernism, Academy Editions, London, 1987 (adresse : ACADEMY GROUP Ltd, 7/8 Holland Street, London W8 4NA).
- (9) Pour comprendre l'importance de Thomas S. Kuhn sur le plan de l'épistémologie scientifique et de la problématique qui nous intéresse ici, on se référera utilement aux explications que nous donne le philosophe Walter Falk dans 2 de ses livres : 1) Vom Strukturalismus zum Potentialismus : Ein Versuch zur Geschichts- und Literaturtheorie (Alber, Freiburg i.B., 1976, pp. 111 à 120 ; recension dans Vouloir, n°15/16, 1985) et 2) Die Ordnung in der Geschichte : Eine alternative Deutung des Fortschritts (Burg Verlag, Sachsenheim, 1985 ; pp. 111 à 114).
- (10) Outre les ouvrages de Feyerabend lui-même, on consultera Angelo Capecci, La scienza tra fede e anarchia : L'epistemologia di P. Feyerabend, La goliardica editrice, Roma, 1977.
- (11) Pour Mohler, la Konservative Revolution fonde de nouvelles valeurs, qui transcendent les frayeurs et les déceptions du nihilisme occidental ; l'Umschlag de la KR n'affronte plus la décadence avec une volonté de la stopper mais, au contraire, en accélérant au maximum ces tendances de façon à ce qu'elles puissent atteindre le plus rapidement possible leur phase terminale. La KR est en ce sens fondatrice de valeurs nouvelles, tout comme la période autour de – 500 l'était pour les Grecs selon Jaspers qui utilise, lui, le terme Achsenzeit, période axiale (cf. Karl Jaspers, Introduction à la philosophie, UGE/10-18, 1965 ; cf. aussi l'interprétation pertinente qu'en donne John Macquarrie, in Existentialism, Penguin, Harmondsworth, 1973).
- (12) cf. Giorgio Locchi, L'Essenza del Fascismo : Un saggio e un intervista a cura di Marco Tarchi, Edizioni del Tridente, s.l., 1981.
- (13) cf. Barbara Stolberg-Rilinger, Der Staat als Maschine : Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats, Duncker & Humblot, Berlin, 1986 (recension in Vouloir n°37-38-39, 1987).
- (14) Cf. George Gusdorf, L'homme romantique, op. cit., pp. 243 à 245.
- (15) Georges Gusdorf, lbid., pp. 159 à 173.
- Pour davantage de précision quant à la personnalité de Carus, lire : Ekkchard Meffert, Carl Gustav Carus, Sein Leben - seine Anschauung von der Ende, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1986 ; Carl Gustav Carus, Zwölf Briefe über das Erdleben, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1986.
- (16) Friedrich Kaulbach, Sprachen der ewigen Wiederkunft : Die Denksituation des Philosophen Nietzsche und ihre Sprachstile, Königshausen & Neumann, Würzburg, 1985. À propos de ce livre, cf. R. Steuckers, « Regards nouveaux sur Nietzsche », in Orientations n°9, 1987.
- (17) Reinhard Löw, Nietzsche, Sophist und Erzieher : Philosophische Untersuchungen zum systematischen Ort von Friedrich Nietzsches Denken, Acta Humaniora, Weinheim, 1984. À propos de ce livre, cf. R. Steuckers, art. cit. in nota (16).
- (18) À propos du potentialisme de Foucault, cf. Walter Falk, Vom Strukruralismus zum..., op. cit. in nota (9), pp. 120 à 130 ; cf. aussi Walter Falk, Die Ordnung..., op. cit. in nota (9), pp. 114 à 116.
- (19) Gilles Deleuze, Nietzsche, PUF, 1968.
- (20) Helmut Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie : Nietzsches ästhetische Theorie und literarische Produktion, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1985. À propos de ce livre, cf. R. Steuckers, art. cit. in nota (16).
- (21) Pierre Chassard, La philosophie de l'histoire dans la philosophie de Nietzsche, GRECE, Paris, 1975.
- (22) cf. Marco Tarchi, « Dinamica della trasgressione : dal "Né destra né sinistra" all "Se destra e sinistra" », in Trasgressioni n°1, 1986.
-
La femme est le présent de l'homme
Ulysse, dans son périple aventureux sur la mer vineuse, croisa l'île des Sirènes, voluptueuses créatures hybrides, qui usaient de leur charme pour décharner les malheureux marins ensorcelés par leurs chants. Comme tout collégien le sait, le héros, afin d'expérimenter la tentation, sans avoir à y succomber, se fit lier au mât de son navire par ses hommes, qui s'étaient bouchés les oreilles de cire, sur les conseils de Circé.
Notre héros ne désirait pas, manifestement, être « libéré ».
Telle était l' « insensibilité » (à nos yeux) des Anciens – et ce, jusqu'au déluge de larmes qui noya la littérature dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle - qu'ils considéraient que les plaisirs, singulièrement les délices de la sexualité (pour autant que celle-ci se présentait parmi les nourritures terrestres, ou célestes, toujours bonnes à goûter) comme des pièges dans lesquels on avait à perdre plus que la vie.
Le monde contemporain présente d’innombrables paradoxes, dont le moindre n’est certainement pas celui qui juxtapose liberté proclamée et servitude assumée – et peut-être jamais société n’en fut autant pétrie. L’un des plus curieux est celui qui allie le relativisme anthropologique et l’ethnocentrisme décomplexé. Ce dernier regarde avec réprobation aussi bien les aires civilisationnelles étrangères à l’Occident, comme l’Islam, ou les types de sociétés du passé, celles par exemple de l’Antiquité ou du moyen-âge, que l’on refoule dans les ténèbres obscurantiste, non sans en sauver des bribes, quitte à commettre, dans ce cas, de grossiers malentendus. L’homme moderne « parvenu » est tellement imbu de ses réussites matérielles, qui ne sauraient qu’impressionner des esprits infantiles, qu’il a renié la découverte qu’il avait faite, à l’aube de ses conquêtes, de l’altérité des civilisations extra-européennes. Les leçons de Montaigne et de ses successeurs n’ont été utilisées que pour miner le vieil ordre de l’ancien régime. La vision édulcorée du Bon sauvage, idée faussée d’une réalité moins acceptable pour des estomacs fragiles, et même le dénigrement voltairien du pauvre hère souffrant maux et abrutissement dans ses forêts, n’ont servi qu’à asseoir le triomphe de l’hédoniste actuel, sûr de lui, ridiculement persuadé que sa société est, finalement, la seule possible.
Son incapacité à penser l’autre s’illustre singulièrement dans ce qui relève du corps. A vrai dire, si l’on entend par corps le système biochimique qui est, de fait, l’héritier sophistiqué de la mécanique cartésienne, et à partir duquel tout est expliqué, l’âme, le comportement, les choix existentiels, et même la capacité à être libre, on jugera de l’aune par laquelle toute société peut être, selon lui, évaluée. La religion, par exemple, sera une sublimation de l’instinct sexuel, ou bien – ce qui équivaut à ne retenir que le même paradigme – une aliénation préjudiciable à la véritable libération de l’individu. Ce freudisme qui privilégie l’infra humain a envahi les consciences et préside presque toujours à toutes les réformes qui se mêlent de transformer l’homme, ou à l'évaluation de ses besoins.
Le néocapitalisme, aboutissement logique de la marchandisation universelle, qui bouleverse et abolit toutes les inhibitions et les interdits perçus comme des empêcheurs de pousse-au-jouir, ne pouvait présenter à la soif de réalisation personnelle, la libération sexuelle dans une société veuve du religieux, que comme la solution. Celle-ci fut revendiquée en tant que voie vers l’autonomie du moi. Le mot d’ordre, à la fin des années soixante, fut à l’audace de s’abandonner aux forces éruptives de l’érotisme et du sexe. La subversion de soi, et la transgression des codes, devinrent le dogme d’une sacralité séculaire et millénariste (puisque achevant le règne de l’histoire, nécessairement imparfaite, pour s’accomplir dans la geste, ou la gestion utopique des désirs).
La femme, objet attitré du désir, et réputée fragile, crut tenir là une revanche.
Il est maintenant nécessaire, non d’expliquer en quoi la liberté est une fausse valeur, erronée et trompeuse – l’on saisira aisément la vanité d’une démonstration quand il s’agit ici, plutôt, d’une nouvelle religion, d’une nouvelle foi, et partant, d’un nouveau fanatisme – mais de capter le timbre, comme en musique, le ton, le rythme, l’amplitude de ces certitudes qui influent sur les comportements sociétaux ou politiques, et qui se traduisent aujourd’hui dans la tentative totalitaire de créer un nouvel homme en conditionnant cyniquement les enfants des maternelles.
Si nous revenons à la sexualité, présumée maîtresse de nos vies, et somme toute la chose sensible, au monde, la plus délectable, en tout cas la plus captatrice de volonté, si l’on oublie les misérables lubies colportées par les péplums, qui se complaisent à nous transmettre une Antiquité vautrée dans le stupre et la fornication, nous sommes bien stupéfaits de constater que les préjugés déforment la perception des choses, que les sociétés qui nous ont précédés n'étaient animées ni par le désir sexuel (ni d'ailleurs par la nécessité économique), et qu'’il en était exactement le contraire. En règle générale, les sociétés traditionnelles réprouvent la chasse au plaisir. Non qu’elles ne l’éprouvent pas, parfois différemment de nos manières, mais elles sont bien plus complexes que la nôtre, et ne jugent pas l’homme (et la femme) de façon unilatérale. Ce que nous avons perdu, nous qui nous soumettons inconditionnellement aux lois de l’économie ou aux pulsions individuelles (et les unes ne vont pas sans les autres), c’est l’intelligence des états multiples de l’être, pour parler comme Guénon. La civilisation de masse a « libéré » l'atome égotique de son appartenance à des groupes complexes, et, par-là, à des éthos différenciés, légitimés par des ancrages supra individuels et supra humains. Autrement dit, chaque être, dans les sociétés traditionnelles, ne s’appartenait qu’en tant qu’il échappait à une emprise auto centrée.
Bien entendu, le mariage allait faire les frais de la « libération » sexuelle. Sans remonter aux Anciens, qui auraient rougi d’avouer qu’ils avaient pris du plaisir avec leurs épouses, et qui réservaient à ce passe-temps nécessaire les courtisanes ou la domesticité pléthorique de cette époque où l’esclave était bon marché (un peu – mutatis mutandis – ce qui se passe, de notre temps, dans certaines entreprises ou dans des groupes où l'autorité donne bien des « libertés » de cuissage), il est de fait que mariage et amour n’ont jamais fait bon ménage. La fin’amor, au XIIème siècle, a fondé sa « morale » érotique sur cette dichotomie, jusqu’au romantisme, dont, finalement nous vivons encore, avec néanmoins plus de cynisme, et même de goujaterie. Plus généralement, l’individu contemporain souffre difficilement les contraintes, surtout si elles ne sont pas sanctifiées par la nécessité, comme le travail, cette nouvelle religion, ou bien, et surtout, quand elles présentent la tare d’être le reliquat des temps anciens, comme le mariage. Quoiqu'il faut convenir, comme nous allons le constater, que la palinodie est poussée jusqu'à investir le mariage des passions d'un amour que l'on ne croyait pas y trouver.
On avouera en effet que la question du mariage devient diablement compliquée. Non pas seulement parce que le projet gendriste de « mariage pour tous » invalide la chose en la neutralisant, en la vidant de sa substance, qui est l’union entre un homme et une femme en vue de procréer, mais parce que le malentendu remonte loin. L’illusion romantique et la bienséance bourgeoise ont favorisé la confusion entre l’amour et le lien matrimonial. Ce qui n’est, avant tout, qu’un contrat (et nous verrons quelle en est la véritable nature) est devenu, sinon dans les faits, du moins dans l’imaginaire commun, la consécration d’un lien émotionnel, sentimental, sexuel fort, et destiné, selon le poncif convenu, à l’éternité. Cette mystique amoureuse et nuptiale, qui a peu de chose à voir avec l’idéal chrétien, qui mettait en avant la charité, c’est-à-dire l’amour dans le Christ, à la base des relations humaines, y compris charnelles, perdure encore parmi les jeunes gens, comme différentes enquêtes d’opinion l’ont montré. Ce qui, en regard de la fragilité actuelle des volontés et le manque de mesure de la durée, est placé la barre très haut, et explique le taux élevé de divorces « prématurés », dont les enfants en très bas âge font les frais. Car souvent, le désir, qui n’a qu’un temps, et la passion, qui se maintient encore moins longtemps, faute de perspective transcendante, spirituelle, religieuse, et même « politiques » (des couples de militants peuvent cheminer, soudés, ensemble, dans un même combat), ne sont pas transformés en un sentiment, certes moins violent, mais plus solide et pérenne. Le mariage contemporain, qui, lors des noces, exige parfois un investissement financier et sociétal hors de proportion, comme s’il fallait se prouver à soi-même que c’était du « sérieux », ressemble par bien des points à ces adoptions inconsidérées d’animaux de compagnie, que l’on abandonne sur les bords des routes. Ce sont cependant, dans ce cas, les enfants qui sont sacrifiés.
Les psychologues et tous les « spécialistes » qui ont quelque intérêt à défendre et à légitimer la permissivité moderne, dont ils tirent profit, ont toujours, contre toute évidence, considéré que ces déstructurations familiales étaient soit un pis aller, soit même une seconde chance pour réaliser des relations plus « épanouissantes », l’essentiel étant d’être « heureux », donc, in fine, de mener une vie sexuelle satisfaisante.
Tous les hommes font la chasse au bonheur, certes, mais ils sont loin d’y mettre tous la même chose, et c’est bien là l’outrecuidance et la cuistrerie de notre âge que de prétendre en détenir le secret. Lorsque l’on compare les pauvres itinéraires, trop humains, des consommateurs d’amour actuels, qui surfent sur internet pour nouer des relations, paient cher les abonnements aux sites de rencontres, imaginent des stratégies labyrinthiques pour croiser l’âme sœur, paramétrant tous les critères culturels, physiques, financiers, sociaux, confessionnels, etc. pour que la carte soit enfin la bonne, il faut convenir que le couple est bien une conquête, ô combien précaire, et un chemin de croix. Le surinvestissement existentiel et affectif qu’il suppose ne peut que provoquer des déboires, des échecs, et une grande souffrance. Ce désespoir se manifeste aussi à un niveau plus trivial, à celui des rapports sexuels crus, la marchandisation de Vénus et la pornographie ayant rendu la chair encore plus triste, et les idéaux de beauté, entretenus par les massmédias, ayant, de facto, relégué la plupart des humains à l’étiage en-deçà duquel on n'a plus de raison de se dire beau et séduisant, ambition désormais inaccessible, le seul graal qui fasse désormais entrer dans le saint des saints. Autrement dit, un monde « libéré », transformant en norme la permissivité, ne peut offrir qu’à quelques élus le paradis rose qu’il promet, la grande masse des mammifères anthropoïdes, n’étant, somme toute, qu’un bétail de bien piètre qualité esthétique. La concurrence est sans doute, alors, plus rude que dans ces temps où il n’était pas nécessaire, pour plaire, de ressembler à tel acteur ou telle actrice. Tout le monde d’ailleurs n’est pas perdant dans cette escroquerie, puisque l’industrie de la beauté est florissante.
Dans la réalité, sans pour autant qu’on détienne, et pour cause, des preuves statistiques dans ce domaine, il y a fort à parier que le « bonheur » engendré par les unions matrimoniales dans le temps passé comme maintenant étaient en gros de même importance, même s’il n’était pas de même nature. Autrement dit, il existait sans doute quantitativement autant de personnes heureuses et malheureuses dans les sociétés traditionnelles, qu’à notre époque qui se vante d’avoir « libéré » l’humain.
Il est même probable que l’intensité du « bonheur » était supérieure auparavant. Pour apprécier à sa juste mesure cette assertion provocatrice, il faut se défaire de quelques préjugés, ce qu’est incapable de faire, il faut bien le dire, l’homme contemporain, qui voit tout au niveau de son nombril, ou plutôt de son appareil géniteur. Il faut pourtant fournir un grand effort d’imagination, et concevoir une terre régie par d’autres paradigmes, aussi sages et raisonnables que ceux que l’on prétend tels maintenant.
Qu’étaient donc le mariage traditionnel, et subséquemment, la femme traditionnelle ? Pour ne prendre que l’exemple romain, qui présente trois sortes de mariages (le « conferreatio », le plus ancien, autrefois réservé aux patriciens, et accordé plus tard aux plébéiens, la « coemptio », qui était un rite de passage, par l’argent, des mains du père à celles de l’époux, et le mariage « per usum », qui était l'officialisation d’une cohabitation), ses origines relieuses, au sens où la religion « relie », étaient primordiales. Il s’agissait d’une part d’avoir des enfants pour continuer le nom de la « famille », laquelle possédait une acception plus large que maintenant, de faire perdurer, comme en Inde et en Chine, le culte du foyer et des ancêtres, et de s’intégrer, ce qui était essentiel pour un Romain, dans le cadre civique, le célibat étant durement réprouvé.
Quand l'homme défendait les remparts de la cité, la femme était au centre de la communauté, dans le cœur vital où l'homme est relié à son fondement. Il n'était nul besoin d'une « journée de la femme » pour rappeler ce rôle essentiel d'un sexe qui était loin d'être « faible ».
Si, d’une part, comme on le voit, l’idéal des hommes et des femmes dépassait leur simple dimension individuelle, et les projetait dans un espace beaucoup plus large, plus grave, et sans doute plus exaltant (celui des dieux et de la cité), du moins en ce qui concerne les formes les plus élevées du mariage, celui-ci ayant pâti du relâchement des mœurs à partir de la fin de la République, il a subsisté dans le christianisme, qui a démocratisé l’union aristocratique, l’a mise à la portée de tous, en reprenant par la même occasion l’exigence de fidélité, aussi bien de la part des femmes, ce qui allait alors de soi, mais aussi de la part des hommes, devoir apparu lorsque le consentement mutuel, lors des « nuptiae », les « noces », s’imposa dans les premiers siècles de l’Empire. C’est à ce moment que l’habitude de passer un anneau à l’annulaire gauche de son conjoint acquiert un sens, que l’épousée, dans la demeure de l’époux, répond par la formule rituelle (et émouvante) : « ubi tu Gaius, ego Gaia » (« Où tu seras Gaius, je serai Gaia »), que le marié présente l’eau et le feu, symboles de la vie commune et du culte familial, ainsi que les clés de la maison, que la mariée offre trois pièces de monnaie, l’une à l’époux, l’autre au Lare, dieu du foyer, et la troisième au dieu du carrefour le plus proche.
Quelle horreur ! crieront les féministes ? Quelle aliénation ! Et quelle servitude de la femme !
Comment faire comprendre un monde qui dépasse l’entendement limité des modernes, lavé par deux siècles d’endoctrinement et de propagande individualistes. Il faudrait passer par toute une étude anthropologique sur les visions du monde, je le répète. Et convaincre l’égocentrique un peu grisé par son illusion d’autonomie que la véritable réalisation humaine s’affirme dans un engagement qui, sous la forme de devoirs, permet à l’homme d’être responsable, de son groupe, de sa famille, de lui-même, en le reliant à une Dikè, à une justice cosmique, à un ordre du monde, et que c’est cette courageuse et volontaire adhésion à la tâche d’être humain, comme aurait pu dire Marc Aurèle, à ce théâtre sérieux, qui fait l’homme, et non cet atome agité qui croit exister authentiquement en produisant une électricité erratique.
On a reproché au christianisme d’être puritain et ennemi de la « chair ». C’est beaucoup le diffamer, ou du moins lui faire trop porter le chapeau. En vérité, l’Antiquité tardive avait accru une tendance qui avait toujours existé dans l’Antiquité, où être trop adonné au plaisir passait pour être efféminé. Ces siècles guerriers, civiques et politiques ne souffraient pas un abandon de l’énergie vitale, mais aussi, des philosophies aussi prisées que le stoïcisme, le platonisme, et même l'épicurisme, louaient sinon l'ascèse, du moins la réduction des désirs à l'essentiel. L’érotisme possédait ses lettres de noblesse, à condition d’être encadré, orienté, sacralisé (par exemple lors de festivités), mais il était bien entendu que le dessein de tout être, plus on s’élevait dans l’échelle des devoir, était la maîtrise. Cette vertu, présente dans la religion chrétienne, appartient aussi au monde chevaleresque du moyen âge. Erec et Enide, de Chrétien de Troyes, en est une illustration éloquente. La « récréantise », l'abandon du devoir pour les plaisirs du lit, contredit l'idéal du guerrier, qui ne doit pas s'arrêter à ce qui affaiblit son énergie vitale.
Tout cela est du monde ancien. Toutefois, pour nous, c’est encore du présent, parce qu’éternel.
Un état de fait, cependant, montera toute la duplicité, la tartuferie d’un système idéologique qui se pare du costume scintillant du plaisir et de la volupté, voire de la tenue d’Eve, pour prouver sa raison d'être. La réalité de la femme, celle, crue et dure, qui prévaut dans le monde tel qu’il est, a vite fait de dégonfler la baudruche.
D’un point de vue capitaliste, la « libération » de la femme a été tout bénéfice, puisque cette main d’œuvre sous qualifiée et sous payée à porté au système de production et d’exploitation un souffle d’air inespéré. Les revendications d’égalité, de parité, on fait tomber tous les scrupules qui interdisaient aux femmes d’être traitées (mal) comme les hommes. C’est ainsi que la Commission européenne a supprimé l’interdiction du travail de nuit pour elle. Parité oblige ! Et là où il n’était nécessaire que d’un salaire pour faire vivre une famille, il en faut maintenant deux, et de nouveaux frais, donc davantage d’emprunts et de dettes.
La « libération » sexuelle a aussi eu pour résultat de fragiliser la femme, surtout celle issue des milieux populaires. Il est vrai que les bobos s’en sortent mieux quand le couple se déchire et que la famille éclate. Encore que... Néanmoins, des enquêtes récentes démontrent que ce sont les femmes qui paient le plus lourd tribut à la crise. Les familles monoparentales, qui concernent les mères à 85% (soit deux millions de foyers), représentent en France une famille sur cinq. De 1999 à 2005, ces familles ont augmenté de 10%. En quarante ans, de plus de 40%. Probablement est-ce là un progrès indéniable vers la liberté. Chez ces familles, on compte un taux de pauvreté de 35%, 2,5 fois plus que l’ensemble des familles. Evidemment, le chômage et l’emploi précaires sont la règle parmi ce que l’on nomme les « mamans solos ». Nous sommes loin des femmes « libérées », « positives », des feuilletons télévisés, ces fictions à propagande bassement mensongères.
Aragon et Ferrat, finalement, avaient en partie raison, en chantant que la femme était l’avenir de l’homme. Oui, la femme est bien l’image de l’homme, mais il faut rectifier l'assertion. Elle est bien le reflet fidèle d'un homme misérable, perdu, malheureux, trompé, cocu fié par l’idéologie soixante-huitarde, et cherchant désespérément, dans des amours éphémères, un bonheur absolu qu’il semble avoir perdu.Claude Bourrinet http://www.voxnr.com/
-
Accroissement vertigineux de la pauvreté Entretien avec Noam Chomsky (1994)
Noam Chomsky, le plus important des philosophes de la gauche américaine, accuse le système occidental d'avoir provoqué une « escalade de la misère » sans précédent. Clinton et les 2 partis américains, asservis à la grande industrie, en sont responsables. Paolo Morisi, le correspondant à Boston de l'hebdomadaire romain L'Italia settimanale, l'a rencontré chez lui pour son journal.
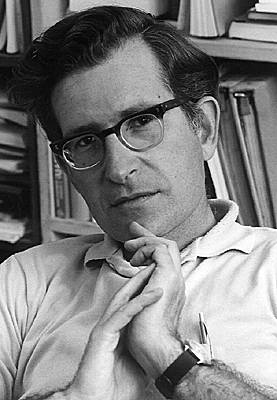 Les données que nous révèle le Census Bureau américain sont claires : le gouffre entre riches et pauvres s'élargit toujours davantage. La pauvreté a augmenté de 14,5% en 1992 et touche désormais 36,9 millions d'Américains. Aujourd'hui, un enfant sur quatre vit dans un état de pauvreté chronique, naît dans une famille détruite où la figure du père est absente. Selon Frank Levy, professeur au Massachussets Institute of Technology (MIT), les pauvres sont face à un horizon plus triste qu'il y a 30 ans, vu les changements qui sont survenus dans le marché du travail et qui tendent à défavoriser les travailleurs les moins spécialisés.
Les données que nous révèle le Census Bureau américain sont claires : le gouffre entre riches et pauvres s'élargit toujours davantage. La pauvreté a augmenté de 14,5% en 1992 et touche désormais 36,9 millions d'Américains. Aujourd'hui, un enfant sur quatre vit dans un état de pauvreté chronique, naît dans une famille détruite où la figure du père est absente. Selon Frank Levy, professeur au Massachussets Institute of Technology (MIT), les pauvres sont face à un horizon plus triste qu'il y a 30 ans, vu les changements qui sont survenus dans le marché du travail et qui tendent à défavoriser les travailleurs les moins spécialisés. Peter B. Edelman, consultant pour le Département de la Santé, affirme qu'outre les changements dans l'économie, l'Amérique ne peut s'en prendre qu'à elle-même : elle est responsable de ses pauvres. « Nous avons perdu la volonté, au niveau national, de faire quelque chose pour les pauvres ». Et il accuse : « Reagan et Bush ont montré qu'ils ne cultivaient aucune préoccupation pour les plus démunis ». Le débat sur la pauvreté est pourtant bien présent dans les colonnes des principaux quotidiens américains. Tant les libéraux (c'est-à-dire la gauche) que les conservateurs pensent qu'ils détiennent la bonne stratégie pour contrer cette pauvreté omniprésente, mais leurs discours nous semblent bien confus.
Alors, qui a les idées les plus claires sur la question ? Noam Chomsky, le célèbre linguiste de notoriété internationale, un intellectuel juif connu pour ses provocations (en 1980, sa lettre défendant la liberté d'expression et par là la possibilité d'ouvrir sereinement à tout débat contradictoire sert d'avant-propos à un livre de l'historien “révisionniste” français Robert Faurisson alors poursuivi en justice) et pour ses positions pacifistes radicales. Dans le passé, Chomsky, qui enseigne au MIT, a critiqué durement l'invasion israélienne du Liban, ce qui lui a valu une excommunication signée par 3 rabbins et, plus récemment, il s'est aliéné le monde culturel et politique américain en condamnant ouvertement la Guerre du Golfe.

♦ Q. : La pauvreté n'a fait qu'augmenter depuis 1992. Le gouffre entre riches et pauvres est plus large que jamais aux États-Unis. Qu'en pensez-vous ?
NC : La disparité sociale croissante est une tendance de longue haleine, due aux changements profonds de l'économie internationale au cours de ces 20 dernières années. Un facteur crucial a été la désintégration du système économique mondial voulu par Nixon au début des années 70, à l'époque des accords de Bretton Woods. Ces mesures ont conduit à une forte expansion des capitaux libres (14 millions de milliards de dollars, selon la Banque Mondiale) et à une accélération rapide de la globalisation de l'économie, ce qui a rendu possible le transfert de la production vers des pays où règne une forte répression sociale et où les salaires sont très bas. Autre conséquence : le déplacement des capitaux d'investissement à long terme vers la spéculation et le commerce. Selon une estimation de l'économiste John Eatwell de l'Université de Cambridge, aujourd'hui, 90% du capital est utilisé à des fins spéculatives, contre 10% en 1971 ! Les effets à long terme sont clairs : la Communauté Européenne elle-même, en tant qu'entité politico-économique, n'est plus en mesure de défendre les monnaies européennes contre la spéculation.
La planification de l'économie nationale des pays riches est considérablement menacée et les pays pauvres subissent un terrible désastre. Le monde est canalisé vers un équilibre qui sera caractérisé par une croissance basse et de bas salaires. Le modèle dual propre au tiers-monde, avec des îlots de richesse au milieu d'une mer de pauvreté, s'est internationalisé, de concert avec une internationalisation de la production. Les raisons de cette évolution sont claires et visibles dans le monde entier. Les gouvernements répondent d'abord aux nécessités du pouvoir domestique, incarné en Occident par les secteurs de la haute finance et des firmes multinationales. Pour le reste, la population, même dans un pays riche comme les États-Unis, devient pour une bonne part superflue pour la production de profits et de richesses, qui sont les valeurs premières de la société capitaliste.
♦ L'Administration Clinton pense-t-elle sérieusement à améliorer les conditions des moins privilégiés ? Comment expliquer que les idées et le programme de Clinton jouissent d'un grand prestige auprès des partis de gauche européens ?
L'Administration Clinton n'a strictement rien fait pour résoudre les problèmes sociaux et économiques internes. Je suis resté stupéfait quand j'ai vu que les partis de la gauche européenne se sont alignés sur les “clintoniens” ; c'est un bien curieux exemple de conditionnement et de subordination à la propagande américaine. Clinton s'est présenté comme un “Nouveau Démocrate”, un représentant de l'aile la plus conservatrice du parti démocrate, que l'on distingue à peine des républicains modérés. Les “Nouveaux Démocrates” se vantent d'avoir abandonné les “clichés” de gauche que sont la redistribution, les droits civils, etc. et de se préoccuper principalement des investissements et de la croissance économiques. Il est vrai qu'ils parlent aussi de l'emploi, mais sur le même ton que Bush et que le Wall Street Journal. Il ne faut point trop gratter : on s'aperçoit bien vite que pour ces messieurs le mot “emploi” a la même signification que “profit”.
L'électorat primaire de Clinton, c'est le secteur de management industriel. En fait, la problématique majeure de la campagne électorale de 1992 était la suivante : on s'est demandé jusqu'à quel point l'État devait protéger les intérêts de cette caste de privilégiés. La réforme dans le domaine de la santé, qui a été l'initiative majeure de Clinton au niveau national, est un exemple patent : il nous indique pourquoi le Président a pu attirer à lui tant de voix issues des castes économiques dirigeantes. La majorité de la population voulait que s'instaure aux États-Unis, comme dans toutes les nations civilisées, une forme d'assistance sanitaire publique. Le plan de Clinton a ainsi satisfait 2 conditions requises par le pouvoir industriel : a) il est radicalement régressif et n'est pas basé sur l'impôt ; b) il octroie un rôle déterminant aux compagnies d'assurances et les gens devront payer les frais immenses de leurs campagnes publicitaires, les hauts salaires de leurs directeurs, leurs profits, leur bureaucratie, etc.
Mes critiques valent également pour les autres points du programme de Clinton, dont l'Administration accorde un rôle prépondérant aux “faucons” dans les rapports avec les pays du tiers-monde et subsidie les exportations américaines en violation des accords du GATT.
♦ Vous ne croyez donc pas que l'Administration Clinton sera plus ouverte aux idées progressistes ? Que penser alors de l'attention toute spéciale que le Vice-Président Gore accorde aux problèmes écologiques ?
L'Administration Clinton ne s'intéresse nullement aux idées progressistes, à moins qu'elles ne puissent être manipulées et instrumentalisées au profit des managers industriels, des financiers de pointe ou des professionnels de l'argent. Pour toutes ces catégories sociales, une forme restreinte d'écologisme est bien vue. En fait, cela ne leur plaît guère que la détérioration de la couche d'ozone nuise aux peuples blancs de l'hémisphère nord ; ils veulent protéger leurs maisons de vacances de l'invasion des exclus et ils évoquent alors des restrictions à la construction de bâtiments dans les zones où ils se sont établis. Mais sur les questions qui touchent directement les droits et les devoirs des puissants et des riches, il ne me semble pas que Clinton et Gore aient fait grand'chose.
♦ Bon nombre de politologues affirment qu'entre le parti démocrate et le parti républicain une convergence s'est établie en politique étrangère et ils citent la Somalie et l'Irak pour étayer leurs arguments. Si une telle convergence existe, pensez-vous qu'il y a aussi une approche commune des problèmes économiques et sociaux internes ?
Les 2 principaux partis politiques américains ne sont au fond que 2 avatars d'un seul et même parti, celui qui défend les intérêts de la grande industrie. Ils sont tellement semblables sur le plan de la culture et de l'imaginaire politiques qu'ils pourraient parfaitement échanger leurs positions sans que personne ne s'en apercevrait ! Pendant les élections de 1984, la plate-forme républicaine envisageait une croissance militaire de type keynésien, stimulée par des prêts énormes contractés par l'État, tandis que les démocrates présentaient un programme de limitation fiscale. Pour autant que je le sache, aucun commentateur politique ne s'est aperçu que les 2 partis avaient tout simplement échangé leurs rôles traditionnels.
Les programmes du Républicain Reagan ont été étonnamment similaires à ceux du Démocrate Kennedy. Leur objectif principal est de faire croire que le système politique est toujours en mouvement, de façon à ce que les électeurs ne perdent pas intérêt à la politique. Environ la moitié de la population croit que le gouvernement est aux mains des grands potentats de l'économie qui ne sont là que pour défendre leurs propres intérêts, et que les 2 partis devraient purement et simplement être abolis. Environ le même nombre de citoyens ne va pas voter.
Pendant plusieurs décennies, le gouvernement américain s'en est tenu à un principe doctrinal : la politique étrangère devait être basée sur la bipartition, ce qui équivaut à une forme de totalitarisme. La politique intérieure, elle, révélait des disputes d'ordre tactique. Sur la plupart des problématiques cruciales, le public est tenu en dehors de la sphère de décision. En fait, la majorité de la population s'oppose à toutes les options prises en considération pour la réforme du système de santé, et refuse le Traité instituant l'ALENA (NAFTA : North American Free Trade Agreement), que l'on fait passer pour un accord de commerce libre, alors qu'il ne l'est pas.
Le pouvoir est aux mains des grands potentats de l'économie, dans une société largement dépolitisée, où les options pour une véritable participation politique sont extrêmement ténues car les simples citoyens n'ont ni la force ni la volonté de faire valoir leurs intérêts qui sont ceux de la communauté nationale toute entière. Ce qui est intéressant à noter dans notre pays, c'est que tout cela se passe dans l'État qui croit incarner la société la plus libre du monde !
♦ Prof. Chomsky, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.
► Propos recueillis par Paolo Morisi, Vouloir n°114/118, 1994.http://www.archiveseroe.eu
-
ERNST JÜNGER : HOMMAGE AU VIEUX SOLDAT
Dans sa cent troisième année, l'ancien combattant de la guerre 14-18 est mort. L'écrivain allemand au beau visage distingué avait presque traversé dans sa totalité le XXe siècle (il était né en 1895 dans la ville célébrissime de Heilejberg).
Son oeuvre et son engagement politique d'avant la seconde guerre furent controversés et il a du subir la bave haineuse de la gauche allemande, même si l'écrivain devait en rire avec morgue en pensant que François Mitterrand l'admirait beaucoup, qui n'avait sans doute pas compris dans toute sa profondeur la portée politique et idéologique de l'oeuvre.
L'ancien soldat de retour du front avait écrit « Orages d'acier », livre qui exaltait la guerre. Elle permettait à l' homme de se réaliser, de se métamorphoser et de se confronter au plus grand des" défis. Elle est en quelque sorte la mère de l' homme (« la guerre notre mère »). Cela nous rappelle Mussolini lorsqu'il en vantait aussi les vertus curatives : « elle guérit de la tremblote ». L'idéal guerrier et chevaleresque, sa spiritualité inhérente étaient loués au plus haut point. Jünger dans son livre « La mobilisation totale » avait même inversé Clausewitz, la politique devenant la continuation de la guerre.
À notre époque, où la guerre peut devenir une guerre presse-bouton, l'idéal guerrier n'est pourtant pas mort. Nous devons être des guerriers politiques, culturels et idéologiques. De nos jours il n' y a plus de front. Le combat est partout dans nos villes, nos banlieues, nos quartiers, nos rues, nos immeubles, à l'école et au travail...
Jünger était avant tout un écrivain mais avait un peu étudié la philosophie. On ne peut parler de lui sans faire référence aux deux philosophes assez proches sur le plan politique (avec bien sûr des nuances) Nietzsche et Heidegger. On trouve des thèmes récurrents aux uns et aux autres assez proches. Jünger avait, bien sûr, lu Nietzsche et avait personnellement connu Martin Heidegger (ils habitaient la même région : le Bade-Wurtemberg en pays Souabe).
L'idéal guerrier s'accompagne, bien évidemment du mépris pour le bourgeois: peureux, couard, grelotteux, sans spiritualité, politiquement libéral-démocrate, dont le seul but dans la vie est la recherche de la sécurité, du confort, et du bien-être matériel. Tout ceci s'oppose aux valeurs héroïques du soldat : le courage, l'audace, l'acceptation du risque et de la hiérarchie. Le guerrier possède et domine cette violence parfois nécessaire pour accoucher de l'être, ceci s'appelle l'impératif ontologique de la violence.
Le bourgeois incarne socialement le nihilisme européen, terme clé que nous allons expliciter. La peste spirituelle de l'Europe est le nihilisme. La France et sa culture drouadelhomesque, avec ses idéaux de gauche qui ont même empoisonné la Droite en est le plus bel exemple et sans doute le pays le plus avancé dans ce domaine de décomposition spirituelle.
Les idéaux français ou européens des «lumières» : droits de l'homme, raison, idéal scientiste, universalisme, économisme, moralité kantienne, conception abstraite de l'homme auquel on nie tout aspect charnel, égalitarisme qui implique la suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre. Bref, tout ce qui globalement recouvre le terme consacré : « les valeurs républicaines ». Idéaux qui aboutissent de façon inexorable vers la haine de soi, le masochisme, un goût morbide pour tout ce qui est mortifère et l'apologie de tout ce qui détruit notre culture, notre pays, notre peuple.
Les symptômes actuels de ce nihilisme sont une partie de la jeunesse blanche qui renie son pays, sa culture et se réfugie dans la drogue, le sexe, la débauche.
Nietzsche avait parfaitement vu que ces valeurs elles-mêmes étaient, conformément à leur essence, intrinsèquement nihilistes, que leur état actuel de décomposition (voir la France actuelle) reflète leur potentiel de départ (et que cela ne vient pas comme le croit encore certains idéologues de gauche d'une baisse de l'idéal initial). Jünger et Heidegger par leur engagement politique de départ, même s'ils ont un peu divergé après, ont donc voulu dépasser le nihilisme européen : « là où croit le danger, croît aussi ce qui sauve ». Cette phrase résolument optimiste d' Höderlin redonnait espoir à Jünger et à Heidegger.
L'engagement nationaliste était une façon de s'opposer sous une forme authentique au nihilisme européen qui obsédait tant les penseurs de génie européens. Pour eux, seule l'Allemagne pouvait avoir cette mission de renouveau spirituel. La défaite momentanée des mouvements nationalistes des années trente ne doit pas faire oublier leur origine intellectuelle, spirituelle et philosophique, le problème étant loin d'être réglé. Le nihilisme européen a atteint en France et en Europe le paroxysme. Et seul un mouvement nationaliste et spirituel fort pourra répondre à cette menace persistante pour l'avenir de la France, de l'Europe et de l'Occident.
par Patrice GROS - SUAUDEAU mai - juin 1998 dans le GLAIVE