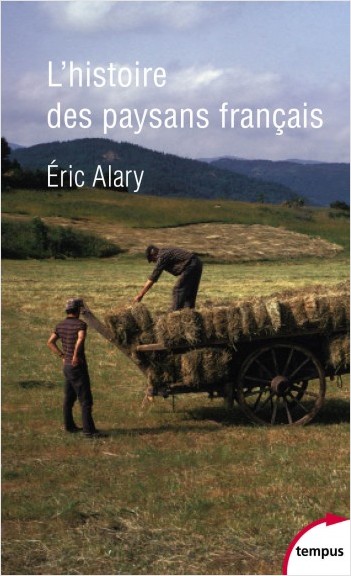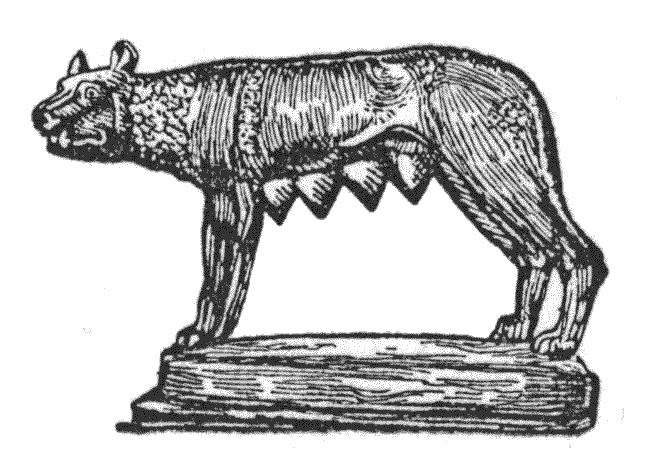Éric Zemmour a donc rencontré Viktor Orbán, qui l’avait invité au Sommet démographique mondial de Budapest. Cette rencontre est importante, puisqu’elle permet au chroniqueur de s’élever au niveau des chefs d’État et de gouvernement avant même de déclarer une candidature à la présidence qui ne fait plus le moindre doute. Viktor Orbán était un opposant au régime communiste inféodé à l’URSS et a été élu et réélu Premier ministre à la suite des victoires de son parti, le Fidesz, « l’Alliance des jeunes démocrates, Alliance civique hongroise » de 1998 à 2002, puis depuis 2010.