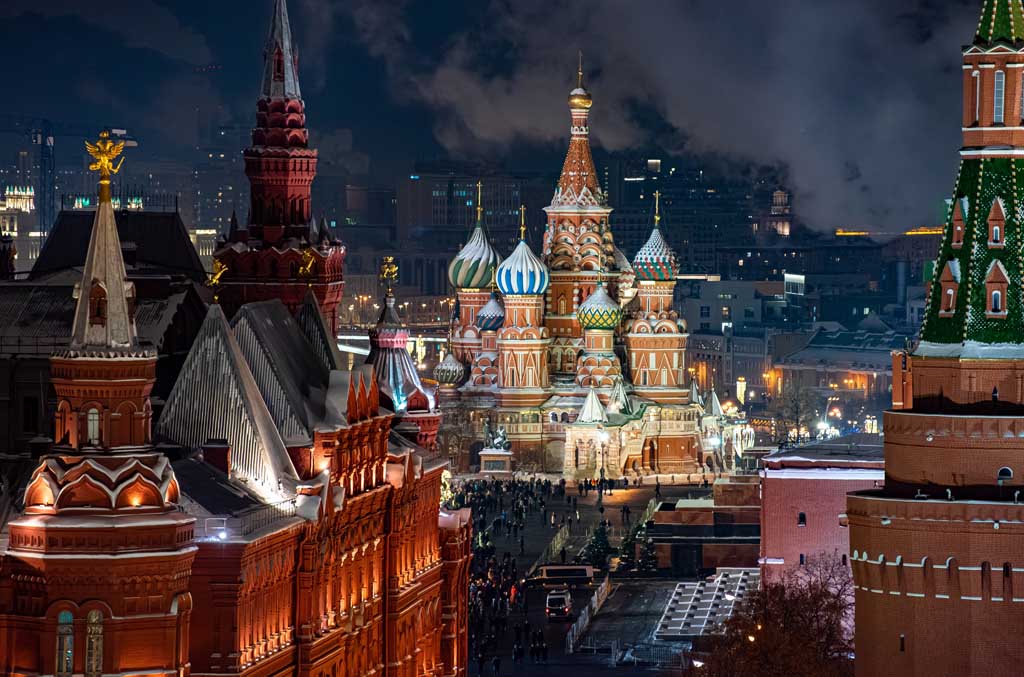
Ancien directeur des Instituts français de Pologne et de Géorgie, Gilles Carasso connaît de l’intérieur les lignes de fracture qui traversent l’Europe de l’Est. Son expérience nourrit une réflexion lucide sur la guerre d’Ukraine et ses répercussions continentales. Au-delà des propagandes antagonistes, il rappelle que la véritable question pour l’Europe n’est pas tant la menace russe que le désengagement américain. Ce reflux de l’imperium atlantique, hérité de 1945, oblige l’Union européenne à redéfinir son autonomie stratégique, jusqu’ici cantonnée aux slogans. Mais nous en sommes loin.
Selon une formule célèbre, la première victime d’une guerre est la vérité. On pourrait ajouter que la seconde est l’intelligence. La guerre d’Ukraine en est l’illustration avec, à l’ouest, la construction de la menace russe et, à l’est, la militarisation de l’esprit public. Ce serait pourtant le moment de réfléchir sérieusement aux conséquences pour l’Europe d’une évolution géopolitique majeure : la disparition progressive de l’imperium américain tel qu’il s’est structuré en 1945 avant d’atteindre son apogée dans les années 1990. « Autonomie stratégique », « Europe puissance », « Coalition des volontaires » ne sont que des slogans qui ne recouvrent pas des objectifs clairs et partagés. Et ils n’offrent aucune vision des relations futures de l’Europe avec ses deux grands surgeons, l’Amérique et la Russie.
Le désengagement américain est un moment de vérité auquel on pourrait appliquer le bon mot de Warren Buffet : « C’est quand la marée reflue qu’on voit qui n’avait pas de culotte. » Sans « culotte » industrielle, il est en effet difficile de faire face aux conséquences de la fin de la mondialisation et du retour des États-Unis au mercantilisme. L’Europe entonne le grand air de la réindustrialisation, mais s’engage à payer un tribut de 600 milliards de dollars d’investissements pour amadouer le suzerain américain. De même, la contractualisation du parapluie militaire américain, jusqu’alors inconditionnel, ne suscite que des réactions apeurées, entre soumission, comme l’a illustré la procession des dirigeants européens à Washington du 18 décembre, et affirmation volontariste d’une mobilisation militaire commune, alors-même que les conditions économiques et politiques de ce sursaut n’existent pas.
Une mobilisation nécessite l’identification d’une menace. Ce ne sont bien sûr pas les États-Unis, pourtant le seul pays à avoir exprimé une revendication sur un territoire sous juridiction européenne (le Groenland), qui sont désignés. Ni la Chine, trop lointaine. Ni les dangers très actuels que constituent la perte de contrôle de l’immigration et la fièvre de la subversion islamique. Non, c’est la Russie.
La question jamais réglée des confins impériaux
J’ai, dans un précédent article1, analysé l’hallucination de la menace russe. Olivier Schmitt a donné récemment une définition plus mesurée de cette « menace » comme une entreprise de déstabilisation de l’Union européenne et de l’OTAN2. C’est reconnaître qu’aucun pays européen, au-delà des confins de l’empire russe, n’est, en réalité, menacé.
Qu’il y ait aujourd’hui une guerre à bas bruit entre la Russie et l’UE, avec le soutien militaire à l’Ukraine d’un côté, et une guérilla informatique de l’autre, est évident. Ce conflit est récent et n’a pas de causes structurelles : pas de revendications territoriales, pas de conflits d’intérêts économiques, pas de risque de submersion démographique. Le seul enjeu visible, c’est la zone des anciens confins de l’empire russe et des empires européens, l’Ukraine, les pays baltes, la Pologne, la Finlande, la Moldavie, qui pourraient faire les frais d’une volonté de la Russie de rétablir par la manière forte sa zone d’influence. Si les Occidentaux l’avaient analysé dans sa complexité depuis 1990, au lieu de s’en croire dispensés par des élargissements successifs de l’OTAN et de l’UE, l’abominable guerre d’Ukraine aurait été évitée. Nous aurions échappé à l’engrenage3 dans lequel elle nous entraîne et qui pourrait un jour nous acculer à devoir répondre à une nouvelle version de la question « Mourir pour Dantzig ? »
Avant d’adopter des postures bellicistes, il eût été judicieux de nous demander en quoi consiste notre devoir de solidarité avec cette Europe de l’Est potentiellement menacée. La seule réponse sérieuse est qu’il faut éviter que ne se creuse à l’Est de l’Europe une zone de turbulences qui, ne pouvant être contenue par un impossible retour au rideau de fer, risquerait, à travers l’Allemagne et la Pologne, de déstabiliser l’Europe entière. Tout le reste, les belles formules sur la défense des valeurs européennes et du droit international, les « sentiments de solidarité », ne sont que l’habillage de manœuvres politico-économiques : la guerre d’Ukraine a fait s’envoler, au profit des États-Unis, le coût pour l’Europe de la politique de « containment » de la Russie.
Ainsi défini l’enjeu appelle une réponse aussi simple dans son principe qu’infiniment compliquée dans sa réalisation : il s’agirait de définir enfin, un siècle après l’effondrement des empires, 35 ans après la fin de l’équilibre des blocs figé en 1945, les nouveaux équilibres d’une architecture de sécurité qui assurerait la stabilité dans la zone des confins.
Y a-t-il une alternative au « containment » de la Russie ?
Ce nouveau « Congrès de Vienne » était possible en 1990, mais il ne l’est plus aujourd’hui. Les élargissements de l’OTAN ont figé les lignes et la seule zone au statut encore incertain, l’Ukraine, est en proie à la guerre. Imaginons cependant que la guerre d’Ukraine s’achève par une stabilisation précaire, que l’OTAN soit ébranlée à la fois par les exigences de Donald Trump et par des doutes croissants sur la qualité de sa garantie de sécurité, que l’UE elle-même connaisse une crise ou encore qu’une violente crispation des relations entre la Russie et les pays baltes, scandinaves ou la Pologne suscite de nouveaux foyers de tensions. Il faudrait bien alors constater que la politique de « containment » de la Russie qui est celle de l’Occident depuis 1990 n’est pas viable dans la durée. La solution de facilité, la guerre ouverte, étant, on peut l’espérer, écartée par la dissuasion nucléaire, il faudrait alors se décider à rechercher avec la Russie la définition d’un véritable équilibre régional tenant compte des réalités démographiques, économiques et stratégiques.
Le premier pas à faire, serait de cesser de considérer la Russie, ce pays gigantesque, qui depuis des siècles suscite fascination et détestation, comme un ogre assoiffé de conquêtes. La Russie était et demeure dans une certaine mesure un empire multinational qui, comme tout empire a sa propre version de la doctrine Monroe : quatre fois envahie, elle ne peut admettre qu’un autre empire s’approche de ses confins. En 1839, le marquis de Custine a dressé un tableau accablant du despotisme russe et d’une société où prévalaient la corruption, l’arbitraire, la servilité. Il est aisé de repérer une permanence de ces traits dans le pouvoir et la société russes actuels. Mais figer notre vision de la Russie dans un constat établi il y bientôt deux siècles, c’est tomber dans un essentialisme qui fait bon marché du mouvement de l’histoire. Il faut, pour le moins, y adjoindre la formule du général de Gaulle en 1966 : On ne peut rien faire sans la Russie en Europe, mais il est difficile de faire quelque chose avec elle.
Depuis, l’Union soviétique et son empire se sont effondrés. Avec toutes les pesanteurs de sa masse gigantesque, la Russie est confrontée depuis trois décennies au triple défi de réinventer un modèle politico-économique après le naufrage du soviétique, de redéfinir son identité nationale après la fin l’Union soviétique, et de trouver sa place dans le monde de l’après-guerre froide. La participation des Occidentaux, au nom de la promotion de l’économie de marché, à l’orgie maffieuse des années 1990, ne l’y a guère aidée.
Aussi, les tâches de ce « nouveau Congrès de Vienne » ne pourraient se limiter aux questions militaires et stratégiques. Qui peut croire que d’éventuelles « garanties de sécurité » données à l’Ukraine suffiraient à résoudre le problème ? Il faudrait également parler économie, entamer la construction d’une zone de coprospérité. On lit partout que l’Europe, et surtout l’Allemagne, se sont mis sous la dépendance des hydrocarbures russes. Mais on pourrait tout aussi bien décrire le même flux d’échanges comme une bonne affaire pour les deux partenaires. La prospérité adoucit les mœurs et calme les prurits nationalistes, elle serait la meilleure garantie des arrangements de sécurité. Que la Russie soit actuellement un partenaire horrible encore imprégné du cynisme soviétique et offrant une sécurité juridique limitée, ne doit pas empêcher de poursuivre cet objectif pour la simple raison qu’elle est et restera notre voisin.
Un second obstacle, encore plus difficile à surmonter, est la méfiance des pays qui gardent un fâcheux souvenir de l’occupation soviétique. La proposition que les Occidentaux leur ont faite en 1994, et qu’ils ont acceptée avec enthousiasme, de tout simplement passer à l’Ouest en tournant le dos à la Russie, ne les incline évidemment pas à rechercher l’entente avec leur encombrant voisin. Et tant que ne seront pas cicatrisées les plaies de la guerre d’Ukraine, ce sera impossible. Il est à craindre qu’un arrangement boiteux ne retarde pour longtemps la guérison. Les atermoiements occidentaux face à cette guerre4 vont sans doute engager un retour à la lucidité quant à cette chimère, mais quand ?
L’impossible alliance russe
Le troisième obstacle, enfin, est que les Européens continuent à intérioriser le veto anglais, puis américain, à l’unification du continent euro-asiatique alors-même que les États-Unis nous offrent de moins en moins en échange et nous somment d’acheter leur GNL quatre fois plus cher que le russe. Essayons un instant d’imaginer le plus grand pays du monde, l’un des pôles de la culture européenne, aux ressources incalculables, notre voisin, arrimé à l’isthme européen : c’est une évidence et c’est impossible. Non pas parce que les Américains s’y opposeraient : quand les pièces du système commencent à se disjoindre, une ferme volonté peut changer beaucoup de choses. Mais parce que cette volonté n’existe pas. Ce n’est pas une volonté européenne qui a signé la vassalisation volontaire de l’Europe, ce sont ses guerres suicidaires. Il n’y aurait pas plus de volonté commune pour un renversement stratégique.
Envisager l’alliance russe, que ce soit dans le cadre de l’UE ou par des arrangements pays par pays ce serait imaginer un avenir non pas anti-américain, mais non-américain de l’Europe. On en est loin. Si nous courbons l’échine devant la politique des tarifs douaniers de Trump, c’est parce que les États-Unis demeurent la première puissance économique du monde, qu’ils disposent de la monnaie d’échange et de réserve internationale et que, malgré les rodomontades des BRICS, ce n’est pas près de changer. Ils sont en outre, et de loin, de la première puissance militaire, et l’Europe découvre avec effarement qu’elle avait tout simplement remis sa défense entre leurs mains. La Russie, « jamais aussi forte ni aussi faible qu’on le croit » (Bismarck) ne saurait jouer un rôle comparable.
Malgré ses handicaps historiques, la Russie a beaucoup à offrir, mais pas l’essentiel : une mythologie. Or, il n’y a pas d’ensemble humain concevable sans un fonds mythologique commun. La réussite américaine en la matière est extraordinaire. Quant à la Russie, « prison des peuples » au XIXe siècle, elle a réussi brièvement au XXe siècle à se faire passer pour la « patrie du socialisme » avant de révéler son visage de « pays du Goulag ». Aujourd’hui, elle expérimente trois « offres » ideéologiques, mais aucune n’a un pouvoir d’attraction.
La première est celle des vertus chrétiennes traditionnelles dont elle serait le bastion. Une nouvelle catégorie de visas, les visas idéologiques, a été créée pour permettre aux familles voulant élever leurs enfants dans une atmosphère exempte d’idéologie woke de s’établir en Russie. Mais ces efforts de propagande sont pathétiques : l’an passé la Russie a connu 8 divorces pour 10 mariages et rien ne semble pouvoir enrayer son effondrement démographique. L’orthodoxie russe recèle sans doute dans les profondeurs de ses monastères des trésors de spiritualité, mais force est de constater qu’elle ne dit rien aujourd’hui que le monde puisse entendre.
La seconde innovation, le « Sud global », n’en est pas vraiment une, c’est une double réactualisation : du tiers-mondisme révolutionnaire version Brejnev/Fidel Castro et du mouvement des non-alignés. Mais contrairement au projet révolutionnaire post-colonial des années 1960, l’ensemble que veut fédérer ou entraîner les BRICS n’a de contenu idéologique que négatif : combattre l’hégémonisme américain, d’abord en affaiblissant le dollar. Les communiqués des sommets des BRICS sont des odes au multilatéralisme, au développement durable et à la lutte contre le changement climatique. Ce sont de parfaits décalques des liturgies onusiennes, on n’y trouve pas la moindre idée originale.
La troisième, celle qui a le plus de réalité, est un culte des ancêtres, celui des combattants de la « grande guerre patriotique » dont la plus belle expression est le défilé annuel du Régiment immortel5. Manifestation de gratitude envers les héros, il soutient l’image d’une Russie refuge des valeurs traditionnelles. Malheureusement, les célébrations du 9 mai, jour de la Victoire et désormais la véritable fête nationale russe, déploient une mythologie guerrière qui nourrit, depuis la guerre d’Ukraine, un embrigadement intellectuel croissant. En outre, la gloire de 1945 interdit le procès du stalinisme, indispensable pour tourner cette page sinistre de l’histoire russe. Enfin, elle renforce un courant politique « rouge-brun » qui veut en découdre avec les puissances occidentales et reproche à Poutine sa modération.
Il n’y a actuellement aucune base idéologique, dans les trois segments de ce qui pourrait être l’Europe de l’Atlantique à l’Oural, sur quoi fonder un avenir commun non-américain. Tous, Russie comprise, continuent à vivre dans la fascination de l’American way of life : automobile, hamburgers, vols low cost et écrans. La nouvelle posture américaine va-t-elle fragiliser son soft power ? Rien n’est moins sûr. Certes, la dernière production du puritanisme américain, le wokisme, tout entier tourné vers la protection et la pénitence, c’est-à-dire vers la peur, marque la limite de l’individualisme occidental, donc du rêve américain, et elle s’accompagne d’une catastrophe démographique. Mais les dirigeants européens, par faiblesse ou par aveuglement, semblent déterminés, quelles que soient les couleuvres que leur fait avaler l’empereur blond, à ne pas sortir de leur cadre de pensée américain.
De son côté, la Russie, plus paranoïaque que jamais, a fait savoir qu’elle n’accorde plus aucune confiance à l’UE et à ses pays-membres. On voit ainsi se dessiner l’un des pires scénarios, loin des rêveries d’alliance russo-européenne évoquées dans cet article : une entente russo-américaine qui enjamberait l’Europe, la laissant se débrouiller avec une UE invertébrée, une OTAN déboussolée, et avec ses vieux démons.
1. Psychopolitique de la menace russe, paru sur le site d’Élements.
2. Olivier Schmitt, « L’Europe contre les tyrans : un plan », Le Grand Continent, 19 août 2025.
3. Cf. Pierre Lellouche, Engrenages, la Guerre d’Ukraine et le basculement du monde, Odile Jacob, 2024.
4. Cf. Pierre Lellouche, op. cit., chap.6 : « Leçons stratégiques : erreurs de calcul et buts de guerre insaisissables ». 5. Actuellement suspendu du fait de la guerre
https://www.revue-elements.com/lalliance-russe-une-evidence-impossible/