culture et histoire - Page 1077
-
Zoom - Louis de Condé : « J’ai voulu tuer de Gaulle ! »
-
L’Humanisme c’est la guerre (II/VI)
Ou comment faire de Jean Bodin l’icône de l’humanisme.
Aux racines de notre monde
Réinterpréter l’aphorisme de Jean Bodin devrait nous permettre de comprendre comment on en est arrivé là. C’est un homme du 16e siècle prenant acte de toutes les mutations s’opérant à cette époque qualifiée de ‘Renaissance’ par les Moderne, car elle rompt avec l’esprit du ‘Moyen-âge’ animé par une conception religieuse de l’Homme. Aux 14e et 15e siècles, peste et guerres incessantes amènent à s’interroger sur la viabilité de pratiques politiques d’essence religieuse. Les mutations surviennent. Alors que le 13e siècle était un âge d’or, le 14e et le 15e sont catastrophiques. La peste noire aurait fait mourir un tiers, voire la moitié de la population européenne, faisant entre 40 et 100 millions de victimes. C’est ensuite la Renaissance. La féodalité cède le pas à la constitution des Etats envisagés plus stables qu’un modèle politique reposant sur le morcellement de l’espace politique.
Les royaumes deviennent des Etats. Les langues forgent l’esprit national. François 1er (1539 : ordonnance de Villers-Cotterêts) impose le français comme la langue du Royaume de France, obligeant les Anglais à construire leur propre langue au nom d’une rupture identitaire. L’Europe sort d’une crise démographique majeure ayant amputé sa population. On sait où est l’Amérique. Etc. C’est dans ce contexte de mutations profondes qu’un auteur s’interroge sur les fondements de la puissance politique. Machiavel (1469 – 1527) est reconnu comme l’auteur rompant avec le principe de l’élection et de la morale comme fondements du pouvoir pour lui préférer des pratiques plus terrestres. Apparaîtra alors la raison d’Etat culminant avec le Traité de Westphalie (1648) où la France catholique soutient les princes protestants allemands contre la maison des Habsbourg à la tête de l’Empire, elle aussi catholique. L’Eglise de Rome cesse dès lors d’être le pivot de la géopolitique européenne. Le protestantisme s’impose. Ayant été éliminé de France, la laïcité s’y substituera pour porter la Modernité. La cosmologie change avec la confirmation de l’héliocentrisme. La Science sera dans son prolongement la philosophie de référence de la Modernité. Dans son ouvrage majeur ‘Le Prince’, Machiavel analyse les jeux de pouvoir et montre comment devenir prince et le rester. Mais ces conseils sont pratiques, contrevenant aux impératifs moraux de l’époque. A l’origine de la RealPolitik fondant la raison d’Etat, le Machiavélisme est donc par essence immoral.
Comprendre Jean Bodin
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’œuvre de Jean Bodin avec comme conclusion que le fondement de la puissance politique, c’est l’Homme. D’où la nécessité d’en instrumentaliser de plus en plus pour renforcer la puissance du Prince et donc par dérivation, de l’Etat. Il est alors impératif d’augmenter cette population, soit par croissance interne, soit par croissance externe.
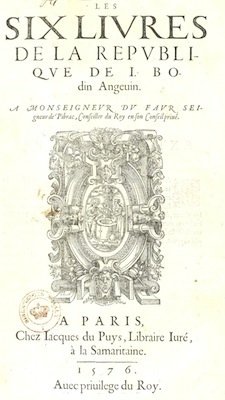 Les six livres de la République, de Jean Bodin
Les six livres de la République, de Jean BodinLa première sera soutenue par l’émergence d’une techno-science dont Ambroise Paré (1510-1590) en est, par exemple, un des premiers contributeurs. La maladie n’est plus une manifestation d’essence divine, mais un fléau que la techno-science combat. Quant à la croissance externe, elle sera alimentée par des conquêtes territoriales et l’exploration du monde dont la découverte des Amériques en 1492 pose le premier jalon. Le monde que nous vivons est créé à cette époque. L’encouragement à l’immigration allogène des pouvoirs publics contemporains est une manifestation de cet esprit dont les racines plongent dans le 16esiècle.
Ainsi, alors que les pratiques sociales entre 500 et 1500 reposaient sur une économie du Salut, – le pécheur cherchant le salut de son âme – l’épanouissement du capitalisme au 16e siècle conduit à la valorisation de postures d’essence chrésmatiques. Le but est alors d’accumuler de la monnaie pour elle-même. Les mercantilistes encourageront cette pratique car elle est un moyen de renforcer la puissance du Prince par l’impôt. Adam Smith (1723-1790) louera l’égoïsme comme moteur de l’économie à l’origine de la richesse des nations, etc. Quant à Karl Marx (1818-1883), en phase avec Jean Bodin, il verra dans le prolétaire le réel créateur de plus-value économique, mais non plus au service du Prince, mais ‘volée’ par le capitaliste. L’économie politique devient alors la discipline de référence pour organiser les rapports sociaux avec comme but de favoriser l’artificialisation de l’écosphère. On appelle cela « le développement » ou « la croissance » aujourd’hui.
Par un travestissement délicat à exposer en quelques lignes, cet humanisme envisagé comme le fondement de la puissance du Prince et de l’Etat s’est métamorphosé en impératif moral faisant de l’Homme l’essence de toute chose, justifiant sa transcendance à l’égard du monde naturel. La conséquence est que le dernier des éléphants vaut moins que le 7.678.456e humain apparu sur terre. Aussi, les humanistes ‘moraux’ pervertissant l’aphorisme de Jean Bodin voient dans les écologistes fondamentalistes les tenants d’un nouvel ordre politique dont l’Homme ne serait plus au sommet, mais simplement une partie de Gaïa. Luc Ferry a limpidement résumé cette posture dans le “Nouvel ordre écologique”… pour la combattre au nom de l’Humanisme.
En effet, pour l’écologiste, aujourd’hui, la crise écologique remet tout en question. L’Homme n’est plus envisagé comme une richesse, mais comme une auto-menace compromettant son existence.
L’Humanisme : une manifestation de l’hybris anthropocentriste
La conséquence est que l’Humanisme réunit maintenant toutes les postures encourageant la singularité humaine contre les déterminismes naturels. Ainsi, la mort est devenue une hérésie pour les transhumanistes alors qu’elle était vue comme une libération chez nos aïeux. On ne discutera pas de l’origine de ces postures humanistes. Son origine est controversée. Les uns la voient dans la Bible, les autres dans la philosophie grecque. Etc. Elle marquerait le début de la civilisation. Laissons les spécialistes discuter. Un regard écologique l’envisage comme la consciencisation de la singularité humaine et donc l’instrumentalisation du Tout à son service, dont la Nature. C’est le fondement de la démesure (l’hybris, ou aussi hubris, du grec ancien) anthropocentriste dénoncée par les écologistes.
Alors que Jean Bodin écrivait; « Or il ne faut jamais craindre qu’il y ait trop de sujets, trop de citoyens : vu qu’il n’y a richesse, ni force que d’hommes : et qui plus est la multitude des citoyens (plus ils sont) empêche toujours les séditions et factions: d’autant qu’il y en a plusieurs qui sont moyens entre les pauvres et les riches, les bons et les méchants, les sages et les fous : et il n’y a rien de plus dangereux que les sujets soient divisés en deux parties sans moyens : ce qui advient ès Républiques ordinairement où il y a peu de citoyens. », les humanistes ont résumé sa posture par un impératif moral sous forme de litote : « il n’est de richesse que d’hommes » dont le sens est très différent des réflexions initiales.
Les conséquences sont connues :
– explosion démographique alors que l’Eglise imposait des normes sociales la contenant;
– apport de la techno-médecine faisant vivre des individus condamnés ;
– apport du capitalisme comme vecteur de l’artificialisation de l’écosphère, etc.La conséquence est une crise écologique potentiellement létale. Aussi, les écologistes attendent, – voire espèrent – maintenant la catastrophe équivalente à celle provoquant la fin du Moyen-âge comme déclencheur d’une mutation nous imposant une société éco-vertueuse, donc renouant avec les impératifs naturels. L’Ecologie en tant que science nous fournit les instruments pour penser cela, et parmi eux, les principes de fonctionnement des écosystèmes que la Modernité transgresse démesurément.
Frédéric Villaret 27/01/2017
-
A propos de la question identitaire : l’autre nom du déracinement, c’est la barbarie
Auteur d’un essai percutant, Le multiculturalisme comme religion politique, Mathieu Bock-Côté est interrogé par Philippe Maxence dans le dernier numéro de L'Homme Nouveau. Extrait :
 "Nous assistons actuellement à une mutation de l’espace public en France. La révolution 68 est contestée dans ses fondements mêmes et les gardiens de cette révolution sont saisis de frayeur. Ils hurlent, ils insultent, ils crachent : on l’a vu notamment entre le premier et le deuxième tour de la primaire de la droite, où la gauche médiatique n’avait pas de mots assez durs pour François Fillon. Ce qu’on lui reprochait, manifestement, c’était de ne pas représenter l’ethos soixante-huitard, de témoigner de la permanence d’une certaine France historique qu’on croyait pourtant vaincue.
"Nous assistons actuellement à une mutation de l’espace public en France. La révolution 68 est contestée dans ses fondements mêmes et les gardiens de cette révolution sont saisis de frayeur. Ils hurlent, ils insultent, ils crachent : on l’a vu notamment entre le premier et le deuxième tour de la primaire de la droite, où la gauche médiatique n’avait pas de mots assez durs pour François Fillon. Ce qu’on lui reprochait, manifestement, c’était de ne pas représenter l’ethos soixante-huitard, de témoigner de la permanence d’une certaine France historique qu’on croyait pourtant vaincue.Mais restons dans le domaine des idées : la véritable nouveauté, c’est qu’il est possible aujourd’hui de contester les fondements de la révolution 68 et non pas uniquement ses dérives. On se délivre ainsi du dispositif idéologique progressiste – j’entends par là que le progressisme n’accepte généralement d’être critiqué qu’à partir de ses propres principes. Il est permis de lui reprocher d’aller trop loin ou d’aller trop vite, mais on ne saurait lui reprocher dans la mauvaise direction. Ceux qui veulent faire autrement sont diabolisés. La droite avait accepté l’interdiction au point de consentir à évoluer dans le périmètre de respectabilité tracé par le progressisme. C’est peut-être ce qui éclate en ce moment. On ne se contente plus de dénoncer les effets pervers et les conséquences désastreuses de Mai 68. On remonte directement aux causes : on le critique dans ses fondements anthropologiques. Quelle conception de l’homme s’est imposée dans la dynamique des radical sixties ? On commence à comprendre que l’homme ne court pas seulement derrière l’accroissement des biens matériels ou des prestations sociales. On redécouvre la figure de l’homme comme héritier et les vertus de la continuité historique. C’est ce qui se trouve derrière la fameuse question identitaire, qui fait resurgir, si vous me passez l’expression, l’impensé de la modernité : le monde ne saurait être intégralement contractualisé, rationalisé, judiciarisé. Mais ne nous enthousiasmons pas trop vite : le progressisme est fragilisé mais il demeure dominant.
Cette redécouverte est-elle une marque du conservatisme ?
Oui. Je note avec bonheur un renouveau conservateur de la pensée politique française. En son centre, une conviction : l’homme doit résister à la tentation de l’ingratitude et au fantasme de la table rase, sans quoi il se décivilisera. L’autre nom du déracinement, c’est la barbarie. L’homme qui ne doit rien à ses pères et qui n’entend pas transmettre le monde à ceux qui suivront ne conserve pas le monde mais le consume. Le conservatisme est indissociable, aujourd’hui, du retour de la question nationale. Nous constatons enfin les limites d’un certain universalisme qui croit délivrer l’homme en le désincarnant. Et on ne peut pas définir un pays en faisant seulement référence à des valeurs universelles – ou comme on dit en France, aux valeurs républicaines. Par définition, les valeurs universelles ne sauraient caractériser l’identité spécifique d’une communauté politique. Il faut plutôt redécouvrir le particularisme qui fonde chacune d’entre elles. Le retour en force des thèmes de l’identité, du besoin d’enracinement, de la vision de l’homme comme héritier, du besoin d’autorité, témoigne d’une redécouverte de cette conception conservatrice du lien social. Et c’est tant mieux. Une philosophie politique repose toujours sur une anthropologie : nous retrouvons aujourd’hui certains besoins fondamentaux de l’âme humaine et nous cherchons à les traduire et les inscrire dans la cité. [Pour lire la suite, commander le numéro]"
-
L’EMPIRE PERSE ACHÉMÉNIDE (~ 550-330 AV. J.-C.) | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER
-
L’Humanisme c’est la guerre (I/VI )
I / VI – L’Humanisme, c’est la guerre ! – Comprendre l’Humanisme.
Frédéric Villaret, chercheur indépendant, essayiste
C’est l’Humanisme qui engendre les conflits meurtriers de ces derniers temps. Pas la nation…
L’Humanisme en question
Difficile de ne pas s’afficher humaniste aujourd’hui. Dire qu’il y a trop d’humains sur terre ou, pire, que nous serions trop nombreux en Europe ou en France garantit une condamnation sociale sans recours possible. La saillie de Nicolas Sarkozy sur la crise démographique que nous connaissons fut très mal accueillie par la bien-pensance et même ignorée des médias mainstream. Le buzz fit flop. Et pourtant, bien avant lui d’autres s’en étaient inquiétés. On citera Thomas Malthus (1766-1834) il y a deux siècles, et plus près de nous, Jacques-Yves Cousteau (1910-1997) ou René Dumont (1904-2001). Mais l’omerta est de rigueur sur ce thème, la bien-pensance imposant cette anarchie démographique au nom de l’humanisme. Entre un Africain de plus et un éléphant en voie de disparition de moins, la réponse s’impose : tant pis pour l’éléphant. Aussi, la posture écologiste est-elle envisagée comme un anti-humanisme, donc condamnable moralement. Et l’humaniste paraphrasant Jean Bodin (1530-1596) assène le coup définitif par : « Il n’y a de richesse que d’hommes ». Or aujourd’hui c’est la Nature qui est considérée comme une richesse. Ceci pour une raison simple. Elle se réduit comme peau de chagrin face à l’explosion d’une anthroposphère qui ne pourrait exister sans elle. Dès l’origine, les fondateurs du mouvement écologiste avaient pointé les démographies débridées comme source du mal.
Dans cet esprit, c’est cet humanisme qui engendre les conflits meurtriers de ces derniers temps. La raison en est que l’humanisme en tant que composante de la Modernité transgresse tous les déterminismes naturels. Doit-on alors remplacer l’expression « Le nationalisme, c’est la guerre » par « L’humanisme, c’est la guerre ! » ?
Le nationalisme, voilà l’ennemi
La doxa d’aujourd’hui condamne le nationalisme au motif que celui-ci serait la cause des grands conflits depuis les guerres napoléoniennes jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Le peuple fut alors convié à ces ordalies jusqu’alors réservées à l’aristocratie terrienne instrumentalisant des déclassés sociaux dans leurs jeux.
Mais le recours à des armes issues de la civilisation techno-industrielle oblige à mobiliser d’énormes ressources humaines pour passer à travers les balles. Sous cet angle, la guerre n’a rien à voir avec une forme politique donnée. Il y eut des conflits entre humains à toutes les époques et en tous lieux. La féodalité, le royalisme, la démocratie, l’impérialisme, les tyrannies de toute sorte et toutes les autres formes politiques adoptées ne sont ni meilleures ni pires, les unes par rapport aux autres, sur le plan écosystémique. Dans cet article, l’humanisme est sur la sellette.
En revanche, selon ces mêmes lieux et époques, ces guerres sont plus ou moins violentes. Encore faut-il évaluer la nature de cet impact. Ainsi pendant la seconde guerre mondiale, les Américains eurent des pertes modérées par rapport aux Allemands ou aux Russes. Quelques centaines de milliers d’un côté; des millions de l’autre. Mais ces pertes étaient-elles comparables ? Les Américains perdirent environ 400.000 à 500.000 hommes jeunes en bonne santé, alors que Russes et Allemands sortirent de la guerre débarrassés de valétudinaires. Ainsi pendant le siège de Leningrad, près de 1 million de victimes civiles furent à déplorer. Mais l’essentiel était des gens fragiles; enfants souffreteux, indigents, malades, vieillards. La population en bonne santé survécut. Aussi, malgré des pertes importantes, Russie et Allemagne marquèrent l’après-guerre d’une vigueur démographique et économique remarquable. Au contraire d’une France, par exemple, dont l’atonie de l’entre-deux-guerres est attribuée aux pertes dans sa population masculine dans la force de l’âge en 14-18. Pour mémoire, 2,4 millions de pertes définitives, c’est-à-dire inaptes à se battre, donc à travailler; 1,4 millions de morts et 1 million d’invalides. D’un point de vue écologique, les morts ne se valent pas.
Or, ce n’est pas le nationalisme qui a tué ces gens. Dans les deux derniers conflits mondiaux, des autocraties, des empires, des monarchies et des républiques luttaient contre des autocraties, des empires, des monarchies et des républiques. En revanche, ce sont des gaz, des bombes et des munitions de toutes sortes issus de la Modernité, mais à l’efficacité inconnue jusqu’alors, qui tuaient et handicapaient. Pour mémoire, la balle d’un fusil napoléonien était mortelle à quelques centaines de mètres alors qu’un fusil contemporain l’est à des milliers. On ne parlera pas de la bombe atomique ou des bombes au phosphore rasant Dresde. Il est incontestable que la civilisation techno-industrielle a permis une efficacité guerrière sans antécédent dans l’histoire. Mais ceci est-il la cause ou simplement la conséquence de postures l’ayant engendrée ? Humanisme et techno-industrie, deux composantes majeures de la Modernité, sont-ils à l’origine de ces mega-conflits ?
Frédéric Villaret, 27/01/2017
-
Politique magazine, numéro de février : « Le nouveau monde »
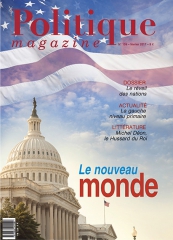 Découvrez le numéro de février !
Découvrez le numéro de février !DOSSIER : Le réveil des nations
Printemps des peuples, retour des nations, permanence des états. La prise de pouvoir de Donald Trump et le choix d’un Brexit « dur » par Theresa May annoncent une nouvelle donne mondiale. En France, un souffle d’espoir, porté par le retour du peuple, est-il en train de se lever ? •
Et aussi dans ce numéro… 54 pages d’actualité et de culture !
s’abonner à Politique magazine
-
LE MIRACLE DE LA VIE : LES 9 MOIS DE GROSSESSE MOIS PAR MOIS...
-
Vous pouvez commander dès maintenant "Le Populisme ou la véritable démocratie", le nouveau livre de Bernard Plouvier
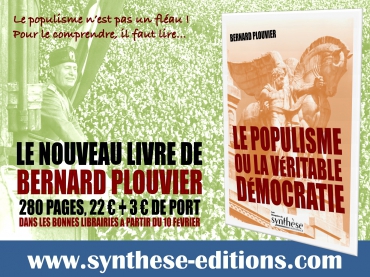
Le commander en ligne cliquez ici
Bulletin de commande cliquez là
-
Une biblio monarchiste de base
 Stéphane Blanchonnet, président du Comité directeur d’Action française, a réuni dans un court article l'amorce d'une bibliothèque royaliste pour un jeune militant. Ce remarquable travail d'analyse est publié dans l'Action Française 2000 parue ce jeudi 5 janvier 2017 ainsi que sur son blogue personnel A-Rebours.
Stéphane Blanchonnet, président du Comité directeur d’Action française, a réuni dans un court article l'amorce d'une bibliothèque royaliste pour un jeune militant. Ce remarquable travail d'analyse est publié dans l'Action Française 2000 parue ce jeudi 5 janvier 2017 ainsi que sur son blogue personnel A-Rebours.
Après avoir consulté l'articulation de la démarche compilatoire, ses raisons et sa conclusion sur A-Rebours.fr (clic), nous invitons le lecteur à revenir vers nous pour profiter de la version 2.0 de cette mini-bibliographie. Tous les bouquins ne sont pas numérisés et gratuits d'accès mais la plupart, si, et l'étudiant reste près de ses sous.
Un tour au local de la Croix des Petits-Champs (Librairie de Flore) nous semble tout indiqué avant d'acheter un ouvrage papier*. Par ailleurs, il y a d'autres accès à ces textes que ceux que nous avons pris. Le seul site Les Vergers sur la Mer ouvre sur l'océan Maurras pour qui sait naviguer. En fouillant plus profondément l'Internet américain, on peut tout trouver dès lors que le texte a été numérisé, et avec un peu d'adresse, on peut bourrer sa liseuse à peu de frais. Les titres ci-dessous sont mis dans l'ordre de l'article de référence. Merci de votre attention.
Voilà ! Avec les recommandations de Monsieur Blanchonnet, vous aurez détaché quelques glaçons de l'iceberg Maurras, vous vous approprierez le reste tout au long de votre vie si elle est longue, mais du Maurras, ça imprime facilement dans le cerveau.La Politique naturelle (CM): Royaliste-Html7
Mes Idées politiques (CM): Vergers-PDF4
Histoire de France (JB): Wikisource-Html5
Histoire de deux peuples (JB): Wikisource-Html6
Vers le roi (LD): Amazon4*
Libéralisme et Liberté (CM): Google_Books-Streaming2
Dictateur et roi (CM): Vergers-PDF2
L'Idée de décentralisation (CM): Vergers-PDF1
L'Avenir de l'intelligence (CM): Vergers-PDF3
La Musique intérieure (CM): Maurras-net-Html2-préface
La Balance intérieure (CM): Maurras-net-Html3-préface
Lettres des jeux olympiques (CM): Maurras-net-Html1
Anthinea (CM): Toronto-Archives-Streaming1
Charles Maurras et l'Action française - une bibliographie (A2B): Leclerc1
Notre avant-guerre (RB): Amazon1*
Mes Arches de Noé (MD): Amazon2*
Les Abeilles de Delphes (PB): Amazon3*
Bonne galette, bon courage.
par Catoneo -
Passé Présent n°137 - Histoire des janissaires ottomans