culture et histoire - Page 1080
-
Karim Ouchikh présente la soirée du SIEL "Les femmes patriotes : un atout pour la France".
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -
La France Bouge - Electre Edition 2017 (FR/EN)
-
L'universalité du christianisme est-il un appel au mondialisme ?
Non, répond Jean-Pierre Maugendre :
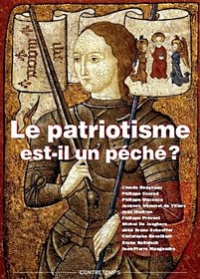 "[...] Il est un fait que le christianisme est une religion à vocation universelle. Citons Gal, III, 28 « Plus de Juif ni de Grec » ou Col III,11 : « Il n’y a plus ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni Barbare, Scythe, esclave ou homme libre mais, tout en tous, le Christ ». Est-ce là un appel à un mondialisme avant l’heure faisant fi des réalités nationales et identitaires ? Le texte précédemment cité de l’épître aux Galates s’éclaire mieux dans son contexte : « Tous en effet vous êtes fils de Dieu par la foi au Christ Jésus car vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Plus de Juif ni de Grec, plus d’esclave ni d’homme libre ; plus d’homme ni de femme, vous tous en effet vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus ». L’Apôtre des Gentils se place clairement sur un plan surnaturel. Il ne prône pas la théorie du gender avant l’heure quand il affirme qu’il n’y a plus ni homme ni femme. Il annonce simplement que tous les baptisés sont appelés à une même dignité et pureté surnaturelle (Dom Delatte in Les épîtres de Saint Paul).
"[...] Il est un fait que le christianisme est une religion à vocation universelle. Citons Gal, III, 28 « Plus de Juif ni de Grec » ou Col III,11 : « Il n’y a plus ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni Barbare, Scythe, esclave ou homme libre mais, tout en tous, le Christ ». Est-ce là un appel à un mondialisme avant l’heure faisant fi des réalités nationales et identitaires ? Le texte précédemment cité de l’épître aux Galates s’éclaire mieux dans son contexte : « Tous en effet vous êtes fils de Dieu par la foi au Christ Jésus car vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Plus de Juif ni de Grec, plus d’esclave ni d’homme libre ; plus d’homme ni de femme, vous tous en effet vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus ». L’Apôtre des Gentils se place clairement sur un plan surnaturel. Il ne prône pas la théorie du gender avant l’heure quand il affirme qu’il n’y a plus ni homme ni femme. Il annonce simplement que tous les baptisés sont appelés à une même dignité et pureté surnaturelle (Dom Delatte in Les épîtres de Saint Paul).Dans sa conférence Qu’est-ce qu’une nation (in Le patriotisme est-il un péché ? éditions Contretemps), Claude Rousseau note que lors de la Pentecôte, après avoir reçu l’Esprit Saint, les apôtres se mirent à prêcher le Christ et chacun – Parthes, Mèdes, Élamites, etc. – les entendait parler la langue du pays où il était né. Le Saint-Esprit avalise ainsi les pauvres langues humaines post-babéliques et ainsi indirectement les nations dont elles sont un des éléments constitutifs majeurs. La diffusion de la Bonne Nouvelle n’implique pas la disparition des nations.
Le Christ a pleuré sur Jérusalem
Le Christ lui-même d’ailleurs a manifesté un attachement émouvant à sa nation en pleurant sur le sort à venir de Jérusalem. « Quand il fut proche de sa ville, en la voyant il pleura sur elle. (…) Le temps va venir pour toi où tes ennemis établiront contre toi des retranchements, t’investiront et t’enserreront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre parce que tu n’auras pas reconnu le moment où tu étais visité » (Lc XIX, 41).
De manière classique, la Cité, puis la nation, est une extension de la famille, une famille de familles. Elle repose sur une base biologique de populations installées sur un territoire donné. Les nations nomades, qui existent, sont inchoatives et incapables de se constituer en États. L’exemple le plus éclatant en est l’État d’Israël qui n’a pu se constituer que lorsqu’il put disposer d’une base territoriale. Cette dimension territoriale de la nation a toujours été confirmée par le christianisme. Ces éléments : une terre et un peuple constituent le corps de la nation. Ils n’en sont pas l’âme. Elle est ce qui différencie cette nation des autres : un patrimoine culturel, intellectuel, moral, esthétique, etc. constitué au fil du temps qui constitue le bien commun de cette nation. Elle est aussi le dessein propre que Dieu a sur chaque nation qu’il a confiée à la protection spéciale d’un ange gardien spécifique, saint Michel pour la France, l’ange gardien du Portugal qui apparaît aux voyants de Fatima, etc. Les nations comme les personnes ont un destin particulier dans le plan de Dieu.
Le patriotisme est une vertu
Étymologiquement la patrie c’est ce qui a rapport aux Pères, aux Anciens. C’est un héritage matériel et immatériel que chacun a reçu. La nation, c’est cet héritage en action menacé en interne par l’infidélité et de l’extérieur par la destruction, conséquence d’une invasion, d’une défaite militaire, d’un génocide, etc. C’est sans doute ce qui, sur le fond, différencie le plus Laurent Dandrieu de Erwan Le Morhedec : le campement bédouin installé, ce qu’à Dieu ne plaise, sur les pelouses du château de Versailles, ou la transformation de la cathédrale Notre-Dame de Paris en mosquée ne choquera sans doute pas notre blogueur breton, si c’est le prix à payer pour un harmonieux vivre ensemble alors que les yeux de Laurent Dandrieu se révulseraient à cette simple évocation. Deux notions antagonistes de la nation s’opposent ainsi irréductiblement. Pour les uns, la nation est une simple relation contractuelle entre vivants, faisant fi du passé. Pour les autres, elle est, selon l’expression de Renan, un plébiscite de tous les jours, le souvenir d’avoir fait de grandes choses ensemble et la volonté d’en faire encore. Elle est ainsi d’abord un héritage dont chacun est comptable à la fois devant les morts d’hier et devant les vivants à venir.
La nation contractualiste est celle du mantra du « vivre ensemble ». Elle est grosse de multiples conflits dans une société frappée d’insécurité identitaire et culturelle comme la nôtre. Un voisin, bien intentionné, vient de nous conseiller, alors qu’un camp de « migrants » – uniquement des hommes originaires d’Érythrée, du Soudan et d’Afghanistan – vient de s’installer à proximité de notre domicile, d’éviter « dans nos maisons, les signes judéo-chrétiens visibles de l’extérieur » et de promouvoir « les vêtements amples pour les femmes ». Est-il conscient, le malheureux, que la première réaction, à moins d’avoir déjà intégré son statut de dhimmi, c’est-à-dire de protégé de l’islam, est plutôt de demander un permis de port d’armes ?
Il est un fait, et un bienfait, que fidèles ou infidèles nous sommes toujours des héritiers. En 2006, la publication dans la presse de caricatures de Mahomet donna lieu dans le monde musulman à de nombreuses violences anti occidentales et anti chrétiennes. Les saucissonneurs du Vendredi Saint de Charlie Hebdo titrèrent alors : « C’est dur d’être aimé par des cons ». Dans leur haine permanente contre le christianisme, ils restaient pétris de christianisme – Dieu est amour – à l’encontre d’une religion dont le leitmotiv est la soumission, islam signifie soumission, et non l’amour.
La reconnaissance de cette dette insolvable envers nos anciens, et d’abord nos parents, porte le beau nom de piété. Elle est la vertu qui nous ouvre les portes de l’avenir car nous disant d’où nous venons elle explicite qui nous sommes et où nous pouvons légitimement ambitionner d’aller. Le reste est fétu de paille emporté par les vents dominants de l’instant présent, par nature changeants, éphémères et souvent trompeurs."
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html
-
1ère fête du Pays réel le 11 mars 2017

-
Mythologie Slave - Mythes et Légendes #6
-
L’ARMÉE ROMAINE | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER
-
Pourquoi faire de l'histoire ?
-
Jacques Bainville - Les conséquences politiques de la paix par André Jacques
-
Sortie à la fin du mois du nouveau livre de Bernard Plouvier : "Le Populisme ou la véritable démocratie"
Un entretien avec l'auteur :
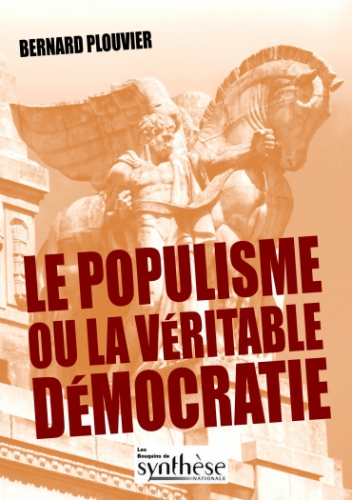 Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?
Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?R. Vous m’avez mal lu : je n’ai pas écrit du populisme qu’il était une forme de démocratie. Je prétends qu’il s’agit de la SEULE véritable démocratie, soit le gouvernement POUR le peuple. Le but de tout gouvernement est d’administrer au mieux le Bien commun. C’est ce que, durant l’Antiquité gréco-romaine – qui est notre racine fondamentale, avec celles moins bien connues des civilisations celto-germano-scandinaves -, l’on nommait la Chose publique.
Pourtant les démocraties grecques antiques n’ont pas été des régimes populistes.
Effectivement, ce que nos brillants universitaires (les historiens allemands sont généralement moins naïfs) nomment la « Démocratie athénienne » n’était qu’une ploutocratie. Pour faire simple, une ploutocratie est un gouvernement de riches qui n’agissent que pour donner à leur caste – héréditaire ou matrimoniale - et à leur classe – liée à la surface sociale – les moyens d’assurer la pérennité de leur domination.
Certes, un peu partout en Grèce, à partir du 6e siècle avant notre ère, on a introduit la notion d’égalité devant la Loi, mais cela ne touchait que les seuls citoyens, nullement les étrangers et moins encore les esclaves qui n’étaient que des biens mobiliers, des choses. En outre, les citoyens pauvres n’avaient que le droit d’élire des riches pour administrer l’État. En gros, cela n’a guère changé en 25 siècles !
Et très vite, les peuples se sont révoltés. D’authentiques populistes ont dominé de nombreuses cités grecques antiques, puis Rome. Ces « tyrans » ont tous été élus, acclamés par le peuple, mais agonis par la classe des lettrés, issus de la caste nobiliaire. La mauvaise réputation du populisme est une affaire de règlement de comptes entre les riches et les chefs des pauvres… car les ploutocrates reviennent toujours et partout au Pouvoir, les pauvres étant trop souvent victimes de leur irréflexion et les gens des media – de l’aède antique au présentateur d’actualités télévisées – étant fort vénaux.
Ce livre est donc une promenade historique, une visite guidée dans le Musée du populisme. Cela signifie-t-il qu’il existe des causes et des effets récurrents dans l’histoire humaine qui mènent au populisme ?
Bien évidemment et cela revient à dire qu’il existe des critères qui permettent à l’observateur de différentier un véritable populiste – être rare – d’un banal démagogue. Il faut être très critique à l’égard de ce qu’affirment les journalistes et les « politologues », cette curiosité contemporaine, lorsqu’ils balancent, un peu au hasard, l’appellation de populiste, ce qui est souvent, pour ces ignorants, une accusation, alors que de nombreux exemples prouvent le bénéfice que certaines Nations ont retiré des gouvernements populistes… et l’étude des échecs est également instructive.
Un chapitre entier du livre est consacré aux valeurs populistes et un autre aux critères, universels et diachroniques, d’un gouvernement authentiquement populiste. Et l’on étudie les différences qui existent entre le régime populiste et le despotisme éclairé.
Comment survient ce type de régime ?
Comme toujours en histoire, il faut, pour observer un phénomène hors du commun, la communion d’un chef charismatique et d’un groupe de compagnons résolus, unis par le même idéal… mais, hélas, pas toujours par des idées communes. Trop de théoriciens tuent un mouvement d’essence populiste avant qu’il puisse prétendre au Pouvoir. C’est ce que l’on a vu en France ou en Espagne durant l’entre-deux-guerres.
Ma question était mal posée : pourquoi un mouvement populiste réussit-il une percée ?
Ce type de mouvement résulte toujours d’un mal-être profond de la Nation, dans ses couches laborieuses et honnêtes… ce qui suffit à différentier le populisme des partis marxistes, dirigés par de très ambitieux intellectuels déclassés et composés de sous-doués hargneux, envieux et fort peu motivés par le travail.
Dès qu’une ploutocratie cesse de proposer au peuple une ambition pour la génération active ou, de façon plus grave encore, une promesse d’avenir pour les descendants, elle devient insupportable. La situation devient intolérable, explosive, lorsque la Nation – soit la fraction autochtone du peuple – est menacée dans sa survie.
L’insurrection devient alors légitime, à moins qu’un mouvement, prenant en compte les besoins et les aspirations du peuple – singulièrement ces valeurs qui font l’identité d’une Nation –, rassemble une majorité électorale qui lui permette de parvenir démocratiquement au Pouvoir, ce qui évite l’insurrection, ses crimes et ses destructions… là encore, on mesure bien la différence entre le populisme et l’ignominie marxiste, où la Révolution est le bien suprême, nécessaire aux chefs et aux petits chefs pour se saisir du Pouvoir et des sinécures.
Finalement, le populisme, ce serait la réaction saine d’un peuple qui souffre, qui est écœuré de ses soi-disant élites et qui aspire à une vie plus digne, faite de travail et d’honnêteté dans la gestion des affaires publiques, permettant d’espérer un avenir meilleur pour les enfants et les petits-enfants ?
Vous avez tout compris.
L'auteur : Bernard Plouvier est né en 1949. Il a été interne des hôpitaux puis chef de clinique au CHU de Lille. Depuis 1979, il est chef de service hospitalier, spécialisé en Médecine interne. Il a été élu membre de l’Académie des Sciences de New York en mai 1980. Il collabore régulièrement à la revue Synthèse nationale ainsi qu'au site EuroLibertés.
Le populisme ou la véritable démocratie, Bernard Plouvier, Les Bouquins de Synthèse nationale, 278 pages, 22 €
Sortie : fin janvier 2017
Le commander en ligne cliquez là
-
Entretien avec Gabriel Robin - Collectif Culture du RBM - Octobre 2016