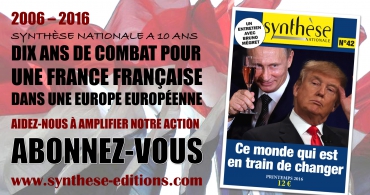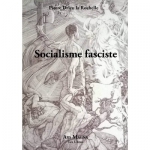 Issu de la gauche républicaine et progressiste, Drieu la Rochelle (1893-1945) se placera dans les années 1930 dans la lignée du premier socialisme français, celui de Saint-Simon, Proudhon et Charles Fourier, ce qui le conduira à adhérer en 1936 au Parti populaire français, fondé par Jacques Doriot, et à devenir, jusqu'à sa rupture avec le PPF en 1939, éditorialiste de la publication du mouvement, L'Émancipation nationale. En 1943, alors que chacun sait que tout est perdu pour les partisans de la collaboration, Drieu la Rochelle, dans un ultime geste de provocation, adhèrera de nouveau au Parti populaire français, tout en confiant à son journal son admiration pour le stalinisme.
Issu de la gauche républicaine et progressiste, Drieu la Rochelle (1893-1945) se placera dans les années 1930 dans la lignée du premier socialisme français, celui de Saint-Simon, Proudhon et Charles Fourier, ce qui le conduira à adhérer en 1936 au Parti populaire français, fondé par Jacques Doriot, et à devenir, jusqu'à sa rupture avec le PPF en 1939, éditorialiste de la publication du mouvement, L'Émancipation nationale. En 1943, alors que chacun sait que tout est perdu pour les partisans de la collaboration, Drieu la Rochelle, dans un ultime geste de provocation, adhèrera de nouveau au Parti populaire français, tout en confiant à son journal son admiration pour le stalinisme.
« Dès 1918, j’ai flairé dans le communisme russe, le moyen de produire une nouvelle aristocratie. Je ne m’étais pas trompé. Je cherche maintenant dans le socialisme de forme européenne, dans le fascisme, cette nouvelle aristocratie. Une jeune aristocratie qui ne sera point fondée sur l’argent, mais sur le mérite. » telle est la profession de foi que Pierre Drieu la Rochelle nous fait dans Socialisme fasciste, un ouvrage publié en 1934 et qui n’avait jamais été réédité.
Les editions Ars Magna
culture et histoire - Page 1212
-
Livre : Parution : Drieu la Rochelle : Socialisme fasciste
-
ZOOM : Petite histoire de la politesse
-
(20) Les Rois de France - Louis XIV, le roi soleil - (1) La conquête du pouvoir
-
2006 - 2016 : le 30 mars prochain, cela fera dix ans que Synthèse nationale vous informe quotidiennement !
Chers Lecteurs, Chers Amis,
Le 30 mars prochain, cela fera dix ans que Synthèse nationale apparaissait sur la toile. Depuis, au moins trois fois par jour, ce blog est alimenté. Il est maintenant quotidiennement consulté par au minimum 3 000 personnes. Parfois, le nombre des connexions dépasse les 25 000.
En dix ans, nous avons donné la parole à plus de 200 personnalités, responsables politiques ou économiques, écrivains, élus et acteurs se réclamant de notre famille d'idées. Nous avons lancé deux revues, Synthèse nationale et les Cahiers d'Histoire du nationalisme cliquez ici, créé une maison d'édition, Les Bouquins de Synthèse nationale cliquez ici et un service de diffusion cliquez là. Nous avons aussi organisé des dizaines de réunions, colloques et séances de dédicaces tant à Paris qu'en Province, ce à quoi il faut ajouter nos journées nationalistes et identitaires qui rassemblent de plus en plus de monde chaque année, à Lille en avril et à Rungis en octobre.
Tout cela a été possible grâce à l'engagement d'une poignée de volontaires et au dévouement de l'équipe de contributeurs qui scrute en permanence l'actualité afin de sélectionner l'essentiel à l'attention des militants et sympathisants de la cause nationale et identitaire.
La seconde raison de la longévité et du développement de Synthèse nationale est la fidélité et la générosité de ses lecteurs. Beaucoup nous aident en s'abonnant à la revue éponyme cliquez là ou aux Cahiers d'Histoire du nationalisme cliquez là, certains en adhérant à l'Association des Amis de Synthèse nationale cliquez là, d'autres enfin en achetant régulièrement les livres que nous éditons ou proposons. Quoi qu'il en soit, nous tenons à tous vous remercier pour votre fidèle amitié. Sans vous, il y a bien longtemps que ce site aurait disparu.
Synthèse nationale fait partie de ces môles de résistance qui gênent le Système. Pour s'en convaincre, il suffit de constater la quantité d'endroits, qu'il s'agisse des services de l'Education dite nationale, des chaines d'hôtels internationaux, des entreprises mondialisées, où son accès est interdit. Cela ne nous décourage pas. Bien au contraire, cela nous incite à amplifier notre action.
Le dimanche 9 octobre prochain, ce sera la dixième journée nationaliste et identitaire à Rungis, ce sera l'occasion de nous retrouver encore plus nombreux pour fêter ce dixième anniversaire. Le monde est en train de changer, l'heure du retour des peuples, des nations, des identités et des traditions européennes approche. Soyons mobilisés, le combat continue.
Amitié à tous.
Roland Hélie
Directeur de Synthèse nationale
-
Succès pour le colloque de Civitas et convergence des dissidents
Civitas a réussi un très joli coup. Samedi 19 mars, son colloque organisé en partenariat avec l'Alliance for Peace and Freedom et le Rassemblement pour la Syrie a fait salle comble autour d'un regroupement exceptionnel d'intervenants issus de la dissidence (Pierre Hillard, Damien Viguier, Youssef Hindi, Jean-Michel Vernochet, Elie Hatem, Roberto Fiore, Irène Dimopoulou, Mère Agnès-Mariam de la Croix, Marion Sigaut, Claire Séverac,...), venus aborder une vaste problématique : "De la guerre au Proche-Orient à l'immigration et au terrorisme en Europe". Il n'y avait plus une chaise libre dès 14h15 et plusieurs dizaines de personnes n'ont pas pu entrer, faute de place. Les intervenants se sont succédés avec des exposés de haut niveau, et pourtant abordables, devant un public très attentif.
Lors de la pause, les différents auteurs présents ont été abondamment sollicités pour dédicacer leurs livres. Ensuite, vinrent les trois derniers exposés, dont celui de Jean-Marie Le Pen, très attendu, avant la conclusion prononcée par Alain Escada.
Ce colloque est un bel exemple de convergence des forces insoumises au Nouvel Ordre Mondial.
Civitas fixe d'ores et déjà rendez-vous le dimanche 8 mai, place Saint Augustin à Paris, pour un hommage à Sainte Jeanne d'Arc dans un même esprit de convergence. A partir de 12h30 se succéderont des animations et des discours avant le départ à 14h30 d'un défilé jusqu'à la place des Pyramides.Lien direct Mis en ligne par Philippe Delbauvre
-
Cercle de Flore - Laurent Dandrieu
-
Philippe de Villiers : « Le retour de l’anneau est en lui-même un signe »
PARIS (NOVOpress) : Philippe de Villiers a accordé un long entretien à l’hebdomadaire Minute, qui consacre cette semaine sa couverture à la présentation de l’anneau de Jeanne d’Arc au Puy du Fou, dimanche dernier. Le fondateur du Puy du Fou y déclare notamment :
Le retour de l’anneau est en lui-même un signe, et le moment de ce retour en est un autre, qui conforte le premier. C’est au moment où la France s’effondre sur elle-même, au moment où elle est comme étourdie par son affaissement, que l’anneau revient. Par ailleurs, le fait que l’anneau revienne en France après un séjour anglais de six cents ans souligne que c’est un bout de France qui revient, c’est un peu de Jeanne qui revient chez nous.
Le signe est le suivant : les Bourguignons et les Anglais ne se sont pas contentés de tuer Jeanne comme une sorcière, ils l’ont brûlée. Ils l’ont brûlée pour qu’il n’en reste rien, rien que de la cendre. Pour être plus précis, il est resté son cœur qui a refusé de se consumer. Ce cœur a été mis dans un sac et jeté dans la Seine.
Les anneaux de Jeanne, puisqu’elle en avait deux, lui ont été retirés, au début du procès, et transmis au roi d’Angleterre par le cardinal de Winchester, supérieur hiérarchique de Cauchon, parce qu’il s’agit d’une pièce sacrée et qu’il faut alors éviter à tout prix que naisse en France, autour de cet anneau, un culte à Jeanne.
Cet anneau a, en fait, une double propriété. D’abord, c’est un trésor du patrimoine national, un trésor de l’histoire de France ; c’est le signe d’une épopée toujours vivante dans le cœur de beaucoup de Français. Mais c’est aussi une relique, la seule relique de la sainte à notre connaissance, et donc il doit être reçu et exposé comme une relique.
Si l’anneau avait été acheté par un musée, il aurait été mis dans une vitrine, derrière une vitre blindée, et il aurait connu là une mort glorieuse. Le Puy du Fou va lui rendre une présence vivante. C’est peut-être pour cela que l’anneau a choisi de rentrer au Puy du Fou plutôt que dans tel ou tel musée où les objets meurent pour la deuxième fois.
En fait, l’anneau n’est pas venu pour mourir de surexposition, l’anneau est revenu pour vivre, et le Puy du Fou c’est la culture vivante, c’est l’histoire de France dans le cœur de tous les Puyfolais et par contagion de tous les visiteurs et spectateurs qui viennent chercher là un petit bout de France, un peu de nos grandeurs perdues.
-
(19) Les Rois de France - Louis XIII, Louis le juste
-
Passé Présent n°94 - Sang Royal, le mystère Louis XVII
-
Régions et patrie
L’Etat central prétend décentraliser.
Vaste galéjade. Inutile d’expliquer le ridicule de cette pseudo-décentralisation pour qui s’intéresse un peu au sujet et jette un œil même furtif chez nos voisins. En France la décentralisation n’est qu’un mot. Jamais un acte. Les régions fonctionnent comme un leurre qui n’a pour but que de décharger l’Etat.
Dire que notre pays est centralisé est gentillet. Croyons plutôt que la France est un pays, ou « le » pays hyper-centralisé.
Que cela ait pu être une force après la Révolution pour unifier notre peuple, chacun est en droit de le penser.
Aujourd’hui c’est une faiblesse.
Sur une carte de France il y a un point ridicule qui se trouve être la capitale et qui prétend que tout autour est un désert qu’il est concevable de nommer « province ».
–Paris nous écrase.
–Paris nous phagocyte.
–Paris nous empêche de respirer.Entendons-nous bien : l’adjectif « ridicule » fait référence à la petite taille du point sur une carte représentant un pays de 552.000 km carrés, la taille d’une grande ville en somme (une capitale, soit).
Tout en France est à Paris, l’Etat y a tout installé et continue de le faire alors qu’il prétend le contraire.
Les délicieux experts qui habitent les bons et loyaux médias sont toujours prompts à taper sur les réalités françaises en comparant allégrement la France aux pays censés représenter des modèles. Ils l’ont fait pendant longtemps en se référant à nos chers amis anglo-saxons. Et puis selon les besoins, on passait au « modèle scandinave ». Plus récemment la sujétion s’est déplacée pour aller souvent renifler son maître de l’autre côté du Rhin.
D’un modèle l’autre et puis que dit-on ?
Il se trouve que ces prétendus modèles où l’on va chercher ce qui est intéressant et, quand ça intéresse, ils sont tous et, sans exception, issus d’un même ensemble, d’une même zone culturelle.
On parle ici de nations appartenant à l’ensemble culturel et linguistique germanique.
Nos experts, parisianistes cela va de soi, aimeraient nous tirer vers ce qu’ils estiment probablement être le haut mais ces pays du nord de l’Occident ont des sociétés différentes et des systèmes différents parce qu’ils ont des identités différentes.
Il serait peut-être temps de se rendre compte que le peuple français est un peuple latin.
Disons que la culture majoritaire est romane, ce qui n’exclut en rien les cultures et les langues régionales celte, basque et germanique ; cela veut simplement dire que nous appartenons à un ensemble de pays de culture et de langue romanes, nous n’appartenons pas à un ensemble de pays, de culture et de langue germaniques.
Tous ces bons experts adoubés par les médias aux ordres de l’idéologie mainstream (dominante) ne comparent cependant jamais la France à ses voisins pour y trouver des exemples de régions véritablement décentralisées.
Car ici réside une partie du problème. Ces experts idéologues opposés avant tout au débat nient l’aspect identitaire des choses. Ils nient même que le peuple français ait une identité.
Pour eux le Français ne peut être autre chose que citoyen d’un pays universaliste et Français de souche est une insulte parmi les plus dégradantes. Ces aboyeurs idéologues décident que les identités c’est sympa, c’est tout mignon mais quand ce sont celles des autres. Elles sont alors aussi fabuleuses qu’exotiques.
Hé oui ! L’exotisme se trouve parfois chez nos voisins directs.
Si le Français n’a pas d’identité, cette dernière ne peut pas être plus nationale que régionale (charnelle).
C’est bien là la matrice de ces régions qui se décident sur un coup de dé, qui s’échangent le matin suivant après le coup de fil d’un « ami », qui portent des noms qui ne sont pas des noms, qui sont parfois des acronymes dont une partie ne désigne rien d’autre que des illusions touristiques, d’autres dont on ne sait quels bureaucrates, après quelque partie de cartes, choisiront leurs noms et par quel processus ils auront imposé leurs élucubrations.
Ni l’histoire, ni la culture, ni l’érudition, ni la langue millénaire et du cru et surtout pas le peuple local ne seront invités à ces jeux géopolitiques qui n’ont pour but que de plaire au reich ou à l’empire dont on ne sait plus si la capitale est Bruxelles, Berlin ou Washington.
Ces régions nouvelles, conglomérats nouveaux d’inventions déjà anciennes, servent les intérêts de l’Union dite européenne et détricotent un peu plus l’identité française à travers sa sujétion à l’Union antinationale d’une Europe succursale étatsunienne mais détricotent aussi l’identité française en tricotant un nouveau patchwork où territoires de langue et de culture d’Oc et territoires de langue et de culture d’Oïl comme territoires de langue et de culture arpitane (franco-provençal) (*) et territoires de langue et de culture germanique ( alsacien, francique, flamand) et territoires de langue et de culture catalane et de langue et de culture basque ne seront pas pris en compte. Les Bretons attendent leur dernier morceau. Les Corses sont épargnés.
Ne nous y trompons pas. La défense de l’identité et le patriotisme ne se renforcent pas de l’élimination des cartes officielles des patries charnelles et régionales. C’est tout le contraire.
Se lever contre ces affabulations géopolitiques intérieures, c’est se lever contre ceux qui ne voient qu’une république mais surtout sans peuple légitime.
Le peuple français, légitime sur sa terre, se renforcera en retrouvant son identité locale. Sa langue régionale, sa patrie charnelle font de lui un Français. C’est le peuple français qui est fait ainsi.
De la Provence à la Bretagne, de la Gascogne à l’Alsace, du Pays basque à l’Ile-de-France et du Pays niçois au Nord-Pas-de-Calais nous pouvons, éventuellement, être une république mais nous sommes surtout un pays, un peuple.
Ceux qui veulent remplacer nos régions, nos langues sont ceux qui veulent remplacer notre peuple. Ceux qui s’opposent à ce crime mondialiste, ceux qui s’opposent à cette mort annoncée veulent garder leur identité.
Nous sommes le peuple français.
Pascal Pottier, 16/03/2016
Note de la rédaction :
(*) Voir aussi : De la patrie… ou du pouvoir absolu
Les intertitres sont de la rédaction