(Ce texte est tiré de l'Introduction générale à l'ouvrage intitulé Le Bienheureux Pie X, Sauveur de la France, Plon, éditeur, Paris 1953).
On ne croit pas être contredit par personne de renseigné si l'on juge que la politique catholique pose toute entière sur le mot de Saint Paul que tout pouvoir vient de Dieu, OMNIS POTESTAS A DEO. La légitimation du pouvoir ne peut venir que de Dieu.
Mais, dans le même domaine catholique, ce pouvoir divin est entendu d'au moins trois manières et vu sous trois aspects.
Il est d'abord conçu comme l'expression de volontés particulières impénétrables, insondables, décrets nominatifs qui ne fournissent pas leurs raisons, qui n'en n'invoquent pas non plus: choix des hommes providentiels, les César, les Constantin, les Alexandre, vocation des peuples, libre et souveraine grâce accordée ou refusée, profondeur et sublimité que l'on constate sans avoir à les expliquer ni à les commenter. Une volonté divine toute pure s'y donne cours (O altitudo !) qui provoque la gloire et l'adoration.
Secondement, l'exercice ou le spectacle de ces volontés suprêmes peut devenir, pour l'esprit ou le coeur de l'homme, un thème d'instruction, de moralisation et d'édification, tantôt pour étonner l'orgueil ou honorer l'humilité, tantôt pour les confondre l'un et l'autre et les persuader d'une sagesse qui manifeste la hauteur de ses conseils mystérieux. Nous avons dans l'oreille les magnifiques alternances de Bossuet: "Soit qu'il élève les trônes, soit qu'il les abaisse...", "de grandes et de terribles leçons". Là le Potestas a Deo semble attesté pour l'enseignement de la morale et de la justice, le progès des vertus personnelles de l'homme et son salut éternel. L'argument vaut pour discipliner ou discriminer les valeurs vraies et fausses. C'est aussi un thème de confiance et d'espoir pour ceux qui traversent une épreuve et qui appellent, d'en bas, l'innocence un vengeur et l'orphelin un père.
Une haute éthique politico-métaphysique s'en déduit régulièrement.
Mais, en sus des premiers déploiement des pouvoirs de la gloire de Dieu, comme des manifestations exemplaires de sa bienfaisance protectrice de l'homme, un troisième aspect doit être retenu: il arrive que l'OMNIS POTESTAS A DEO découvre un arrangement supérieur divinement établi. Ce qui est alors évoqué, c'est une suprême raison, la raison créatrice d'un plan fixe, clairement dessiné, d'un ordre stable et défini: de ce point de vue, les familles, les corps, les cités, les nations sont soumis de haut à des constantes d'hygiène, à des lois de salut, qui règlent leur durée et leur prospérité. Le substances vivantes, les corps physico-chimiques, même les arts humains, ont leurs conditions de stabilité et de progrès. De même les sociétés s'élèvent ou s'abaissent selon qu'elles se conforment ou non à cet ordre divin.
Les deux Testaments s'accordent à dire: que les foyers soient bien assis, et vos enfants pourront être nourris, dressés, et éduqués; que les parents ne mangent pas de raisins verts, et leurs enfants n'auront pas les dents agacées; que l'Etat ne soit point divisé, il ne sera pas menacé de périr; que les corps sociaux naturels ne soient ni asservis ni desséchés par l'Etat, celui-ci et ceux-là auront ensemble la vigueur, l'énergie, la luxuriance; que la nation soit soutenue par l'expérience des Anciens et la force de la jeunesse, ses ressources en recevront le plus heureux emploi; que la tradition règle et modère les initiatives; que la jeune vie spontanée ravive et renouvelle les habitudes traditionnelles, les groupes sociaux en seront sains, solides, puissants; qu'au surplus le tendre amour de l'ascendance et de la descendance, comme celui dusol natal, ne cesse de gonfler le coeur de tous, le bien public s'en accroîtra du même mouvement, etc... etc... Mais surtout qu'on ne perde pas de vue qu'il y a ici un rapport d'effets et de cause ! Le bon arbre porte un bon fruit. Que le mauvais arbre soit arraché et jeté au feu. Si vous voulez ceci, il faut vouloir cela. Vous n'aurez pas de bon effet sans prendre la peine d'en cultiver la haute cause génératrice. Si vous ne voulez pas de celle-ci, la sanction du refus est prête, elle est très simple, elle s'appellera la "fin". Non votre fin, personne humaine, mais celle du composé social auquel vous tenez et qui dépérira plus ou moins lentement, selon que le mal, non combattu, aura été chronique ou aigu, superficiel ou profond. Les conditions de la société, si on les transgresse, laissent la société sans support, et elle s'abat.
Ce langage, nourri des "si" qui sont propres aux impératifs hypothétiques de la nature, n'est aucunement étranger aux théologiens dont je crois extraire ou résumer les textes fidèlement. Ce qu'ils en disent n'est pas tiré en en corps du Pater ni de Décalogue. Ils n'en signifiant pas moins un "Dieu le veut" indirect, mais très formel. On s'en convaincra par une rapide lecture de la Politique tirée de l'écriture sainte, où l'optime arrangement terrestre ne cesse d'être illustré, soutenu et, rappelons-le, légitimé, par un ordre du ciel.
Or, s'il est bien curieux que cette POLITIQUE sacrée ait été inscrite par Auguste Comte dans sa bibliothèque positiviste, il ne l'est pas moins que tous les physiciens sociaux, qui se sont succédé depuis Aristote, ne parlent guère autrement que le docteur catholique Bossuet. A la réflexion, c'est le contraire qui devrait étonner: à moins que, victimes d'une illusion systématique complète, les théologiens n'eussent enchaîné ces déductions au rebours de toute réalité, l'accord n'était guère évitable. Les phénomènes sociaux se voient et se touchent. Leurs cas de présence, d'éclipse ou de variations, leurs durées, leurs disparitions, leurs croissances ou décadences, tombent sous les sens de l'homme s'il est normal et sain. Comment, s'il existe un ordre des choses visibles, ne serait-il pas déchiffré de quiconque a des yeux pour voir ? Bien entendu, il ne s'agit en ceci d'aucun Surnaturel révélé. C'est la simple lecture du filigrane de l'Histoire et de ses Ordres. Que disent-ils ? Quel est leur texte ? Voilà la question, non une autre. Car la question n'est pas ici de savoir quelle main a écrit cet ordre: qualem Deus auctor indidit, dit Léon XIII. Est-ce Dieu ? Ou les dieux ? Ou quelque nature acéphale, sans conscience ni coeur ? Cet Être des Êtres, créateur ou ressort central, peut, quant à lui, se voiler, Deus absconditus, qu'on affirme ou qu'on nie. Ce qui n'est pas caché, ce qui n'est pas niable, ce que voit un regard clair et pur, c'est la forme ou figure du plan (crée ou incréé, providentiel ou aveugle) tel qu'il a été invariablement observé et décrit jusqu'à nous. Quelques uns de ces impératifs conditionnels apparaissent comme des "aphorismes" à La Tour du Pin. Or cette rencontre, où convergent la déduction religieuse et l'induction empirique, est encore plus sensible dans ce qu'elle critique et conteste de concert que dans ce qu'elle a toujours affirmé.
Le coeur de cet accord de contestation ou plutôt de dénégation entre théologiens et naturalistes porte sur le point suivant: LA VOLONTE DES HOMMES NE CREE NI LE DROIT NI LE POUVOIR. NI LE BIEN. PAS PLUS QUE LE VRAI. Ces grandes choses-là échappent aux décrets et aux fantaisies de nos volontés. Que les citoyens s'assemblent sur l'Agora et le Forum ou leurs représentants dans le palais de Westminster ou le Palais-Bourbon, il ne suffira pas d'accumuler deux séries de suffrages, de soustraire leur somme et de dégager ainsi des majorités. Si l'on veut "constituer" un pays, lui donner une législation, ou une administration qui vaille pour lui, c'est-à-dire le fasse vivre et l'empêche de mourir, ces dénombrements de volontés ne suffisent pas; aucun bien public ne naîtra d'un total de pures conventions scrutinées s'il n'est participant ou dérivé d'un autre facteur. Lequel ? La conformité au Code (naturel ou divin) évoqué plus haut: le code des rapports innés entre la paternité et la filiation, l'âge mûr et l'enfance, la discipline des initiatives et celle des traditions. Le code inécrit des conditions du Bien est le premier générateur des sociétés. Si le contrat envisagé ne se subordonne, en tout premier lieu, à ce Code, il ne peut rien, il ne vaut rien. L'esprit éternel de ce Code se rit des prétentions volontaristes, du Contrat, comme des contractants. Telle est la moelle intérieure des leçons que recouvrent ou découvrent les faits.
Oublions tous les faits, dit Jean-Jacques au début du plus fameux et du plus funeste des CONTRATS. Son système exige cet oubli des faits. Si, en effet, on ne les excluait pas, les faits viendraient en foule revendiquer dans la fondation des sociétés une très grande part du volume et de l'importance que s'est arrogés le contrat.
Il n'est pas question de méconnaître le nombre ou la valeur des pactes et des conventions auxquels donne lieu la vie sociale de tous les temps. L'erreur est de prétendre ne former cette vie que de contrats. Énorme erreur. Car le contrat ne représente ni le plein de la vie sociale, ni la partie la plus vaste ou al plus profonde. Quand l'homme se sera entendu répéter cent fois que son vote choisit et crée le bien ou le mal social, il n'en sera pas beaucoup mieux obéi par les faits: pas plus que ses préférences ne seront suivi des obédiences de la pluie et du beau temps, il ne sera pas rendu maître de l'heur ou du malheur de sa ville ou de son pays qui, l'un et l'autre, dépendront non pas de la loi qu'il édicte, mais de celle qu'il tire de l'expérience de son passé, comme le physicien de l'observation des astres en courses et des tensions de l'air supérieur.
Lire la suite
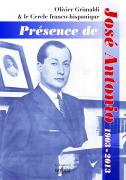 Sur la Phalange espagnole, lire :
Sur la Phalange espagnole, lire :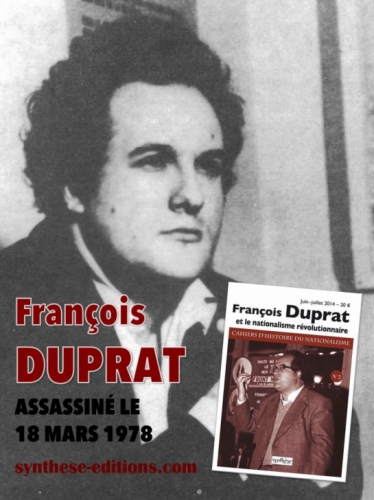 C’est le 26 octobre 1940 que François Duprat naît à Ajaccio dans une famille que l’on pourrait plutôt classer « à gauche ».
C’est le 26 octobre 1940 que François Duprat naît à Ajaccio dans une famille que l’on pourrait plutôt classer « à gauche ».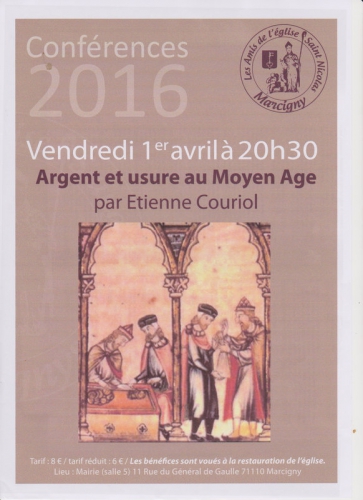
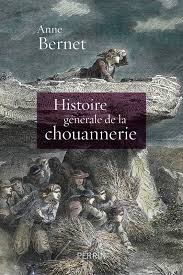 Anne Bernet, historienne et critique littéraire, est l’auteur de nombreux ouvrages de grande qualité.
Anne Bernet, historienne et critique littéraire, est l’auteur de nombreux ouvrages de grande qualité.