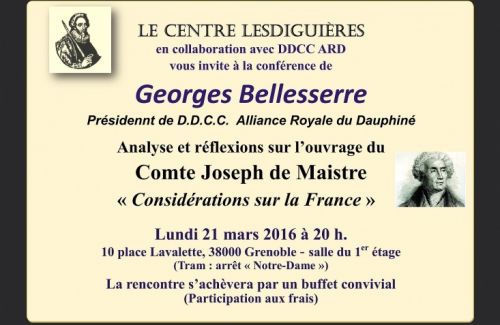« Agis seulement d’après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle. » Emmanuel Kant, in Fondation de la métaphysique des mœurs (1ère formulation)
Schopenhauer est un grand admirateur de Kant. Il salue avec ferveur l’importance de La Critique de la Raison pure(1781 et 1787), et, de manière plus générale, l’apport de l’idéalisme transcendantal dans l’histoire de la philosophie. En effet, on peut considérer l’œuvre de Kant comme la charnière entre la philosophie moderne et contemporaine (certains voient même en Kant l’inventeur de la phénoménologie). Cependant, si l’admiration de Schopenhauer est grande, son indignation l’est tout autant à la lecture de la Critique de la Raison pratique (1788). Il écrit alors, dans le cadre d’un concours organisé par la Société royale des sciences du Danemark, un véritable pamphlet contre la déontologie kantienne, Le Fondement de la morale (1841). Bien qu’étant le seul à concourir, Schopenhauer ne remporta pas le prix. Il fut jugé indigne, la philosophie de Kant étant sacro-sainte à cette époque, une telle critique ne pouvait se légitimer. La pensée de Schopenhauer, même si elle est souvent violente et problématique, mérite toute notre attention. Nous étudierons donc les arguments qu’oppose Schopenhauer à la philosophie morale de Kant. La réfutation tourne autour de deux arguments principaux :
– La morale kantienne, dans sa forme même, c’est-à-dire impérative, est éminemment problématique.
– Le fondement de la déontologie kantienne, la liberté comme autonomie de la volonté, entre en profonde contradiction avec la philosophie de Schopenhauer.
Cependant, Le Fondement de la morale se présente comme une série d’arguments juxtaposés, plus ou moins pertinents. Il sera donc assez difficile (même si l’œuvre est plutôt courte) de rendre compte, dans notre devoir, de la totalité des objections. Néanmoins, nous essaierons de tirer l’essentiel de la critique schopenhauerienne en s’intéressant aux arguments les plus fondamentaux, qui sont, eux-mêmes, plus ou moins légitimes. De plus, on peut penser qu’il existe un terrible décalage entre la philosophie de Kant et celle de Schopenhauer. Certains présupposés (notamment sa conception de la volonté), à la base de son œuvre principale Le monde comme volonté et comme représentation (1818), rendent impossible la conciliation entre les deux esprits. Nous nous pencherons donc, en premier lieu, sur un point fondamental de la déontologie kantienne que critique Schopenhauer : la liberté comme condition de possibilité de la morale. Ensuite nous verrons en quoi Schopenhauer reconduit la morale kantienne à la simple recherche du bonheur. Ensuite nous montrerons en quoi, pour Schopenhauer, la loi morale de Kant demeure influencée par la morale théologique, notamment par le démontage de la forme impérative. Finalement nous expliquerons la position de Schopenhauer et surtout son scepticisme vis à vis de la raison comme principe fondateur de la morale. Il s’agit tout d’abord de rappeler quelques éléments fondamentaux de la philosophie de Schopenhauer.
L’enjeu premier de son œuvre est la chasse aux illusions, son entreprise passe par une critique radicale de la représentation (elle est faussée) et de la liberté humaine (elle n’est qu’une illusion). Aux yeux de Schopenhauer, l’univers est gouverné par un principe immanent à toute chose : la volonté. Il faut, bien sur, entendre ce terme dans un sens très précis, la volonté de Schopenhauer ne doit pas être envisagée comme l’attribut humain classique mais comme une entité substantielle, métaphysique, une force vive hypostasiée ; la volonté de Schopenhauer est la chose en soi. Ce qui caractérise la volonté de Schopenhauer, ce qui fait que sa philosophie n’est pas un léger déplacement mais une véritable rupture, est qu’elle est absolument irrationnelle. L’homme est donc gouverné par une volonté folle, qui décide pour lui. Aux yeux de Schopenhauer, nous sommes complètement déterminés, nous sommes les marionnettes de la volonté. La seule véritable liberté nous est extérieure (même si la volonté est dans les choses). Il y a chez Schopenhauer un refus radical de l’anthropocentrisme. En effet, nous n’occupons, en aucun cas, une place particulière par rapport aux autres êtres naturels. Nous sommes, au même titre que les animaux et les plantes, déterminés par notre environnement et nos désirs ; même si le schéma, quand il doit s’appliquer à l’homme, est plus complexe. Il découle naturellement de ce présupposé que la liberté humaine est une grande illusion. Nous ne décidons jamais à partir d’un vouloir libre, la volonté individuelle n’existe pas, ce n’est qu’une manifestation particulière et fourbe de la volonté métaphysique. En revanche, à la fin de la deuxième section de la Fondation de la métaphysique des mœurs, Kant définit la volonté comme absolument autonome. C’est une volonté libre, inconditionnée. Elle échappe à toute détermination, ou du moins, la seule chose qui la « détermine » est la liberté, comme principe premier de son autonomie. Pour Kant, nous sommes libres. Il tient, comme tous les grands penseurs de la causalité, « les deux bouts de la chaîne » (Bossuet). Nous sommes à la fois soumis à la causalité mécanique, c’est-à-dire au déterminisme naturel, et à la causalité par volonté, la liberté. Pour Kant, l’une n’exclut pas l’autre. Kant est compatibiliste, il cherche à dépasser la contradiction en pensant la liberté comme une Idée de la raison.
Il y a donc une véritable incompatibilité entre la philosophie de Schopenhauer qui pense la volonté comme une sorte d’hypostase irrationnelle et la déontologie kantienne qui pose comme condition la liberté de notre vouloir. Aux yeux de Schopenhauer, le point le plus problématique de la philosophie morale de Kant est l’hypothèse du libre arbitre. En effet, pour Kant, la liberté humaine est possible, elle n’est pas incompatible avec le déterminisme naturel. Nous sommes nous-mêmes des causes au sein de l’ordre des causes.
C’est à partir de ce présupposé que Schopenhauer peut déployer son argument principal qui est comme la toile de fond du Fondement de la morale. Kant, nous l’avons déjà évoqué, fonde sa philosophie morale sur un impératif catégorique, l’homme afin d’agir de manière morale peut (ou doit) choisir de répondre à ce même impératif. C’est en étant guidé par une « volonté bonne » qu’il peut y adhérer. Cette « volonté bonne » n’est d’ailleurs possible que si l’homme est libre. Car, comme le pense Kant, à quoi bon penser la volonté si celle-ci n’est pas libre. Ce postulat très traditionnel est intéressant ; c’est comme si Kant, de manière anticipée, apportait un discrédit à la philosophie de Schopenhauer. A quoi bon penser une volonté qui ne soit pas libre ? C’est exactement ce que fait Schopenhauer quand il thématise le principe d’individuation dans Le monde comme volonté et comme représentation. La volonté humaine n’est pas libre, ou plutôt, il n’y a pas de volonté humaine, elle est illusoire, il n’y a qu’une volonté métaphysique. Celle-ci se sert de nous, elle nous laisse croire que nous disposons de notre volonté afin de pouvoir affirmer son existence ; en fait la volonté individuelle n’est qu’un moyen pour que la volonté métaphysique s’accomplisse et persévère.
Schopenhauer voit dans la position kantienne sur la liberté un aveu de faiblesse. En effet, à la fin de la deuxième section de la Fondation de la métaphysique des mœurs, Kant nous dit que la liberté ne peut avoir qu’une valeur théorique, c’est une Idée de la raison, on ne peut que la supposer et en aucun cas la démontrer. Pour Schopenhauer, il est absolument inadmissible de fonder une philosophie morale, « pratique », sur un présupposé absolument « théorique ». Kant avait pourtant montré beaucoup de réserves en ce qui concerne la réalité pratique de la liberté de vouloir, il affirme qu’elle n’a de valeur réelle que dans la philosophie théorique. Schopenhauer est donc bien étonné de voir ce principe friable au fondement de la morale de Kant. De plus, il y aurait comme une incompatibilité entre la liberté, comme Idée de la raison, et la philosophie morale qui, pense Schopenhauer, doit s’intéresser au monde, à la réalité. Schopenhauer pense, nous l’avons dit plus haut, que la liberté chez Kant n’est pas prouvée, elle est simplement théorisée ; cette manière d’aborder le problème trahit une insuffisance dans la pensée de Kant.
De manière plus générale, Schopenhauer pense que la tradition philosophique, quand elle se penche sur le problème de la morale, se trompe dans la manière de procéder, ou du moins se satisfait d’un primat discutable. En effet, Schopenhauer distingue dans le chapitre VI du Fondement de la morale, le ο, τι (littéralement, « le fait que ») du διοτι (« pourquoi ») de la vertu. Le ο, τι désigne quelque chose comme une approche spéculative de la morale, son but est de fonder un premier principe, c’est une approche déontologique, c’est celle de Kant. Le διοτι, en revanche, peut s’identifier à une perspective beaucoup plus pratique, il ne s’agit plus de donner à la morale une base formelle qui tendrait à l’universel mais bien plutôt de répondre concrètement à la question « Que dois je faire ? » (Socrate illustre bien cette approche). Pour Schopenhauer, la tradition se trompe en accordant le primat au o, τι de la vertu, en effet, la véritable difficulté réside dans le διοτι. Pour Schopenhauer, la tradition philosophique a choisi la facilité en voulant seulement établir un principe théorique, il est beaucoup plus problématique de dicter un comportement juste aux hommes par rapport à leurs actions particulières.
Selon Schopenhauer, la morale de Kant est donc complètement détachée de la réalité. En effet, Schopenhauer pense que la morale doit tirer sa teneur de l’expérience. Or, Kant soutient que « dans une philosophie pratique, il ne s’agit pas de donner les raisons de ce qui arrive, mais les lois de ce qui devrait arriver, cela n’arrivât-il jamais. » Voici un présupposé extrêmement problématique pour Schopenhauer. En effet, à quoi peut bien servir la morale si elle n’est pas appliquée dans la réalité ? Pourquoi fonder une loi qui ne sera respectée par personne ? Comment peut on prétendre avoir cerné l’essence de la morale sans prendre en compte les actions humaines ?
Schopenhauer, dans le chapitre II du Fondement de la morale, commence par accorder un point positif à la philosophie morale de Kant, elle aurait réussi à se détacher de la tradition antique mais aussi de la pensée moderne qui rapportent toujours la morale au bonheur ; respectivement sous un rapport d’identité et de causalité. « Kant a bien mérité de la morale en un point : il l’a purifiée de tout souci du bonheur, de tout eudémonisme. » Mais la lucidité pessimiste de Schopenhauer ne concède ce point que pour le critiquer par la suite. En effet, Schopenhauer explique que la notion de « souverain bien » réintègre de manière dissimulée ce souci du bonheur que Kant souhaitait au départ évacuer. «Au fond, toute cette morale n’aboutit qu’à la recherche du bonheur : elle se fonde sur l’intérêt; elle est cet eudémonisme même, que d’abord Kant, le trouvant hétéronome, a éconduit solennellement, par la grande porte hors de son système; maintenant, caché sous le nom du souverain bien, par la petite porte, il s’y glisse de nouveau.» Cependant, on peut penser que l’interprétation de Schopenhauer ne prend pas en compte un certain nombre de nuances. Il ne faut pas faire l’amalgame entre le « souverain bien », alliance de la vertu et du bonheur et l’eudémonisme au sens large. En effet, l’accès au bonheur chez Kant est pensé comme avant tout une soumission à la raison, le primat étant accordé à la vertu. Si la morale de Kant propose un accès au bonheur, il ne s’agit en aucun cas d’une quelconque satisfaction individuelle. Le bonheur réside dans le respect envers la loi. C’est dans un accord total entre la loi morale et l’individu, ou plutôt le sujet, que le bonheur est envisageable. Pour Kant, il n’y a pas de bonheur sans raison, sans vertu, sans morale. La critique de Schopenhauer a donc une validité formelle, mais ne saisit pas toutes les subtilités de la déontologie kantienne, ou plutôt il refuse de les considérer et taxe Kant de pédanterie.
Le « solitaire de Francfort » formule une objection terrible au chapitre IV du Fondement de la morale, la morale kantienne serait fondée sur une pétition de principe. En effet, Kant, sans aucun souci de démonstration, pose dès le départ que la morale doit être basée sur une loi. Schopenhauer pense que ce présupposé est illégitime car il n’est absolument pas démontré. Pour Schopenhauer, cette loi morale devrait plutôt être déduite que prise comme point de départ de sa réflexion. On ne peut fonder la morale sur les notions de nécessité morale et de devoir car elles sont relatives par essence. Autre objection intéressante de Schopenhauer : si la loi morale est fondée a priori, elle doit être universelle et nécessaire. Or, Kant le soutient lui-même, « il est absolument impossible de cerner par expérience avec une complète certitude un seul cas ou la maxime d’une action par ailleurs conforme au devoir ait reposé purement et simplement sur des principes moraux et sur la représentation du devoir. » Comment se fait il alors qu’une loi fondée sur l’a priori et donc nécessaire n’ait eu aucune répercussion dans la réalité ? Comment se fait il qu’une pure nécessité n’arrive pas, alors que, lorsqu’on regarde dans le premier dictionnaire de philosophie venu, on trouve : est nécessaire tout ce qui ne peut pas ne pas être, en opposition à contingent. Si la loi morale de Kant était si nécessaire et universelle, elle ne manquerait pas d’advenir. Voici un point sur lequel les deux philosophes ne peuvent s’arranger. En effet, pour Kant, si la loi morale n’est pas suivie par les hommes, c’est parce qu’ils font un mauvais usage de leur liberté. Or, pour Schopenhauer, l’homme n’est pas libre, il n’a aucun rempart contre le déterminisme, il ne peut que se soumettre à la nécessité.
Une autre critique est lancée contre les successeurs de Kant, et en particulier contre Fichte qu’il méprise particulièrement et l’accuse d’être un philosophailleur, un « Hanswurst » (Jean- saucisse), dans le théâtre de marionnettes allemand ce nom désigne le personnage qui répète les gestes du héros (en l’occurrence Kant). Schopenhauer pense que la reprise fichtéenne de l’idéalisme transcendantale n’est qu’un miroir grossissant des défauts du système kantien. Fichte, donc, pense que la loi morale de Kant s’appuie sur des faits de conscience, comme si elle était tirée d’une exigence interne. Or, aux yeux de Schopenhauer, et c’est un point que l’on peut difficilement réfuter, s’appuyer sur la conscience, c’est fonder la morale sur l’anthropologie et donc sur l’expérience. Cette interprétation de Fichte entre en contradiction radicale avec la volonté kantienne de fonder la morale sur le pur a priori, et donc complètement indépendamment de l’expérience. « Il ne faudrait pas se laisser aller à cette pensée, qu’on doit pour établir la réalité du principe moral, la déduire de la constitution particulière de la nature humaine. » ; « Il ne s’agit pas de rien tirer par déduction de notre connaissance de l’homme, de l’anthropologie. » Voilà la preuve, les arguments que Kant donne à Schopenhauer pour discréditer la réflexion de ses héritiers qui affirmeront que la loi morale repose sur des faits de conscience. Cependant, Kant précise, et Schopenhauer a apparemment délaissé cet aspect, que sa morale pour ne pas être un concept vide, « une coquille sans noyau » (expression de Schopenhauer), doit se conformer aux lois de la nature. Il faut nécessairement que sa morale, pour ne pas être détachée de la réalité, trouve sa place dans l’ordre des causes. Cela n’est possible qu’en présupposant la liberté comme autonomie de la volonté. Et c’est, sans aucun doute, sur ce point que l’ensemble de la critique schopenhauerienne tourne, les autres arguments qu’il présente dans son Fondement de la morale, sont en fait assez secondaires.
Cependant, une objection presque aussi fondamentale est formulée par Schopenhauer, elle concerne la forme « impérative » de la morale kantienne. Une des notions centrales de la déontologie kantienne, « le respect face à la loi », masque en fait une influence dont Kant, malgré tous ses efforts, n’arrive pas à se détacher : la morale des théologiens. En effet, Schopenhauer, toujours dans le Fondement de la morale (Chapitre VI), s’étonne de cette dénomination singulière. Pourquoi Kant parle-t-il de « respect »? Schopenhauer considère que cette notion de respect n’est là que pour masquer la véritable nature de son impératif, ce n’est pas un « respect face à la loi » qu’exige Kant, mais bien plutôt une « soumission ». Soumission à quoi ? À une loi ? Certainement pas, pense Schopenhauer, ou du moins cette loi n’est pas celle que nous croyons. La morale de Kant qui se veut désintéressée de l’intérêt particulier est en fait mensongère. Aux yeux de Schopenhauer, derrière cette morale abstraite ce cache une entité que nous connaissons bien : dieu. L’impératif catégorique est perçu comme un emprunt au Décalogue de Moïse. La morale kantienne repose donc sur l’hypothèse suivante : une volonté étrangère (Dieu) commande, châtie et promet des récompenses (mais bien sur ne récompense pas). Or, selon Schopenhauer, plus une hypothèse est naturellement théologique, moins elle est philosophique. Seul l’athéisme peut espérer fonder une morale objective. Kant n’est que la victime du théisme occidental. La critique de la Métaphysique kantienne va donc de pair avec celle du théisme occidental.
L’impératif catégorique, dans sa forme même, trahit donc une influence à laquelle Kant ne peut renoncer. Pour Schopenhauer, derrière cette forme impérative se trouve en fait un « Tu dois ! », preuve incontestable de l’inclination, peut être inconsciente, de Kant. Si, comme le dit Schopenhauer, l’impératif catégorique dissimule la morale des théologiens, alors la morale kantienne perd ce qui faisait qu’elle était désintéressée (sur le plan individuel). En effet, si l’homme n’est pas soumis à une loi transcendantale comme le pense Kant, mais bien à un commandement divin, alors l’homme qui se soumet à cette morale se voit influencé par « le désir de récompense» et par « la crainte du châtiment ». La loi morale de Kant, qui avait une exigence universelle, s’écroule sous les coups d’un tel présupposé. Elle est reconduite à l’intérêt individuel, l’homme n’est plus moral que par crainte de l’enfer. Schopenhauer, dans sa lancée, vocifère contre une autre formulation de l’impératif catégorique tout aussi problématique que la première : « Agis uniquement d’après une maxime telle, que tu puisses vouloir, au même moment, la voir érigée en loi universelle, valable pour tout être raisonnable. » En fait, Kant s’exprime en ces termes : « « Je ne dois jamais me conduire autrement que de telle sorte je puisse aussi vouloir que maxime soit vouée à devenir une loi universelle. » (Fondation de la métaphysique des mœurs, 1ère section, p.71). Pour Kant, l’agir moral n’est possible que s’il est le produit d’une volonté, dépouillée de motifs extérieurs, qui n’aurait pour autre but que l’universalisation de son action. L’agir, chez Kant, n’est moral que s’il est universalisable.
Pour Schopenhauer, la loi de Kant repose sur une réciprocité supposée et donc sur l’égoïsme (chapitre VII duFondement de la morale). En effet, je ne souhaite agir d’une certaine manière que car je sais que j’aimerai qu’on se comporte de même avec moi. La loi de Kant serait en fait forgée par l’égoïsme. C’est, aux yeux de Schopenhauer, la seule qualité (au sens d’attribut) humaine, typiquement humaine, capable de décider de cette loi. L’exigence d’universalité dissimule en fait un juge bien peu moral. La loi kantienne, même si elle est formulée de manière positive, se résumerait à cette parole biblique bien connue : « Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse. » C’est bien parce que je ne veux pas souffrir que je décide de forger une loi basée sur l’universalité. Pour Schopenhauer, la loi kantienne n’est pas désintéressée, bien au contraire, elle serait comme un égoïsme cristallisé.
Ce point nous amène à nous pencher sur une autre prise de position problématique de Kant. Il dit, dans la troisième section du Canon de la raison pure intitulé de l’opinion, du savoir et de la croyance (in Critique de la raison pure), que pour que la loi morale ait un sens, pour qu’elle ne soit pas vaine, l’homme doit penser que, dans l’Au delà, dieu considérera à juste titre et récompensera l’agir moral en rendant notre âme immortelle. Où se trouve alors le désintéressement ? Voilà ici, formulée par Kant lui-même, une contradiction. En effet, si l’homme, afin de supporter cette contrainte morale assez inhumaine qu’est la déontologie kantienne, espère quelque chose de dieu, alors il n’est plus dans le désintéressement. Le « Que dois-je faire ? » ne doit pas, pour rester cohérent avec la doctrine kantienne, se rapporter au « Que m’est-il permis d’espérer ? » Et cela, Schopenhauer, nous l’avons vu plus haut, l’avait bien remarqué. La loi morale de Kant, qui n’est ce qu’elle est que parce qu’elle remplie les critères d’universalité et de désintéressement, se voit ici dépouillée de ce qui la constituait. On peut dire que Schopenhauer désarme la loi morale en découvrant derrière l’exigence d’universalité un égoïsme indestructible et derrière un prétendu désintéressement, un espoir de récompense dans l’Au delà. Autre argument important de Schopenhauer : la Raison ne peut fonder la morale. Kant forge une identité inédite mais surtout discutable entre l’acte moral et l’acte raisonnable. Pour Schopenhauer, ce sont deux domaines complètements différents, ils ont toujours été distingués, il n’y a que Kant qui a pensé que la vertu ne puisse être issue d’autre chose que de la raison. Aux yeux de Schopenhauer, la raison doit servir à fonder la science mais en aucun cas la morale, celle-ci doit être déterminée selon l’ordre des sentiments. Cette objection, à première vue séduisante, est en fait au moins aussi problématique que l’hypothèse de Kant. En effet, il faut présupposer la raison pour expliquer les interrogations humaines, l’homme ne se serait pas mis à s’interroger sur une quelconque morale s’il ne possédait la raison. Elle est la condition nécessaire de tout questionnement humain. Ceci dit, l’objection de Schopenhauer demeure intéressante. L’équivalence agir raisonnable / agir moral doit être nuancée. En effet, un acte commandé par la raison n’est pas nécessairement moral. Il suffit de regarder dans l’histoire des hommes pour se rendre compte que la raison s’est souvent faite l’alliée du mal. Parallèlement, on peut donner l’exemple d’un acte moral et déraisonnable, celui de Schopenhauer est le suivant : « (…) si je donne à un pauvre aujourd’hui ce dont j’aurai demain plus besoin que lui encore ; si je me laisse aller à prêter à un homme dans l’embarras une somme qu’attend un créancier ; semblables cas ne sont point rares. » (Chapitre VI)
Schopenhauer se montre également très sceptique devant une distinction mystérieuse de Kant, entre homme et être raisonnable fini. Pourquoi cette distinction ? Quelle est son utilité ? Pour Schopenhauer, il est illégitime d’opérer une telle distinction. En effet, si l’on ne peut pas penser l’étendue sans les corps, au même titre, on ne peut concevoir la raison indépendamment de l’homme. Même s’il est évident que Kant ne pense pas aux « bons anges » qu’évoque Schopenhauer, on peut penser très sérieusement qu’il considère qu’une autre forme de raison est possible. Cette hypothèse, même si elle est toute théorique, peut être confirmée à la lecture de la troisième section du Canon de la raison pure (que nous avons déjà cité) dans la première Critique : « S’il était possible de décider de la chose par quelque expérience, je parierais volontiers tous mes biens qu’il y a des habitants dans au moins quelques unes des planètes que nous voyons. Ce pour quoi je dis que ce n’est pas simplement une opinion, mais une forte croyance, qui me fait penser qu’il y a aussi des habitants dans d’autres mondes. »
Schopenhauer et Kant sont donc, en morale, irréconciliables, ils ne peuvent s’entendre car abordent le problème de façons trop différentes. Kant cherche à déterminer une forme pure de l’agir moral à travers son impératif catégorique, c’est-à-dire formuler une loi qui, si elle est suivie, assurerait la moralité d’un acte, ou du moins cet acte serait « conforme au devoir ». Le problème réside en ce point, il ne serait que « conforme au devoir », l’homme qui agit « par devoir » est une chimère. Pour Schopenhauer, l’homme est inévitablement déterminé par des motifs sensibles, il est toujours intéressé, il ne peut considérer l’autre comme une fin, il le considérera toujours comme un moyen. Cependant, Kant savait très bien que sa loi morale ne pouvait être suivie, c’est une exigence que l’homme est incapable de remplir, est c’est certainement cela que l’on peut lui reprocher. Pourquoi fonder une morale à ce pont déconnectée de la réalité, même si Kant affirme qu’il prend pour point de départ la finitude de l’homme pour penser la morale, on peut se demander si, en chemin, il ne l’a pas oubliée. Schopenhauer nous présente donc dans le Fondement de la morale une critique sévère qui met en relief les failles de la déontologie kantienne, notamment son attachement problématique au protestantisme qui la rend, pour Schopenhauer, inévitablement faussée. Ce dernier souligne également quelques postulats discutables, en l’occurrence le choix arbitraire de la loi comme fondement ou encore l’identification raison / morale. Mais ce qui reste le plus fondamental dans la critique schopenhauerienne est la mise en lumière de certaines contradictions, en premier lieu, l’hypothèse du libre arbitre basée sur l’autonomie de la volonté, parti pris absolument irrecevable pour Schopenhauer, mais également la prétention à rompre avec l’eudémonisme, chose que Kant, après examen, n’a pas vraiment réussi à faire, notamment en liant sa morale, qui se veut désintéressée, à l’espoir d’une âme immortelle auprès de dieu. Schopenhauer, de manière plus général, pense que la morale kantienne n’a qu’une valeur théorique, et cela revient en fait à dire qu’elle n’en possède aucune. Schopenhauer, dans la deuxième partie du Fondement de la morale, propose à son tour une morale qui se veut beaucoup plus pratique et qui se base, non plus sur la raison ou la liberté, mais sur la pitié.
M. http://philitt.fr/2012/10/28/schopenhauer-critique-de-la-morale-kantienne/
 Dans cette première livraison de Francelemag, on trouvera une réflexion de Jean-Yves Le Gallou, président de la Fondation Polémia, auteur, essayiste…, qu’il livre à nos lecteurs sur le Retour de l’histoire.
Dans cette première livraison de Francelemag, on trouvera une réflexion de Jean-Yves Le Gallou, président de la Fondation Polémia, auteur, essayiste…, qu’il livre à nos lecteurs sur le Retour de l’histoire.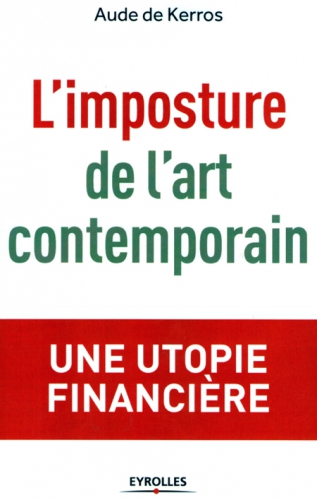 L’imposture de l’Art contemporain – Une utopie financière
L’imposture de l’Art contemporain – Une utopie financière