Dernières semaines de septembre. Chez les Viets.
Il apparaît donc clairement que la prise de That Khé est la prochaine étape de Giap. Pendant cette douzaine de jours que la colonne Le Page passe à That Khé,Giap continue à aménager son dispositif à quelques heures de marche de la ville. Le gros du corps de bataille viet constituée de la Division 308, du Régiment 209, du Régiment d'artillerie 95, s'organise dans la région montagneuse située entre la frontière de Chine (13/14 km de la RC4 en ligne directe) et la chaîne du Na Kéo et du Na Moc N'ga qui borde à l'est la RC4, autour de Bo Bach et Poma.
Ces unités que nous qualifierons chez nous, de "Réserve Générale" sont assistées de bataillons régionaux de "l'Interzone du Viet Bac nord et de Lang Son" (ainsi sont-ils qualifiés par les Viets) : les Bataillons 428, 888 et 426. Le bataillon 426 était chargé auparavant de la garde rapprochée de l'état-major de Giap, et a assisté le Régiment 174 du colonel Dang Van Viet lors de la deuxième attaque de Dong Khé, et va continuer de l'accompagner pour la suite des événements.
Une nouvelle reconnaissance aérienne aperçoit le drapeau viet flottant sur l'ancienne citadelle de Dong Khé mais peu d'activité dans la place. Les unités qui en ont la garde, dont le Régiment 209, sont blotties dans la jungle non loin du village car, pour Giap, il est inopportun de garder un effectif important dans ce qui était auparavant la citadelle et qui a pris l'aspect du fort de Douaumont en 1917, après les pilonnages de l'artillerie viet et nos bombardements aériens.
Le Régiment 174 après la chute de Dong Khé a reçu l'ordre de faire mouvement vers le sud de That Khé en contournant la ville par l'ouest, toujours accompagné du Bataillon 426 et appuyé de quatre pièces de 75. Il est chargé de couper la RC 4 entre That Khé et Na Cham et doit s'apprêter à attaquer les postes échelonnés sur ce parcours, pour interdire les renforts depuis Lang Son et les replis depuis That Khé.
Enfin se surajoutent, aux unités régulières viets, les nombreuses milices populaires et de guérillas des villages de la région. Le Vietminh a décrété la mobilisation générale qui est en réalité une mobilisation régionale massive en vue de la "contre-offensive générale". Le rapport du 18 septembre 1950 de l'officier de renseignement de That Khé signale que les commissaires politiques font la chasse aux Vietnamiens ralliés aux troupes françaises. La population de deux villages, suspecte aux yeux du Vietminh, aurait été enlevée. Le rapport du 20 septembre de ce même service note que toute la population disponible de la région a été réquisitionnée pour aménager les pistes et les points de ravitaillement. Les pelles et les pioches des particuliers ont été collectées. Le bétail a été recensé. Une taxe par famille a été prélevée.
A la même période, le commandement français était en possession d'un volumineux dossier de renseignement portant le nom de code "Cantal" en provenance probablement d'agents chinois et parvenu peut-être par la voie de notre attaché militaire en Chine nationaliste (?). L'extrait ci-dessous montre l'intense activité développée entre Chinois communistes et Viets qui aurait dû appeler nos états-majors à moins de décontraction :
- 13 septembre. 300 artilleurs du Yunnan arrivent de Chine par la route coloniale n° 2 via Ha Giang avec un nombre indéterminé de canons.
- 14 septembre. Des soldats VM (soldats du Vietminh) s'entraînent sur 6 canons anti-aériens en Chine à Trung Si.
- 20 septembre. 70 tonnes de riz sont en réserve sur la frontière dont 30 viennent juste d'arriver de Chine. D'ailleurs, devant l'importance des données chiffrées de ce rapport, notre service de renseignement se demande s'il n'est pas l'objet de tentative de désinformation par des agents du Vietminh.
- Ce même 20 septembre. 300 Chinois communistes sont partis vers le Tonkin avec 6 mortiers de 60.
- 22 septembre. 1 500 VM sont en déplacement à 17 km au nord de Long Tchéou (ville chinoise derrière la frontière).
- Ce même jour, 1 500 VM arrivent à 5 km au nord de Dong Dang (village à 14 km au nord de Lang Son) par Lieu Cao, point de passage de la frontière de Chine.
- 29 septembre. Un centre de transmission chinois à Aï Hao (?) est en liaison permanente avec plusieurs centres viets : près de Cao Bang, à Bac Kan et à Ta Lung.
- Important trafic de camions depuis la Chine vers le Tonkin avec destination finale Trung kanh Phou : rames d'une vingtaine de camions les 4, 7, 10 et 11 septembre.
- Plus d'une centaine de blessés VM sont soignés en Chine à l'hôpital de Fa Tong et à Long Tchéou.
- Par ailleurs dans les jours précédents, un important mouvement de soldats viets en route depuis la Chine vers le Tonkin a été signalé par un autre informateur. Il parle de plus de 10 000 hommes. Ce chiffre est tellement important que l'officier de renseignement se demande si notre agent n'a pas été "retourné" ; à noter que l'effectif total des deux Régiments 102 et 88 qui revenaient de l'entraînement en Chine comme nous le savons maintenant, avoisinait les 10 000 hommes.
- 30 septembre, un général chinois accompagné d'une centaine de personnes est arrivé au Tonkin avec pour mission de diriger les attaques viets, précise la source chinoise.
Ces comptes-rendus qui tombaient tous les jours sur le bureau des généraux et des chefs d'état-major étaient-ils lus avec attention ?
Ainsi le corps de bataille viet fort d'une trentaine de milliers d'hommes, appuyé de milliers de coolies et bénéficiant d'une aide déterminante de la Chine, rapide dans l'exécution mais plus lent dans la décision, s'organisait tout doucement aux abords de That Khé, à quelques heures de marche de la place, en vue de son attaque prochaine. Et voici que va se glisser bientôt au milieu d'eux, une colonne de Français de moins de 3 000 hommes qui monte de Lang Son.
Bien sûr Giap non plus n'est pas dupe, les Français vont sûrement essayer de reprendre Dong Khé. Laissons-les tout de même monter pour voir comment ils vont se découvrir. Ainsi ce n'est pas le supposé génie de Giap qui a conçu cet encerclement des deux colonnes, mais les circonstances qui ont fait que nous allions nous enfermer dans la nasse qui n'étaient pas tendues au départ pour les deux colonnes, mais pour encercler et faire tomber That Khé. C'est ce que conclura, dans son rapport, le capitaine Jeanpierre, un des trois officiers rescapés du 1er BEP, ainsi que la 2e Bureau. A coup sûr alors a germé chez Giap l'idée de faire un coup double : prendre That Khé et exterminer un corps d'élite français.
Une célèbre, courageuse (et adorable, ajoute Bigeard) journaliste qui a sauté plusieurs fois avec les paras, Brigitte Friang fait remarquer plus tard que ce n'est pas le génie de Giap qui a gagné les batailles mais plutôt la suffisance de nos officiers généraux qui les a perdues.
Le rendez-vous manqué, Serge Desbois
http://www.oragesdacier.info/2016/03/giap-tente-de-couper-la-route-coloniale.html
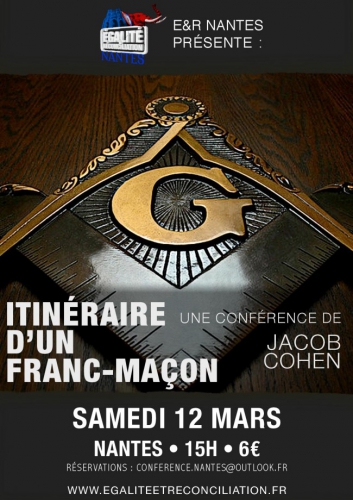

 Premier livre de l'année 2016 : La Société Thulé de Detlev Rose
Premier livre de l'année 2016 : La Société Thulé de Detlev Rose