culture et histoire - Page 1217
-
(22) Les Rois de France - Louis XV, le bien aimé
-
Livre Libre - Gilbert Collard / Jean-Pierre Stora : Alger d'hier et de toujours
-
C'est notre devoir d'offrir une sépulture digne aux Vendéens de 1793
Lu ici :
"En 2009, à l'occasion des travaux d'extension d'un centre culturel au Mans, les ossements de centaines de victimes des combats des 12 et 13 décembre 1793 ont été découverts, enterrées à la hâte dans des fosses communes. Il s'agit majoritairement de combattants vendéens de la Virée de Galerne.
A l'issue des travaux scientifiques menés par Elodie Cabot, anthropologue, l'avenir de ces 154 squelettes exhumés s'est à nouveau posé.
« A la recherche d'un lieu symbolique et commémoratif, la Chapelle du Mont des Alouettes, appartenant au Diocèse de Luçon, est apparue rapidement pour de nombreux Vendéens comme un lieu consensuel », explique Henry Renoul en charge du projet. Ce lieu viendrait compléter d'autres sites évoqués « le Mémorial de Vendée aux Lucs-sur-Boulogne, dédié aux victimes des colonnes infernales, et Saint-Florent-le-Vieil où les généraux vendéens Cathelineau et Bonchamps sont enterrés ».
L'Association des Descendants des Chouans et des Vendéens, les Vendéens de Paris, Vendée Militaire, Vérité pour la Vendée ont fait connaître publiquement leur préférence pour le Mont des Alouettes.
Pour Véronique Besse, « c'est notre devoir d'offrir une sépulture digne à ces Vendéens de 1793. Le Mont des Alouettes est un lieu parfait pour leur rendre hommage : un lieu de mémoire reconnu et chargé de symboles. Il est donc normal que la Ville des Herbiers soutienne ce projet ». Un projet également soutenu par Philippe de Villiers, ancien Secrétaire d'Etat à la Culture et Gilles Bourdouleix, député-maire de Cholet.
Propriétaire de la chapelle, l'association diocésaine de Vendée, par la voix de Mgr Castet, évêque de Luçon a manifesté son intérêt pour « le site spirituellement très significatif du Mont des Alouettes ».
Christophe Rabiller, architecte vendéen, travaille actuellement sur le projet. Selon ses premières réflexions, une crypte d'environ dix mètres cube pourrait être creusée dans le sous-sol de la chapelle des Alouettes. Ceci est d'autant plus facilement réalisable que la chapelle est bâtie en grande partie sur un remblai. Une vitre épaisse constituerait le plafond de cette crypte et l'allée centrale du sol de la chapelle. Tout autour de cette fosse, les cercueils des 154 squelettes et au fond, sur un miroir, 154 bougies lumineuses s'y réfléchiront.
« Une structure associative pour recueillir les fonds vient d'être créée. Dès que tous les signaux sont au vert, nous lançons la souscription publique », conclut Henry Renoul." -
(21) Les Rois de France - Louis XIV, le roi soleil - (2) À la poursuite de la gloire
-
Après deux ans aujourd'hui, présence de Jean-François Mattéi
Jean-François Mattéi chez Charles Maurras parle du Chemin de ParadisJean-François Mattéi nous a quittés le 24 mars 2014. Deux années ont passé.Grand philosophe, d'une culture immense mais d'une simplicité et d'une urbanité rares, Jean-François Mattéi connaissait bien Lafautearousseau, il l'appréciait, le lisait, et y écrivit volontiers.C'est le mardi 23 mai 2013 que lafautearousseau publia le premier article que lui donna Jean-François Mattéi, traitant d'un sujet qu'il connaissait bien et qui lui tenait à coeur, la théorie du genre... On pourra s'y reporter. [Le Père Goriot et la Mère Vauquer]. D'autres textes suivirent, dont un intéressant échange avec Pierre de Meuse sur le statut de l'universel. Et Jean-François Mattei est intervenu à maintes reprises dans nos cafés politiques à Marseille et Aix en Provence et en de multiples autres occasions : colloques à Paris, aux Baux de Provence, soirées du 21 janvier à Marseille, hommage à Maurras à Martigues, etc. On en trouvera de nombreuses traces dans nos vidéos. De même dans nos grands textes* qui ont publié de larges extraits [25 au total] de son important ouvrage Le regard vide - Essai sur l'épuisement de la Culture européenne.Le 4 février 2014, à peine plus d'un mois avant de nous quitter, Jean-François Mattei avait donné au Café actualité d'Aix en Provence, une conférence qui fut sans-doute l'une de ses dernières interventions publiques en même temps que l'une des plus brillantes où, à travers son diagnostic sur la crise des fondements de notre civilisation, se trouve remarquablement exposée sa conception de l'ordre des cités, des sociétés et de la civilisation en général. On l'écoutera avec profit et, pour ceux qui ont connu Jean-François Mattei, avec émotion. •
* Grands Textes et Le regard vide, par Jean-François Mattei
Voir aussi l'éphéméride de ce jour
et
Décès de Jean-François Mattéi : par dessus tout, une perte pour la pensée française
-
Livre : Parution : Drieu la Rochelle : Socialisme fasciste
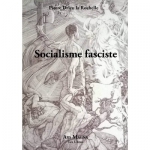 Issu de la gauche républicaine et progressiste, Drieu la Rochelle (1893-1945) se placera dans les années 1930 dans la lignée du premier socialisme français, celui de Saint-Simon, Proudhon et Charles Fourier, ce qui le conduira à adhérer en 1936 au Parti populaire français, fondé par Jacques Doriot, et à devenir, jusqu'à sa rupture avec le PPF en 1939, éditorialiste de la publication du mouvement, L'Émancipation nationale. En 1943, alors que chacun sait que tout est perdu pour les partisans de la collaboration, Drieu la Rochelle, dans un ultime geste de provocation, adhèrera de nouveau au Parti populaire français, tout en confiant à son journal son admiration pour le stalinisme.
Issu de la gauche républicaine et progressiste, Drieu la Rochelle (1893-1945) se placera dans les années 1930 dans la lignée du premier socialisme français, celui de Saint-Simon, Proudhon et Charles Fourier, ce qui le conduira à adhérer en 1936 au Parti populaire français, fondé par Jacques Doriot, et à devenir, jusqu'à sa rupture avec le PPF en 1939, éditorialiste de la publication du mouvement, L'Émancipation nationale. En 1943, alors que chacun sait que tout est perdu pour les partisans de la collaboration, Drieu la Rochelle, dans un ultime geste de provocation, adhèrera de nouveau au Parti populaire français, tout en confiant à son journal son admiration pour le stalinisme.
« Dès 1918, j’ai flairé dans le communisme russe, le moyen de produire une nouvelle aristocratie. Je ne m’étais pas trompé. Je cherche maintenant dans le socialisme de forme européenne, dans le fascisme, cette nouvelle aristocratie. Une jeune aristocratie qui ne sera point fondée sur l’argent, mais sur le mérite. » telle est la profession de foi que Pierre Drieu la Rochelle nous fait dans Socialisme fasciste, un ouvrage publié en 1934 et qui n’avait jamais été réédité.
Les editions Ars Magna -
ZOOM : Petite histoire de la politesse
-
(20) Les Rois de France - Louis XIV, le roi soleil - (1) La conquête du pouvoir
-
2006 - 2016 : le 30 mars prochain, cela fera dix ans que Synthèse nationale vous informe quotidiennement !
Chers Lecteurs, Chers Amis,
Le 30 mars prochain, cela fera dix ans que Synthèse nationale apparaissait sur la toile. Depuis, au moins trois fois par jour, ce blog est alimenté. Il est maintenant quotidiennement consulté par au minimum 3 000 personnes. Parfois, le nombre des connexions dépasse les 25 000.
En dix ans, nous avons donné la parole à plus de 200 personnalités, responsables politiques ou économiques, écrivains, élus et acteurs se réclamant de notre famille d'idées. Nous avons lancé deux revues, Synthèse nationale et les Cahiers d'Histoire du nationalisme cliquez ici, créé une maison d'édition, Les Bouquins de Synthèse nationale cliquez ici et un service de diffusion cliquez là. Nous avons aussi organisé des dizaines de réunions, colloques et séances de dédicaces tant à Paris qu'en Province, ce à quoi il faut ajouter nos journées nationalistes et identitaires qui rassemblent de plus en plus de monde chaque année, à Lille en avril et à Rungis en octobre.
Tout cela a été possible grâce à l'engagement d'une poignée de volontaires et au dévouement de l'équipe de contributeurs qui scrute en permanence l'actualité afin de sélectionner l'essentiel à l'attention des militants et sympathisants de la cause nationale et identitaire.
La seconde raison de la longévité et du développement de Synthèse nationale est la fidélité et la générosité de ses lecteurs. Beaucoup nous aident en s'abonnant à la revue éponyme cliquez là ou aux Cahiers d'Histoire du nationalisme cliquez là, certains en adhérant à l'Association des Amis de Synthèse nationale cliquez là, d'autres enfin en achetant régulièrement les livres que nous éditons ou proposons. Quoi qu'il en soit, nous tenons à tous vous remercier pour votre fidèle amitié. Sans vous, il y a bien longtemps que ce site aurait disparu.
Synthèse nationale fait partie de ces môles de résistance qui gênent le Système. Pour s'en convaincre, il suffit de constater la quantité d'endroits, qu'il s'agisse des services de l'Education dite nationale, des chaines d'hôtels internationaux, des entreprises mondialisées, où son accès est interdit. Cela ne nous décourage pas. Bien au contraire, cela nous incite à amplifier notre action.
Le dimanche 9 octobre prochain, ce sera la dixième journée nationaliste et identitaire à Rungis, ce sera l'occasion de nous retrouver encore plus nombreux pour fêter ce dixième anniversaire. Le monde est en train de changer, l'heure du retour des peuples, des nations, des identités et des traditions européennes approche. Soyons mobilisés, le combat continue.
Amitié à tous.
Roland Hélie
Directeur de Synthèse nationale
-
Succès pour le colloque de Civitas et convergence des dissidents
Civitas a réussi un très joli coup. Samedi 19 mars, son colloque organisé en partenariat avec l'Alliance for Peace and Freedom et le Rassemblement pour la Syrie a fait salle comble autour d'un regroupement exceptionnel d'intervenants issus de la dissidence (Pierre Hillard, Damien Viguier, Youssef Hindi, Jean-Michel Vernochet, Elie Hatem, Roberto Fiore, Irène Dimopoulou, Mère Agnès-Mariam de la Croix, Marion Sigaut, Claire Séverac,...), venus aborder une vaste problématique : "De la guerre au Proche-Orient à l'immigration et au terrorisme en Europe". Il n'y avait plus une chaise libre dès 14h15 et plusieurs dizaines de personnes n'ont pas pu entrer, faute de place. Les intervenants se sont succédés avec des exposés de haut niveau, et pourtant abordables, devant un public très attentif.
Lors de la pause, les différents auteurs présents ont été abondamment sollicités pour dédicacer leurs livres. Ensuite, vinrent les trois derniers exposés, dont celui de Jean-Marie Le Pen, très attendu, avant la conclusion prononcée par Alain Escada.
Ce colloque est un bel exemple de convergence des forces insoumises au Nouvel Ordre Mondial.
Civitas fixe d'ores et déjà rendez-vous le dimanche 8 mai, place Saint Augustin à Paris, pour un hommage à Sainte Jeanne d'Arc dans un même esprit de convergence. A partir de 12h30 se succéderont des animations et des discours avant le départ à 14h30 d'un défilé jusqu'à la place des Pyramides.Lien direct Mis en ligne par Philippe Delbauvre

