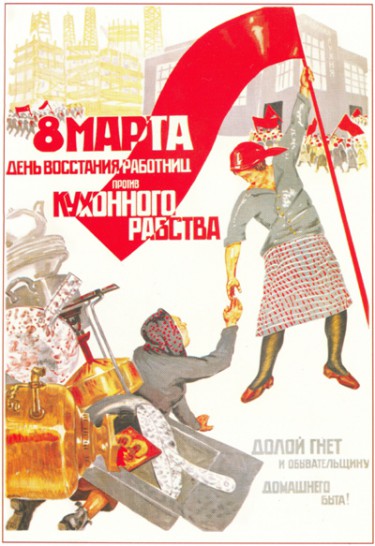Dans le livre troisième de son fameux Essai sur l'inégalité des races humaines, publié dans les années 50 du 19ième siècle, Arthur de Gobineau décrivait les flux migratoires des peuples indo-européens en Orient et relevait que «vers l'année 177 av. J. C., on rencontrait de nombreuses nations blanches à cheveux clairs ou roux et aux yeux bleus, installées sur les frontières occidentales de la Chine. Les scribes du Céleste Empire, auxquels nous devons de connaître ce fait, citent cinq de ces nations… Les deux plus connues sont le Yüeh-chi et les Wu-suen. Ces deux peuples habitaient au nord du Hwang-ho, aux confins du désert de Gobi… De même, le Céleste Empire avaient pour sujets, au sein de ses provinces du Sud, des nations aryennes-hindoues, immigrées au début de son histoire» (1).
Arthur de Gobineau tirait ses informations des études de Ritter (Erdkunde, Asien) et de von Humboldt (Asie centrale); tous deux se basaient sur les annales chinoises de la dynastie han, dont les premiers souverains ont commencé leur règne en 206 av. J. C. De fait, nous savons aujourd'hui que, dès le 4ième siècle avant J.C., les documents historiques du Céleste Empire évoquaient des peuples aux cheveux clairs, de mentalité guerrière, habitant sur les confins du territoire, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Turkestan chinois ou le Xinjiang. Selon Gobineau, ces faits attestaient de la puissance expansive et implicitement civilisatrice des populations "blanches". Mais, au-delà des interprétations unilatérales et, en tant que telles, inacceptables de l'écrivain français, presque personne n'a pris en considération la signification que ces informations auraient pu revêtir pour retracer l'histoire de la culture et des influences culturelles, sur un mode moins banal et linéaire que celui qui était en vogue au 19ième siècle.
On a plutôt eu tendance à rester incrédule quant à la fiabilité des annales, parce qu'on était animé par un indécrottable préjugé euro-centrique, selon lequel les peuples de couleurs étaient en somme des enfants un peu fantasques, incapables de saisir l'histoire dans sa concrétude. En outre, à l'époque, il était impossible de vérifier la présence de ces populations "blanches" : même en admettant qu'elles aient existé, personne ne pouvait dire depuis combien de temps elles avaient disparu, noyées dans la mer montante des populations asiatiques voisines. Cette zone géographique, jadis traversée par la légendaire "route de la soie" et devenue depuis longtemps en grande partie désertique, était devenue inaccessible aux Européens, qui ne pouvaient évidemment pas y mener à bien des études archéologiques sérieuses et approfondies.
Latin, irlandais ancien et tokharien
Comme l'a souligné Colin Renfrew, célèbre pour ses recherches sur les migrations indo-européennes, ce n'est qu'au début du 20ième siècle que les premiers érudits ont pu s'aventurer dans la région, en particulier dans la dépression du Tarim et dans diverses zones avoisinantes (2). Ils ont trouvé de nombreux matériaux, bien conservés grâce à l'extrême aridité du climat désertique qui règne là-bas. Il s'agit essentiellement de textes en deux langues, écrits dans une langue jusqu'alors inconnue, qui utilisait cependant un alphabet du Nord de l'Inde; à côté du texte en cette langue, figurait le même texte en sanskrit. Ce qui a permis de la comprendre et de l'étudier assez rapidement. Cette langue a été appelée par la suite le "tokharien", dénomination que l'on peut juger aujourd'hui impropre. Elle se présentait sous deux formes légèrement différentes l'une de l'autre, qui révélaient "diverses caractéristiques grammaticales les liant au groupe indo-européen" (3). Notons le fait que les ressemblances les plus frappantes liaient cette langue au celtique et au germanique, plutôt qu'aux groupes plus proches de l'iranien et des autres langues aryennes d'Asie. A titre d'exemple, nous comparerons quelques mots fondamentaux que l'on retrouve respectivement en latin, en irlandais ancien et en tokharien. "Père" se dit "pater", "athir" et "pacer"; "Mère" se dit "mater", "mathir" et "macer"; ""Frère" se dit "frater", "brathir" et "procer"; "Sœur" se dit "soror", "siur" et "ser"; "Chien" se dit "canis", "cu" et "ku" (4). A titre de curiosité, signalons une autre correspondance: le nombre "trois" se dit "tres" en latin, "tri" en irlandais ancien et "tre" en tokharien.
Les affinités sont donc plus qu'évidentes. «Les documents remontent aux 7ième et 8ième siècles après J. C. et comprennent des correspondances et des comptes rendus émanant de monastères… Des deux versions de la langue tokharienne, la première, nommée le "tokharien A" se retrouve également dans des textes découverts dans les cités de Karashar et de Tourfan, ce qui a amené certains savants à l'appeler le "tourfanien". L'autre version, appelée "tokharien B", se retrouve dans de nombreux documents et textes trouvés à Koucha et donc baptisée "kouchéen" (5).
Processus endogène ou influence exogène ?
Aujourd'hui, on tend à penser que ces langues ont été parlées par les Yüeh-chi (ou "Yü-chi"), le peuple mentionné dans les annales antiques, peuple qui avait entretenu des contacts prolongés avec le monde chinois. C'est là un point fondamental, qui est resté longtemps sans solution. En fait, sur la naissance de la civilisation chinoise, deux opinions s'affrontent : l'une entend privilégier un processus entièrement endogène, sans aucune influence extérieure d'autres peuples; l'autre, au contraire, met en évidence des apports importants, fondamentaux même, venus d'aires culturelles très différentes. La première thèse est naturellement la thèse officielle des Chinois, mais aussi celle de tous ceux qui s'opposent à toute conception de l'histoire qui pourrait donner lieu à des hypothèses "proto-colonialistes" voyant en l'Occident la matrice de tout progrès. Les défenseurs les plus convaincants de la thèse "exogène" —c'est-à-dire Gobineau, déjà cité, mais aussi Spengler, Kossina, Günther, Jettmar, Romualdi, etc.— sont ceux qui soulignent, de manières très différentes, le rôle civilisateur des peuples indo-européens au cours de leurs migrations, parties de leur patrie primordiale, pour aboutir dans les contrées lointaines auxquelles ils ont donné une impulsion bien spécifique. Bien sûr, dans certains cas, ces auteurs ont constaté que l'apport culturel n'a pas été suffisamment fort pour "donner forme" à une nouvelle nation, vu le nombre réduit des nouveaux venus face aux populations indigènes; néanmoins, la simple présence d'une influence indo-européenne a suffit, pour ces auteurs, pour imprimer une impulsion vivifiante et pour animer un développement chez ces peuples avec lesquels les migrants indo-européens entraient en contact. Ce serait le cas de la Chine avec les Tokhariens.
Par exemple, Spengler (6) souligne l'importance capitale de l'introduction du char de guerre indo-européen dans l'évolution de la société chinoise au temps de la dynastie Chou (1111-268 av. J. C.). D'autres auteurs, comme Hans Günther, plusieurs dizaines d'années plus tard, avait avancé plusieurs hypothèses bien articulées et étayées de faits importants, attribuant à cette pénétration de peuples indo-européens l'introduction de l'agriculture parmi les tributs nomades d'Asie centrale, vers la moitié du deuxième millénaire; il démontrait en outre comment l'agriculture s'était répandue en Asie centrale, parallèlement à l'expansion de populations de souche nordique.
Bronze et chars de guerre
De même, l'introduction du bronze en Chine semble, elle aussi, remonter aux invasions indo-européennes; ensuite, on peut supposer qu'aux débuts de l'histoire chinoise, il y a eu l'invasion d'un peuple équipé de chars de guerre, venu du lointain Occident. Par ailleurs, on peut dire que les sinologues actuels reconnaissent tous l'extrême importance du travail et du commerce du bronze dans le développement de la société en Chine antique (7). La même importance est attribuée aujourd'hui, par de plus nombreux sinologues, à l'introduction de certaines techniques agricoles et du char hippo-tracté.
Les études de Günther sur le parallélisme entre la présence de peuples aux cheveux clairs et la diffusion de la culture indo-européenne en Asie ont d'abord été diabolisées et ostracisées, mais, aujourd'hui, au regard des apports nouveaux de l'archéologie, elles méritent une attention nouvelle, du moins pour les éléments de ces études qui demeurent valables. Peu d'érudits se rappellent que, dans l'oasis de Tourfan, dans le Turkestan chinois, où vivaient les Tokhariens, on peut encore voir des fresques sur lesquelles les ressortissants de ce peuple sont représentés avec des traits nettement nord-européens et des cheveux clairs (8). C'est une confirmation de la fiabilité des annales du Céleste Empire. On ne peut donc plus nier un certain enchaînement de faits, d'autant plus que l'on dispose depuis quelques années de preuves plus directes et convaincantes de cette installation très ancienne d'éléments démographiques indo-européens dans la zone asiatique que nous venons d'évoquer. Ces installations ont eu lieu à l'époque des grandes migrations aryennes vers l'Est (2ième millénaire avant J. C.), donc avant que ne se manifestent certains aspects de la civilisation chinoise.
Ces preuves, disions-nous, nous n'en disposons que depuis quelques années…
Les traits europoïdes des momies d'Ürümtchi
En 1987, Victor Mair, sinologue auprès de l'Université de Pennsylvanie, visite le musée de la ville d'Ürümtchi, capitale de la région autonome du Xinjiang. Il y voit des choses qui provoquent chez lui un choc mémorable. Il s'agit des corps momifiés par cause naturelle de toute une famille : un homme, une femme et un garçonnet de deux ou trois ans. Ils se trouvaient dans une vitrine. On les avait découverts en 1978 dans la dépression du Tarim, au sud du Tian Shan (les Montagnes Célestes) et, plus particulièrement, dans le désert du Taklamakan (un pays peu hospitalier à en juger par la signification de son nom : "on y entre et on sort plus!").

Plusieurs années plus tard, Mair déclare au rédacteur du mensuel américain Discover : «Aujourd'hui encore, je ressens un frisson en pensant à cette première rencontre. Les Chinois me disaient que ces corps avaient 3000 ans, mais ils semblaient avoir été enterrés hier» (9). Mais le véritable choc est venu quand le savant américain s'est mis à observer de plus près leurs traits. Ils contrastaient vraiment avec ceux des populations asiatiques de souche sino-mongole; ces corps momifiés présentaient des caractéristiques somatiques qui, à l'évidence, étaient de type européen et, plus précisément, nord-européen. En fait, Mair a noté que leurs cheveux étaient ondulés, blonds ou roux; leurs nez étaient longs et droits; ils n'avaient pas d'yeux bridés; leurs os étaient longs (leur structure longiligne contrastait avec celle, trapue, des populations jaunes). La couleur de leur épiderme —maintenu quasi intact pendant des millénaires, ce qui est à peine croyable— était typique de celle des populations blanches. L'homme avait une barbe épaisse et drue. Toutes ces caractéristiques sont absentes au sein des populations jaunes d'Asie.
Les trois "momies" (il serait plus exact de dire les trois corps desséchés par le climat extrêmement sec de la région et conservés par le haut taux de salinité du terrain, qui a empêché la croissance des bactéries nécrophages) constituaient les exemplaires les plus représentatifs d'une série de corps —à peu près une centaine— que les Chinois avaient déterrés dans les zones voisines. Sur base des datations au radiocarbone (10), effectuées au cours des années précédentes par des chercheurs locaux, on peut dire que ces corps avaient un âge variant entre 4000 et 2300 ans. Ce qui nous amène à penser que la population, dont ils étaient des ressortissants, avait vécu et prospéré pendant assez longtemps dans cette région, dont la géologie et le climat devaient être plus hospitaliers dans ce passé fort lointain (on y a d'ailleurs retrouvé de nombreux troncs d'arbre desséchés).
Spirales et tartans
Le matériel funéraire et les vêtements de ces "momies", eux aussi, se sont révélés fort intéressants. Par exemple: la présence de symboles solaires, comme des spirales et des swastikas, représentés sur les harnais et la sellerie des chevaux, relie une fois de plus ces personnes aux Aryens de l'antiquité, sur le plan culturel.
L'étoffe utilisée pour fabriquer leurs vêtements était la laine, qui fut introduite en Orient par des peuples venus de l'Ouest. Le "peuple des momies" connaissait bien l'art du tissage: on peut l'affirmer non seulement parce que l'on a retrouvé de nombreuses roues de métier à tisser dans la région mais aussi parce que les tissus découverts sont d'une excellente facture. Pour attester des relations avec le Céleste Empire, on peut évoquer une donnée supplémentaire: la présence d'une petite composante de soie dans les effets les plus récents (postérieurs au 6ième siècle av. J. C.), qui ont de toute évidence été achetés aux Chinois. Les autres éléments vestimentaires, dans la majeure partie des cas, démontrent qu'il y avait des rapports étroits avec les cultures indo-européennes occidentales; le lot comprend notamment des vestes ornées et doublées de fourrure et des pantalons longs.
Plus révélateur encore: on a retrouvé dans une tombe un fragment de tissu quasi identique aux "tartans" celtes (11) découverts au Danemark et dans l'aire culturelle de Hallstatt en Autriche, qui s'est développée après la moitié du 2ième millénaire avant J. C., donc à une époque contemporaine de celle de ces populations blanches du Xinjiang. Si l'on pose l'hypothèse que les Celtes d'Europe furent les ancêtres directs de ces Tokhariens (ou étaient les Tokhariens tout simplement), cette preuve archéologique s'accorde bien avec ce que nous disions plus haut à propos des similitudes entre la langue celtique et celle des Indo-Européens du Turkestan chinois : les deux données, l'une linguistique, l'autre archéologique, se renforcent l'une l'autre.
Chapeau à pointe et coquillages
Autre élément intéressant : la découverte d'un couvre-chef à pointe, à larges bords, que l'on a défini, avec humour, comme un "chapeau de sorcière"; il était placé sur la tête de l'une des momies de sexe féminin, remontant à environ 4000 années. Ce chapeau ressemble très fort à certains couvre-chef utilisés par les Scythes, peuple guerrier de la steppe, et qu'on retrouve également dans la culture iranienne (on pense aux chapeaux des Mages). Ces populations étaient des populations d'agriculteurs, comme le prouve la présence de semences dans les bourses. Elles avaient également des rapports avec des populations vivant en bord de mer, vu que l'on a retrouvé près des momies ou sur elles de nombreux coquillages de mollusques marins.
L'intérêt extrême de ces vestiges a conduit à procéder à quelques études anthropologiques (principalement d'anthropométrie classique), sous la direction de Han Kangxin de l'Académie Chinoise des Sciences Sociales (Beijing). Ces études ont confirmé ce que le premier coup d'œil déjà permettait d'entrevoir : dans de nombreux cas, les proportions des corps, des crânes et de la structure générale du squelette, ne correspondent pas à celles des populations asiatiques jaunes, tandis qu'elles correspondent parfaitement à celles que l'on attribue habituellement aux Européens, surtout aux Européens du Nord.
Par le truchement de l'archéologie génétique, on pourra obtenir des données encore plus précises, pour élucider ultérieurement les origines et la parenté de ce peuple mystérieux. La technique, très récente, se base sur la comparaison de l'ADN mitochondrial (12) des diverses populations, que l'on veut comparer, afin d'en évaluer la distance génétique. L'un des avantages de cette technique réside dans le fait que l'on peut aussi analyser l'ADN des individus décédés depuis longtemps, tout en restant bien sûr très attentif, pour éviter d'éventuelles contaminations venues de l'environnement (par exemple, les contaminations dues aux bactéries) ou provoquées par la manipulation des échantillons. L'archéologie génétique s'avère utile, de ce fait, quand on veut établir un lien, en partant des molécules, entre l'anthropologie physique et la génétique des populations.
Les premiers tests ont été effectués par un chercheur italien, le Professeur Paolo Francalacci de l'Université de Sassari. Ils ont confirmé ultérieurement l'appartenance des individus analysés aux populations de souche indo-européenne, dans la mesure où l'ADN mitochondrial, qui a été extrait et déterminé, appartient à un aplotype fréquent en Europe (apl. H) et pratiquement inexistant au sein des populations mongoloïdes (13). Les autorités de Beijing n'ont autorisé l'analyse que d'un nombre réduit d'échantillons; beaucoup restent à étudier, en admettant que les autorisations soient encore accordées dans l'avenir.
Traits somatiques des Ouïghours
Enfin, il faut également signaler que les habitants actuels du Turkestan chinois, les Ouïghours, présentent des traits somatiques mixtes, où les caractéristiques physiques europoïdes se mêlent aux asiatiques. On peut donc dire que nous nous trouvons face à une situation anthropologique où des ethnies de souches diverses se sont mélangées pour former, en ultime instance, un nouveau peuple. Ce n'est donc pas un hasard si les autorités de Beijing craignent que la démonstration scientifique de l'existence de tribus blanches parmi les ancêtres fondateurs de l'ethnie ouïghour contribue à renforcer leur identité culturelle et qu'au fil du temps débouche sur des aspirations indépendantistes, violemment anti-chinoises, qui sont déjà présentes. Cette situation explique pourquoi les Chinois boycottent quasi ouvertement les recherches menées par Mair et ses collaborateurs.
En conclusion, l'ampleur, la solidité et la cohérence des données obtenues contribuent à confirmer les intuitions de tous les auteurs, longtemps ignorés, qui ont avancé l'hypothèse d'une contribution extérieure à la formation de la civilisation chinoise. Cette contribution provient de tribus aryennes (ndlr: ou "proto-iraniennes", selon la terminologie de Colin McEvedy que nous préférons utiliser), comme semble l'attester les découvertes effectuées sur les "momies", et permet d'émettre l'hypothèse que le bronze et d'autres acquisitions importantes ont été introduites directement, et non plus "médiatement", par ces tribus dans l'aire culturelle de la Chine antique.
Par exemple, Edward Pulleyblank a souligné récemment qu'il «existait des signes indubitables d'importations venues de l'Ouest : le blé et l'orge, donc tout ce qui relève de la culture des céréales, et surtout le char hippo-tracté, …, sont plus que probablement des stimuli venus de l'Ouest, ayant eu une fonction importante dans la naissance de l'âge du bronze en Chine» (14).
Bien sûr, cette découverte ne conteste nullement la formidable originalité de la grande culture du Céleste Empire, mais se borne à mettre en évidence quelques aspects fondamentaux dans sa genèse et dans son évolution ultérieure, tout en reconnaissant à juste titre le rôle joué par les nomades antiques venus d'Europe.
Giovanni MONASTRA.
(e mail: g_monastra@estovest.org ; texte paru dans Percorsi, anno III, 1999, n°23; le texte original italien est sur: http://www.estovest.org/identita/indocina.html ).
Notes :
[1] Arthur de Gobineau, Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane, Rizzoli, Milano 1997, p. 443.
[2] Colin Renfrew, Archeologia e linguaggio, Laterza, Bari 1989, p. 77.
[3] ibidem, p. 79.
[4] Les Chinois, pour désigner le chien, utilisent le terme "kuan", qui est quasiment le seul et unique mot de leur langue qui ressemble au latin "canis" ou à l'italien "cane", sans doute parce que le chien domestique à été introduit dans leur société par des populations indo-européennes, qui ont laissé une trace de cette transmission dans le nom de l'animal.
[5] Colin Renfrew, Archeologia ecc.cit., pp. 78-9.
[6] Oswald Spengler, Reden und Aufsätze, Monaco 1937, p. 151.
[7] Jacques Gernet, La Cina Antica, Luni, Milano 1994, pp. 33-4.
[8] Luigi Luca Cavalli-Sforza, Geni, Popoli e Lingue, Adelphi, Milano 1996, p. 156.
[9] Discover, 15, 4, 1994, p. 68.
[10] La méthode du radiocarbone (14C) se base sur le fait que dans tout organe vivant, outre l'atome de carbone normal (12C), on trouve aussi une certaine quantité de son isotope, le radiocarbone, qui se réduit de manière constante, pour devenir un isotope de l'azote. Tandis que le rapport entre 14C et 12C reste stable quand l'organisme est en vie, cet équilibre cesse d'exister à partir du moment où il meurt; à partir de cette mort, on observe un déclin constant qui implique la disparition du radiocarbone, qui diminue de moitié tous les 5730 ans. De ce fait, il suffit, dans un échantillon, de connaître le rapport entre deux isotopes pour pouvoir calculer les années écoulées depuis la mort de l'organisme. La méthode connaît cependant une limite : elle ne peut pas s'utiliser pour des objets d'investigation de plus de 70.000 ans.
[11] Archaeology, Marzo 1995, pp. 28-35. Le "tartan" est une étoffe typique du plaid écossais. Pour se documenter plus précisément sur les divers éléments liés aux textiles et aux vêtements de ce peuple, nous recommandons la lecture d'un ouvrage excellent et exhaustif, comprenant de nombreuses comparaisons avec les équivalents en zone européenne : Elizabeth Wayland Barber, The Mummies of Ürümchi, W. W. Norton & Company, Inc., New York, 1999.
[12] Les mitochondries sont des organites présents dans les cellules des eucaryotes (tous les organismes vivants, des champignons aux mammifères) à des dizainesde milliers d'exemplaires. Seules ces structures, mis à part le noyau cellulaire, contiennent de l'ADN, molécule base de la transmission héréditaire, mais leur ADN est de dimensions beaucoup plus réduites que celui du noyau (200.000 fois plus court) : il sert uniquement pour la synthèse des protéines nécessaires à ces organites. Il faut se rappeler qu'au moment de la fécondation, il semble que seule la mère transmet les mitochondries à sa progéniture.
[13] Journal of Indo-European Studies, 23, 3 & 4, 1995, pp. 385-398.
[14] International Rewiew of Chinese Linguistics, I, 1, 1998, p. 12. Voir aussi: Elizabeth Wayland Barber, The Mummies of Ürümchi, op. cit.
http://vouloir.hautetfort.com/archives/category/tradition/index-12.html