Fabrice Hadjadj dit : « L’apôtre qui balbutie comme un homme ivre vaut mieux que celui parle comme un livre ». Essayons de nous situer entre ces deux extrêmes. Partons d’un constat. Le déferlement des vagues du capitalisme (d’abord industriel) puis du turbocapitalisme (largement financiarisé) a complètement changé le monde. En 1980 déjà, Raymond Williams faisait le constat suivant : « Nous-mêmes, nous sommes des produits : la pollution de la société industrielle n’est pas seulement à trouver dans l’eau et dans l’air, mais dans les bidonvilles, dans les embouteillages, et ces éléments non pas seulement comme objets physiques mais nous-mêmes en eux et en relation avec eux […] Le processus […] doit être vu comme un tout mais pas de manière abstraite ou singulière. Nous devons prendre en compte tous nos produits et activités, bons et mauvais, et voir les rapports qui se jouent entre eux qui sont nos propres relations (1) ».
Plus de 60 % d’urbains sur terre, et bientôt les trois quart
Situons l’enjeu de notre sujet, l’écologie urbaine. En 1800 environ 3 % de la population mondiale vivait en ville, en 1900, c’était 15 %, en 1950, nous avons doublé en pourcentage d’urbains, c’était 30 %. En l’an 2000 c’était 50 %. Nous en sommes à quelque 60 %. L’urbanisation apparaît une tendance inexorable. Elle a été massive en France. Nous avons basculé d’une civilisation à une autre des années quarante aux années actuelles. C’est ce que Henri Mendras a appelé « la fin des paysans ».
À partir de là, il est clair que si nous n’appliquons pas l’écologie à la ville, cela n’a aucun sens. Cela ne concernerait pas la majorité des hommes. Étymologiquement, l’écologie est la science de l’habitat. C’est l’habitat au sens large : nous vivons dans une maison, mais aussi dans un territoire, et dans un environnement mental. C’est notre écosystème (2). C’est pourquoi l’écologie de la ville a sa place dans une écologie plus large, l’écologie des civilisations, car c’est ainsi que les hommes vivent. Ils créent des habitusintermédiaires entre l’individu et l’humanité en général. Ces habitus sont les peuples, les civilisations, les enracinements, les religions. Les hommes n’accèdent pas directement à l’universel. Ils y accèdent par des médiations. Vouloir nier ces dernières fut tout le projet moderne, amplifié par le projet hypermoderne. Une vraie postmodernité ne peut consister qu’à revenir sur ce projet moderne de nier les médiations, qui bien entendu sont plurielles, car l’homme est multidimensionnel.
Le terme écologie a été créé par l’Allemand Ernst Haeckel. Sa société de pensée fut après sa mort interdite par les nationaux-socialistes. Il définissait l’écologie comme « la science des relations de l’organisme avec l’environnement ». Comment transformons–nous notre environnement en puisant dedans et en le manipulant, et comment cet environnement transformé nous transforme lui-même (on a aussi appelé cela anthroponomie : comment les phénomènes que nous vivons réagissent sur les lois comportementales de notre propre humanité) ? Le moins que l’on puisse dire est que la question est majeure.
L’écologie n’est pas le simple environnement
L’écologie a souvent été réduite à un simple environnementalisme. Dans les années 1970 est apparu un « ministère de l’environnement ». La question était : comment préserver notre « cadre de vie » ? Il s’agissait de voir la nature en tant qu’elle nous est utile, si possible pas trop moche quand elle est dans notre champ de vision. Faut-il préciser que l’écologie va au-delà. Il s’agit des équilibres entre l’homme et la nature. Et de ces équilibres à long terme. « La rupture entre l’homme et la nature c’est aussi la rupture de l’homme avec lui-même » écrit Philippe de Villiers.
L’écologie est la prise en compte de ces équilibres, et en ce sens l’écologie urbaine n’est qu’une branche de l’écologie humaine. C’est l’étude des rapports, tels qu’ils se nouent et se transforment, entre la nature et la ville. Ajoutons qu’elle ne concerne pas seulement les rapports des hommes et de la nature, mais les rapports des hommes entre eux. Une société où l’on prend soin de la nature et du vivant n’est pas sans conséquence sur les rapports des hommes entre eux et plus généralement sur la conception par les hommes de « la vie bonne ».
Pas d’écologie urbaine sans éthologie humaine
Si nous parlons des rapports des hommes entre eux, c’est qu’il y a un lien entre l’écologie humaine et l’éthologie. La vie en ville multiplie les frictions, elle est un terrain d’étude des comportements humains, et c’est le propos de l’éthologie humaine. C’est en d’autres termes l’étude systémique du comportement de l’homme en société, en tant qu’il est un animal mais n’est pas seulement cela. Cela doit à Aristote mais aussi à Konrad Lorenz, à Irenaus Eibl-Eibesfeldt, à Boris Cyrulnik, à Edgar Morin… Cette éthologie humaine est à prendre en compte par l’écologie urbaine, sauf à l’atrophier.
Quelle est l’origine de l’écologie urbaine ? C’est l’École de Chicago (3) (école sociologique à ne pas confondre avec son homonyme en économie, une école ultra-libérale). Elle apparaît dans les années 1900 et se renouvelle vers 1940-1950. C’est à cette dernière époque qu’elle commence à être connue, avec notamment Erving Goffman. L’École de Chicago analyse la constitution des ghettos, et l’ensemble des phénomènes de ségrégation et marginalité, à partir de l’exemple de Chicago. C’est une école de sociologie urbaine. Mais les idées ne sont pas neutres, elles agissent sur le réel, et l’École de Chicago a poussé à intégrer des préoccupations d’écologie urbaine. L’École de Chicago donnera naissance à des monographies comme celle intitulée Middletown, et consacrée à Muncie, dans l’Indiana.
L’école de Chicago influence plusieurs études de sociologie menées par Paul-Henri Chombart de Lauwe, Jean-Claude Chamboredon et d’autres. Les marxistes ont aussi essayé d’adapter à l’économie urbaine les théories de Marx comme la baisse tendancielle du taux de profit. Les promoteurs capitalistes agissent en effet comme tout possesseur de capital qui cherche à accroître son profit. Reste à connaître les répercussions précises de cela sur les formes urbaines : reproduction du même modèle de bâtiment plus économique que la variété, consommation d’espace excessive avec des lotissements pavillonnaires, la viabilisation des terrains étant assurée par la puissance publique, construction de tours dans les zones où une forte densité est possible et rentable, etc. Francis Godard, Manuel Castells, Edmond Préteceille ont travaillé dans cette direction et ont du s’ouvrir à d’autres angles de vue que ceux strictement marxistes.
D’Henri Lefebvre à Michel Ragon
Une place à part doit être faite à Henri Lefebvre. Ses études tendent à montrer que l’homme moderne, celui des sociétés soumises au Capital connaît une vie inauthentique, à la fois dans son espace (la ville) et dans le temps (sa temporalité est entravée par les exigences du productivisme). L’opposition travail/loisir devient une opposition production/consommation. La séparation a/ des lieux de production, b/ de loisir et consommation, et c/ des lieux de résidence aboutit à une mise en morceau de l’homme moderne, à une désunification de l’homme. Par son analyse du malaise qui s’est installé entre l’homme et la ville, Henri Lefebvre, mais aussi d’autres auteurs comme Michel Ragon éclairent les voies de ce qui pourrait être une écologie urbaine.
En France, la notion d’écologie urbaine est reprise à partir des années 1980 par Christian Garnier. Avant même l’usage du terme écologie urbaine, des auteurs ont développé une réflexion sur la ville dans une perspective proche de l’écologie urbaine : en France, Gaston Bardet, Marcel Poëte, Jean-Louis Harouel, Françoise Choay, Henri Laborit, ailleurs Patrick Geddes, Louis Wirth et d’autres. Toutes ces études ont été très marquées par La ville (4), le livre de Max Weber paru en 1921. Dans ce livre inachevé Max Weber explique que toute ville est ordonnée autour d’un idéal-type. Celui des villes modernes de l’Occident exprime ainsi notre rationalité spécifique.
Quelle écologie urbaine doit être pensée et mise en œuvre ? Il faut d’abord, d’une manière générale, imaginer la ville comme un support d’activités humaines qui doivent prendre en compte le sol qui est le leur. Ce sol, c’est une terre, qui permet la vie de l’homme à certaines conditions, des conditions qu’il importe de préserver. Il s’agit donc de ne pas épuiser notre planète. Notre sol, c’est aussi un territoire historique. La terre de France et les terres d’Europe ne sont pas n’importe quelle terre, leur culture, leur agriculture, leur histoire urbaine est spécifique. Il faut faire avec notre histoire, et non pas dans un esprit de table rase. Faire n’importe quoi de notre terre, c’est faire n’importe qui de notre mémoire. Nous priver de passé, c’est aussi nous priver d’avenir. Il s’agit de ne pas épuiser le réservoir mythologique de notre terre, sa dimension sacrale.
En second lieu, l’écologie urbaine doit partir des besoins humains. L’homme a besoin de repères et d’échelles maîtrisables. Le gigantisme ne lui convient pas (5). Maîtriser la taille est un enjeu essentiel.
Le turbocapitalisme crée des turbovilles (qui sont des antivilles)
Le premier aspect est donc celui de la ponction de l’homme sur la nature via la ville. C’est la question de la ville durable. Ville économe en énergie, ville ne détruisant pas la nature autour d’elle, voilà les impératifs. Cela implique l’ensemble de la conception du réseau de villes dans un pays. Bien entendu, ce réseau est le fruit d’une histoire. En France, il y a depuis six ou sept siècles une hypertrophie de Paris ? Il y a une part d’irréversibilité. Mais pas de fatalité. Les pouvoirs publics – en sortant du libéralisme – peuvent accentuer ou faire évoluer certaines caractéristiques. Dans le turbocapitalisme mis en oeuvre par les dirigeants de la France, la priorité est donnée à quelques très grandes métropoles (moins de 10). Ces turbovilles ne sont pas pour les hommes. Elles nous déshumanisent et nous décivilisent. D’autres choix sont possibles. Plutôt que de développer encore Lyon ou Bordeaux, mieux vaut donner leur chance à Niort, la Roche-sur-Yon, Besançon, etc. Cela implique de revenir à une politique active de la puissance publique et à une politique d’aménagement du territoire. Sans répéter les erreurs du productivisme des années 1960.
Pour limiter la ponction de l’homme sur la nature et sur les paysages naturels, il faut aussi éviter l’étendue spatiale excessive des villes. Cela s’appelle lutter contre l’étalement urbain. Tous les ans la France artificialise quelque 80 000 hectares de terres (800 km2), soit en 4 ans la surface agricole moyenne d’un département. Ou encore 1,5 % du territoire national tous les 10 ans. Tous les 10 ans depuis les années 1990 les surfaces urbanisées (route, constructions, chantiers) augmentent d’environ 15 %. Cela s’ajoute bien entendu à l’existant. « Les villes couvrent désormais 119 000 km2 de territoire, contre 100 000 en 1999. Ainsi, 1 368 communes rurales en 1999 sont devenues urbaines en 2010, le plus souvent par intégration à une agglomération, alors qu’à l’inverse seulement 100 communes urbaines sont devenues rurales (6) ». C’est 22 % de notre territoire qui est déjà artificialisé, c’est-à-dire soustrait à la régulation naturelle et à ses rythmes.
Halte à l’étalement urbain et à la démesure des villes
Pour éviter la poursuite de la consommation d’espace par les villes, il faut se satisfaire d’un non accroissement de la population de nombre de ces villes, celles qui sont déjà trop étendues. Or, ce sont celles-là même que les gouvernements veulent développer plus encore. Ils nous emmènent dans le mur. Il faut en tout cas, au minimum, densifier l’existant et non consommer de nouveaux espaces. Il faut ainsi construire sur le construit. Il est frappant, quand on voyage en France, de trouver des bourgs, ou des petites villes, dont le centre ville est quasiment à l’abandon, en terme d’entretien des maisons et de l’espace public, mais qui ont créé des lotissements pavillonnaires en périphérie, avec des « pavillons » tous identiques et sans charme. Or, l’étalement urbain, en plus de ses inconvénients en matière d’écologie (nouvelles routes à viabiliser et à entretenir…), est contradictoire avec la création de lien social, favorise la voiture, l’individualisme extrême et rend irréalisable l’organisation de transports en commun, bref favorise un mode de vie renforçant l’emprise de la société de consommation. C’est ici que les préoccupations écologiques – le premier aspect que nous avons évoqué – rejoignent les préoccupations directement humaines, les besoins humains qu’éclairent l’écologie et l’éthologie, notamment le besoin de repères, le besoin de liens de proximité, le besoin d’un équilibre entre l’« entre soi » et l’ouverture.
L’homme a besoin d’une densité raisonnable. De quoi parle-t–on ? Il faut d’abord dissiper les idées reçues. « 65 % des Français pensent que la densité est quelque chose de négatif » relevait l’Observatoire de la ville en 2007. Les grands ensembles ont en fait une densité faible à l’échelle du quartier, en intégrant bien sûr la voirie. Elle est de 0,6 ou 0,7 environ soit 700 m2 construit sur un terrain de 1 000 m2. C’est ce que l’on appelle le coefficient d’occupation des sols (COS). Dans les quartiers parisiens de type haussmannien, la densité est de 6 à 7 fois supérieure. Elle est entre 4 et 5 de COS (5 000 m2 construits sur 1 000 m2 au sol). Reste aussi à savoir s’il s’agit, et dans quels pourcentages, de bâti de logement ou de bâti de locaux d’activité, ce qui ne donne pas le même rythme à la ville, la même vie, la même animation.
Il y a densité et densité : la qualité est le vrai enjeu
Il y a aussi la densité par habitants. Un logement de 70 m2 est–il occupé par trois personnes ou par cinq personnes ? La réponse varie notamment selon les milieux sociaux. Tous ces paramètres doivent être pris en compte. Ils interviennent dans le vécu et le ressenti de chacun. La densité, c’est la question du bâti à l’hectare mais aussi aux échelles plus grandes, comme le km2 (exemple : Paris c’est 100 km2 et donc 10 000 ha [hectares], et la ville inclue jardins, rues, boulevard périphérique, etc.) mais c’est aussi la question de la taille de la population à ces mêmes échelles.
Dans le XVIe arrondissement de Paris, il y a quelques 100 000 logements sur 16 km2. Cela fait un peu plus de 6 000 logements au km2 soit 60 logements à l’hectare. Avec 160 000 habitants, le XVIe a une densité de près de 10 000 habitants au km2, soit 100 habitants à l’ha. Il faut donc notamment mettre en regard 100 habitants pour 60 logements, ce qui donne une première indication de logement plutôt sous-occupés (ce que confirmerait la prise en compte de la taille de ces logements). On relève en tout aussi qu’un des arrondissements les plus denses en termes de bâti est un des plus recherchés. La densité urbaine ne paraît pas être dans ce cas une souffrance insurmontable. Peut-être parce qu’il y a aussi un environnement de qualité et un bâti de qualité. Il peut, en d’autres termes, y avoir qualité urbaine et densité assez élevée. Si le bâti et les espaces publics sont de qualité, et si la sécurité est bonne.
De nouveaux quartiers intégrant les préoccupations de ville durable ont une densité assez proche du XVIequoique un peu inférieure. Ainsi Fribourg-en-Brisgau vise les 50 logements/ha. Autre exemple, les nouveaux quartiers sur l’eau d’Amsterdam sont autour de 25 logements à l’ha. Avec au moins deux personnes par logement, ce qui est une estimation minimum, on remarque que nous avons une densité nettement supérieure à la ville de La Courneuve. Avec 40 000 habitants sur 7,5 km2 l’ensemble de la commune n’a en effet qu’un peu plus de 50 habitants à l’hectare. En termes de densité de population les maisons sur l’eau d’Amsterdam font mieux ! Et ce sans la moindre barre et tour.
L’essentiel à retenir c’est qu’une densité de bâti faible peut correspondre aussi bien à des quartiers considérés comme « agréables » tel Le Vésinet et à des quartiers peu appréciés comme les « 4 000 » de La Courneuve.
Si une densité raisonnable est nécessaire, elle ne résume pas tous les axes de l’écologie urbaine. Le phénomène des « villes lentes » représente une utile prise de conscience des directions nécessaires. Lenteur rime avec taille raisonnable. Les « villes lentes » ne doivent pas dépasser 60 000 habitants (un exemple de ville lente : Segonzac, en Charente). En d’autres termes, il faut fixer une limite au développement. À partir d’une certaine taille, se « développer » c’est grossir, et grossir c’est devenir impotent. Cela vaut pour les États comme pour les villes. Les villes lentes ne sont pas le contraire des villes rapides, elles sont le contraire des villes obèses.
Les grosses villes sont des villes obèses
Les villes lentes sont d’ailleurs souvent plus rapides que les grosses villes qui, malgré tout un réseau de transports rapides, sont celles où l’on perd le plus de temps dans les trajets. Explication : les grosses villes sont souvent des villes obèses. Pour éviter des villes obèses, il faut relocaliser l’économie et la répartir partout. Il faut créer des territoires autonomes et équilibrés entre habitat, activités et subsistance. Il faut à chaque ville son bassin de nourriture à proximité et cela dans la permaculture, une agriculture naturelle, permanente et renouvelable. Il faut économiser la nature tout comme les forces des hommes. À la réduction du temps de travail doit correspondre une réduction du temps et de l’intensité d’exploitation de la nature. Il nous faut cesser de coloniser la nature.
Comment relocaliser ? En sortant des spécialisations économiques excessives, en faisant de tout, et partout. Les savoirs faire doivent être reconquis, les industries réimplantées partout, mais des industries sans le productivisme frénétique, des industries à taille, là aussi, raisonnable. Il faut retrouver l’esprit des petits ateliers de la France des années 1900. Il ne doit plus y avoir un seul département français sans ses industries et ses ouvriers, dans la métallurgie, dans les machines à bois, dans la construction de bateaux, de fours à pain, etc. Il faut nous revivifier au contact des beautés de l’industrie. Cela ne peut se faire qu’avec un État stratège, avec les outils de la fiscalité, du contrôle des banques et de la planification subsidiaire, de l’État aux régions. L’objectif dans lequel prend place l’écologie urbaine c’est « vivre et travailler au pays ». C’est l’autonomie des territoires, et donc l’autonomie des hommes.
Tout relocaliser. Y compris nos imaginaires
En résumé, il faut se donner comme objectif de replier les villes sur elles-mêmes et de mettre fin à l’étalement urbain, de privilégier l’essor des villes moyennes et non celui des villes déjà trop grandes, de relocaliser l’économie et mettant en œuvre la préférence locale, d’aller vers de petits habitats collectifs, ou vers l’individuel groupé, de favoriser le développement des transports en commun, possibles seulement dans une ville dense.
Habiter n’est pas seulement se loger. Cela désigne le séjour de l’homme sur la terre. Heidegger écrit : « Les bâtiments donnent une demeure à l’homme. Il les habite et pourtant il n’y habite pas, si habiter veut dire seulement que nous occupons un logis. À vrai dire, dans la crise présente du logement, il est déjà rassurant et réjouissant d’en occuper un; des bâtiments à usage d’habitation fournissent sans doute des logements, aujourd’hui les demeures peuvent même être bien comprises, faciliter la vie pratique, être d’un prix accessible, ouvertes à l’air, à la lumière et au soleil : mais ont-elles en elles-mêmes de quoi nous garantir qu’une habitation a lieu ? (7) ». La question de l’écologie urbaine est cela même : nous permettre d’habiter la ville en tant que nous habitons le monde.
Pierre Le Vigan
Notes
1 : cf. Problems in materialism and culture. Selected essays, London, 1980.
2 : La notion d’écosystème a été introduite en 1941 par Raymond Lindeman et développée ensuite par Eugène Odum.
3 : Yves Grafmeyer et Isaac Joseph (dir.), L’école de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Aubier, 1984.
4 : La Découverte, 2014, postface d’Yves Sintomer.
5 : Olivier Rey, Une question de taille, Stock, 2014. Voir aussi Thierry Paquot, La folie des hauteurs. Pourquoi s’obstiner à construire des tours, François Bourin, 2008; Désastres urbains. Les villes meurent aussi, La Découverte, 2015.
6 : cf. www.actu-environnement.com, 25 août 2011.
7 : Martin Heidegger, « Bâtir, habiter, penser », conférence de 1951 in Essais et conférences, Gallimard, 1958.
http://www.europemaxima.com/?p=4712
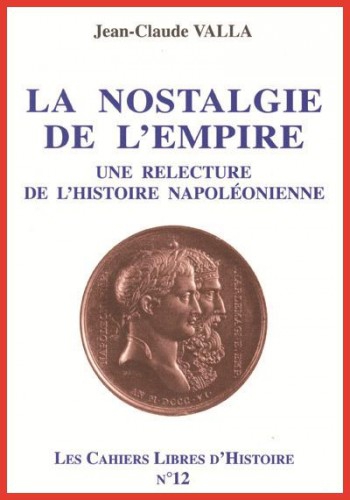 Jean-Claude Valla, La nostalgie de l’Empire, une relecture de l’histoire napoléonienne, éditions L’Aencre (collection Les Cahiers Libres d’Histoire), 2004
Jean-Claude Valla, La nostalgie de l’Empire, une relecture de l’histoire napoléonienne, éditions L’Aencre (collection Les Cahiers Libres d’Histoire), 2004