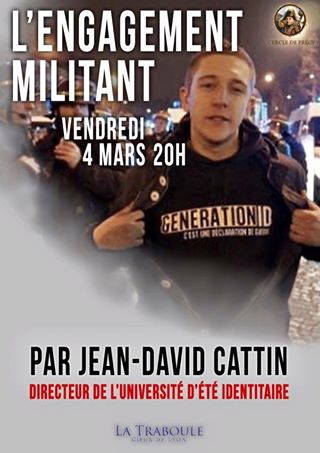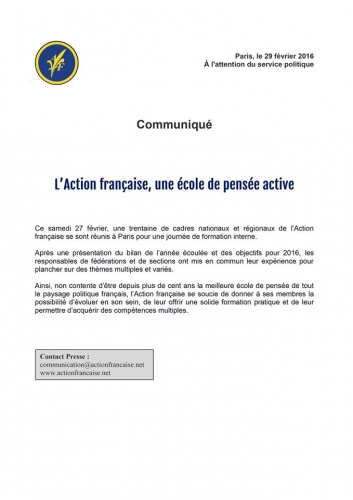Juan Asensio est essayiste et critique littéraire. Il collabore à de nombreuses revues dont Études, L’Atelier du Roman et La Revue des deux Mondes. Depuis 2004, il tient le site Stalker qui se conçoit comme une « dissection du cadavre de la littérature ». Nous nous sommes entretenus avec lui sur son écrivain préféré : Georges Bernanos.
PHILITT : De quand date votre découverte de Georges Bernanos ? Le coup de foudre fut-il immédiat ou vous a-t-il fallu un moment pour appréhender la force de sa langue et le caractère ténébreux de son univers ?
Juan Asensio : C’est lors d’une sortie de classe dans une salle de cinéma que j’ai été pour la première fois confronté à l’œuvre de Georges Bernanos. Sous le soleil de Satan, adapté par Maurice Pialat, venait de sortir sur les écrans. Le film était promis à une longue carrière polémique qui devait connaître son acmé avec le poing crânement brandi par le réalisateur devant le mufle ahuri des imbéciles qui le sifflaient lors de la remise de la Palme d’or du Festival de Cannes. Nous étions alors en 1987, et il me faut ici remercier mon professeur de français de première, Madame Colette Douai, de nous avoir emmenés voir ce film puissant, quoi que nous ayons pensé depuis de sa fidélité après tout relative au texte et surtout, plus grave, à l’esprit du roman de Georges Bernanos. Je ne crois pas abusif de dire que ce fut un choc, bien davantage qu’un coup de foudre, mais un choc d’abord visuel, que je n’avais éprouvé, durant ces mêmes années de scolarité à l’externat Sainte-Marie, à Lyon, que devant Stalker de Tarkovski et Cris et Chuchotements de Bergman. Le premier avait été projeté, si mes souvenirs sont bons, dans une salle de cinéma minuscule se trouvant entre la place des Terreaux et les pentes de la Croix-Rousse, qui n’existe plus depuis de bien longues années. Je revois encore l’affiche du film, qui m’avait intrigué. J’ai regardé le second sur l’écran du ciné-club du collège précédemment nommé. Je me souviens encore du geste d’horreur et de dégoût de ma voisine, deux mains devant la bouche, yeux fermés et tête détournée, durant la projection du film de Bergman, au moment où l’une des héroïnes plonge dans son sexe une lame tranchante. J’ai parlé de choc visuel à propos de l’adaptation réalisée par Maurice Pialat du premier roman de Georges Bernanos. Comment pouvait-il en aller autrement, d’ailleurs, puisqu’il s’agissait d’un film à la lumière chiche, de scènes à la composition non pas sommaire mais épurée tournées en partie à la brune ?
Le choc fut d’abord cinématographique avant d’être littéraire…
Il n’en reste pas moins que ce choc fut renouvelé, réanimé par une nouvelle brûlure, littéraire donc, du moins pour moi, existentielle, cette fois première ou même primaire, bien réelle et non pas transposée d’un support artistique à un autre, par la lecture du roman publié en 1926 par celui que Nimier appela le Grand d’Espagne, et que ce choc fut de nouveau visuel (contrairement à ce que professait Sartre, parlant de la littérature, dans L’imaginaire), convoquant mes sens, donc phénoménologique bien davantage qu’esthétique. Pardonnez-moi d’employer une série de grands mots mais je ne vois pas d’autre façon de décrire l’effet que me fit cette lecture. Si le maquignon démoniaque était capable de voir au fin fond du cœur de l’abbé Donissan, si ce dernier pouvait lire le péché tapi au dernier recès de Mouchette, je voyais, pour ma part, littéralement devant moi, parfois même sans fermer les yeux, les scènes ténébreuses et pourtant sidérantes de vérité que Bernanos avaient peintes, son chevalet planté dans la boue des tranchées de la Grande Guerre, des cratères de laquelle son roman était sorti, comme un animal sauvage sans nom.
Je n’ai pas immédiatement, à l’époque, dévoré les autres romans de Bernanos, et me suis contenté, pour commencer, de lire et de relire le premier roman de cet écrivain qui, comme nul autre hormis Dostoïevski ou Shakespeare (et plus tard, découvrirais-je, Stevenson ou Conrad, Melville ou Lowry), évoquait les tourments les plus secrets de l’âme et, surtout, figurait ce que nous pourrions appeler, sans intention blasphématoire, la présence réelle du diable, présence qui enfin devenait crédible depuis que Baudelaire puis Bloy avaient figé le Père du Mensonge dans le diamant noir de l’Irrévocable, présence cependant imparfaite, labile et grotesque puisqu’elle s’incarnait sous la défroque d’un rusé maquignon et la possession, au sens démonologique du terme, d’une gamine vicieuse, Mouchette. C’est un peu comme si, enfin me suis-je dit puisque je passais comme aujourd’hui mes journées à lire, un univers romanesque original et implacable se découvrait sous mes yeux de lecteur des œuvres du grand Russe, mais aussi de Stevenson ou d’Hawthorne (aucun écrivain français à l’époque, car je lisais les fadaises d’Aragon, de Breton, de Ponge ou, rendez-vous compte, du vieux faune Philippe Sollers, et ne savais rien de Léon Bloy, que je découvrirais quelques années plus tard seulement, dans les rayonnages improbables d’une Fnac de la place Bellecour !), qui tous figurèrent d’une façon ou d’une autre, mais avec moins de crâne éclat que ne l’avait fait ce diable de Bernanos, la geste noire du Démon.Sous le soleil de Satan fut pour moi, je le répète, ce que devrait être toute grande lecture pour un lecteur conséquent, ce qu’avait été la découverte de L’Ange des ténèbres, ce que serait celle, quelques années plus tard, d’Absalon, Absalon !, de la Connaissance de la douleur ou encore de La Persuasion et la Rhétorique. Progressivement, lentement, en prenant bien soin de respecter l’ordre chronologique de parution des œuvres de Georges Bernanos, romans, essais mais aussi correspondance et, parallèlement, tout ce qui avait été écrit sur lui, je m’enfonçais en tout cas dans les terres dangereuses desquelles un Michel Bernanos semble d’ailleurs ne pas être revenu, le regard chargé de visions coruscantes et tentatrices. Quelle Gorgone le fils prodigue de Georges Bernanos, auteur de l’admirable La Montagne morte de la vie ou, moins connu mais tout aussi énigmatique, du texte intitulé Ils ont déchiré Son image a-t-il fixée dans la nuit ?
Depuis cette époque désormais lointaine, je n’ai pas cessé de relire Georges Bernanos, quitte à le délaisser radicalement, mais en l’ayant en somme toujours à l’esprit, même lorsque je découvrais des auteurs n’ayant a priori que peu de rapport avec lui, m’attachant aussi, depuis quelques années, à lire ou relire les auteurs qu’il a lui-même lus, comme Joseph Conrad, Léon Bloy bien sûr, mais encore Ernest Hello, si profondément oublié, et tant d’autres que Bernanos, assez curieusement d’ailleurs, se plaisait à ne mentionner que rarement, comme s’il répugnait à avouer qu’il était, en plus d’un grand romancier, l’un des plus grands romanciers à vrai dire du siècle passé, un excellent lecteur.
Bernanos est un des rares écrivains à briller autant par ses romans que par ses essais polémiques. En quoi est-il difficile de conjuguer les deux ? Connaissez-vous un auteur qui soit son égal de ce point de vue-là ?
Je vais plus loin que vous, car il faut rappeler que c’est à regret que Georges Bernanos a délaissé son œuvre proprement romanesque, ses chers personnages, Chevance, le curé d’Ambricourt, la seconde Mouchette, Chantal de Clergerie, pour se consacrer, vers la fin de sa vie, face à l’urgence apocalyptique qui explosait à ses yeux, à des essais, même si les tout premiers d’entre eux, Jeanne relapse et sainte, La Grande Peur des bien-pensants et Les Grands Cimetières sous la lunesont encore étroitement imbriqués avec les romans, sont comme des espèces de romans, d’ailleurs. Ainsi, l’essai magistral sur Édouard Drumont peut à mon sens parfaitement se lire comme un ample roman sur l’honneur perdu, l’attachement aux valeurs anciennes, la déshumanisation d’un monde autrefois non point admirable mais à tout le moins cohérent, sous l’effet dévastateur de la circulation colossale des masses d’argent, la taylorisation vite devenue folle de la production, y compris celle de cadavres, la destinée solitaire d’un homme qui ne s’est jamais rendu et, comme Georges Bernanos, aura toujours fait face. Mais après l’écriture du dernier chapitre de Monsieur Ouine, de février à mai 1940, plus rien de strictement romanesque, alors que des essais paraîtront encore, non seulement importants mais bien souvent splendides, comme le sont Les Enfants humiliés qui furent publiés en 1949, une année après la mort de l’écrivain, mais qui ont été écrits de septembre 1939 à mai 1940, ou encore La Lettre aux Anglais en 1956 (chez Gallimard, mais dès 1942 à Rio de Janeiro) ou Le Chemin de la Croix-des-Âmes (de nouveau chez Gallimard en 1948, à Rio de Janeiro en 1943-1944). Je constate comme vous que cette position est assez originale, car je ne vois pas, sur cette question d’une répartition non seulement logique mais à vrai dire assez admirable entre des essais polémiques et des romans, d’autre écrivain français qui pourrait être rapproché de Georges Bernanos.
Un autre écrivain moustachu peut-être ?
Nous pourrions bien sûr songer à Léon Bloy, que Bernanos découvrit dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, mais le Mendiant ingrat a tout de même écrit peu de romans, à la double exception bien connue du Désespéré et de La Femme pauvre qui forment un ensemble. Nous pourrions encore, plus près de nous, évoquer l’immense Pierre Boutang, mais ses romans, y compris celui qui est son texte le plus abouti et difficile, parfois tout bonnement hermétique, Le Purgatoire, ne sont pour lui que des moyens détournés de mener ses recherches poético-politiques de très haut vol. Les mauvaises langues pourraient même parler, à propos de Boutang, de romans à thèse, et il est tout de même assez difficile d’accorder au Secret de René Dorlinde par exemple, que j’évoquerai dans la prochaine livraison de la revue Perspectives libres, la puissance hallucinatoire de Sous le soleil de Satan ! Romancier ou pas, il faudra quoi qu’il en soit finir par accorder la place qui revient à Pierre Boutang en tant que philosophe et, tout bonnement, écrivain et critique littéraire de race, dans ce pays où les fausses gloires pullulent et se reproduisent comme des larves de mouche sur un cadavre, la biographie qui doit bientôt paraître de Stéphane Giocanti, que l’ami Rémi Soulié a lue et trouvé intéressante, permettra sans doute de procéder à cette juste réappropriation d’un génie, bien supérieur à celui de Philippe Muray par exemple, devenu la coqueluche de la droite journalistique, râleur portatif réduit comme une tête de Jivaro à quelques poncifs terriblement commodes et creux. Il n’en reste pas moins qu’il serait je crois quelque peu abusif de considérer Pierre Boutang comme un véritable romancier, ce que Georges Bernanos, lui, fut incontestablement.
Je songe d’ailleurs, en passant, au cas de Philippe Muray, qui pourrait après tout convenir à notre débat, même si ses romans, heureusement rares, sont pratiquement illisibles et surtout sans beaucoup d’intérêt. Quant à son œuvre proprement critique, pléthorique et même bavarde à mesure qu’il a été journalisé, donc avachi et dilué par l’équipe deCauseur, je crois qu’il n’a jamais fait que répéter, d’une manière ou d’une autre et même assez ridiculement lorsqu’il procédait à une « mise en musique » de vers de mirliton houellebecquien, son grand œuvre, Le XIXe siècle à travers les âges bien sûr. Si nous devions examiner plus avant la question que vous me posez, je crois qu’il faudrait délaisser le terrain proprement français, tant labouré et désormais si pauvre que le Goncourt y fait pousser, à grand renfort de pisse journalistique et de lisier éditorial, ses courges transparentes, et aller voir ailleurs, pas très loin, où ont vécu et même vivent encore des écrivains n’ayant pas peur de penser, du côté de l’érudit Claudio Magris par exemple ou du remarquable W. G. Sebald, dont les essais, d’une subtilité et d’une poésie folles, sont comme des enquêtes romanesques qui n’ont pas peur de sonder une réalité derrière laquelle se tapit l’horreur, toujours prête à bondir comme un lion cherchant qui dévorer.
Que pouvez-vous nous dire de la relation quasiment sentimentale qu’entretenait Bernanos avec Édouard Drumont, un maître qu’il n’a jamais renié ?
Cette relation est aussi trouble que fascinante, et il est frappant de constater que, si Georges Bernanos a pris ses distances avec Charles Maurras, qu’il a accusé de ne pas avoir tenté le coup de force qu’il avait pourtant appelé de ses vœux les plus ardents durant des lustres et, ainsi, s’être moqué prodigieusement des femmes et des hommes qui lui ont fait confiance, il semble en effet ne s’être jamais vraiment éloigné de Drumont qu’il a admiré et, vous avez raison, qu’il a aimé comme un maître et un ami. Pourquoi, d’ailleurs, cet homme profondément fidèle qu’était Georges Bernanos s’en serait-il éloigné ? Il est faux de prétendre que l’on s’éloigne des maîtres, alors même que l’on ne s’éloigne que des petits maîtres. Or Drumont fut un grand maître pour Georges Bernanos. La réponse à ma question n’en est pas moins facile et, je m’empresse de le préciser au risque de devoir subir les foudres de diverses ligues de vertu, entièrement justifiée : c’est en raison de l’antisémitisme non seulement indéniable mais virulent de Drumont, qui devenait tout simplement intenable après la catastrophe de l’extermination des Juifs d’Europe dans les usines à cadavres nazies, que Bernanos aurait pu et, sans nul doute, dû, s’éloigner d’Édouard Drumont. Je suppose, mais rien n’est moins certains, qu’un livre comme La Grande Peur des bien-pensants aurait pu être assez difficilement écrit par le Bernanos de l’après Seconde Guerre mondiale, car, sur la tragédie inconcevable vécue par les Juifs, l’écrivain a eu des mots sans la moindre ambiguïté, contrairement à ce que les ânes, mauvais lecteurs par-dessus le marché, continuent de nous répéter, une fois tous les deux ou trois ans, en répétant comme s’il s’agissait d’un schibboleth ouvrant le domaine du plus furieux antisémitisme le fameux mot de l’auteur sur le fait qu’Hitler a déshonoré l’antisémitisme.
Je me permets de citer un passage de l’article que j’ai consacré sur Stalker à l’essai de Georges Bernanos sur Drumont : « Laissons ici la parole à Drumont, comme tant de fois Bernanos la lui laisse dans son livre : “J’étais guidé uniquement par la haine de l’oppression qui fait le fond de ma nature. L’oppression me rend malade physiquement. Obligé, pendant de longues années, pour subvenir à mes charges de famille, de refouler ce que je pensais j’avais fini par attraper des crampes d’estomac, une anorexie qui me contractait la gorge au moment du repas. Cette douleur a complètement disparu du jour où j’ai pu exprimer librement ma manière de voir, proférer mon verbe (pro, en avant, ferre, porter), ce que je fis dans La France juive et dans La Fin d’un monde” ». Ces lignes sont émouvantes sinon magnifiques. Elles pourraient être appliquées à l’exemple même de Georges Bernanos, tout pressé de délivrer son furieux rêve qui a grossi dans la boue des tranchées de la Première Guerre mondiale, et qui lui aussi, bien plus d’une fois, a dû jouer sa vie sur un raidissement de toute sa volonté, commandant au corps, rétif, de s’élancer dans le paysage défoncé par les obus, et qui lui aussi, nous le savons par de nombreux témoignages, fut bien près, plus d’une fois encore, d’écouter le chant des sirènes du désespoir qui sont sans pitié pour l’imprudent, et qui, lui aussi, ne s’estima jamais quitte avec l’oppression, qui le rendait malade. C’est un échec, l’échec d’un homme complexe (que l’on ne me dise pas que tous les hommes le sont, c’est absolument faux !) qui a attiré Georges Bernanos et, plus qu’un échec, l’aura mystérieuse dont le désespoir enveloppe un destin exceptionnel mais, de plus d’une façon, raté.
L’antisémitisme de Bernanos est donc une question difficile à trancher…
Il n’en reste pas moins que la question de l’antisémitisme de Georges Bernanos, lequel fut bien réel durant les premières années de sa carrière littéraire passées sous l’influence de l’Action française, même s’il ne s’est jamais laissé aller aux débordements de pure haine d’un Drumont ou d’un Léon Daudet, est complexe et a fait l’objet de travaux intéressants, comme celui de Joseph Jurt publié dans les actes du colloque de Cerisy-La-Salle publiés en 1972. Elle est du reste assez bien synthétisée par Philippe Lançon dans un article paru dans Libération en 2008. Certains passages de ce livre suffisent encore à effrayer les petits apeurés vertueux, moins d’ailleurs en raison de cruelles notations à l’égard des Juifs traditionnellement rattachés à la domination de l’Argent que parce que ce livre, de par son incroyable écriture, bondit comme un fauve à la gorge des prudents. C’était du reste bel et bien l’intention de Bernanos qui affirmait dans sa correspondance que cet ouvrage était scandaleux. Ce scandale peut se lire, à présent que les événements politiques auxquels il fait référence nous sont presque aussi lointains que nos premiers ancêtres bipèdes, d’une toute autre façon. Je suis en effet frappé par le désespoir profond qui suinte de ces pages, et ce n’est pas pour rien que, dans cette même correspondance, dans une lettre adressée à son ami Robert Vallery-Radot, Bernanos écrit qu’il se trouve littéralement « entre les bras d’un mort ». L’un des titres auxquels Bernanos a songé pour ce livre n’est-il pas Au bord des prochains charniers, car, à ses yeux, il a « essayé de faire le livre que Drumont lui-même eût fait à l’intention des jeunes Français tombés comme de la lune en ce monde et grandis depuis 1914, c’est-à-dire entre deux cimetières » ?
C’est en fin de compte Robert Brasillach qui a raison, lui qui parlait dans Une génération dans l’orage de La Grande Peur des bien-pensants comme d’un livre« torrentiel et chimérique », à condition d’entendre ce dernier qualificatif dans son acception première, qui évoque des êtres n’ayant qu’une existence diminuée, fantomatique, qui vous hante, car ces morts ne voulaient tout simplement, pour la plupart d’entre eux, mourir, comme cela est magnifiquement dit dans Monsieur Ouine. En évoquant Drumont, Bernanos fait d’abord acte de création purement littéraire, car c’est un monde qui n’existe même plus à son époque qu’il fait se lever et sortir de son tombeau qui a même fini de sentir la charogne. Il n’y a plus rien de cette époque, car en écrivant sur Drumont, Bernanos essaie moins de faire revivre les vieilles aspirations et les échecs du Maître qu’un monde qui a été balayé, et qui bientôt pourra même être considéré comme imaginaire par les générations qu’il faut, coûte que coûte selon Bernanos, alerter contre le chaos tel qu’il se prépare. Ce chaos, l’écrivain l’a vu, bête rampante, dans les événements politiques complexes qu’il a analysés dans La Grande Peur des bien-pensants.
L’espérance est une notion centrale dans l’œuvre de Bernanos. Elle est pourtant mise à mal puisque, selon lui, « Satan est le maître de la terre ». La préservation de la « vie intérieure » est-elle pour l’écrivain la condition de possibilité de l’espérance ?
La préservation de la vie intérieure est la condition de la plus stricte survie de l’homme, dans le « monde cassé » dont parle Gabriel Marcel, dans le monde décentré qu’évoque Zissimos Lorentzatos, dans le monde désenchanté analysé par nombre d’auteurs, dans le monde qui fuit Dieu selon Max Picard. Georges Bernanos a ajouté sa voix, tonitruante, spectaculaire, spectrale aussi car elle semble nous avertir depuis une contrée qui n’est plus tout à fait celle que nous connaissons et qui est probablement celle dont parle Ernst Jünger dans ses magnifiques Orages d’acier. Que l’espérance soit, plus qu’une notion, un postulat sans lequel rien n’est possible, une évidence, et cela alors même, comme vous le savez, que Georges Bernanos a connu de terrifiantes crises d’angoisse et de désespoir, n’est pas un hasard, pas plus que ce n’est un hasard s’il a tant aimé son vieux maître Drumont, dont il a génialement disséqué le profond désespoir qui ne l’a jamais pourtant empêché de se dresser face à ce qu’il considérait comme des manifestations inouïes et pourtant banales de la plus féroce injustice.
C’est peut-être la grande force de l’œuvre de Georges Bernanos, que de nous proposer une réserve de vie intérieure, comme un de ces « cœurs de parc » où vivent des espèces protégées, devenues rares, comme les loups splendides qu’il est interdit, du moins en théorie, d’y chasser. Aujourd’hui, c’est un poncif que d’affirmer que toute forte de vie individuelle, fût-elle résiduelle, est menacée, mais des havres de repos existent, comme la Zone dans laquelle le stalker n’a pas peur de conduire celles et ceux qui le désirent. Nous sommes plus que jamais confrontés à la possibilité d’une île, merveilleux titre vous le savez de Michel Houellebecq, mais l’île que nous propose Georges Bernanos n’a fort heureusement rien d’une de ces îles touristiques pelées et arasées par le napalm du tourisme. L’orgueil démoniaque, le désespoir, le mauvais rêve, le mensonge, les yeux brillants de bêtes dont nous avons oublié les noms s’y tapissent, mais aussi la joie, le courage, la fidélité, la bonté, la lucidité, la lumière, l’espérance, l’honneur d’être homme.
Pour Bernanos, le monde moderne est, à proprement parler, « satanique » dans la mesure où il ambitionne de recommencer la création en sens inverse. Bernanos est-il, comme Léon Bloy, un écrivain apocalyptique ?
Oui, tout à fait, et ce n’est pas sans raison que tel commentateur avisé de l’œuvre romanesque de Georges Bernanos a pu affirmer que son dernier roman, Monsieur Ouine, était tout entier prophétique. Un autre, Hans Aaraas, a assuré qu’il s’agissait d’un « poème apocalyptique ». Ce livre ténébreux, d’une folle complexité, résonne du pas des mendiants qui feront trembler la terre et pourrait être considéré comme une espèce de membrane, s’ouvrant parfois mais de toute manière poreuse, entre le monde des morts et celui des vivants. Le fait, d’ailleurs, d’évoquer une dimension prophétique ou même apocalyptique (la seconde découlant logiquement de la première) pose à mon sens des questions fascinantes, qui n’ont été jusqu’à présent guère traitées par la communauté des fâcheux, nos universitaires à courte vue et épais binocles : qu’en est-il de la réalité des affirmations qu’un Bloy ou un Bernanos ont lancées à la face des prudents qui les ont moqués ou se sont détournés d’eux en les traitant d’illuminés frôlant l’apoplexie ? Quels sont les liens entre ce que nous pourrions, à bien des égards, appeler un don de prescience et la tradition de l’inspiration à laquelle plus aucun professeur ne croit, surtout s’il a l’esprit boursouflé de fadaises sur la mort de l’auteur (et celle du Père, et celle de Dieu) ? Comment l’auteur a-t-il procédé pour proférer, au sein même de son texte, ce qui ne pouvait, par essence, qu’excéder la parole, par définition inadaptée, ou, tout au moins, singulièrement limitée ? Ce sont des sentiers dans lesquels nul je crois ne serait prêt à se lancer inconsidérément, pour la simple raison qu’ils longent plus d’une fois les frontières du royaume de la littérature, qui est vaste mais pas infini. Derrière ces frontières, le Verbe, mais tout bon lecteur de Monsieur Ouine a ressenti ce frisson de pure étrangeté, d’angoisse et même d’horreur : il y a dans ce roman lacunaire quelque chose de colossal, d’innommable qui se révèle, parfois, à la surface d’une écriture plus d’une fois menacée de pure et simple dislocation, comme le montrent les admirables Cahiers de Monsieur Ouine publiés par Daniel Pézeril. C’est la marque des plus grandes œuvres que de s’aventurer dans ces zones si peu frayées, où la puissance évocatoire de la langue semble elle-même comme interloquée devant ce qu’elle découvre. Mais Georges Bernanos lui, fidèle à sa plus chère volonté, n’a pas reculé et, comme toujours, a fait face. Ainsi, je crois que l’œuvre de Georges Bernanos est moins derrière que devant nous, à condition bien sûr que les nouvelles générations de lecteurs soient encore capables de parvenir à lire ces textes.
Peut-on dire que le personnage de M. Ouine est une allégorie de l’homme moderne ?
Je me méfie de ce genre de réduction herméneutique qui se termine en -ique, car les lectures allégoriques, symboliques, théologiques ou, les pires de toutes, en tout cas les plus sottes et ridicules, psychanalytiques d’une œuvre littéraire en limitent la portée, et manquent leur objet qui est, tout de même, une écriture de romancier. Parler d’une œuvre romanesque comme d’une allégorie ou même d’un symbole ne vaut en règle générale pas grand-chose et, ma foi, nous pourrions dire de bien d’autres personnages, comme le Marius Ratti de Broch, le Bartleby de Melville ou le Kurtz de Conrad, qu’ils sont des allégories ou même des symboles (je ne confonds bien évidement pas les deux notions) de l’homme moderne. Les lectures allégoriques ou bien symboliques des œuvres romanesques ne donnent jamais de résultats bien probants, car il y a dans ce type de démarche la volonté, parfois clairement avouée, de faire dire à l’œuvre concernée beaucoup plus qu’elle n’a voulu dire, et cela au détriment même de la matérialité de cette œuvre, sa langue, son écriture. Il n’en reste pas moins, cessons de pinailler, que Monsieur Ouine, encore davantage que Monsieur Teste, peut en effet incarner le visage sordide d’une modernité devenue folle, toute pleine de mots tournant à vide, dans « un camp de concentration verbal » selon l’image extraordinaire d’Armand Robin dansLa Fausse parole. Comme je l’ai écrit plus d’une fois, le dernier roman de Georges Bernanos n’appartient pas au passé, mais à notre présent, celui d’une paroisse morte (qui fut le premier titre envisagé par l’auteur pour son roman) et, comme ne cessait de me le répéter l’épouse de Jean-Loup Bernanos qui était frappée par sa dimension oraculaire, prophétique, à notre futur.
Vous déplorez, à juste titre, le manque de considération et le relatif oubli qui frappe l’œuvre de Bernanos. La réédition en 2015 de ses œuvres romanesques dans la prestigieuse collection de la Pléiade va-t-elle dans le bon sens ? Les lecteurs sont-ils prêts à découvrir ou redécouvrir Bernanos ?
Pourquoi diable voudriez-vous qu’une multitude de gloses universitaires sans beaucoup d’originalité, voire sans aucune originalité, vendues au prix modique de plus de 130 euros si je ne m’abuse, puissent intéresser un autre public que celui, admirablement consanguin, des universitaires et des étudiants qui gravitent autour d’eux comme un satellite prévisible tourne autour de sa planète favorite, de laquelle il ne souhaitera même pas se désorbiter le jour du Jugement dernier ? Ces derniers seront tout contents de voir cités leurs travaux par des étudiants et d’autres universitaires, qui considéreront comme un impératif épistémologique irrécusable le fait de se débarrasser de la précédente édition fournie par cette même collection de la Pléiade, qu’ils ne manqueront pas de considérer comme étant affreusement datée. Pourtant, c’est bel et bien cette édition préparée par Gaëtan Picon, Michel Estève et Albert Béguin que j’utilise et continuerai d’utiliser, car elle est excellente et, en dépit même de ses défauts, qui est écrite, ce qui n’est à l’évidence pas le cas de la nouvelle édition, comme nous le montre assez rapidement sa vague préface, donnée par un certain Gilles Philippe. Je vais illustrer mon propos par un seul exemple de l’inutilité de ce travail censé être savant (et j’exclus, de ce dernier, l’excellente chronologie de la vie de Bernanos donnée par Gilles Bernanos). Vous connaissez comme moi les toutes premières lignes de Sous le soleil de Satan, où Georges Bernanos évoque Paul-Jean Toulet, un auteur plus qu’intéressant aujourd’hui hélas bien oublié. Dans les notes de la première édition des romans de l’auteur en Pléiade, nous lisons sous la plume de Michel Estève que « l’on peut rapprocher, sur certains points mineurs », La Jeune Fille verte écrite par Toulet du premier roman de Bernanos (cf. p. 1776 de l’édition datant de 1974).
Cette nouvelle édition apporte-t-elle quelque chose de nouveau ?
Prenons (sans l’acheter) le récent travail dû à notre cohorte dûment estampillée ABOC, ou appellation bernanosienne d’origine contrôlée, et lisons la note se rapportant à ce mystérieux passage, cette fois donnée par Pierre Gille : « Plutôt qu’aux célèbres Contrerimes (1921), Bernanos pourrait se référer ici au dernier roman de Paul-Jean Toulet (1867-1920), La Jeune Fille verte ». Bernanos, ajoute Pierre Gille en tirant soigneusement la langue, aura trouvé dans le roman de Toulet« une satire particulièrement vive du monde bourgeois et ecclésiastique d’une petite ville, et des ambiances, comme l’évocation finale, par l’orateur, des “heures divines du crépuscule” » (cf. p. 1190 de la nouvelle édition). Est-ce bien tout ? Oui, c’est tout. Absolument passionnant, non, que de connaître les dates de naissance et de mort d’un auteur et d’apprendre deux ou trois renseignements, que je n’ai pas rapportés ici, à propos de la publication de son dernier roman ! Je tire en tout cas mon chapeau à Pierre Gille, auteur d’un travail intéressant quoique brouillon et surtout inutilement compliqué et non complexe (dans mes souvenirs) sur la question de l’angoisse dans les romans de Bernanos. Je le salue humblement, sans aucune ironie, parce qu’il réussit l’exploit de nous parler d’un glaçon accroché à la monture de sa paire de lunettes alors que, devant lui, se trouve un iceberg de belle taille. Certes, il aura vite fait de m’objecter que la masse réelle d’un iceberg est justement celle qui ne se voit pas, et je serai pour une fois d’accord avec notre universitaire, car, en effet, c’est ne strictement rien avoir vu, tout du moins soupçonné, que d’évoquer La Jeune Fille verte par le minuscule trou de la lorgnette satirique, alors que, les bras m’en tombèrent lorsque je lus ce roman, il est évident que Mouchette doit beaucoup de ses caractéristiques à cette mystérieuse jeune fille verte peinte par Toulet ! Mes yeux, d’habitude bien ouverts lorsque je lis un livre, à la différence de ceux, sans doute fatigués par l’âge, de notre vénérable universitaire et commentateur insignifiant, se dessillèrent pour de bon lorsque je compris que, par le biais du roman de Paul-Jean Toulet, c’est le titre le plus célèbre d’Arthur Machen, Le Grand Dieu Pan (que Toulet avait traduit en français avant la parution de Sous le soleil de Satan) qui affleurait justement dans ce dernier. La preuve de mes dires ? Une simple lecture, mais une vraie lecture se concentrant sur les caractéristiques du démoniaque, telles qu’elles apparaissent dans les trois romans en question (rappelons-les : Le Grand Dieu Pan, La Jeune Fille verte, Sous le soleil de Satan) suffirait pour écrire une belle étude autrement plus passionnante et originale que la note tout juste informative de Pierre Gille.
Je ne puis que renvoyer le lecteur intéressé par cette question à ma propre lecture, qui est prudente mais fournit quelques éléments assez troublants à mes yeux. Pas davantage nos si rigoureux bernanosiens ne semblent s’être avisés du fait que le premier roman de Bernanos pouvait être rapproché de l’un des romans les plus célèbres de Blaise Cendrars, Moravagine, qui a paru en 1926, l’année même oùSous le soleil de Satan a éclaté comme une mine à la face des apôtres zélés du Progrès. Là encore, je renvoie le lecteur à ma longue note sur cette lecture. Du reste, sans trop nous attarder sur ce type de lecture sans âme, ni même beaucoup de rigueur intellectuelle, qui exigerait pour être défait et moqué comme il se doit un travail poussé de lecture comparative, nous pourrions nous borner à constater que la note que Michel Estève a consacrée au dédicataire du premier roman de Georges Bernanos, Robert Vallery-Radot (cf. p. 1777 du volume mentionné plus haut) est beaucoup plus développée que celle de Pierre Gille. Pour quelle raison ? Demandez-le lui, et pensez par la même occasion à demander à celui qui étudia, avec René Guise, l’un des manuscrits du premier roman de Bernanos, pourquoi son travail en Pléiade est si impeccablement professoral, c’est-à-dire à peu près creux ! Il me semble particulièrement regrettable que Gallimard, pour sa collection-phare, n’ait désormais plus recours qu’à des universitaires pur jus, appartenant au petit monde si furieusement consanguin de la recherche (quand il s’agit bel et bien de recherche, et non pas de mandarinat stérile). Si encore ce travail était véritablement érudit, voire, nous pouvons rêver, original, il justifierait son prix exorbitant, mais nous en sommes tellement loin !
Vous aurez peut-être l’envie, en me lisant, de me faire remarquer que mes propres modestes recherches ne sont pas même mentionnées (à une exception près, mais dans une indication bibliographique purement factuelle, cf. p. 1188, op. cit.) par l’un de nos impeccables et savants lecteurs. En effet, mais elles ne risquaient certainement pas de l’être, en raison du refus catégorique qu’opposa à ma présence, au sein de cette très noble assemblée de professeurs pléiadisés constituée par le regretté Max Milner, Monique Gosselin-Noat, mon éphémère et lamentable directrice de thèse. Je l’évoque, plaisamment vous vous en doutez,dans cette note, et me contenterai d’affirmer que cette personne, invitée à tous les colloques traitant d’auteurs ayant vécu au cours des 20 derniers siècles, et qui ne répète jamais beaucoup plus que des banalités, m’a profondément, à tout jamais même, dégoûté de l’Université, du moins d’un certain type d’Université. De quel ordre est le travail de Monique Gosselin-Noat ? Il s’agit d’un recyclage, pas même inspiré, et ce n’est d’ailleurs absolument pas un hasard si Pierre-Guillaume de Roux, qui publie désormais tous les radotages hystérico-guerriers d’un essayiste aussi profondément nul que Richard Millet, a fait paraître le dernier recyclage de cette spécialiste mondialement célèbre de l’œuvre de Georges Bernanos, dont la thèse sur l’écriture du surnaturel était déjà un fourre-tout assez phénoménal.
Après ce petit détour par les chemins qui ne mènent jamais bien loin de l’Alma mater comprise, à la mode si typiquement française hélas, comme une matrice productrice de gloses asséchantes, j’en reviens à votre question finale : les œuvres fulgurantes de Georges Bernanos, qu’il s’agisse de ses romans, de ses essais ou de ses Dialogues des Carmélites, seront découvertes ou redécouvertes comme elles l’ont été jusqu’à présent, toujours, par la grâce d’une rencontre, d’une réelle présence qui se donnera par bien des truchements, y compris le nôtre, virtuel, que je ne me permettrai pourtant jamais de sous-estimer, après 12 années d’apostolat dans la Zone, celui qui vous permet de m’interroger et, de mon côté, de vous répondre.
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2016/02/26/l-oeuvre-de-georges-bernanos-est-moins-derriere-que-devant-nous.html
 sous-titré « les ésotérismes contre la tradition chrétienne », cet ouvrage introuvable depuis des années était très attendu par ceux qui suivent le travail d’Alain Pascal.
sous-titré « les ésotérismes contre la tradition chrétienne », cet ouvrage introuvable depuis des années était très attendu par ceux qui suivent le travail d’Alain Pascal.