Hyacinthe de Gailhard-Bancel était né, le jour de la Toussaint de l’an de grâce 1848, à Allex, dans cette partie de la Drôme qui sert de Marche commune à la Provence et au Dauphiné. Le village repose dans un lit de la rivière, à mi chemin entre son confluent avec le Rhône et la ville de Crest dont le fier donjon commandait la porte du Diois.
C’est dans ce cadre villageois que grandira Hyacinthe ; c’est à l’école communale, alors dirigée par des Frères, qu’il apprendra à lire et à écrire. Mais l’enfant inquiète ses parents par une trop grande nervosité qui semble l’épuiser ; ils se demandent s’il pourra supporter le régime, alors assez rude, de l’internat pendant ses études secondaires. A quel conseiller sûr s’adresser autre que le saint prêtre dont la réputation de visionnaire prodigieux attire alors de véritables foules vers un misérable hameau des Dombes ?
La mère, en compagnie de l’enfant trop fluet, prend donc le chemin d’Ars, et s’en revient rassurée. L’abbé Jean-Baptiste Vianney a posé sa main sur la jeune tête blonde, et a dit simplement : « Madame vous pouvez mettre cet enfant au collège. Il guérira et il vous donnera beaucoup de consolations.»
Une fois de plus l’homme de Dieu aura été bon prophète, Hyacinthe deviendra exceptionnellement robuste ; il vivra longtemps, et ce n’est pas seulement pour sa mère qu’il sera une source de consolations.
Le voilà donc élève à Montgré, près de Villefranche-sur-Saône, dans le célèbre collège que la Société de Jésus à créé pour la jeunesse du Sud-Est. H. de Gailhard-Bancel y fera connaissance avec toute l’élite de sa génération et y nouera bien des amitiés qu’il retrouvera plus tard toutes prêtes à faire équipe avec lui. Généreux, ouvert, vif, cordial, incapable de feindre, intrépide aussi, l’adolescent promet déjà tout ce que l’homme fait tiendra.
Après le baccalauréat, c’est la Faculté de Droit de Grenoble, puis l’inscription au stage du Barreau de Paris. Nous sommes en 1872, à l’heure où La Tour du Pin et Albert de Mun, sous l’impulsion de M. Maignen, décident de faire de l’œuvre des cercles Catholiques d’Ouvriers l’instrument pratique de la doctrine sociale catholique, et ce sera la grande chance de la vie de H. de Gailhard-Bancel que sa rencontre avec ces deux hommes dont il deviendra le disciple, l’ami et le compagnon de luttes. C’est la Tour du Pin qui le marquera le plus de son influence et qui le poussera vers les réalisations sociales pratiques dans le cadre de la profession et du terroir ; et, lorsque, trente ans plus tard, la fragilité de sa gorge obligera Albert de Mun à ne plus aborder la tribune que pour de rares et brèves interventions, H. de Gailhard-Bancel, devenu son collègue, prendra le relais du grand parlementaire catholique. Mais nous n’en sommes pas encore là. Brusquement, la mort soudaine du chef de famille met fin à cet apprentissage providentiel. Hyacinthe de Gailhard-Bancel dépouille la toge et abandonne la chicane pour venir remplir à Allex la tâche que Dieu avait dévolue aux siens : guider tout un petit monde rural, le conseiller, l’aider, l’entraîner vers le mieux, être enfin ce que Frédéric Le Play a défini une « autorité sociale », ne tenant son ascendant que des services rendus.
Comme il prend dès le début son nouveau rôle au sérieux, il s’affilie dès ce moment à la Société d’Agriculture de France qui vient d’être reconnue d’utilité publique et qui s’applique à développer et à répandre dans tout le pays les meilleures méthodes de culture. Mais cette action générale, il voudrait la décentraliser, la faire pénétrer dans les campagnes les plus reculées grâce à des associations locales de paysans.
…Mais M. le préfet de la Drôme, en rappelant à M. Gailhard-Bancel que la loi française interdisait les associations de plus de vingt personnes et en lui refusant l’autorisation demandée, eut tôt fait de le ramener à une vue plus exacte des possibilités que la IIIè République offrait aux chimériques de son espèce !
Par bonheur, le vote de la loi du 21 mars 1884 allait lui permettre de reprendre espoir.
Ce n’est pas que les auteurs de cette loi aient eu le moins du monde l’intention de permettre aux paysans de se grouper pour la défense de leurs intérêts professionnels : lorsque son texte parvint sur le bureau du Luxembourg, aucun député n’avait songé, au cours des longs débats qu’il avait suscités au Palais-Bourbon, d’y insérer une clause qui intéressât les agriculteurs.
Dans l’ouvrage attachant où il a réuni les souvenirs de sa vie syndicale et parlementaire. Les Syndicats Agricoles aux champs et au Parlement, M. de Gailhard-Bancel nous conte par quel heureux hasard un modeste sénateur, qui n’eut pas, au cours de sa vie parlementaire, d’autre occasion de passer à la postérité, devint le père du syndicalisme agricole :
« Ce sénateur, M. Oudet, entrait dans la salle des séances au moment où le Président donnait lecture du texte de l’article 3 de la loi, qui était ainsi conçu : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux. »
- Et pourquoi pas agricole ? demanda M. Oudet, dans une interruption.
- Pourquoi pas, en effet ? Et le Sénat à l’unanimité décida que le mot agricole serait introduit dans le texte de l’article 3. »
Il faudra un second hasard, non pas pour que M. de Gailhard-Bancel songe à utiliser ce texte pour créer un Syndicat Agricole à Allex, mais pour qu’il s’y décide. Le jeune maître des Ramières passe ses journées dans les champs à cette époque printanière, et, le soir venu, n’a guère le loisir de lire ce qui s’est déjà fait ailleurs dans cet ordre d’idées, ni l’envie de jeter sur le papier des projets de statuts. Heureusement, la Providence intervient à nouveau : un cheval ombrageux et effarouché, une voiture qui verse dans le fossé, un bras gauche cassé…, et voilà réunies les conditions de quinze jours d’arrêt forcés à la chambre, au bout desquels la rédaction des statuts du Syndicat Agricole d’Allex sera achevée ! Ils seront déposés le 6 décembre 1884, trois mois après ceux des Syndicats Agricoles de Poligny et de Die qui leur ont servi de modèle ; et c’est le moment de prendre acte que les trois premiers fondateurs de syndicats agricoles : MM. Louis Milcent, de Fontgalland et de Gailhard-Bancel sont trois catholiques et royaliste fervents.
Grâce à sa réussite dans le cadre de sa paroisse, il ne fut pas difficile à M. de Gailhard-Bancel de faire proliférer le syndicalisme agricole en Bas-Dauphiné. Dès 1885, le village voisin de Grane crée son syndicat; en 1886, toutes les communes appartenant aux deux cantons de Crest se constituent en sections syndicales du syndicat de Crest. En 1881, la contagion gagne les cantons voisins, si bien que cette année-là est marquée par la fondation de l’Union des Syndicats de la Drôme, sous la présidence de M. de Fontgalland.
M. de Gailhard-Bancel avait une autre idée de la doctrine sociale chrétienne. Etant partisan, au contraire, d’une organisation corporative unitaire, il ne lui fût pas venu à l’esprit d’accoler l’épithète de catholique aux Syndicats Agricoles qu’il préconisait. Mais, il trouvait naturel que ces Syndicats, fondés dans n pays où le catholicisme était la religion très largement dominante, fussent imprégnés de la même atmosphère chrétienne que les villages où ils s’instituaient. Un esprit aussi profondément croyant que le sien ne pouvait imaginer qu’il en fût autrement. C’est dans sa foi que lui-même trouvait le jaillissement intarissable de son dévouement envers son prochain ; comment eût-il pu penser qu’il en fût autrement chez autrui ? :
« Quand le bon Dieu, se plaisait-il à redire, donne à un homme de l’influence, de la fortune, de la vigueur, des loisirs, ce n’est pas uniquement pour son profit personnel qu’il les lui donne, c’est pour qu’il les mette au service de ses citoyens. »
Exigeant pour lui, indulgent pour les autres, il n’eût jamais songé à imposer à son entourage, comme une obligation, ce qui lui était nécessité personnelle. Mais il n’avait pas besoin d’exhorter pour entraîner, il lui suffisait d’obéir à sa règle de vie.
Ce n’est pas lui qui proposa aux syndiqués de son terroir de faire une retraite fermée annuelle, c’est un des membres du syndicat d’Allex qui lui en donna l’idée en lui écrivant :
« Vous nous avez rendu beaucoup de services matériels grâce au Syndicat, et nous vous en sommes bien reconnaissants ; mais vous ne nous en rendez pas au point de vue religieux, et pourtant ce serait bien nécessaire. Pensez-y ; nous sommes quelques-uns qui attendons de vous ce service. »
De cette requête devait naître ces retraites réservées aux membres des Syndicats et auxquelles la Trappe de N.D. d’Aiguebelle offrait son cadre discret et ombragé ; et aussi ces pèlerinages paysans à N.D. de l’Osier et à N.D. du Laus où l’exposé du conférencier agricole succédait au sermon du prédicateur.
M. de Gailhard-Bancel avait les dons naturels de l’orateur populaire : la voix chaleureuse dont un léger blèsement ne gâtait nullement le charme, la phrase ample, harmonieuse et bien construite, l’éloquence simple et imagée, et, par-dessus tout cela, un accent de conviction ardente qui enflammait son auditoire.
Rapidement, il devint le conférencier attitré des Congrès cantonaux catholiques où une place était toujours réservée aux problèmes ruraux.
Le Dauphiné, la Provence, le Velay, le Lyonnais faisaient à l’envi appel à lui, et sa renommée devint si grande dans tout le Sud-Est que, lorsque les catholiques du Haut-Vivarais (où paradoxalement, il n’avait jamais été appelé !) cherchèrent, en 1898 un candidat capable d’enlever la première circonscription de Tournon à la franc-maçonnerie, c’est à M. de Gailhard-Bancel qu’ils firent appel.
L’apôtre du syndicalisme agricole s’était toujours défendu d’avoir des visées politiques, afin de garder à son action corporative un caractère totalement désintéressé. L’argument du danger grandissant que
faisait courir à la France la politique de décatholicisation méthodique poursuivie par le gouvernement de la République n’eût pas suffi à le déloger de cette position de principe. Il y fallut les instances pressantes du saint évêque de Viviers, et, finalement l’ordre formel donné à sa conscience de fils de l’Eglise par Mgr Bonnet. Vainement objecta-t-il : « Mais, Monseigneur, je suis royaliste ! » Il s’entendit répondre : « Pas plus que moi, cher M. de Gailhard ! Je ne vous demande pas de ne plus l’être. Je vous demande simplement d’être candidat de défense religieuse et d’action sociale dans le cadre des institutions que la France s’est donnée. »
Cette formule édulcorée de ralliement est la seule qu’il accepta jamais ; encore fut-elle pour lui un sacrifice méritoire !
Sa candidature de 1898 fut un très honorable échec, qui eut bientôt sa revanche, à l’occasion d’une élection partielle. Le 31 décembre 1899, Hyacinthe de Gailhard-Bancel était élu député de Tournon. Il devait représenter jusqu’en 1924 cette pittoresque région des Boutières, peuplée de montagnards rudes et énergiques que, depuis les guerres de religion, le dualisme confessionnel fait s’affronter farouchement.
Les catholiques du Haut-Vivarais, qui retrouvaient en lui leur foi intransigeante, l’adoptèrent avec enthousiasme et lui vouèrent une fidélité dont le temps n’usa point la ferveur. Chaque année, au premier dimanche d’août, ils accouraient par milliers sur le haut sommet où repose le corps de Saint-Jean-François Régis qui garda leurs ancêtres de l’hérésie huguenote, et, après la messe, célébrée en plein air dans le site grandiose de Lalouvesc, ils acclamaient passionnément leur député exaltant en termes magnifiques leur métier et leur croyance. C’est là que nos yeux et nos oreilles d’enfant ont vu et entendu celui dont le nom éveille encore chez nous l’écho d’une reconnaissante admiration.
Tel fut le précurseur de l’Action Catholique Rurale.
La Providence devait lui envoyer des épreuves à la mesure de sa grade âme : la Grande Guerre lui prit trois de ses fils et sa fille unique, religieuse en exil. Cependant, la mort miséricordieuse, qui venait le prendre, après quatre-vingt-six ans de vie bien remplie, le 22 mars 1936, épargnerait à ses yeux de chair l’affreux spectacle de la mort de son fils Henry, ancien officier de marine, devenu à son tour le maître des Ramières et l’animateur des Syndicats de la Drôme, arrêté par les F.F.I. à la Libération pour le crime majeur d’être syndic départemental de la Corporation Paysanne, arraché à la prison de Valence par un assaut de P.T.P. communistes, sauvagement abattu sur une place de la ville, avec défense à quiconque de recueillir le pauvre corps martyrisé et livré pendant vingt-quatre heures aux outrages de la populace…
http://www.royalismesocial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=60

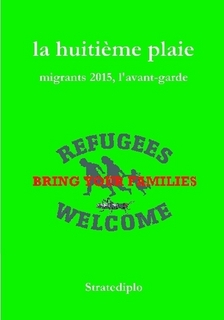 Les membres de l'Union européenne s'apprêtent à régulariser deux millions de hors-la-loi introduits illégalement par voie de fait en 2015, afin d'inviter leurs douze millions d'ayants-droit au regroupement familial, tout en accueillant encorehuit millions (certains disent treize) de nouveaux hors-la-loi en 2016 pour ouvrir la porte au regroupement familial deleurs quarante-huit millions d'ayants-droit en 2017. Le gouvernement français, aussi discret sur les chiffres que pendant la canicule de 2003, a déjà réservé 20 % de ces soixante-dix millions d'hères venus d'un autre monde. Cette régularisation illégale est inacceptable, il n'y a pas d'alternative heureuse à l'application des textes votés. Il fallait exposer les chiffres, enjeux, acteurs, desseins, feintes et pièges, pour que les peuples d'Europe puissent agir avant que l'irréparable ne soit commis. Car s'ils
Les membres de l'Union européenne s'apprêtent à régulariser deux millions de hors-la-loi introduits illégalement par voie de fait en 2015, afin d'inviter leurs douze millions d'ayants-droit au regroupement familial, tout en accueillant encorehuit millions (certains disent treize) de nouveaux hors-la-loi en 2016 pour ouvrir la porte au regroupement familial deleurs quarante-huit millions d'ayants-droit en 2017. Le gouvernement français, aussi discret sur les chiffres que pendant la canicule de 2003, a déjà réservé 20 % de ces soixante-dix millions d'hères venus d'un autre monde. Cette régularisation illégale est inacceptable, il n'y a pas d'alternative heureuse à l'application des textes votés. Il fallait exposer les chiffres, enjeux, acteurs, desseins, feintes et pièges, pour que les peuples d'Europe puissent agir avant que l'irréparable ne soit commis. Car s'ils