Le 20 novembre 1975, mourait le général Franco
Après trente cinq jours d’agonie, et un acharnement thérapeutique digne des médecins du Kremlin, beaucoup de désinformations sur son état de santé, et peut-être même sur sa survie, produisirent, en dehors de l’Espagne, une forme de gêne sinon de dégoût à l’égard d’un homme de l’Histoire qui reçut bien peu d’éloges posthumes. De façon remarquablement contradictoire, la presse européenne à la fois relevait la mort d’un dictateur, le dernier issu des terribles années trente, et redoutait que sa disparition signalât une nouvelle période de troubles dans son pays. « L’après-franquisme » comme on disait alors semblait lourd de menaces, dans une société qui ne s’était pas complètement réconciliée avec elle-même, en proie au terrorisme basque et à l’irrédentisme catalan, dont plusieurs régions affichaient encore un visage de sous-développement, où l’Église romaine semblait tenir sous la coupe de l’obscurantisme un peuple en grande partie arriéré, et dont l’avenir politique, avec un futur roi de pacotille qui ne pourrait qu’échouer, paraissait aussi sombre que le pelage des taureaux a las cinco de la tarde.
Et puis le miracle se produisit. Seul des dirigeants occidentaux, Valéry Giscard d’Estaing l’avait pressenti. La Movida, la démocratisation, le surgissement de responsables politiques de qualité, la modernisation économique et sociale, un bouillonnement culturel dont toute l’Europe devint jalouse, enfin l’admirable prise en main du destin du pays par ce jeune roi qui allait se révéler comme un des plus grands hommes d’État de la fin du XXe siècle.
L’Espagne avait-elle, d’un fier coup d’épaule bien dans la tradition castillane, tourné le dos aux « années noires » du franquisme ? Ou bien Franco était-il pour quelque chose dans cette inattendue et admirable métamorphose ? Telle est bien la question qui, pendant longtemps, n’osa être posée. Avec le temps, l’écriture de l’Histoire s’apaise et permet d’examiner plus sereinement les causes des évènements comme les aboutissements des phénomènes.
Certes Franco fut un homme brutal, secret, manipulateur, implacable et cruel, fermé à la perception de bien des évolutions de son temps. À bien des égards, il se situe dans cette lignée interminable des généraux félons qui, à coup de pronunciamientos, bâtirent tout au long du XIXe siècle la légende noire de l’Espagne.
Le coup d’État dynastique commis par Ferdinand VII le 31 mars 1830 ayant plongé le royaume dans un état quasiment constant de guerre civile, aggravé par les déconvenues outre mer de l’ancienne première puissance coloniale mondiale, avait brisé ce lien qu’Ernest Renan baptisa « vouloir vivre ensemble » pour qualifier ce qui fait le ciment d’une nation. Alors que, partout en Europe, notamment en Allemagne et en Italie, les vieux souverainismes régionaux s’effaçaient pour donner naissance à de nouvelles puissances, l’Espagne s’enfonçait au contraire dans le réveil d’irréductibles différences qu’aucun ferment fédérateur ne parvenait à réduire. Et le paroxysme en fut atteint avec la guerre civile déclenchée en 1936 par les exactions du gouvernement de Front populaire.
Indubitablement, Franco était un homme de cette époque et agit en homme de cette époque. Cependant, et voilà tout le mystère du personnage, il réussit là où tous ses prédécesseurs avaient échoué, offrant à l’Espagne la fin de ses déchirements. La paix et l’ordre rétablis au prix d’une dictature de trente ans. Était-il possible de faire autrement ?
Mais Franco fut aussi un homme du futur et même souvent, visionnaire. Au moins par trois fois et à des titres essentiels.
C’est d’abord lui qui, en 1940, sut dire non à Hitler, refusant que les troupes allemandes traversassent son pays pour fermer la Méditerranée. L’Espagne y aurait gagné la reprise de Gibraltar mais aurait porté une lourde responsabilité devant l’Histoire : que serait en effet devenue la deuxième guerre mondiale si l’Allemagne avait contrôlé l’Afrique du Nord dès juillet 1940 ? De même que pendant quatre ans, le sud des Pyrénées devint la seule région d’Europe continentale à représenter un refuge, certes fragile et incertain mais refuge quand même, pour les juifs persécutés. Justifiant la fameuse formule : « Franco a sauvé plus de juifs que Picasso » (qui, en effet, n’en sauva aucun) Conscient de tout cela, De Gaulle refusait qu’on dît du mal de Franco devant lui et se dépêcha, dès qu’il eut quitté le pouvoir en 1969, d’aller saluer le caudillo à qui la France libre devait tant.
C’est lui qui, en deuxième lieu, fonda le redressement de l’économie espagnole sur deux atouts : le tourisme et l’immobilier. Politique qui suscita par la suite de nombreuses et vives critiques mais que, curieusement, aucun des gouvernements postérieurs à 1975 ne remit fondamentalement en cause …
C’est lui, enfin, qui comprit que l’avenir de l’Espagne passait par le rétablissement de la monarchie légitime tant il est vrai qu’aucun État de droit ne peut se passer d’ancrage dans son Histoire, comme il comprit que seul ce régime permettrait à son pays d’établir durablement la démocratie et les libertés publiques, toujours ignorées jusque là.
Relevons au passage que le « régent du royaume d’Espagne », en désignant Juan Carlos plutôt que le prince Alphonse, libéra la branche aînée des Bourbons pour le trône de France, la séparation des deux couronnes, gravée dans le marbre d’Utrecht, se trouvant ainsi définitivement assurée et conforme aux lois fondamentales du royaume. On ne sait toutefois si Franco prit cette décision en toute connaissance de cause. Mais, s’il s’agit d’une légende, outre sa portée réelle, elle justifie de la part des royalistes français une reconnaissance presque aussi grande que celle exprimée par le général De Gaulle.
Daniel de Montplaisir
http://www.vexilla-galliae.fr/civilisation/histoire/1644-il-y-a-40-ans-mourait-le-general-franco
 Après Lemmy Kilmister (voir nos éditions précédentes), un autre grand artiste, même si n’officiant pas exactement dans la même registre, vient de nous quitter à son tour : Michel Delpech.
Après Lemmy Kilmister (voir nos éditions précédentes), un autre grand artiste, même si n’officiant pas exactement dans la même registre, vient de nous quitter à son tour : Michel Delpech.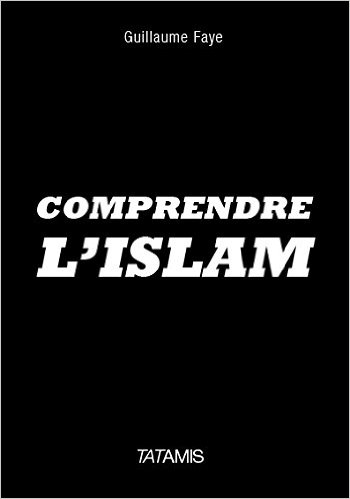 Le retour de l’Islam au premier plan de la scène mondiale est indéniablement l’un des événements majeurs du XXe et du XXIe siècles. Ce dernier est source de polémiques diverses, suscite rejet, parfois haine mais aussi l’inverse. D’un point de vue historique, les royaumes musulmans et l’empire Ottoman furent pendant de nombreux siècles l’ennemi (extérieur) de l’Europe, voyant cette dernière comme terre de conquête. Mais le voilà implanté chez nous depuis maintenant plusieurs décennies à cause des torrents migratoires se déversant sur notre continent ainsi que des politiques dites de « regroupement familial ». Ce phénomène, facilité par de nombreuses complicités, est considéré par certains comme un enrichissement culturel, par d'autres comme une invasion et même parfois comme une conquête, est-il à craindre ? A l’aulne des attentats du 7 janvier 2015 et de la tragédie du 13 novembre 2015, il est, à fortiori, légitime de se poser une telle question. Connaître et comprendre l’Islam s’impose donc comme une nécessité. Le dernier livre de Guillaume Faye qui s’appelle justementComprendre l’Islam arrive ainsi à point nommé.
Le retour de l’Islam au premier plan de la scène mondiale est indéniablement l’un des événements majeurs du XXe et du XXIe siècles. Ce dernier est source de polémiques diverses, suscite rejet, parfois haine mais aussi l’inverse. D’un point de vue historique, les royaumes musulmans et l’empire Ottoman furent pendant de nombreux siècles l’ennemi (extérieur) de l’Europe, voyant cette dernière comme terre de conquête. Mais le voilà implanté chez nous depuis maintenant plusieurs décennies à cause des torrents migratoires se déversant sur notre continent ainsi que des politiques dites de « regroupement familial ». Ce phénomène, facilité par de nombreuses complicités, est considéré par certains comme un enrichissement culturel, par d'autres comme une invasion et même parfois comme une conquête, est-il à craindre ? A l’aulne des attentats du 7 janvier 2015 et de la tragédie du 13 novembre 2015, il est, à fortiori, légitime de se poser une telle question. Connaître et comprendre l’Islam s’impose donc comme une nécessité. Le dernier livre de Guillaume Faye qui s’appelle justementComprendre l’Islam arrive ainsi à point nommé.