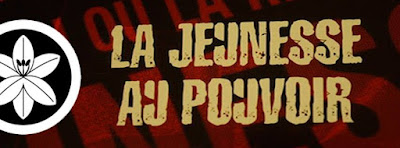culture et histoire - Page 1291
-
Francois Bousquet : La revue Eléments fait sa mue et met Onfray à la «une»
-
[Paris] 21 novembre 2015 : Colloque d’Action française
Colloque d’Action française le samedi 21 novembre !
De nombreux intervenants apporteront un éclairage pertinent sur la question de l’immigration. Réservez votre après-midi, participez, et partagez autour de vous !

-
Camp Maxime Real del Sarte 2015 - Compte rendu
-
L’autre Léon de Bruxelles par Georges FELTIN-TRACOL
En avril – mai 2014 paraissait le premier numéro des Cahiers d’histoire du nationalisme grâce aux bons soins des « Bouquins de Synthèse Nationale » animé par Roland Hélie. Cinq autres numéros ont suivi avec différents thèmes sur François Duprat, Gustav Mannerheim, Jean-Louis Tixier-Vignancour, le PFN, Jacques Doriot et le PPF. Un septième consacré à la croix celtique vient de sortir.
Sous la direction de Christophe Georgy, ce premier numéro évoque la personnalité, la vie et l’œuvre de Léon Degrelle (1906 – 1994), le charismatique chef du Rex belge et courageux combattant anti-communiste sur le front de l’Est. C’est un bel ouvrage sur lequel souffle un esprit rexiste et européen de bon alois. Que l’ami Hélie me pardonne de raconter une savoureuse anecdote. Voulant disposer d’exemplaires de ce Léon Degrelle pour la deuxième Journée régionale de Synthèse Nationale dans le Nord, il convenait avec l’imprimeur de lui remettre les volumes dans une bourgade normande. Le transfert réalisé, il leva les yeux au ciel et découvrit qu’ils étaient sous l’enseigne lumineuse d’un établissement nommé… « Rex » !
Le succès de ce premier numéro a incité « Les Bouquins de Synthèse Nationale » à s’aventurer dans le multimédiat en éditant un CD exceptionnel : un entretien inédit d’une durée de deux heures avec Léon Degrelle ! Ce « monument historique » selon Jean-Marie Le Pen continue à susciter plus de vingt ans après sa disparition indignations pathétiques et enthousiasme véritable. Outre un discours de Degrelle à ses compatriotes travaillant à Berlin en 1942, on y trouve diverses contributions ainsi que la réaction hargneuse du site antifa belge RésistanceS.be.
Redoutable procureur contre les tripatouillages politiciens et la décadence morale de sa patrie, Léon Degrelle s’afficha en homme d’action. À la fois journaliste, homme de presse, écrivain, grand reporteur et baroudeur, il séjourne clandestinement au Mexique afin de témoigner du martyr des Cristeros. En tintinologue averti, Francis Bergeron revient sur un fameux copinage, celui de Léon Degrelle avec Hergé. Ce dernier s’inspira-t-il de son téméraire ami pour concevoir son célèbre personnage ? « Alors, Tintin, c’est Degrelle ? Pas si simple. […] Tintin, c’est Hergé, comme Madame Bovary, c’est Flaubert. Ou plus exactement Tintin, c’est le jeune homme idéal qu’Hergé aurait aimé être. […] Mais il est vrai que Tintin, c’est quand même un peu Degrelle (pp. 46 – 47). »
Cette amitié aurait pu porter préjudice au père de Tintin, car la répression fut implacable pour Degrelle et les siens. La résistance assassina l’un de ses frères. Elle condamna son épouse à dix ans de prison. Elle arrêta, emprisonna et tortura ses parents, coupables de l’avoir enfanté. « En 1944, ajoute Christophe Georgy, il avait été condamné à mort par un jugement prononcé à l’encontre de toutes les règles judiciaires légales, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’interjeter appel, un jugement digne d’un tribunal d’exception ! (p. 37) » Pis, le Parlement bien corrompu de Belgique étendit spécialement pour lui seul les délais de prescription avant de le déclarer « étranger indésirable ». En revanche, les actuels clandestins migrants… Sa persécution se poursuivit post mortem avec un arrêté royal du 18 avril 1994 interdisant le retour de ses cendres outre-Quévrain !
L’exil de Léon Degrelle en Espagne ne fut pas toujours serein. Son ami espagnol Alberto Torresano rappelle qu’il échappa à huit tentatives d’enlèvement. Si l’une d’elles avait réussi, Léon Degrelle risquait la peine de mort. Aurait-il été exécuté pour des motifs politiques et historiques ? L’interrogation demeurera à jamais sans réponse. Pourquoi un tel acharnement ? Pour le président de l’ancienne Œuvre française, Yvan Benedetti, « Léon Degrelle a dénoncé l’argent-roi, la canaillocratie, les terroristes de la mondialisation, lesbanksters… (p. 197) ». Dans un discours prononcé à Berlin le 7 février 1943, il assure que la guerre « a été délibérément voulue, cyniquement préparée, par une Haute-Finance qui ne voulait pas d’un État populaire où elle n’aurait plus le contrôle de l’État et ne ressemblerait plus dans ses coffres le profit du travail du peuple (pp. 79 – 80) ». Cette haine irrationnelle à son égard s’explique aussi parce que « Hitler, rappelle Saint-Loup, auteur des SS de la Toison d’Or, l’avait choisi pour fils, selon Sparte (p. 106) ». Pour le journaliste dissident Henri de Fersan, Degrelle constitue un parfait « exemple de la fidélité par son sang versé (p. 177) ». Quant à Jean-Yves Dufour, il dépeint un homme curieux, boulimique de lectures variées. « On a accusé Degrelle d’être mégalomane et mythomane. Il pouvait avoir tendance à l’exagération, et à la projection de ses rêves dans la réalité, mais jamais au mensonge. Il croyait en lui, il ne doutait pas de ses capacités. Il fut même surnommé ironiquement Modeste. Mais ce sont là des qualités nécessaires aux hommes d’État (p. 129). » Or Camille Galic se « méfie des légendes vivantes (p. 117) » avant de se raviser.
Pour l’animateur de la revue Réfléchir & Agir, Pierre Gillieth, « Degrelle reste […] un exemple et il garda l’espoir jusqu’au bout (p. 192) ». Par ailleurs, « Léon Degrelle était curieux de tout, des autres peuples, de ce qui faisait leur vie, avait beaucoup voyagé, signale Edwige Thibaut. Il exécrait cette xénophobie idiote. Il n’était pas l’homme d’une appartenance étriquée et égocentrique. La conscience de soi, de son identité, est une force rayonnante qui ne redoute pas le contact et ne peut être dilué dans la différence (p. 143) ». « Ce modèle de poète-guerrier que donne Degrelle, poursuit Alexandre Gabriac, est excellent pour la jeunesse nationaliste d’aujourd’hui, puisqu’elle permet d’affirmer à travers son exemple qu’un homme marche sur deux jambes : la réflexion et l’action (p. 172) ». Edwige Thibaut considère même que « Léon Degrelle était avant tout un Bushi d’Occident, un homme de guerre, de cœur et de don total, qui sut manier aussi bien la plume que l’épée et dont la vertu dépassera toujours ce qu’il fut (p. 151) ».
Et si son œuvre la plus profonde n’était ni ses écrits journalistiques, ni son action politique, ni son engagement militaire, ni même son rôle – d’après-guerre – de grand témoin, mais la relance du « mythe bourguignon » ? Pierre Vial examine cet idéal historique et géopolitique européen, référence fugace au Grand Duché d’Occident au XVe siècle et à l’éphémère Lotharingie après 843. Le président de Terre et Peuple l’envisage tel un mythe, c’est-à-dire « une force de mobilisation de l’imaginaire destiné à susciter l’action (p. 155) ». Intarissable sur le sujet et pourfendeur constant de dogmes historiques erronés, « l’historien Léon Degrelle ne mériterait-il pas d’être réhabilité, s’interroge Camille Galic ? (p. 120). » Même dans ce domaine, surtout dans ce domaine hautement explosif, les vérités assénées par Degrelle dérangent.
Les télévisions française et belge francophone ont en effet censuré avec une belle régularité toute émission qui évoquait l’« autre Léon de Bruxelles ». Pensons au fameux Autoportrait d’un Fasciste réalisé en 1978 par Jean-Michel Charlier (le grand scénariste de BD) pour FR3 et qui n’a jamais été diffusé. Heureusement que Jean-Michel Charlier contourna l’épais murs du silence en publiant Léon Degrelle persiste et signe. Ce lourd silence voulu est une nouvelle fois défait par un double CD : Léon Degrelle raconte. L’ultime témoignage enregistré quelques mois avant son décès.
Léon Degrelle fut l’acteur des tempêtes du XXe siècle. Son courage, sa hardiesse, sa droiture, sa rectitude intellectuelle et politique en firent le parangon même du soldat politique, un type d’homme qui reviendra probablement bientôt.
Georges Feltin-Tracol
• Christophe Georgy (sous la direction de), Léon Degrelle. Documents et témoignages, Cahiers d’histoire du nationalisme, n° 1, avril – mai 2014, 206 p., 20 €.
• Léon Degrelle nous parle. L’ultime témoignage…, double CD avec un cahier de 16 p. illustrées, 2 h. d’écoute, 20 € (+ 3 € de port).
À commander tous les deux à Synthèse Nationale, 116, rue de Charenton, F – 75012 Paris, France. Commandes en ligne possibles sur www. synthese-editions.com.
-
Pouvoir et politique d’après Hannah Arendt
Hannah Arendt appartient au petit nombre de penseurs politiques les plus importants du XXe siècle. Après avoir fait des études philosophiques approfondies en Allemagne auprès de Karl Jaspers et de Martin Heidegger, elle émigre en France en 1933, puis se fixe définitivement aux États-Unis à partir de 1941 où elle enseigne la sociologie dans différentes universités.
L’originalité d’Hannah Arendt est de mêler dans ses analyses une série de remarques nées de l’observation endurante des phénomènes sociaux, culturels, politiques à une réflexion approfondie des écrits des auteurs qui, au fil des siècles, ont pensé la politique. Ce qui lui permet de fixer précisément les limites chronologiques d’une telle réflexion : « Notre tradition de pensée politique a un commencement bien déterminé dans les doctrines de Platon et d’Aristote. Je crois qu’elle a connu une fin non moins déterminée dans les théories de Karl Marx » (La Crise de la culture, p. 28). La faculté politique autorise l’activité humaine la plus noble, la plus généreuse, la plus proche de son humanité et de son essence d’homme. Apte à la parole et à la vie en commun, l’homme se distingue de l’animal, trouvant sa destination et sa valeur dans la vie publique quand il est en rapport avec d’autres hommes à qui il s’adresse librement et sur un pied d’égalité : « La double définition aristotélicienne de l’homme comme zôon politikon (vivant apte à vivre en cité) et comme zôon logikon (être doué de langage), un être accomplissant sa vocation la plus éminente dans la faculté de la parole et dans la vie de la polis, était destinée à distinguer le Grec du barbare et l’homme libre de l’esclave » (La Crise de la culture, p. 35). La véritable liberté politique ne consiste pas à faire retraite dans la sphère de la vie privée mais à participer à l’action publique, menée avec des égaux et reposant sur des choix individuels.
***
La question du pouvoir se définit à partir d’une série d’oppositions.
Dans le chapitre « Sur la violence » de Du mensonge à la violence : Essais de politique contemporaine (p. 152-156), Hannah Arendt applique la réduction phénoménologique à l’examen du pouvoir, ce qui l’amène à un travail autant méthodologique que linguistique. Il importe de distinguer le pouvoir, qui permet à l’homme d’exercer une activité efficace dans le monde, de la puissance qui ne concerne qu’une personne unique, de la force qui intéresse une énergie individuelle ou collective, de l’autorité qui investit naturellement celui qui la possède de la capacité reconnue et acceptée d’imposer telle ou telle obligation, de la violence enfin qui ne s’applique qu’à une pratique destinée à soumettre physiquement ses opposants.
◊ La puissance
La puissance est le phénomène le plus évident du pouvoir. Elle dégénère souvent dans une violence qui apparaît dans les moments paroxystiques de la vie politique. Une ère politique nouvelle suppose un mouvement de table rase qui s’accompagne nécessairement de violence car « la violence est le commencement, aucun commencement ne pourrait se passer de violence ni de violation » (Essai sur la révolution, p. 23). Ainsi se comprend la terreur révolutionnaire qui, pour fonder une nouvelle façon de penser et de vivre, une nouvelle organisation de la hiérarchie sociale, n’hésite pas à user de méthodes radicales pour exterminer les réfractaires.
Or, les révolutions, comme les guerres, correspondent à un moment de trouble et d’indécision où la vie en commun, la vie politique disparaît en tant que telle au profit de la libération de forces bestiales, animales, où les hommes sont gouvernés plus par leurs instincts que par leur raison. La violence, en effet, apparaît quand le pouvoir s’affaiblit et « dans la mesure où la violence joue un rôle dominant dans la guerre et la révolution, l’une comme l’autre agissent,stricto sensu, en dehors du domaine politique » (Essai sur la révolution, p. 12). Celui qui use de la violence dans le but d’imposer son autorité refuse sa condition d’homme comme être de langage : « La violence […] est incapable de parole» (Essai sur la révolution, p. 21).
Ainsi apparaît la différence essentielle entre pouvoir et violence. Alors que le premier use de persuasion et de sages précautions, « le pouvoir, mais non la violence, est l’élément essentiel de toute forme de gouvernement. La violence est, par nature, instrumentale ; comme tous les instruments, elle doit toujours être dirigée et justifiée par les fins qu’elle entend servir » (Du mensonge à la violence, p. 161).
◊ Le pouvoir
De fait, la marque la plus certaine d’un pouvoir authentique et sûr de lui est la non-violence : « la polis, l’État-cité, se définit de manière explicite comme le mode de vie fondé sur la persuasion exclusivement et non sur la violence » (Essai sur la révolution, p. 11). Le pouvoir est le fonds qui donne leurs assises aux pensées et aux actions humaines. Alors que la violence exhibe son caractère instrumental, le pouvoir transcende les affaires de tous les jours en leur donnant un sens et une mesure : « loin d’être un moyen en vue d’une fin, le pouvoir est en fait la condition même qui peut permettre à un groupe de personnes de penser et d’agir en termes de fins et de moyens » (Du mensonge à la violence, p. 161).
La polis grecque est le lieu où les égaux confrontent librement leurs opinions et usent d’arguments solidement étayés et présentés à l’aide d’un art rhétorique soigneusement travaillé afin de mieux persuader l’autre. Le pouvoir suppose donc un monde commun où chacun peut recevoir par la parole de l’autre le dévoilement d’une vérité jusqu’alors cachée et peut à son tour agir pour le bien de tous : « La grammaire de l’action — l’action est la seule faculté humaine qui demande une pluralité d’homme — et la syntaxe du pouvoir — le pouvoir est le seul attribut humain qui ne s’applique qu’à l’espace matériel intermédiaire par lequel les hommes sont en rapport les uns avec les autres — se combinent dans l’acte de fondation grâce à la faculté de faire des promesses et de les tenir qui, dans le domaine de la politique, pourrait bien être la plus haute faculté humaine » (Essai sur la révolution, p. 258).
◊ Le pouvoir totalitaire
Selon Hannah Arendt, le système totalitaire combine les caractères suivants :
- Une idéologie officielle qui coiffe tous les aspects de la vie individuelle et collective, et qui explique l’humanité d’après une trajectoire qui d’un présent rejeté radicalement se dirige vers un état parfait.
- Un parti unique de masse, dirigé par le seul dictateur.
- Une terreur, organisée par la police politique, dirigée non seulement contre les opposants, mais contre des portions entières de la population et de la société, et aboutissant à ce que David Rousset a appelé l’univers concentrationnaire.
- L’atomisation systématique de la société, l’isolement de l’individu. D’une part, on détruit les anciennes structures (famille, églises, corps intermédiaires). D’autre part, on mobilise la population dès l’enfance (jeunesses hitlériennes, komsomols staliniens) au sein du parti et de ses organisations satellites qui quadrillent l’ensemble de la vie sociale et professionnelle.
- La mainmise sur tous les moyens d’information et de propagande.
Comme le montre Hannah Arendt dans Eichmamm à Jérusalem (1966), l’homme du totalitarisme n’est pas un monstre. Il est même désespérément banal dans le mesure où il n’est qu’un fonctionnaire méticuleux et consciencieux, un subalterne discipliné. « La terreur, écrit l’auteur par ailleurs, produisit un phénomène étonnant, elle fit que le peuple allemand participa aux crimes des chefs. Ceux qui étaient asservis devinrent des complices… des hommes dont on ne l’eût jamais cru possible, des pères de famille, des citoyens qui exerçaient consciencieusement leur métier, quel qu’il fût, se mirent avec la même conscience à assassiner et à commettre, si l’ordre leur en était donné, d’autres forfaits dans les camps de concentration » (article sur La Culpabilité allemande, 1945). L’homme du totalitarisme, à l’instar d’Eichmann, considère qu’il fait son devoir, et rien de plus. Hannah Arendt maintient qu’Eichmann n’a fait qu’obéir aux ordres donnés par le pouvoir nazi, ce qui marque de suspicion le bien-fondé du procès intenté contre lui par les autorités israéliennes plus de quinze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
◊ L’autorité
Chronologiquement, la violence précède le pouvoir. Le commencement de tout pouvoir politique s’opère, pratiquement toujours, dans le sang. C’est même par la révolution que le commencement a lieu et « les révolutions sont les seuls événements politiques qui nous placent directement, inéluctablement, devant le problème du commencement » (Essai sur la révolution, p. 25).
Mais, de même qu’à l’origine du pouvoir on trouve la violence, avant l’instauration de l’autorité il y a la liberté : « La liberté en tant que phénomène politique date de l’essor des États-cités grecs. Depuis Hérodote, elle a été conçue en tant qu’organisation politique dans laquelle les citoyens vivaient ensemble en dehors de l’autorité, sans division entre gouvernés et gouvernant » (Essai sur la révolution, p. 39). Or, cette liberté n’a rien à voir avec l’égalité qui n’a pas, avant la Révolution française, accédé à la dignité de valeur suprême : « l’idée même l’égalité telle que nous la comprenons, au sens que toute personne est née égale à toutes les autres du fait même de sa naissance et que l’égalité est un droit de naissance, était totalement inconnue antérieurement à l’époque moderne » (Essai sur la révolution, p. 54).
L’important, cependant, est que l’autorité transcende tout pouvoir : « la crise de l’autorité dans un gouvernement autoritaire est toujours une force extérieure et supérieure au pouvoir qui est le sien » (La Crise de la culture).Étymologiquement, auctoritas vient de augere, “augmenter”, « et ce que l’autorité ou ceux qui commandent augmentent constamment, c’est la fondation » (La crise de la culture, p. 129). L’autorité n’a donc besoin ni de violence ni de persuasion pour s’imposer: elle tire d’elle-même, c’est-à-dire du passé, sa propre justification. Quand on cesse de respecter l’autorité, c’est qu’on a perdu le lien religieux avec le passé. Un père de famille ou un professeur qui accepte de parler d’égal à égal avec son fils ou son élève renie son autorité de fait en refusant de maintenir intact le lien de supériorité entre le passé et le présent (1).
◊ Le primat du politique et de la vie en commun
Le Mit-sein
C’est dans les paragraphes 25 à 27 de Être et Temps que Heidegger développe l’analyse du Mit-sein, de l’être-ensemble. Il remarque (§ 25) qu’autrui est un a priori de la condition humaine, une donnée première au même titre que l’espace et le temps par exemple : « le Dasein n’est jamais donné sans les autres » et « les autres sont toujours « là-avec ». Ce qui lui permet d’avancer au § 26 que « l’être-avec est un existential », c’est-à-dire une structure première de l’homme compris comme Dasein, au même titre que le langage ou le souci. Ainsi, « le monde du Dasein est monde-commun (Mitwelt).L’être-au est être-avec (Mitsein) en commun avec d’autres. L’être-en-soi à l’intérieur du monde est coexistence (Mitdasein). Se trouvant d’emblée, dès qu’il est jeté dans le monde, en compagnie d’autres hommes, « le Dasein est essentiellement en lui-même être-avec ».
Dans l’être-avec, il est offert à l’homme d’avoir un rapport authentique et libre à lui-même. Il éprouve sa propre liberté quand, avec d’autres, il travaille à une tâche qui libère chacun du poids de l’égoïsme et de l’inauthenticité : « l’être-en-compagnie de ceux qui sont employés à la même tâche ne se nourrit souvent que de méfiance. Au contraire l’engagement dans la même tâche se détermine à partir du Dasein qui se prend chaque fois proprement en main. Cette façon d’être authentiquement liés ensemble permet seule un rapport direct à la tâche entreprise, elle met l’autre face à sa liberté pour lui-même » (§ 26). C’est dire que dans l’être-avec authentique, le Dasein est libre. Il fonde son être sur la reconnaissance de la présence d’autres Dasein ; c’est-à-dire des êtres intimement concernés par le problème de l’être. Évoluant dans un monde commun, les hommes s’offrent chacun l’un à l’autre leur liberté.
C’est sur cette liberté que se fonde l’établissement du pouvoir. Mais depuis les temps chrétiens, tels que le Moyen Âge les a vécus, la vie humaine est devenue la valeur suprême et la vie privée l’emporte sur la vie publique. Or, faire œuvre politique, c’est s’engager dans un espace et dans un temps qui transcendent l’espace et le temps humains : « pour les Grecs et pour les Romains aussi bien, malgré toutes leurs différences, la fondation d’un corps politique était engendrée par le besoin qu’avait l’homme de dépasser la mortalité de la vie humaine et la fugacité des actes humains » (La Crise de la culture, p. 94).
Le monde est chaque fois renouvelé quand un homme agit librement dans un monde commun: « le courage libère les hommes de leur souci concernant la vie, au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable parce qu’en politique, ce n’est pas la vie mais le monde qui est en jeu » (La Crise de la culture, p. 203). C’est pourquoi vivre en domaine politique revient à dire la vérité : parce que Lessing était un homme intégralement politique, il a soutenu que la vérité ne peut exister que là où elle est humanisée par le parler, là où chacun dit, non pas ce qui lui vient à l’esprit, mais ce qui lui « semble vérité » (Vies politiques, p. 41).
Ainsi se définit la vérité : « Conceptuellement, nous pouvons appeler la vérité ce que l’on ne peut pas changer ; métaphoriquement, elle est le sol sur lequel nous nous tenons et le ciel qui s’étend au-dessus de nous » (La Crise de la culture, p. 336). Accepter que le pouvoir existe, agir librement pour ou contre lui, c’est donc mettre à jour la vérité.
► Gilles Vannier, in : Analyses & Réflexions sur le pouvoir, ouvrage coll., ellipses, 1994.
◘ Note en sus :
1) « Affranchi de l’autorité des adultes, l'enfant n'a donc pas été libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique : la tyrannie de la majorité. En tout cas, il en résulte que les enfants ont été pour ainsi dire bannis du monde des adultes. Ils sont soit livrés à eux-mêmes, soit livrés à la tyrannie de leur groupe, contre lequel, du fait de sa supériorité numérique, ils ne peuvent se révolter, avec lequel, étant enfants, ils ne peuvent discuter, et duquel ils ne peuvent s'échapper pour aucun autre monde, car le monde des adultes leur est fermé. Les enfants ont tendance à réagir à cette contrainte soit par le conformisme, soit par la délinquance juvénile, et souvent par un mélange des deux », H. Arendt, La Crise de la culture, Gal., 1972.
-
« Situation de la France ». Sur un livre de Pierre Manent par Pierre LE VIGAN
Comment faire une place à l’immigration déjà présente, et surtout l’immigration musulmane, en évitant « l’éviscération spirituelle », ou encore le grand remplacement des âmes achevant le processus engagé avec le grand oubli des origines… européennes de l’Europe ? Faut-il refuser le religieux ? Faut-il le nier, ou le minimiser systématiquement ? Faut-il se contenter de répéter les mantras de la laïcité ? Pierre Manent ne le croit pas. Il pense que ce qu’il faut mettre face à l’islam, face au plein (un trop plein ?) de l’Islam, ce ne peut être le creux, le vide de la laïcité. Ce ne peut être que l’affirmation des origines principalement chrétiennes de l’Europe. Principalement chrétiennes, et aussi juive : l’un ne peut aller sans l’autre.
De là, un livre plein d’interrogations mais aussi fort de quelques convictions, écrits après les attentats de janvier 2015. C’est un livre contre le renoncement. Non pas le renoncement à lutter contre le terrorisme – c’est là une affaire de technicien de la sécurité et de la police –, mais, plus fondamentalement, le renoncement à affirmer ce que nous sommes.
Nous sommes les hommes d’un territoire, l’Europe, et plus précisément l’Occident européen, qui a effectivement une histoire souvent conflictuelle avec l’islam, et qui est avant tout la terre d’une autre religion, le christianisme, lui-même enchâssé dans un support gréco-romain, païen et polythéiste. L’erreur de l’analyse laïque du fait religieux est de croire que la religion ne peut être qu’une affaire individuelle. Ce n’est pas le cas ni avec le catholicisme, ni avec l’islam – voire moins encore. La vérité, c’est que quand la IIIe République a voulu arracher l’éducation à l’Église catholique, c’est parce que le christianisme lui-même était à l’origine de l’idée de laïcité, et ce fut pour substituer à la morale chrétienne une morale laïque qui était exactement la même, et, on l’oublie aujourd’hui, qui était une religion de la patrie. La laïcité d’alors consistait à apprendre l’amour des sciences et l’amour de la patrie.
La laïcité d’aujourd’hui est tout autre. C’est un grand évidement : il s’agit d’extirper tout ce qui est foi. C’est le grand évitement du sacré. L’éducation laïque prépare les enfants à « être les sociétaires d’une société sans forme où les religions se dissoudraient comme le reste », écrit Pierre Manent. Nous oscillons alors, en matière de relations avec les musulmans, entre une exigence d’invisibilité et une tolérance à tout sous le nom de « respect des croyances ». Or, si cacher son visage ne peut être toléré car le propre des relations humaines, c’est de voir le visage de l’autre et de pouvoir se faire signe, un tissu sur les cheveux ne pose pas plus de problème que d’arborer une casquette de pseudo-joueur américain de basket – ce qui ne tombe pas sous le coup de la réprobation générale. Dans le même temps, le respect des croyances, s’il n’implique pas l’invisibilité de ceux qui croient, ne peut légitimer aucune restriction à la liberté d’expression. Il ne saurait y avoir, en fait, de « respect des croyances »– les croyances New Age sont-elles intellectuellement respectables ? –, mais, à proprement parler, de respect de ceux qui croient. Encore faut-il que la liberté d’expression soit valable pour tous : pour les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo mais aussi pour Dieudonné. Sinon, nous ne serons pas crédibles.
Pierre Manent le dit justement : nous ne saurions nous attacher étroitement à « une thèse savante qui prétendrait déterminer l’identité de l’Europe ». Cela ne veut pas dire que l’on peut faire des Européens de n’importe qui dans n’importe quelles conditions. Il faut, dit justement Pierre Manent, une communauté d’expérience. Il faut aussi indiquer clairement quel est notre modèle politique. L’Europe n’a pas choisi le césaro-papisme. Elle a choisi le modèle des nations. Dans une religion sans pape comme l’islam, la fusion des pouvoirs spirituel et césarien peut être une tentation. Ce n’est pas la voie européenne. C’est pourquoi les Européens doivent dire clairement ce que nous savons : spirituellement, l’Europe n’est pas vide. Ce n’est pas un récipient. En Europe, le principe d’alliance avec le Très-Haut n’est pas la même chose que le principe d’obéissance à Dieu dans l’islam. Mais cela pose aussi la question de l’Europe de Bruxelles : c’est l’Europe d’un nouveau papisme « droits-de-l’hommiste » et césarien à sa manière insidieuse. Les nouveaux prêtres de la religion des droits de l’homme sont aussi les prêtres de la religion du Marché, du Capital et de l’indifférenciation généralisée des hommes. Ils imposent aux Européens un remplacement de peuple qui ne peut qu’aboutir – et c’est déjà en cours – à des catastrophes humaines et civilisationnelles.
« Que voulons-nous faire en politique si nous sommes incapables de définir notre communauté d’appartenance et d’action politique ? » Comment pouvons-nous être respectés en tant qu’Européens non musulmans (chrétiens ou pas, athées ou agnostiques) si nous ne sommes, en Europe, que les tenanciers d’un lieu de l’extension illimitée des droits de la « particularité individuelle » ? Du fait de la conjonction de la laïcité (dans sa version laïciste) et du culte de la diversité, on ne nomme que les musulmans. On ne dit pas ce que sont les non musulmans. « Tu n’es pas musulman ? Tu n’es pas juif ? Alors, tu n’es rien ? » Or, les non musulmans (et non juifs) sont quelque chose. Ils sont tout d’abord Européens. Ils sont aussi chrétiens de civilisation, même s’ils ne le sont pas (ou plus) forcément de foi. Les musulmans eux-mêmes ne s’y trompent guère. On peut ainsi dire qu’un musulman intégré, c’est un musulman qui respecte les droits et devoirs de la république c’est-à-dire une indifférence polie, tandis qu’un musulman assimilé, ce n’est pas un musulman dépouillé de sa culture, mais c’est un musulman qui vous souhaite « joyeux Noël » (et non pas « joyeuses fêtes »), c’est-à-dire qui a compris qui vous êtes, même si vous n’avez pas la foi, et qui vous respecte en tant que tel, en tant que membre d’une certaine civilisation (un musulman qui respectera en vous le membre de la « patrie des droits de l’homme », cela n’existe tout simplement pas pour la raison assez estimable que les musulmans ne sont pas naïfs). Ces réalités des perceptions sociales, d’un côté et de l’autre, du côté chrétien et musulman, nos gouvernants veulent les amender car elles ne sont pas conformes à la doxa dominante. A-t-on vu dans l’histoire totalitarisme plus insidieux que le nôtre, fouillant à ce point les consciences ? Face aux droits de l’homme sans racine, face aux droits de l’homme « sans qualité » (Robert Musil), désidentifié (Alain Finkielkraut), et « sans gravité » (Charles Melman), face à l’homme occidental qui ne prend rien au sérieux, face à l’homme postmoderne ricanant et rigolard, l’« homo Canal + » ou « Homo comicus » (François L’Yvonnet), il se produit une islamisation rampante et rapide car le désir va du côté de ceux qui croient en quelque chose.
Pierre Manent a certainement raison de dire que nous devrions exiger des musulmans français qu’ils rompent les liens avec les puissances étrangères qui les financent, pour faire vivre un islam vraiment de France. Tout cela suppose toutefois de sortir d’une indifférence réciproque. Cela suppose de ne pas seulement demander aux musulmans – et à chacun d’entre nous – d’adhérer aux « valeurs de la République », qui ne coûtent rien et n’engagent à rien, si ce n’est à payer ses contraventions et ses impôts. Cela suppose de sortir des incantations laïcistes. La laïcité est un dispositif, utile du reste, mais ce n’est pas un site. Le site, c’est la nation française, c’est une nation d’Europe au milieu d’autres nations d’Europe.
De Louis Massignon au père Michel Lelong en passant par Maxime Rodinson et Jacques Benoist-Méchin, il y a toute une tradition d’intérêt d’intellectuels français pour l’islam. Cette tradition n’intéresse plus un seul instant nos pseudo-élites et hommes politiques. En déstabilisant les régimes arabes laïcs, qui ne l’étaient d’ailleurs pas au sens européen du terme (Irak, Libye, Syrie, …) mais en un autre sens, nos gouvernants sont pourtant co-responsables de la mort de millions de musulmans. Ils sont aussi responsables d’une aggravation des flux migratoires dont souffre l’Europe et qui, pour autant, ne sont pas une solution saine pour les immigrants et moins encore pour leurs pays d’origine. Cette déstabilisation des pays de l’Orient se retourne contre nos peuples, ici, en Europe, et ce ne sont pas des musulmans laïcs qui posent des bombes, mais des islamistes radicaux ultra-religieux, bien que parfaitement contaminés par les aspects les plus extrêmes de l’hypermodernité. Ce sont des religieux sans culture, fracassant notre laïcisme sans culture.
Fatigués d’être eux-mêmes et même d’être quelque chose, les Européens cherchent à se donner le repos en enlevant toutes les barrières : entre peuples, entre sexes, entre économie. C’est la tentation du grand repos de la mort. Nous ne voulons plus « continuer l’histoire européenne », remarque Pierre Manent. Faire son histoire, c’est effectivement fatigant. Mais il ne tient pas à nous de ne plus être perçu comme Européens. Nous voulons le grand repos et la liberté. Nous aurons la fatigue et l’esclavage. Le courage sauve au moins l’honneur. Bien souvent, il sauve même un peu plus que cela. C’est pour cela qu’un Zemmour écrit des livres.
Dans le long travail de reconstruction d’une armature spirituelle et morale, il faudra certainement demander, note Pierre Manent, aux musulmans français de se séparer de l’Oumma, et de reconnaître la France comme la première de leur communauté d’appartenance. Il faudrait dire : faire passer l’Oummaaprès l’appartenance à la communauté nationale française. Il faudra aussi rappeler à chacun que l’Europe n’est pas le lieu abstrait des droits de l’homme coupé du citoyen mais la terre d’une longue civilisation. L’Europe n’est certes pas immuable, mais elle n’est nullement pour autant une coquille vide. Jacques Benoist-Méchin, présentant des lettres de soldats de la Grande Guerre, définissait notre tâche comme celle « de stimuler la genèse d’un nationalisme nouveau, plus large et plus lucide que le bellicisme traditionnel », qui préserverait « la vitalité de la France, au regard des autres nations; la vitalité de l’Europe au regard des autres civilisations ».
Pierre Le Vigan
• Pierre Manent, Situation de la France, Desclée de Brouwer, 2015, 176 p., 15,90 €
• D’abord paru sur Metamag, le 6 octobre 2015.
-
03 Le Temps des Cathédrales Dieu est Lumière (G Duby) 1978
-
Hannah Arendt : l’âge sombre, le paria et le parvenu
Recension : Agnes HELLER, « Eine Frau in finsteren Zeiten », in :Studienreihe der Alten Synagoge, Band 5 : Hannah Arendt, “Lebensgeschichteeiner deutschen Jüdin”, Klartext Verlag, Essen, 1995-96, 127 p.
Dans un volume publié par le centre d’études juives Alte Synagoge, Agnes Heller se penche sur la vision du monde et des hommes qu’a développéeHannah Arendt, au cours de sa longue et mouvementée quête de philosophe. Cette vision évoque tout à la fois un âge sombre (finster) et un âge de Lumière, mais les périodes sombres sont plus fréquentes et plus durables que les périodes de Lumière, qui sont, elles, éphémères, marquées par la fulgurance de l’instant et la force de l’intensité. Les périodes sombres, dont la modernité, sont celles où l’homme ne peut plus agir politiquement, ne peut plus façonner la réalité politique : Hannah Arendt se montre là disciple de Hegel, pour qui le zôon politikon grec était justement l’homme qui s’était hissé au-dessus de la banalité existentielle du vécu pré-urbain pour accéder à l’ère lumineuse des cités antiques. Urbaine et non ruraliste (au contraire de Heidegger), Hannah Arendt conçoit l’oikos primordial (laHeimat ou la glèbe / Die Scholle) comme une zone anté-historique d’obscurité tandis que la ville ou la cité est lumière parce qu’elle permet une action politique, permet le plongeon dans l’histoire. Pour cette raison, le totalitarisme est assombrissement total, car il empêche l’accès des citoyens/des hommes à l’agora de la Cité qui est Lumière. L’action politique, tension des hommes vers la Lumière, exige effort, décision, responsabilité, courage, mais la Lumière dans sa plénitude ne survient qu’au moment furtif mais très intense de la libération, moment toujours imprévisible et éphémère. Agnes Heller signale que la philosophie politique de Hannah Arendt réside tout entière dans son ouvrageVita activa ; Hannah Arendt y perçoit l’histoire, à l’instar d’Alfred Schuler, comme un long processus de dépérissement des forces vitales et d’assombrissement ; Walter Benjamin, à la suite de Schuler qu’il avait entendu quelques fois à Munich, parlait d’un “déclin de l'aura”. Hannah Arendt est très clairement tributaire, ici, et via Benjamin, des Cosmiques de Schwabing (le quartier de la bohème littéraire de Munich de 1885 à 1919), dont l’impulseur le plus original fut sans conteste Alfred Schuler. Agnes Heller ne signale pas cette filiation, mais explicite très bien la démarche de Hannah Arendt.
L'histoire : un long processus d’assombrissement
L'histoire, depuis les Cités grecques et depuis Rome, est donc un processus continu d’assombrissement. Les cités antiques laissaient à leurs citoyens un vaste espace de liberté pour leur action politique Depuis lors, depuis l’époque d’Eschyle, ce champ n’a cessé de se restreindre. La liberté d’action a fait place au travail (à la production, à la fabrication sérielle d’objets). Notre époque des jobs, des boulots, du salariat infécond est donc une époque d’assombrissement total pour Hannah Arendt. Son pessimisme ne relève pas de l’idéologie des Lumières ni de la tradition messianique. L’histoire n’est pas, chez Hannah Arendt, progrès mais régression unilinéaires et déclin. La plénitude de la Lumière ne reviendra pas, sauf en quelques instants surprises, inattendus. Ces moments lumineux de libération impliquent un “retournement” (Umkehr) et un “retour” bref à cette fusion originelle de l’action et de la pensée, incarnée par le politique, qui ne se déploie qu’en toute clarté et toute luminosité. Mais dans cette succession ininterrompue de périodes sombres, inintéressantes et inauthentiques, triviales, la pensée agit, se prépare aux rares irruptions de lumière, est quasiment le seul travail préparatoire possible qui permettra la réception de la lumière. Seuls ceux qui pensent se rendent compte de cet assombrissement. Ceux qui ne pensent pas participent, renforcent ou accélèrent l’assombrissement et l’acceptent comme fait accompli. Mais toute forme de pensée n’est pas préparation à la réception de la Lumière. Une pensée obnubilée par la vérité toute faite ou recherchant fébrilement à accumuler du savoir participe aussi au processus d'assombrissement. Le totalitarisme repose et sur cette non-pensée et sur cette pensée accumulante et obsessionnellement “véritiste”.
L’homme ou la femme, pendant un âge sombre, peuvent se profiler sur le plan culturel, comme Rahel Varnhagen, femme de lettres et d’art dans la communauté israélite de Berlin, ou sur le plan historique, comme Benjamin Disraeli, qui a forgé l’empire britannique, écrit Hannah Arendt. Mais, dans un tel contexte de “sombritude”, quel est le sort de l’homme et de la femme dans sa propre communauté juive ? Il ou elle s’assimile. Mais cette assimilation est assimilation à la “sombritude”. Les assimilés en souffrent davantage que les non-assimilés. Dans ce processus d’assimilisation-assombrissement, deux figures idéal-typiques apparaissent dans l’œuvre de Hannah Arendt : le paria(1) et le parvenu, deux pistes proposées à suivre pour le Juif en voie d’assimilation à l’ère sombre. À ce propos, Agnes Heller écrit :
« Le paria émet d’interminables réflexions et interprète le monde en noir ; il s’isole. Par ailleurs, le parvenu cesse de réfléchir, car il ne pense pas ce qu’il fait ; au lieu de cela, il tente de fusionner avec la masse. La première de ces attitudes est authentique, mais impuissante ; la seconde n’est pas authentique, mais puissante. Mais aucune de ces deux attitudes est féconde ».
Ni paria ni parvenu
Dès lors, si on ne veut être ni paria (par ex. dans la bohème littéraire ou artistique) ni parvenu (dans le monde inauthentique des jobs et des boulots), y a-t-il une troisième option ? “Oui”, répond Hannah Arendt. Il faut, dit-elle, construire sa propre personnalité, la façonner dans l’originalité, l’imposer en dépit des conformismes et des routines. Ainsi, Rahel Varnhagen (2) a exprimé sa personnalité en organisant un salon littéraire et artistique très original où se côtoyaient des talents et des individualités exceptionnelles. Pour sa part, Benjamin Disraeli a réalisé une œuvre politique selon les règles d’une mise en scène théâtrale. Enfin, Rosa Luxemburg, dont Hannah Arendt dit ne pas partager les opinions politiques si ce n'est un intérêt pour la démocratie directe, a, elle aussi, représenté une réelle authenticité, car elle est restée fidèle à ses options, a toujours refusé compromissions, corruptions et démissions, ne s’est jamais adaptée aux circonstances, est restée en marge de la “sombritude” routinière, comme sa judéité d’Europe orientale était déjà d’emblée marginale dans les réalités allemandes, y compris dans la diaspora germanisée. L’esthétique de Rahel Varnhagen, le travail politique de Disraeli, la radicalité sans compromission de Rosa Luxemburg, qu’ils aient été succès ou échec, constituent autant de refus de la non-pensée, de la capitulation devant l’assombrissement général du monde, autant de volontés de laisser une trace de soi dans le monde. Hannah Arendt méprisait la recherche du succès à tout prix, tout autant que la capitulation trop rapide devant les combats qu’exige la vie. Ni le geste du paria ni la suffisance du parvenu…
S’élire soi-même
Agnes Heller écrit :
« Paria ou parvenu : tels sont les choix pertinents possibles dans la société pour les Juifs émancipés au temps de l’assimilation. Hannah Arendt indique que ces Juifs avaient une troisième option, l’option que Rahel Varnhagen et Disraeli ont prise : s’élire soi-même. Le temps de l’émancipation juive était le temps où a démarré la modernité. Nous vivons aujourd'hui dans une ère moderne (postmoderne), dans une société de masse, dans un monde que Hannah Arendt décrivait comme un monde de détenteurs de jobs ou un monde du labeur. Mais l’assimilation n’est-elle pas devenue une tendance sociale générale ? Après la dissolution des classes, après la tendance inexorable vers l’universalisation de l’ordre social moderne, qui a pris de l’ampleur au cours de ces dernières décennies, n’est-il pas vrai que tous, que chaque personne ou chaque groupe de personnes, doit s’assimiler ? N’y a-t-il pas d’autres choix sociaux pertinents pour les individus que d'être soit paria soit parvenu ? S’insérer dans un monde sans se demander pourquoi ? Pour connaître le succès, pour obtenir des revenus, pour atteindre le bien-être, pour être reconnu comme “modernes” entre les nations et les peuples, la recette n'est-elle pas de prendre l’attitude du parvenu, ce que réclame la modernité aujourd'hui ? Quant à l'attitude qui consiste à refuser l’assimilation, tout en se soûlant de rêves et d’activismes fondamentalistes ou en grognant dans son coin contre la marche de ce monde (moderne) qui ne respecte par nos talents et où nous n’aboutissons à rien, n’est-ce pas l’attitude du paria ? ».
Nous devons tous nous assimiler…
Si les Juifs en voie d'assimilation au XIXe siècle ont été confrontés à ce dilemme — vais-je opter pour la voie du paria ou pour la voie du parvenu ? — aujourd'hui tous les hommes, indépendamment de leur ethnie ou de leur religion sont face à la même problématique : se noyer dans le flux de la modernité ou se marginaliser. Hannah Arendt, en proposant les portraits de Rahel Varnhagen, Benjamin Disraeli ou Rosa Luxemburg, opte pour le “Deviens ce que tu es !” de nietzschéenne mémoire [maxime reprise à Pindare]. Les figures, que Hannah Arendt met en exergue, refusent de choisir l’un ou l’autre des modèles que propose (et impose subrepticement) la modernité. Ils choisissent d’être eux-mêmes, ce qui exige d’eux une forte détermination (Entschlossenheit). Ces hommes et ces femmes restent fidèles à leur option première, une option qu’ils ont librement choisie et déterminée. Mais ils ne tournent pas le dos au monde (le paria !) et n’acceptent pas les carrières dites “normales” (le parvenu !). Ils refusent d’appartenir à une école, à un “isme” (comme Hannah Arendt, par ex., ne se fera jamais “féministe”). En indiquant cette voie, Hannah Arendt reconnaît sa dette envers son maître Heidegger, et l’exprime dans sa laudatio, prononcée pour le 80ème anniversaire du philosophe de la Forêt Noire. Heidegger, dit-elle, n’a jamais eu d’école (à sa dévotion) et n'a jamais été le gourou d’un “isme”. Ce dégagement des meilleurs hors de la cangue des ismes permet de maintenir, en jachère ou sous le boisseau, la “Lumière de la liberté”.
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°42, 1999.
1 : La Tradition cachée : Le juif comme paria, HA, trad. S. Courtine-Denamy, C. Bourgois, 1987 ; rééd. 10/18, 1997.
2 : Rahel Varnhagen : La vie d'une Juive allemande à l'époque du romantisme, HA, trad. H. Plard, Paris, Tierce, 1986 ; rééd. Presses-Pocket, 1994 (Rahel Varnhagen : The Life of a Jewess, 1958).
Courte bibliographie :
- Les Origines du Totalitarisme (1951) suivi de Eichmann à Jérusalem (1963), Gallimard / Quarto, 2002
- La Crise de la culture (1961), trad. P. Lévy (dir.), Gallimard / Folio, 1989 [recension]
- Essai sur la révolution (1963), trad. M. Chrestien, Gallimard / Tel, 1985 [recension]
- Condition de l’homme moderne (1958), trad. G. Fradier, Presses-Pocket, 1988
- Qu’est-ce que la politique ?, trad. S. Courtine-Denamy, Seuil, 1995
- La vie de l’esprit, trad. L. Lotringer, PUF, 2005
- Juger, trad. M. Revault d'Allonnes, Seuil, 2003
-
Les contes de la Crypte
Dans le journal électronique Vexilla Galliae, j'ai lu la énième mise au point sur la légitimité du duc d'Anjou à s'asseoir sur le trône de France, ce qui ne laisse de m'étonner, tant on y revient souvent, à croire que ce n'est pas sûr. C'est un communiqué du prince Sixte-Henri de Bourbon Parme, duc d'Aranjuez, qui a déclenché la bronca de la crypte légitimiste, communiqué dans lequel il disait en quelques mots tout le mal qu'il pensait de la ligné isabélitaine espagnole, d'une totale usurpation par rapport à la loi salique de Bourbon et donc à la lignée carliste qu'il représente. Avant d'aller plus loin, nous convions le lecteur à passer quelques minutes sur deux anciens articles de Royal-Artillerie et un autre sur la généalogie des Bourbons d'Espagne :
- L'énigme Godoy ou le soupçon de régénération du sang de Bourbon
- Le parti de l'Honneur (une lettre de Brasillach sur le carlisme)
- De la paternité dynastique des Bourbons d'Espagne
En réfutation des allégations carlistes et des commentaires œcuméniques de certains (dont le piéton du Roi), deux articles ont été produits récemment sur Vexilla Galliae, l'un du professeur Bouscau qui démontre, s'il en était encore besoin (et il en est apparemment besoin), la parfaite légitimité du prince Louis ; l'autre de l'historien Daniel de Montplaisir apportant son renfort à la même thèse. Par courtoisie, mais aussi parce que nous partageons certains de leurs arguments, nous lions ces deux articles ci-dessous :
- Communiqué du Groupement universitaire pour l'étude des institutions publiques de la Monarchie française
- Mise au point sur le droit royal
Disons-le carrément : il est horripilant de voir capter la monarchie par un royalisme tutélaire hors duquel point de salut. La Cour suprême royaliste proclame le château fièrement dressé pour l'éternité sur ses fondations entourées de douves, et nul ne veut voir que, franchi le rempart, il est complètement ruiné. Le royaume qu'il était succomba trois fois sous le poids de la monarchie d'alors (1789/92 - 1830 - 1848), monarchie qui fut battue par la guerre civile en quatre rois. La dynastie vaincue ne peut même pas invoquer la défaite d'une guerre étrangère envahissant le territoire comme pourrait s'en prévaloir l'histoire napoléonienne. En 1789, la monarchie séculaire s'est effondrée sur elle-même ; rétablie par le Congrès de Vienne (donc par l'étranger) en 1814, cette monarchie rénovée subit le rejet du greffon en 1830 ; et la solution miracle du roi bourgeois anglicisé proche des gens ne fit pas plus longtemps illusion, qui dut détaler comme un péteux en 1848. Se fonder sur de pareils antécédents est très osé, d'aucun camp ! Pense-t-on attirer ainsi l'intérêt de l'Opinion sur une nouvelle offre politique (presque) inédite ? La balle au centre ! On repart à zéro.Le principe monarchique prime le prince. Il n'est plus possible d'en démontrer ses bienfaits sur Royal-Artillerie qui depuis dix ans les rabâche. Mais la monarchie française ne peut être "encagée" par la dernière dynastie régnante, chassée depuis cinq générations (167 ans). Certes, les surgeons de la maison de Bourbon peuvent se régir par les lois fondamentales du royaume de France s'ils le décident ainsi, mais ils ne peuvent pas y être contraints par les "docteurs de la Loi" édictant voies et moyens au nom d'un royaume disparu. A quel titre professeurs et marquis poudrés dicteraient-ils leurs conclusions aux princes pour les imposer lors d'une restauration ? Les ancêtres de nos princes firent les lois qui les arrangeaient. Même s'ils ne sont plus en capacité de légiférer (pas plus que les docteurs d'ailleurs), leurs descendants actuels sont tout aussi libres de réfléchir aux conditions et circonstances d'une accession. Philippe V a importé ses lois en Espagne, ce qui n'était ni nécessaire, ni très rusé (ils avaient les Partidas d'Alfonso el Sabio) mais bon... le tempérament espagnol a renoué plus tard avec ses origines et va sans doute abandonner totalement ce qui reste des lois de Bourbon pour assurer la succession des filles de Felipe VI. Un roi Bourbon revenu chez nous pourrait très bien éditer un corpus doctrinal différent des lois fondamentales qui conviendrait mieux à la situation politique du moment. Un roi non-Bourbon aussi !
Que la monarchie revenue de cette façon déplaise aux thuriféraires de l'Ancien régime n'a que peu d'intérêt pour la suite. Que les déçus repartent d'où ils viennent, dans les livres d'histoire. L'important est le meilleur futur possible de ce magnifique pays mis à l'encan par la loi démocratique de l'envie, et surtout celui des gens qui l'habitent, et certainement pas le confort des émotions royalistes. C'est la monarchie qui nous sauvera et la monarchie est d'abord un principe de gouvernement des hommes avant que d'être un régime successoral.
Nos princes sont libres. Aussi libres que les sujets appelés aujourd'hui citoyens qui cherchent à revenir en monarchie pour les bienfaits et avantages propres à ce régime. Quand Jack Lang admet qu'un roi améliorerait les institutions en sauvant la pointe de pyramide de la dispute démagogique ; quand Jacques Attali déplore que le gouvernement démocratique soit incapable de gérer le temps long et s'épuise à des querelles sans intérêt ; quand Emmanuel Macron met en scène l'absence du père de la Nation à la tête de l'Etat depuis qu'on a coupé notre roi en deux ; quand de plus en plus d'hommes politiques observent le pourrissement quasiment irrémédiable des institutions républicaines gangrenées par les syndicats et le secteur protégé ; on peut s'autoriser à penser que l'option monarchique revient sur la table.Au sein de cette option, Bourbon est une option, au milieu d'autres options dont l'ex-nihilon'est pas la moindre. L'affection que nous portons naturellement à nos princes ne les dispense pas de se préparer sérieusement à la fonction de roi, régent, lieutenant-général, que sais-je, surtout pour ceux d'entre eux qui aspirent à nous gouverner. Il est important que ce souci d'être au-dessus du lot soit partagé publiquement avec les militants et les cotisants. Pure justice. Que le meilleur gagne, mais pour cela il lui faudra passer le rapport supérieur de la boîte à vitesses car aucun de ceux que nous connaissons n'est prêt. Qui avait parlé du Mérovingien caché ? C'est pour finir sur un sourire.
-
Conférence Dextra le vendredi 23 octobre : La jeunesse au pouvoir par Julien Langella
Chers amis, Chers camarades,Nous recevrons vendredi soir, Julien Langella qui viendra nous présenter son livre :"La jeunesse au pouvoir"Ce livre, qui récemment fait beaucoup parler de lui, permet un regard nouveau sur la situation politique française Plus d'infos sur cet ouvrage :http://www.leseditionsdurubicon.com/nos-ouvrages.htmlNous vous attendons nombreux vendredi, n'hésitez pas inviter vos amis !