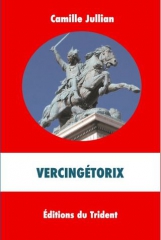 Pour tous les peuples la reconquête de la liberté commence par un éveil de la mémoire. À l'inverse, la destruction volontaire de celle-ci équivaut à un projet fort clair. La liquidation de l'identité des nations.
Pour tous les peuples la reconquête de la liberté commence par un éveil de la mémoire. À l'inverse, la destruction volontaire de celle-ci équivaut à un projet fort clair. La liquidation de l'identité des nations.
L'ex-compagnon de Valérie Trierweiler persiste à nuire, par ses fausses réformes comme par ses vraies reculades. Cela durera jusqu'en 2017 et, s'il est réélu, au-delà.
Cette triste évidence reçoit ces temps-ci une confirmation supplémentaire par la faute d'une soi-disant ministre de l'Éducation. Mme Vallaud-Belkacem, nullité notoire, de l'aveu même de Ségolène Royal qui l'employa naguère, peut se montrer agressive à ses heures sous un masque doucereux. On vient ainsi d'apprendre par ce personnage que, désormais les "candidats professeurs seront évalués sur les valeurs de la République." Cette évidente menace pour la liberté d'opinion n'est énoncée d'ailleurs qu'incidemment, tel un simple dommage collatéral accompagnant la refonte des programmes scolaires. Cette opération d'ensemble est destinée à abaisser encore les enseignements du latin, du grec, de l'allemand ou de l'histoire. De telles matières sont jugées par les fous pédagogistes trop élitistes, trop identitaires, et, sans doute, au dire des cancres, trop difficiles.
Trop ardu se révélerait aussi l'apprentissage essentiel de notre langue dans les classes primaires.
La langue française, trop subtile, viendra bientôt rejoindre celles qui représentent ses racines, au cimetière des langues mortes.
Que cela puisse échouer, on doit, bien entendu, le souhaiter et tout faire pour en enrayer le processus mortifère.
Mais même si les protestations, qui se multiplient, devaient aboutir à une reculade, la seule tentative qu'elle développe suffit en elle-même à nous éclairer sur ce qui se prépare. La ministre actuelle ne fait office que de porte-parole de la bureaucratie scolaire. Si, donc, elle-même se trouvait déplacée lors d'un remaniement prochain les nuisances demeureraient intactes au sein des ateliers administratifs de la démolition culturelle.
Remontons donc plus haut.
L'Europe est entrée dans une phase accélérée d'autodestruction.
Ainsi, au sujet de la vague croissante d’arrivées par la Méditerranée de migrants non voulus, un récent affrontement a opposé Mme Theresa May, ministre de l'Intérieur britannique à Mme Federica Mogherini. Celle-ci théorise le plan d’action de la Commission [anti] européenne. Dans le Times du 13 mai, son interlocutrice s'exprimait au nom du gouvernement conservateur vainqueur des élections en Grande-Bretagne.
À un tel titre, Mme May réaffirmait l'évidente nécessité pour son pays de pouvoir les renvoyer chez eux. La politicienne italienne du "parti démocrate", – transmutation "politiquement correcte" du vieux parti communiste, – ose, au contraire, formuler le principe selon lequel "pas un seul réfugié ou migrant intercepté en mer ne sera renvoyé contre son gré".
Ce personnage, hélas, est entré en fonction le 1er novembre 2014 en tant que "haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité."
Tant que son influence pourra ainsi s'exprimer les gentils organisateurs du processus en cours peuvent persister dans leur odieux trafic.
Or, si la suite des siècles, sur tous les continents, a vu les assauts successifs des invasions étrangères, toutes ne se sont pas montrées positives, loin de là. Puisque l'on prétend nous inculquer de force ces "valeurs de la république", jamais sérieusement définies, qu'on se contente de relire les paroles de la Marseillaise, hymne national selon l'article 2 de la Constitution. "Quoi ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers…" s'interroge et s'indigne son rédacteur qui s'exclame "Liberté liberté chérie combats avec tes défenseurs".
Si l'Histoire, en effet, peut s'écrire comme une suite de développement des empires, si certains ont joué un rôle civilisateur, tel bien sûr celui de Rome (1)⇓, la lutte légitime contre l'envahisseur, quel qu'il soit, fait elle aussi partie des principes de santé.
Le jeune chef arverne n'était pas confronté à François Hollande mais au plus grand conquérant de tous les temps en la personne de Jules César : celui-ci ne rencontra pas d'adversaire plus coriace.
Héros fondateur de l'Histoire de France, Vercingétorix (2)⇓ne luttait pas contre une Union européenne branlante mais contre un Empire romain en pleine expansion. Du reste les Gaulois, vaincus, allaient y prendre toute leur place et partager pendant cinq siècles les destinées de Rome.
Vercingétorix réussit un exploit : celui d'unifier les tribus divisées, et diverses, de la Gaule indépendante. (3)⇓ Il sut mener une guerre très dure et son souvenir est demeuré constitutif de la conscience nationale. N'acceptons pas son effacement.
JG Malliarakis
"Une passion pour la Gaule"
- cf. "La Gaule dans l'empire romain" par Camille Jullian⇑
- cf. "Vercingétorix" par Camille Jullian⇑
- cf. "La Gaule avant César" par Camille Jullian ⇑
- http://www.insolent.fr/
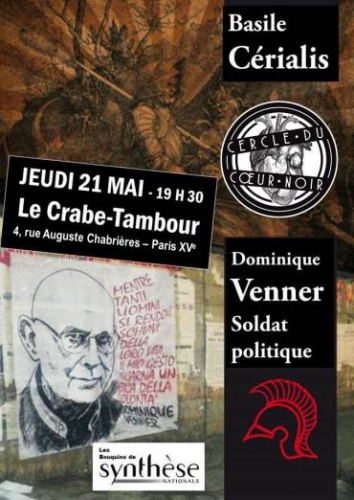
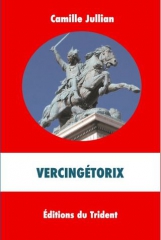 Pour tous les peuples la reconquête de la liberté commence par un éveil de la mémoire. À l'inverse, la destruction volontaire de celle-ci équivaut à un projet fort clair. La liquidation de l'identité des nations.
Pour tous les peuples la reconquête de la liberté commence par un éveil de la mémoire. À l'inverse, la destruction volontaire de celle-ci équivaut à un projet fort clair. La liquidation de l'identité des nations.