Au détour d’un des tomes paru en 1979 de son Livre des armes, Dominique Venner soulignait « la signification rituelle » de l’arme chez Henry de Montherlant. L‘auteur du Solstice de Juin qu’il admirait tant, qui célébrait le suicide comme un vieux Romain et »qui se donnera la mort avec un pistolet ». Il relevait aussi »les confidences d’une autre écrivain mort tragiquement, Pierre Drieu La Rochelle: Je voulais être un homme complet, non pas seulement un rat de cabinet, mais aussi un homme d’épée , qui prend des responsabilités, qui reçoit des coups ». Dominique Venner a été tout cela. Figure emblématique de la mouvance nationale et nationaliste, l’écrivain, historien, essayiste, âgé de 78 ans, s’est donné la mort hier à l’aide d’un pistolet devant l’autel de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un suicide à teneur hautement symbolique, en un lieu sacré qui incarne toute une part du génie et de la spiritualité de notre civilisation européenne. C’est sous le signe de la défense de celle-ci, de notre identité, que Dominique Venner s’engagea en politique et dans le combat des idées jusqu’à son dernier souffle. Nous adressons à sa famille, ses proches, sa femme, ses enfants, nos très sincères condoléances.
Membre fondateur du mouvement Jeune Nation avec Pierre Sidos, Dominique Venner sera embastillé après son service militaire en Algérie pour son activisme au sein de l’OAS. A sa sortie de prison, il fonde en 1963 le mouvement Europe-Action et surtout s’oriente vers la rédaction de textes doctrinaux – Pour une critique positive, Qu’est-ce que le nationalisme ?- pour réarmer intellectuellement, donner des outils à l’opposition nationaliste au Système.
Approché un temps pour prendre la tête du Front National lors de sa création en 1972, il choisira le combat métapolitique et jouera un rôle influent dans la mouvance dite de la « Nouvelle droite« . Ses livres d’histoire et ses essais érudits, d’un style sobre et vigoureux, feront autorité.
Ses ouvrages sur les corps-Francs (Baltikum), la guerre de sécession, son Histoire de l’Armée rouge (prix d’histoire de l‘Académie française en 1981), son superbe récit autobiographique (Le coeur rebelle), son admirable travail au sein de la très belle publication qu’il dirigeait depuis des décennies -Enquête sur l’histoire, devenue en 2002 La Nouvelle Revue d’Histoire- en feront un auteur très lu au sein de la famille de pensée dans laquelle il évoluait, et même bien au delà.
Sa passion pour les armes et notamment pour l’art cynégétique (il y consacrera de très nombreux ouvrages) lui ouvrit aussi d’autres portes. C’est d’ailleurs son amitié avec l’ex résistant François de Grossouvre, ami et conseiller de François Mitterrand, président du Comité des chasses présidentielles jusqu’à son suicide présumé le 7 avril 1994 dans son bureau de l’Elysée,qui fut la genèse de sa magistrale « Histoire critique de la Résistance »..
Il y démontrait que loin des mythes propagées par la gauche socialo-communiste, ladite Résistance fut surtout et principalement structurée par des hommes et de femmes issus des courants du nationalisme français.
Alors, comment expliquer la fin tragique de Dominique Venner qui avait subi il y a quelques années les assauts d’une longue maladie? Marine Le Pen y a vu comme beaucoup un « dernier geste, éminemment politique » pour » tenter de réveiller le peuple de France« , même s »Il n’en demeure pas moins que c’est dans la vie et l’espérance que la France se redressera et se sauvera. »
L’historien Bernard Lugan qui co-animait avec lui Le libre journal des historiens sur Radio Courtoisie a lu à l’antenne hier une lettre que D. Venner a laissé à ses amis:
« Je me sens le devoir d’agir tant que j’en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. Je choisis un lieu hautement symbolique (…) que je respecte et j’admire. Mon geste incarne une éthique de la volonté. Je me donne la mort pour réveiller les consciences assoupies. Alors que je défends l’identité de tous les peuples chez eux, je m’insurge contre le crime visant au remplacement de nos populations. »
Très engagé dernièrement dans le combat pour la défense de la famille traditionnelle et contre le mariage et l’adoption par les couples homosexuels, il écrivait dans le dernier texte mis en ligne sur son blog hier que « les manifestants du 26 mai auront raison de crier leur impatience et leur colère. Une loi infâme, une fois votée, peut toujours être abrogée.«
Il rappelait qu’à part » le FN », « depuis 40 ans, les politiciens et gouvernements de tous les partis , ainsi que le patronat et l’Église, ont travaillé activement à la disparition de notre identité », « en accélérant par tous les moyens l’immigration afro-maghrébine ». « Les manifestants du 26 mai ne peuvent ignorer cette réalité. Leur combat ne peut se limiter au refus du mariage gay. »
« Il ne suffira pas d’organiser de gentilles manifestations de rue pour l’empêcher. C’est à une véritable réforme intellectuelle et morale, comme disait Renan, qu’il faudrait d’abord procéder. Elle devrait permettre une reconquête de la mémoire identitaire française et européenne, dont le besoin n’est pas encore nettement perçu. »
« Il faudra certainement des geste nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences, secouer les consciences anesthésiées et réveiller la mémoire de nos origines. Nous entrons dans un temps où les paroles doivent être authentifiées par des actes. »
Geste spectaculaire et symbolique, Bruno Gollnisch interrogé sur BFM-TV-, a analysé ce suicide comme « une protestation contre la décadence de notre société ». « C’est un témoignage de désespoir, c’était certainement un homme d’honneur et qui a vécu la situation actuelle très mal. »
Bruno a regretté, par ailleurs, que cet « intellectuel extrêmement brillant » n’ait « pratiquement jamais été invité dans les débats historiques et politiques où il aurait tout à fait eu sa place ». Directeur d’une revue historique «parfois politiquement incorrecte», il s’est peut-être «inspiré de Montherlant, de Drieu La Rochelle, de l’écrivain japonais Mishima, qui s’est suicidé aussi». «Il admirait beaucoup les samouraïs, il admirait les chevaliers, c’était un peu un chevalier des temps modernes, hérissé contre la décadence de notre civilisation».
Son éditeur Pierre-Guillaume de Roux -fils de Dominique de Roux- a constaté lui aussi que ce suicide revêtait «une puissance symbolique extrêmement forte qui le rapproche de Mishima», nationaliste, défenseur du Japon traditionnel et de l’Empereur , contempteur du monde moderne américanisé et décadent.
Sur le site de l‘Express, le journaliste Tugdual Denis n’a rien compris au geste de Venner lorsqu’il y voit celui d’un « païen, en proie à un combat obsessionnel envers le christianisme. Dans la religion catholique, le suicide est un pêché mortel; dans la religion des combattants fous, un acte d’héroïsme. »
Certes, Dominique Venner, nous l’avions relevé sur ce blog , regrettait comme d’autres, et notamment comme beaucoup de parfaits catholiques, que « l’Église n’a jamais engagé son influence toujours grande dans le rejet de l’immigration de peuplement extra-européenne ».
Il savait aussi que cette politique de substitution de population est surtout le fruit d’une odieuse volonté politique: « adoptant le métissage comme horizon, la plupart des pays d’Europe occidentale ont favorisé les flots migratoires en provenance de l’Orient ou de l’Afrique. Au regard de nouvelles lois, par un complet renversement de la morale vitale, le coupable cessa d’être celui qui détruisait son peuple, pour devenir celui qui, au contraire, œuvrait pour sa préservation. »
Le spécialiste anti FN du Front de Gauche, Alexis Corbière n’a lui aussi rien compris pour le coup à ce qu’est le Front National -ou fait semblant de ne pas comprendre- lorsqu’il s’étonne de l’hommage rendu par Jean-Marie Le Pen, Bruno, Julien Rochedy (FNJ) ou encore Marine à un »ex de l’OAS » comme Venner , alors que Florian Philippot saluait la mémoire de De Gaulle il y a quelques semaines.
Mouvement de rassemblement, de réconciliation nationale, le FN a toujours accueilli dans ses rangs des hommes et des femmes venus de tous les horizons politiques, qui de bonne foi, et par delà les militantismes ou les votes passés , s’engagent ici et maintenant autour du plus grand dénominateur commun: la défense de la patrie, de notre identité, de nos valeurs, la survie de la France française.
Cela est n’est pas plus incohérent que la salade de courants qui traversent le PS, de clubs rivaux qui phagocytent l’UMP ou que de voir cohabiter au sein du Front de Gauche communistes orthodoxes, écolo-gauchistes et trotskystes francs-maçons…
Frigide Barjot n’a elle aussi pas compris grand chose à ce geste de D. Venner, et surtout à ce qui est en train de se passer dans la société française, et dont le succès des manifs pour tous est un révélateur parmi d’autres.
Sur RTL , mélangeant un peu tout, elle a affirmé que « La manif pour tous est un mouvement de paix, un mouvement d’accueil et un mouvement tourné au contraire vers la vie. Je suis très attristée que les gens (l’aient) aussi mal compris, mais (le) parcours d’extrême droite (de D. Venner, NDLR) (n’)était effectivement pas tout à fait dans la compréhension de l’évolution de la société. »
Mme Barjot ne se bat donc pas contre l’évolution de la société -imposée par le Système- quand elle s’oppose au « mariage pour tous »? Et pense-t-elle que les foules, très majoritairement »blanches et catholiques » qui défilent depuis cet automne contre la loi Taubira, sont plus favorables à l’immigration de peuplement que les ouvriers (largement) déchristianisés victimes du mondialisme?
A la vérité, comme nous le confiait un ami normand de longue date de Dominique Venner, Gilles D., « ils seront nombreux les braves gens, ce dimanche 26 mai, à marcher dans les rues de Paris, en pensant à son sacrifice et à sa résonance, voire au combat de toute une vie mené par Venner contre la décadence. Quelque part, on peut dire que pour l’accompagner par l’esprit dans sa dernière demeure, Dominique aura une foule aussi importante que celle qui a accompagné Victor Hugo dans la sienne!«
Dominique Venner faisait le constat selon lequel notre civilisation est la seule dont les crimes et les fautes ne furent jamais le fruit de ses principes, mais la conséquence de leur trahison.
Ainsi, dans Histoire et tradition des Européens » (2002) , livre que les jeunes générations frontistes se font (se feront) un devoir de lire, Venner posait parfaitement l’enjeu essentiel du combat intellectuel: « Qu’ils le sachent ou non, les hommes sont dépendants de leurs représentations, de leurs idées même incertaines, mêmes inconscientes. »
« Aussi n’est-il pas faux de prétendre que les idées mènent le monde, quelle que soit la cause de leur formation. En dépit des apparences, les actions humaines ne sont pas déterminées par l’utilitaire mais par de systèmes de valeurs en conflit. Et toujours se posera l’obligation de gagner la bataille des idées ou d’être terrassé dans sa substance même. » Tout est dit.
http://www.gollnisch.com
![]() « Je suis sain de corps et d’esprit, et suis comblé d’amour par ma femme et mes enfants. J’aime la vie et n’attend rien au-delà, sinon la perpétuation de ma race et de mon esprit. Pourtant, au soir de cette vie, devant des périls immenses pour ma patrie française et européenne, je me sens le devoir d’agir tant que j’en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. J’offre ce qui me reste de vie dans une intention de protestation et de fondation. Je choisis un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre Dame de Paris que je respecte et admire, elle qui fut édifiée par le génie de mes aïeux sur des lieux de cultes plus anciens, rappelant nos origines immémoriales.
« Je suis sain de corps et d’esprit, et suis comblé d’amour par ma femme et mes enfants. J’aime la vie et n’attend rien au-delà, sinon la perpétuation de ma race et de mon esprit. Pourtant, au soir de cette vie, devant des périls immenses pour ma patrie française et européenne, je me sens le devoir d’agir tant que j’en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. J’offre ce qui me reste de vie dans une intention de protestation et de fondation. Je choisis un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre Dame de Paris que je respecte et admire, elle qui fut édifiée par le génie de mes aïeux sur des lieux de cultes plus anciens, rappelant nos origines immémoriales.
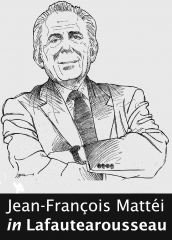 La littérature est décidément prémonitoire. Dans Le Père Goriot, Balzac décrit une pension parisienne, rue Neuve-Sainte-Geneviève, avec son allée bordée de lauriers roses. On y pénètre par une porte surmontée d’un écriteau sur lequel on lit : MAISON-VAUQUER, et dessous : Pension bourgeoise des deux sexes et autres.
La littérature est décidément prémonitoire. Dans Le Père Goriot, Balzac décrit une pension parisienne, rue Neuve-Sainte-Geneviève, avec son allée bordée de lauriers roses. On y pénètre par une porte surmontée d’un écriteau sur lequel on lit : MAISON-VAUQUER, et dessous : Pension bourgeoise des deux sexes et autres.
