La guerre du Vietnam et l'intervention des troupes états-uniennes du côté du Sud-Vietnam pro-occidental déclenchent dès 1965 un vent de contestation aux États-Unis mêmes, vent qui souffle bientôt en tempête sur tous les pays du « camp capitaliste » et particulièrement sur les campus, désormais de plus en plus vastes et ouverts aux nouvelles classes montantes des sociétés démocratiques. Le mouvement étudiant SDS (Students for a Democratic Society), à l'origine de la première manifestation américaine contre la politique interventionniste des États-Unis au Vietnam, fait partie de cette nouvelle gauche radicale très portée sur la « théorisation » et capable de fournir à ses militants un instrument dialectique efficace. Sans doute parce que la jeunesse a besoin de certitudes plus encore que de réalités et de nuances, elle est moins attirée par une Eglise qui doute que par des chapelles qui affirment... Et les groupuscules marxistes-léninistes, trotskistes et maoïstes, profitent de la réprobation d'une grande partie de l'opinion publique en Europe de l'Ouest (et même du général de Gaulle dont le discours de Phnom-Penh retentit encore douloureusement aux oreilles de l'administration états-unienne...) pour recruter et former des cadres, en Allemagne, en Italie et bien sûr en France, que « l'oncle Ho » connaît bien...
A Paris, les groupes d'extrême-gauche, même s'ils ne comptent pas beaucoup de membres actifs, font bien du bruit et savent se faire une large publicité par des « opérations » (manifs, chahuts, éventuellement bagarres) qu'ils font « mousser », comme savaient le faire jadis les Camelots du Roi, « première bande révolutionnaire d'Europe » selon un observateur d'avant 1914 : tout est utilisé, et la guerre du Vietnam est une véritable aubaine. Autour de ce thème, ils cristallisent tous les mécontentements d'une jeunesse mal à l'aise dans une société de consommation dont le confort ne remplace pas encore le « supplément d'âme » indispensable aux jeunes, cet idéalisme un peu romantique qui fait parler de la jeunesse comme d'une folie passagère, d'une passion incontrôlable...
Dans les rues de Paris apparaissent des vendeurs du Courrier du Vietnam et d'autres publications pro-Vietcong, et à partir de 1966-67, les accrochages entre militants d'AF et communistes, qu'ils soient « orthodoxes » ou « révolutionnaires », redeviennent monnaie courante, l'AF dénonçant les atrocités commises par le Nord-Vietnam d'Ho Chi Minh. Désormais la guerre qui embrase le Sud-est asiatique semble, au moins pour un temps, devenir le point de référence (et de fixation) des militants politiques, comme le souligne Ludivine Bantigny dans son récent « 1968. De grands soirs en petits matins » : « La guerre du Vietnam obsède et nourrit la colère, en France aussi », ce que, dès décembre 1967, AF-Université (le mensuel des étudiants monarchistes d'AF) traduit par une couverture représentant un soldat vietnamien brandissant une kalachnikov sur fond de carte parisienne, avec ce titre explicite : « Les obsédés du Vietnam » qui pourrait avoir inspiré la phrase de Mme Bantigny. Ce thème semble ainsi investir totalement le champ politique étudiant, et même au-delà (mais de façon moindre) : tout le monde doit prendre position.
Pour l'AF, le choix est clair : la lutte anticommuniste reste une priorité. Les premières prises de position du mouvement, ou plutôt de l'hebdomadaire Aspects de la France, ne semblent pas très originales : « (…) A cause de l'importance grandissante du conflit vietnamien, les Français se tournent à nouveau vers l'Asie du Sud-Est, ou plutôt les journaux leur disent de s'intéresser à la guerre qui s'y déroule. (…)
Ainsi nous assistons à un viol des consciences, ainsi nous voyons par aveuglement ou par opportunisme des hommes rendre peu à peu la subversion sympathique à ceux qui de façon naturelle devraient la détester. Ceux qui se servent du feu sauront-ils le maîtriser ? (…)
Saluons les soldats qui contiennent la marée rouge au Vietnam pour qu'elle ne vienne pas un jour battre à leur porte – et à la nôtre. » (1). N'est-ce pas aussi pour l'AF un moyen de montrer son antigaullisme traditionnel quand le général de Gaulle, en 1966, a dénoncé les bombardements américains au Vietnam dans son discours de Phnom Penh ? Si bien que les royalistes maurrassiens s'unissent à d'autres nationalistes pour « faire le coup de poing » contre les meetings « Paix au Vietnam » organisée par la gauche marxiste : c'est le cas à Toulouse le 6 février 1967, ou à Aix-en-Provence, où les militants d'AF sont l'épine dorsale d'un « Front Universitaire anti-communiste » dont le seul but semble être de gêner la propagande marxiste.

A Rennes, les étudiants royalistes participent à cette campagne en dénonçant l'hypocrisie de la presse de gauche, et en insistant sur l'absence d'équilibre quant aux informations distillées par la grande presse et les journalistes considérés comme trop souvent tendancieux : « On se scandalise des ponts détruits, de la vie « sous les bombes », de l'escalade américaine, mais la position du « couteau sous la gorge » n'est pas plus confortable. QUI a eu le courage de dénoncer, durant les années passées, la véritable, l'horrible escalade des gorges tranchées, des seins coupées, des membres écartelés, des moissons ravagées, des enterrés vivants et des brûlés vifs par les terroristes Vietcongs ? ».
Dans les universités, les lycées ou sur les marchés, militants d'AF et vendeurs du Courrier du Vietnams'affrontent donc régulièrement, ce que relatent les rubriques d'activités des sections publiées dans A.F.U. durant toute l'année scolaire 1967-68, mais Patrice Sicard (l'une des jeunes plumes les plus prometteuses de la nouvelle génération royaliste des années 60) qui observe avec attention l'agitation pro-vietnamienne devenue le véritable point de repère et base du recrutement de l'extrême-gauche, va plus loin dans l'analyse du phénomène, en dépassant la simple lecture politique ou « partisane » : « (…) Le Vietnam devient un traumatisme à symptômes obsessionnels (…).
L'engagement « pour le Vietnam » représente chez le lycéen ou l'étudiant français une démarche d'ordre pathologique. Le 17ème parallèle représente d'abord une autre chose, négation radicale du milieu (familial, local, national, confessionnel), où s'est déroulé l'enfance : l'hystérie pro-FNL peut donc servir d'exutoire à un effort d'affranchissement individualiste, ou pulsion sociale. (…)
Ce défoulement se double d'une persistance manichéenne héritée de la petite enfance : les « gentils » et les « méchants » sont maquillés en Vietcong et Marines. Il s'agit d'une crispation inconsciente sur une explication sommaire du monde (…). C'est une traduction post-marxiste du schéma hitlérien, à ceci près que le Mal au lieu d'être juif, latin ou bolchevique, devient occidental. » (2). Déjà, il discerne les vraies causes de ce que sera Mai 68 et les motivations profondes des manifestants et émeutiers.
De plus, il revient, au lendemain du mois de Mai, sur l'importance des « Comités Vietnam », sur le rôle de ceux-ci et sur la stratégie à adopter à leur égard : « Nous dénonçons depuis quatorze mois les « Comités Vietnam » comme les pilotis d'une nouvelle organisation révolutionnaire dans la jeunesse, distincte du communisme classique et proche de l'Union Nationale des Etudiants de France. Les C.V.N. prenaient prétexte du conflit vietnamien pour créer dans les lycées et les facultés un bouillon de culture favorable au drapeau rouge ; il fallait donc éviter de leur répondre en jouant la carte « Sud-Vietnam », il fallait briser leur schéma de propagande. » (3). En prônant le nationalisme français plutôt que « l'occidentalisme » de l'extrême-droite « madelinienne » (du nom d'Alain Madelin, qui deviendra par la suite le chantre d'un libéralisme décomplexé, et qui était alors l'un des dirigeants emblématiques du mouvement Occident, dont le symbole était la croix celtique), l'Action Française cherche à éviter d'être en « contre-dépendance » de l'extrême-gauche sur un thème que cette dernière maîtrise bien et sur lequel elle veut amener ses adversaires pour mieux se valoriser elle-même. Mais l'AF parvient-elle toujours à contourner ce piège ? Là aussi, la politique de la « ligne de crête » est délicate et parfois incomprise, y compris au sein des militants et sympathisants de l'AF...
Mais, ce qui a servi de thème porteur pour nombre de groupes d'extrême-gauche et qui les a nourri depuis de longs mois, n'est pas, pour autant, le déclencheur ni même l'accélérateur de Mai 68... A moins que la question des résidences universitaires et de leur mixité ne soit rien d'autre que l'application de la stratégie « Créer partout des petits Vietnam » ? En fait, et Sicard semble l'avoir bien compris, « la vérité est ailleurs »...
(à suivre : La question étudiante vue par l'Action Française à la veille de Mai 68)
Notes : (1) : Gérard Baudin, dans AFU, février 1967, numéro 120.
(2) : Patrice Sicard, dans Aspects de la France, 22 février 1968, numéro 1013.
(3) : Patrice Sicard, dans AFU, juin 1968, numéro 135.
http://nouvelle-chouannerie.com/


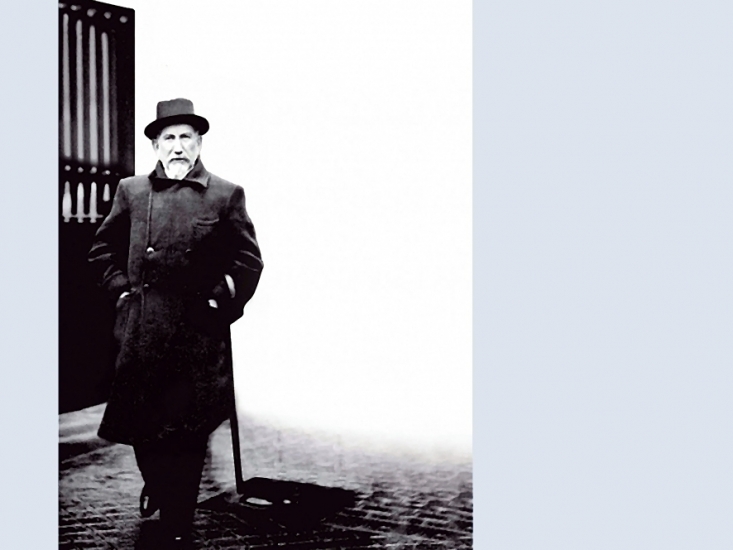
 Il s'agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n'y sommes plus ; si notre sol nous appartient ou si nous allons perdre avec lui notre fer, notre houille et notre pain ; si, avec les champs et la mer, les canaux et les fleuves, nous allons aliéner les habitations de nos pères, depuis le monument où se glorifie la Cité jusqu'aux humbles maisons de nos particuliers. Devant un cas de cette taille, il est ridicule de demander si la France renoncera aux traditions hospitalières d'un grand peuple civilisé. Avant d'hospitaliser, il faut être. Avant de rendre hommage aux supériorités littéraires ou scientifiques étrangères, il faut avoir gardé la qualité de nation française. Or il est parfaitement clair que nous n'existerons bientôt plus si nous continuons d'aller de ce train. (…)
Il s'agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n'y sommes plus ; si notre sol nous appartient ou si nous allons perdre avec lui notre fer, notre houille et notre pain ; si, avec les champs et la mer, les canaux et les fleuves, nous allons aliéner les habitations de nos pères, depuis le monument où se glorifie la Cité jusqu'aux humbles maisons de nos particuliers. Devant un cas de cette taille, il est ridicule de demander si la France renoncera aux traditions hospitalières d'un grand peuple civilisé. Avant d'hospitaliser, il faut être. Avant de rendre hommage aux supériorités littéraires ou scientifiques étrangères, il faut avoir gardé la qualité de nation française. Or il est parfaitement clair que nous n'existerons bientôt plus si nous continuons d'aller de ce train. (…)
