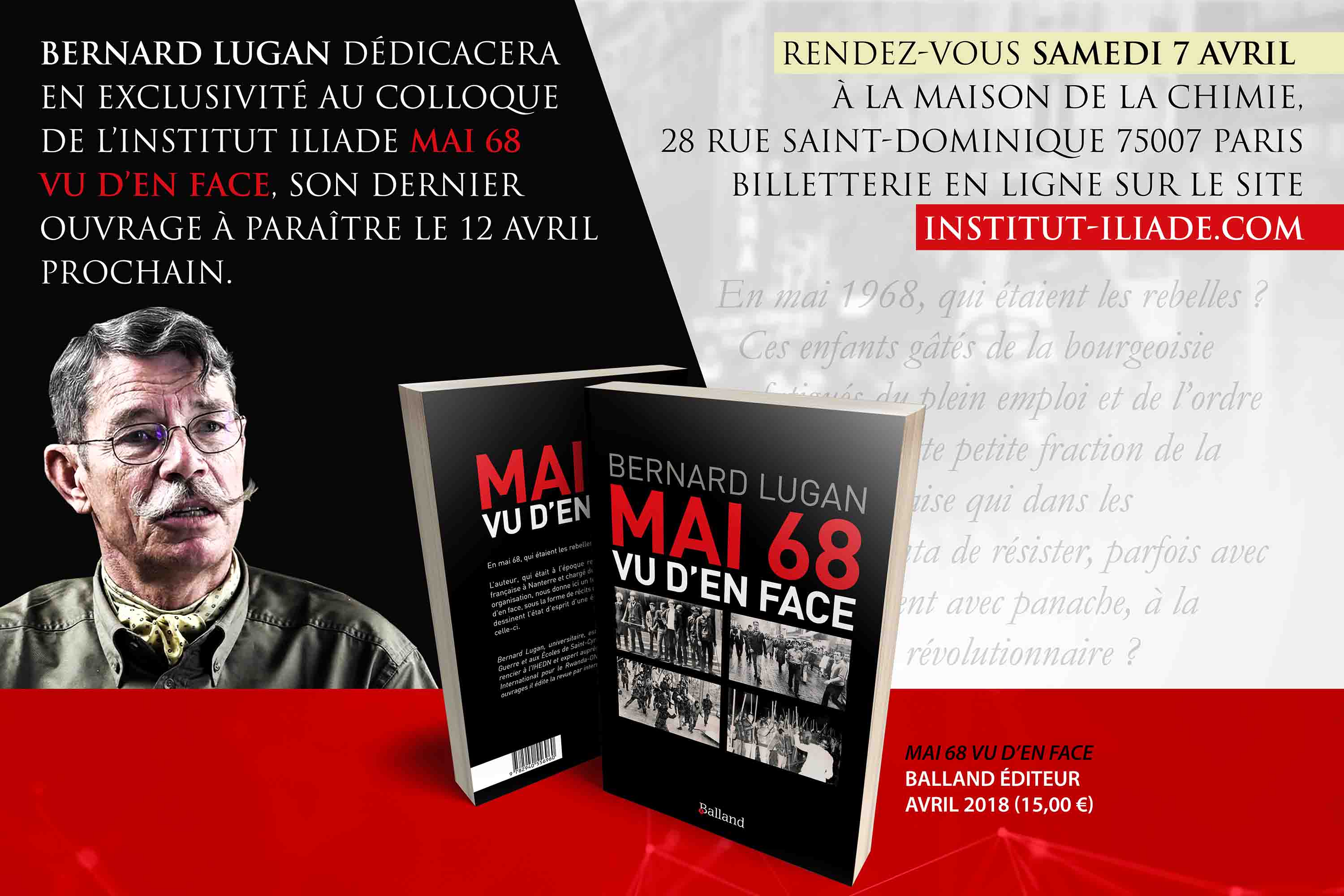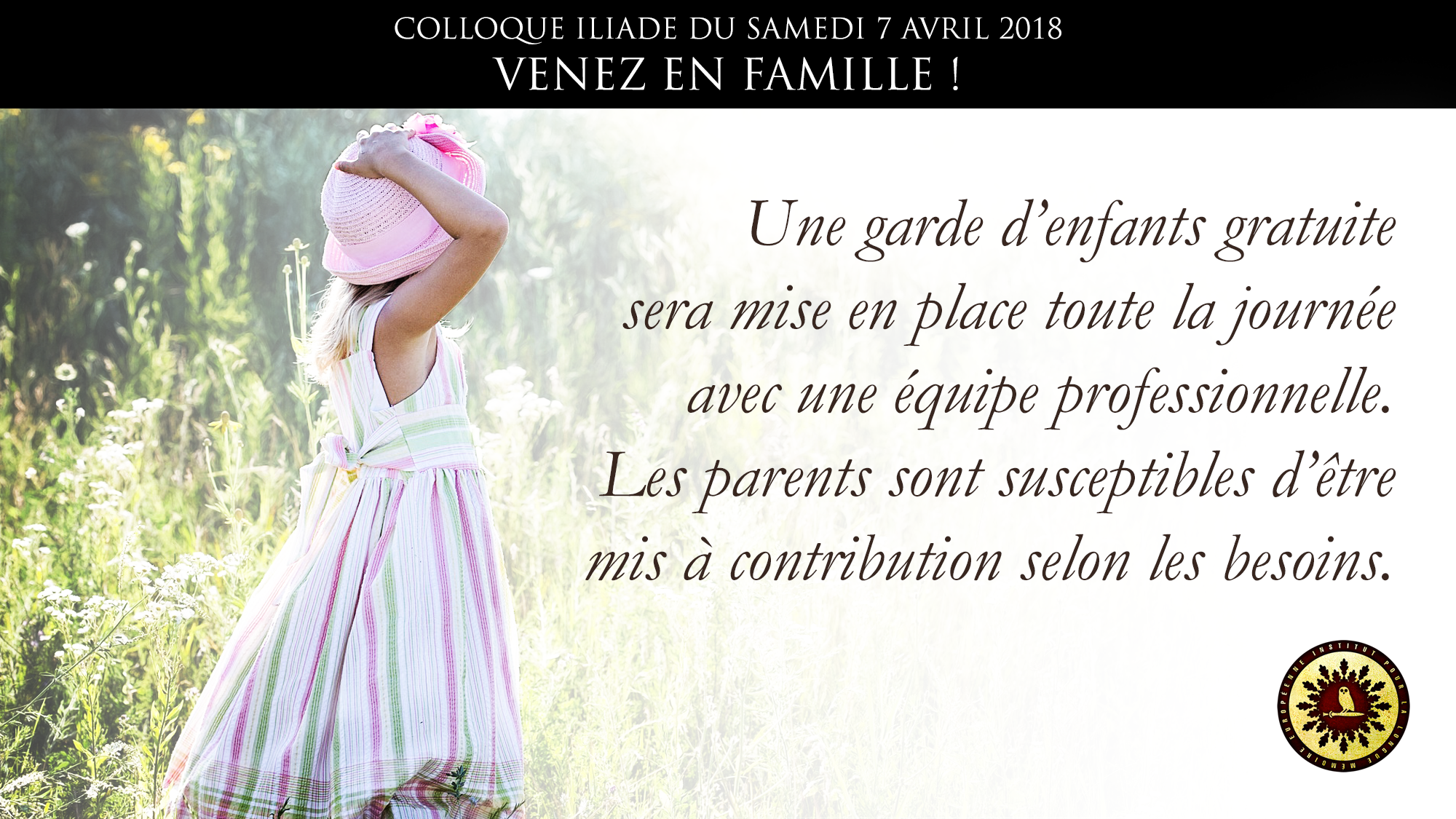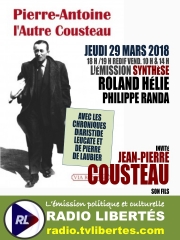En 2014, les éditions Le Cercle publient Le Minotaure planétaire. L‘ogre américain, la désunion européenne et le chaos mondial, de Yanis Varoufakis, un professeur d’économie gréco-australien qui a participé à la rédaction de la partie économique du programme de Georges Papandréou, futur Premier ministre socialiste grec entre 2009 et 2011. L’auteur ne sait pas encore qu’il rencontrera souvent ce Minotaure au cours de ses 162 jours de ministre grec des Finances.
Yanis Varoufakis raconte dans Conversation entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe cette brève expérience ministérielle et les négociations âpres avec l’Eurogroupe, la Banque centrale européenne (BCE), le Fonds monétaire international (FMI), la Commission européenne et ses homologues, en particulier avec le plus puissant d’entre eux, l’Allemand Wolfgang Schäuble, qui en découlent. Il offre ainsi un témoignage de première main sur les mécanismes de ce qu’on croit être l’« eurocratie ». On reste cependant confondu devant sa naïveté et son absence de sens politique. L’« Homme de connaissance » se mue rarement en « Homme de puissance »…

Extérieur à Syriza dont il désapprouve publiquement le projet économique et affligé par l’alliance scellée avec les souverainistes des Grecs indépendants, Yanis Varoufakis se revendique libéral-démocrate, progressiste, pro-européen et humaniste. C’est par amitié pour Alexis Tsipras et par devoir envers ses compatriotes pressurés et appauvris qu’il accepte cette mission impossible : renégocier la dette de la Grèce. Il croit bénéficier de l’appui total du jeune et nouveau Premier ministre de gauche radicale. Or, dès son entrée en fonction, il apprend que son ministère dépend d’un ministère de l’Économie dont le titulaire n’est autre que le vice-Premier ministre, très lié à certains milieux bancaires. On lui impose ensuite un directeur de cabinet, véritable œil du parti à ses côtés. Varoufakis reconnaît volontiers « avoir été aveugle à une réalité aussi dure et déplaisante (p. 302) ».
En Grèce néo-colonisée
Son livre est poignant quand il mentionne les souffrances endurées par l’héroïque peuple grec. Celles-ci résultent des recommandations de la troïka (la BCE, le FMI et la Commission européenne). Cette officine guère respectable s’indigne de la diminution du traitement des haut-fonctionnaires grecs qui la servent, mais exige la suppression immédiate des aides financières aux plus défavorisés, la réduction du montant des pension des retraités, la hausse des taxes et le paiement immédiat des impôts par des entreprises exsangues. Les versements consentis à la Grèce en font selon l’expression de l’auteur un « Renflouistan » ! Il s’agit en réalité d’une « économie de la canonnière ».
Yanis Varoufakis dénonce l’indéniable processus de colonisation 2.0 de son pays par l’engeance financière cosmopolite. Par exemple, « l’administration fiscale grecque est un des exemples les plus sidérants de régime néocolonial des temps modernes (p. 172) ». En pratique, « le directeur de l’administration [fiscale et douanière] devait désormais être approuvé par la troïka et ne pouvait être renvoyé sans son approbation (p. 57) ». Pis, « certains départements des ministères-gruyères envoyaient d’abord leurs données et leurs documents à la troïka, qui les approuvait, et seulement ensuite à leur ministre. Comme si ce n’était pas assez, la troïka exigeait le droit d’envoyer des émissaires à Athènes, lesquels se rendaient dans les mêmes ministères et rassemblaient des données qu’ils triaient et vérifiaient avant que nous ne les ayons vues (pp. 307 – 308) ». Après juillet 2015, toutes les lois votées par la Vouli, le Parlement monocaméral, devront être en préalable approuvées par la troïka.
Certes, « l’insuffisance du développement, la mauvaise gestion et la corruption endémique de la Grèce expliquent sa fragilité économique permanente (p. 32) ». Il est possible d’y remédier alors que « son insolvabilité, plus récente, est due aux défauts de fabrication fondamentaux de l’Union européenne et de son union monétaire, autrement dit l’euro. À l’origine, l’Union européenne était un cartel de grandes entreprises conçu pour limiter la concurrence entre les principales industries lourdes d’Europe et s’assurer des marchés dans les pays périphériques – l’Italie et, plus tard, la Grèce. Les déficits de pays comme la Grèce étaient le reflet des excédents de pays tels que l’Allemagne. Tant que la drachme était sous-évaluée, les déficits étaient maîtrisés. Mais le jour où la drachme a été remplacée par l’euro, les prêts des banques françaises et allemandes ont envoyé les déficits grecs dans la stratosphère (p. 33) ». Yanis Varoufakis explique qu’avec les difficultés hellènes, « l’austérité révèle sa vraie nature : une politique économique de l’échec fondée sur un moralisme immoral (p. 51) » parce que le renflouement de la Grèce organisé sous la présidence de Sarközy « faisait reposer le plus gros du sauvetage des banques françaises et allemandes sur les contribuables de nations plus pauvres que la Grèce, par exemple la Slovaquie et le Portugal. Ces contribuables-là, de même que ceux de pays co-fondateurs du FMI comme le Brésil et l’Indonésie, seraient contraints, à leur insu, de virer de l’argent aux banques de Paris et de Francfort (pp. 36 – 37) ». Les médiats de propagande ont-ils répercuté cette information ? Non, car, comme le dit le président aviné de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker : « Quand les choses deviennent sérieuses, il faut mentir (p. 35). » Sinon la vérité aux peuples contribuables serait insoutenable d’autant que « plus un banquier est insolvable, surtout en Europe, plus il a de chances de s’approprier des parts importantes des revenus de tous les autres – : ceux qui triment, ceux qui innovent, les pauvres et, bien entendu, ceux qui n’ont aucun pouvoir politique (p. 38) ». Les petites frappes de la délinquance quotidienne devraient devenir des criminels de haut vol intouchables, c’est-à-dire des banksters.
Ses compétences économiques et son ignorance des codes de la politique-spectacle font de Yanis Varoufakis une proie facile pour la désinformation bankstériste. Contre lui, « la machine de propagande de Bruxelles fonctionnait à plein régime (p. 287) ». Sachant que les « banquiers ont simplement pris le relais et financé les médias afin de manipuler l’opinion publique, donc de contrôler le jeu politique, qui lui permettait de garder les commandes des banques en faillite. Cela dit, contrairement aux promoteurs, ils ont été assez astucieux pour éviter de devenir propriétaires de chaînes de télévision et de journaux déficitaires. Ils ont maintenu en vie les médias en leur offrant des clopinettes en échange de publicités pour leurs banques (p. 66) », il estime qu’« à l’heure où l’establishment dit libéral se récrie face aux fake news de l’alt-right en pleine insurrection, il est utile de se rappeler que, en 2015, ce même establishment a lancé une campagne de retournement de la vérité et de diffamation terriblement efficace contre le gouvernement pro-européen et démocratiquement élu d’un petit pays européen (p. 10) ». La revendication du credo libéral n’est pour lui qu’un prétexte. Critique envers « les télé-évangélistes de l’asservissement (p. 164) », Varoufakis considère qu’« un establishment qui exploite sans vergogne des contre-vérités pour annuler un mandat démocratique et imposer des politiques dont ses propres fonctionnaires savent qu’elles ne sont pas efficaces ne saurait être qualifié de “ libéral ” (p. 476) ». Tout sera mis en œuvre pour briser cet opposant farouche « aux prêts en série insoutenables qui maquillent une faillite pour en faire un problème d’illiquidité (p. 46) ».
De féroces descriptions
Certains portraits croqués dans ce livre sont féroces. L’auteur se surprend de découvrir le socialiste Michel Sapin, ministre français des Finances, tout ignorer de la langue anglaise, maîtriser plus qu’imparfaitement les arcanes économiques et montrer une incroyable duplicité à son égard : cordial en privé, cassant devant les journalistes et les officiels. « La comédie de Michel Sapin était à l’image de ce qui ne fonctionne pas dans la République française (p. 198). » Quelques instants plus tôt, le même Sapin lui avait déclaré : « – Yanis, il faut que vous compreniez. La France n’est plus ce qu’elle était (p. 198). » Que voulait dire le vieux pote de « Flamby » ?
Au fil de ses rencontres électriques avec le président de l’Eurogroupe, le ministre néerlandais Jeroen Dijsselbloem, Varoufakis le trouve « encore plus vil que d’habitude (p. 429) ». Son jugement cinglant embrasse les socialistes français et les sociaux-démocrates allemands qui « n’ont cessé de se contredire, entre promesses creuses et vaines paroles (p. 397) ». L’auteur éprouve en revanche un véritable respect pour Wolfgang Schäuble. Ce partisan implicite du Grexit pense que « des élections ne sauraient changer une politique économique (p. 241) ». À quoi bon alors en organiser et ensuite tenter d’exporter ailleurs les « démocraties » occidentales ? Schäuble jette un temps le masque et se montre tel qu’il est : libéral et sécuritaire. Ancien du FMI et collaborateur de Varoufakis, Glenn Kim présente dans un courriel la personnalité de Schäuble qui « déteste au plus haut point les marchés. Pense qu’ils sont contrôlés par les technocrates. […] C’est un européiste ardent. Il croit au destin d’une Europe à l’allemande (pp. 216 – 217) ». L’auteur évoque un esclandre lors d’une réunion ministérielle, le 16 avril 2015. Ce jour-là, Michel Sapin envoie paître Schäuble qui envisageait accroître l’influence de la troïka au sein de l’Eurolande. En effet, « Wolfgang Schäuble rêvait de voir la troïka dicter sa loi à Paris (p. 479) ». Ce n’est que partie remise. L’auteur se montre en revanche assez bienveillant envers la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et couvre d’éloges Emmanuel Macron.
Yanis Varoufakis n’approuve pas le Grexit autant de la Zone euro que l’Union pseudo-européenne. Il cherche plutôt une « politique de désobéissance constructive au sein de l’Union européenne. […] La seule alternative possible à la dystopie qui se met en place à mesure que l’Europe se désintègre (p. 481) ». Il soumet donc à la troïka plusieurs plans, mais elle « refusait systématiquement nos propositions sans en avancer une seule de son côté (p. 348) », non seulement pour des motifs techniques ou politiques, mais parce qu’il comprit bientôt que « ce que tous ces hommes avaient en commun : c’étaient tous des transfuges de Goldman Sachs (p. 244) ! » Cela expliquerait-il l’absence de vision politique dans les instances européennes et leur neutralisation par des procédures loufoques ? « La démocratie était morte le jour où l’Eurogroupe avait obtenu le pouvoir de dicter leur politique économique à des États privés de toute souveraineté fédérale démocratique (p. 241). » L’auteur apprend ainsi qu’il ne peut pas distribuer le moindre document de travail informel à ses homologues de l’Eurogroupe sous peine que ce papier soit ensuite débattu au Bundestag. Et si Varoufakis l’envoie en pièce jointe par courriel, il romperait le protocole et le document en question ne serait pas pris en compte ! L’inertie comme direction du désordre…
Yanis Varoufakis déplore en particulier le juridisme tatillon et les pesants rituels qui paralysent les séances de l’Eurogroupe et du conseil européen des ministres. Il apprend vite que les fonctionnaires européens lui mentent, le prennent de haut et ne lui communiquent jamais les documents officiels. Il regrette que la rédaction du communiqué final de l’assemblée soit plus importante que les choix adoptés (ou non). Il s’étonne de règles qui contreviennent aux propres valeurs de la démocratie délibérative. Le président de l’Eurogroupe introduit le sujet; il donne ensuite la parole respectivement aux représentants de la Commission européenne, du FMI et de la BCE; il laisse enfin s’exprimer dans un temps imparti relativement court les ministres. « Un spectateur impartial et sensé en conclurait que l’Eurogroupe n’est là que pour permettre aux ministres de valider et légitimer les décisions prises en amont par les trois institutions (p. 238). »
L’Eurogroupe existe-t-il vraiment ?
« Les représentants de l’Europe officielle sont formatés pour exiger des ministres, des Premiers ministres, même du président de la France, qu’ils plient dès les premières menaces des gros bras de la BCE (p. 176). » La réalité est plus féroce encore. Jeroen Dijsselbloem ose tancer Pierre Moscovici, le Commissaire aux Affaires économiques et financières, ce qui « trahissait l’inféodation de la Commission à des forces qui manquent de fondement légal ou de légitimité démocratique. […] Par la suite, chaque fois que [… Pierre Moscovici] ou Jean-Claude Juncker essaieraient de nous aider, j’avais des frissons parce que je savais que ceux qui détenaient le pouvoir nous taperaient dessus sans pitié pour leur montrer l’exemple et remettre la Commission européenne à sa place (p. 265) ». Exaspéré, Varoufakis balance à Christine Lagarde : « Quand la BCE s’acoquine avec des banquiers corrompus et corrupteurs qui sabotent sciemment la démocratie, ça s’appelle une action ennemie (p. 362) ».
Les souvenirs de l’auteur prouvent que ministricules et bureaucrates font en sorte d’exclure et de nier tout cadre politique avec la ferme intention de mettre sur le même niveau fonctionnaires de la troïka et membres de gouvernement. « Les discussions techniques et les discussions politiques doivent être fusionnées et organisées au même endroit (p. 378) », affirme Pierre Moscovici. Le 27 juin 2015, suite à sa demande, le secrétariat de l’Eurogroupe lui répond que « l’Eurogroupe n’a pas d’existence légale, dans la mesure où il ne relève d’aucun des traités de l’Union. C’est un groupe informel réunissant les ministres des Finances des États membres de la la zone euro. Il n’existe donc pas de règles écrites sur ses procédures que son président serait tenu de respecter (p. 441) ». C’est exact, mais la reconnaissance de son caractère informel invalide toutes les restrictions que Jeroen Dijsselbloem a imposées à Yanis Varoufakis ! Oui, « l’Eurogroupe est une drôle de créature. Les traités européens ne lui confèrent aucun statut légal, mais c’est le corps constitué qui prend les décisions les plus importantes pour l’Europe. La majorité des Européens, y compris les politiques, ne savent pas exactement ce que c’est, ni comment il fonctionne (p. 237). » L’auteur s’aperçoit que « le Groupe de travail Eurogroupe (EWG) [est] sur le papier […] l’instance au sein de laquelle se préparent les réunions de l’Eurogroupe; en réalité, ce groupe est une sorte de sombre creuset dans lequel la troïka concocte ses plans et ses politiques (p. 127) ». Relais direct d’Angela Merkel, Thomas Wieser « était président du Groupe de travail Eurogroupe, cet organe dont le rôle est de préparer les réunions de l’Eurogroupe, là où les ministres des Finances de chaque pays prennent les décisions clés. En théorie, donc, Wieser était le délégué de Jeroen Dijsselbloem, ministre des Finances néerlandais et président de l’Eurogroupe. Ce que je ne savais pas et que je mesurerais plus tard, c’est que c’était l’homme le plus puissant de Bruxelles, beaucoup plus puissant que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ou que Pierre Moscovici, le commissaire aux Affaires économiques et financières (le ministre des Finances de la Commission), voire, en certaines occasions, plus puissant que Dijsselbloem lui-même (pp. 143 – 144) ». Plus qu’une crise monétaire, financière ou économique, on devine que la crise est avant tout politique du fait de l’occultation volontaire et souhaitée du politique. Pourtant, « l’Europe peut donner naissance à des institutions efficaces : la Banque européenne d’investissement. La BEI appartient en effet aux États membres et elle est gouvernée par les ministres des Finances européens (p. 268) ». Le plus grave demeure le consentement béat de la plupart de minables politiciens. Wolfgang Schäuble le reconnaît volontiersau cours d’un échange privé avec Varoufakis : « Vous êtes le seul de l’Eurogroupe à avoir compris que la zone euro est insoutenable. L’union monétaire a été mal conçue. Nous avons besoin d’avoir une union politique, ça, ça ne fait aucun doute (p. 402). » Schäuble applique cependant une politique contraire parce qu’il écarte son européisme militant par rapport à de puissants intérêts atlantistes et mondialistes qu’il représente.
Mieux soutenu par son Premier ministre, Yanis Varoufakis serait peut-être parvenu à négocier avec les usuriers rapaces de la Grèce, car les « institutions », à savoir l’abjecte troïka, commençaient à se diviser entre elles et en leur sein autour de l’acceptation ou non des solutions réfléchies du gouvernement grec. Ce ne fut pas le cas. Dépité par les manœuvres politiciennes tortueuses de Tsipras, prêt à renier ses engagements de campagne afin de rester au pouvoir et d’en jouir quotidiennement, et écœuré par le viol gouvernemental du référendum du 5 juillet 2015 (61,31 pour le « non »), l’auteur démissionne dès le lendemain. La dissolution de la Vouli lui fera ensuite perdre son mandat de député, ayant refusé de se représenter. Aujourd’hui, il fait l’objet d’une accusation de « haute trahison » devant les parlementaires. Un comble ! En devenant ministre, Varoufakis savait qu’il servirait de fusible, mais pas si vite et pas comme bouc émissaire.
Conversation entre adultes est un ouvrage essentiel pour mieux comprendre les rouages absurdes de la machinerie pseudo-européenne, bankstérisée et effectivement proto-maffieuse qui massacre toute véritable idée européenne. Le récit de Yanis Varoufakis est un avertissement pour tout gouvernement qui tenterait de discuter avec les « institutions ». Celles-ci ne connaissent qu’un seul langage : la force. Heureusement que la France détient toujours de l’arme nucléaire…
Georges Feltin-Tracol
• Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe, Éditions Les liens qui libèrent, 2017, 526 p., 26 €.
http://www.europemaxima.com/dans-lantre-du-minotaure-par-georges-feltin-tracol/