Fabrice Hadjadj publie un recueil de chroniques où il mêle des réflexions inspirées de la vie quotidienne sur le sexe, la religion, la technique et le travail. Entre Houellebecq et Chesterton, il nous livre une profonde critique de l'époque ... Ces réflexions sont importantes et ne sont pas à prendre à la légère. Elle traitent de l'essentiel, de l'avenir de notre société et des personnes qui lui appartiennent par la naissance et par la tradition. Nous publions ces réponses de Fabrice Hadjadj à Eugénie Bastié [Figarovox, 21.12.2017] comme une suite, en plusieurs journées. Lafautearousseau
 Vous êtes un grand défenseur de la différence des sexes. À l'heure où le désir est soit criminalisé par un féminisme puritain soit caricaturé par l'univers marchand, quel regard portez-vous sur les relations hommes-femmes ?
Vous êtes un grand défenseur de la différence des sexes. À l'heure où le désir est soit criminalisé par un féminisme puritain soit caricaturé par l'univers marchand, quel regard portez-vous sur les relations hommes-femmes ?
Là encore, je ne suis pas un défenseur des sexes, je remarque simplement que j'en ai un, assez capricieux, d'ailleurs, et qui n'est pas l'autre. Si seulement nous étions encore dans la guerre des sexes, genre Lysistrata ! Mais non, ce qui se joue à cette heure c'est la concurrence victimaire et le contentieux contractuel. Je m'explique. Nous devons dénoncer le harcèlement, le viol et rendre justice, mais le mode de dénonciation qui est en cours a des soubassements néo-libéraux, qui n'ont rien à voir avec les sexes. On veut dénier l'obscurité du désir, on prétend que toutes les relations devraient se dérouler comme le contrat passé entre deux agents rationnels dont les intentions sont parfaitement transparentes. Pour éviter toute accusation éventuelle, les maris auront la prudence d'obtenir un consentement signé de leur épouse, et éventuellement de la payer pour son « travail émotionnel ». Mais ça ne marche pas comme ça. Et même ça ne marche jamais. La polarité sexuelle ne pourra jamais être réduite à un marché passé entre deux contractants. Emmanuel Lévinas disait qu'elle contenait toujours une part d'adoration et de profanation. Il faut donc lutter - d'abord en soi-même - contre la violence faite aux femmes, mais il faut aussi admettre que le désir qui pousse un homme vers une femme - et réciproquement - n'a rien à voir avec la fiction de l'agent rationnel telle que l'invente la théorie économique moderne.
Dans l'une de vos chroniques, vous faites un lien entre terrorisme et technocapitalisme… Selon vous, la propagation de l'idéologie djihadiste trouve un terreau favorable dans la mondialisation spectaculaire et marchande ?
L'affrontement entre consumérisme et islamisme n'est que superficiel: c'est la même forma mentis ; dans les deux cas, il s'agit d'atteindre le paradis en appuyant sur des boutons. Daech n'a rien d'un retour des prétendues ténèbres médiévales. C'est un mouvement postmoderne, constitué par des individus déracinés, qui se recrutent par Internet, qui font des selfies avec kalachnikov et des vidéos d'égorgement dans des mises en scène de série télévisée, enfin qui subsistent grâce aux pétrodollars. Leur « Dieu » ne s'est pas fait chair. Il n'est ni charpentier ni talmudiste - ce qui leur aurait donné, avec le sens du concret, un certain sens de l'humour. Le djihadisme est peut-être une réaction au vide occidental, à son absence de sens ou de transcendance, mais c'est aussi une extension de ce vide, une perte radicale de la terre, de la culture et de l'histoire. A suivre ...
Directeur de l'université Philantropos. Il publie « Dernières nouvelles de l'homme (et de la femme aussi) », Taillandier, 352 p., 18,90 €.

Journaliste Débats et opinions
A lire dans Lafautearousseau ...
Fabrice Hadjadj : Questions-Réponses essentielles et critiques sur notre époque [1]
Fabrice Hadjadj : Questions-Réponses essentielles et critiques sur notre époque [2]



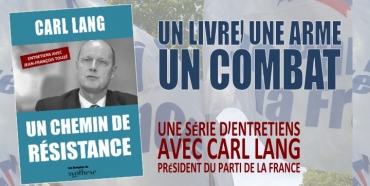
 Vous prônez le retour à une vie simple, le goût du foyer et de la décroissance. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de vouloir retourner à la bougie ou de vivre comme un amish ?
Vous prônez le retour à une vie simple, le goût du foyer et de la décroissance. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de vouloir retourner à la bougie ou de vivre comme un amish ?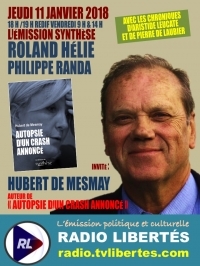 Ecoutez l'émission
Ecoutez l'émission