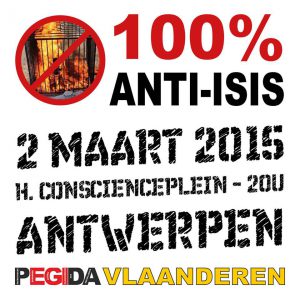Honnêtement, je n’aurais jamais pensé que le jour viendrait où j’aurais à dire du bien de l’opposition libérale ou non-système russe, mais apparemment, ce jour est venu, c’est aujourd’hui. A ma grande surprise, tous les chefs de cette opposition ont fait jusqu’à maintenant des déclarations très modérées et raisonnables, et tous ceux que j’ai entendus ont apparemment rejeté l’idée que le Kremlin est derrière le meurtre. Maintenant, cela va peut-être de soi pour la plupart d’entre nous, mais pour l’opposition libérale ou démocratique russe, c’est un vrai changement de ton. Beaucoup d’entre eux ont même dit que ce meurtre était uneprovocation (ce qui, dans ce contexte, signifie coup monté!) pour déstabiliser la Russie et provoquer une crise. Même Irina Khakamada, habituellement une vraie cinglée, a dit que c’était soit une provocation soit l’action d’un petit groupe d’extrémistes.
Peut-être sont-ils conscients que l’opinion publique russe ne l’achètera pas, ou peut-être ont-ils un moment de décence, mais pour autant que je sache, personne n’a pointé le doigt sur Poutine (okay, quelqu’un l’a probablement fait quelque part, mais je ne suis pas au courant). Encore une fois, c’est tout à fait remarquable.
Tout le monde, les pro et les anti-Kremlin, ont convenu qu’il est absolument essentiel que ce crime soit résolu. Comme je crois personnellement que c’était un crime sous fausse bannière organisé par les US/UK (Etats-Unis et Royaume-Uni), je m’attends tout à fait à ce qu’on trouve quelqu’un et, comme nous le disons en russe, que la piste aboutisse dans l’eau, autrement dit qu’il n’y aura aucune preuve d’une implication occidentale. En fait, même si le FSB aboutit à une telle preuve, les Russes ne la rendront très probablement pas publique, mais l’utiliseront en coulisses. Quant à ceux qui ont organisé le coup, ils ont aussi besoin que quelqu’un soit pris, parce que si jamais personne n’est attrapé, cela ressemblera trop à du travail de professionnel; mais si une petite cellule – disons, de nationalistes antisémites enragés – se fait prendre, cela disculpera tous les autres suspects possibles. Si on considère que le crime s’est produit à 200 mètres du Kremlin, et que le centre de la ville est truffé de caméras, je m’attends à une arrestation dans les prochaines 48 heures, une semaine au maximum.
Le résultat est qu’en Russie, cette action sous fausse bannière est déjà clairement un échec, même la célèbre opposition libérale ou démocratique russe ne veut pas toucher à cette chose. C’est en effet une très bonne nouvelle. En Occident, évidemment, c’est une autre histoire, les Anglo-sionistes l’utiliseront à fond, aucun doute à ce propos.
The Saker
PS: Puisque nous parlons de fausses bannières : on me pose souvent la question de savoir pourquoi Poutine ne dit pas que le 9/11 était de la cuisine maison, bien qu’il doive le savoir. Bien sûr qu’il le sait, mais posez-vous une question simple: pourquoi dirait-il quelque chose? Qu’est-ce que la Russie aurait à y gagner? Cela ne ferait que le diaboliser davantage, ainsi que la Russie, aux yeux de ceux qui croient au conte de fées officiel et cela n’apporterait rien du tout à Poutine et à la Russie. Quant aux faits, eh bien ils sont tous exposés au grand jour, exactement comme l’assassinat de JFK ou Gladio, 7/7, l’attentat à la gare de Bologne, Charlie Hebdo et tous les autres. Ce n’est tout simplement pas le boulot de Poutine de partager des informations avec le public occidental, son boulot c’est d’être au service du peuple russe. Enfin, bien que j’en doute personnellement, il est possible que certains services de renseignement russes aient été impliqués dans les attentats de Moscou en 1999, donc Poutine pourrait vouloir agir avec prudence ici, de peur de représailles des Etats-Unis s’ils révèlent ce qu’ils savent.
Traduit par Diane, relu par jj pour le Saker Francophone
Le Saker original – le 28 février 2015 – Source thesaker.is
Source Article from http://reseauinternational.net/bonnes-nouvelles-de-russie-meme-lopposition-liberale-pro-us-refuse-dincriminer-le-kremlin/