A la page 5 du journal Rivarol du 29 juin 2017 est paru un entretien portant sur la publication de mon dernier livre La franc-maçonnerie, 300 ans d’imposture. L’intégralité de l’article est en ligne ci-dessous. Merci à Jérôme Bourbon (directeur de Rivarol) pour sa proposition d’interview.

RIVAROL : Le titre de votre sixième ouvrage, La franc-maçonnerie, 300 ans d’imposture, est suffisamment explicite. Qu’est-ce qui a motivé l’écriture de ce livre ?
Johan LIVERNETTE : Ce livre est dans la continuité du précédent, Le complot contre Dieu, qui démontait le mondialisme, ce projet de destruction à grande échelle. Cette fois, La franc-maçonnerie, 300 ans d’imposture est centré uniquement sur la secte maçonnique. Mon but fut de publier le livre le plus complet et le plus documenté possible sur le sujet, en structurant mon travail sur différents axes, de manière à faire le tour de la question en 372 pages. Lorsque j’ai vu que la franc-maçonnerie allait fêter son tricentenaire, je me suis dit que c’était le bon moment pour fournir ce travail de synthèse.
R. : Justement, sous quel angle abordez-vous la franc-maçonnerie dans votre livre ? Quelles thématiques sont-elles traitées ?
J. L. : Sous tous les angles. Il n’y a qu’à regarder la table des matières pour se rendre compte que cette étude est très large. Des thématiques sont cependant plus approfondies que d’autres. Je pense notamment aux origines de la franc-maçonnerie, à l’initiation, à la notion de contre-Église, aux faux principes maçonniques, à son caractère luciférien et puis surtout à l’action des sociétés secrètes durant l’histoire, c’est-à-dire depuis trois siècles.
R. : La révolution française de 1789 est-elle abordée dans votre livre ?
J. L. : Oui bien évidemment. Elle est le point de départ de toute cette conspiration. La révolution française est l’œuvre majeure de la franc-maçonnerie. Depuis 1789, aucun événement important ne se produit sans le concours des loges ou sans leur consentement. D’ailleurs, depuis cette révolution dite “française”, tout peut s’expliquer par le complot talmudo-maçonnique. Car tout ou presque provient d’arrières-loges liées à la haute finance apatride. C’est ce que je m’étais efforcé de démontrer en seulement 50 pages dans la Synthèse du mouvement révolutionnaire mondial.
R. : La franc-maçonnerie, 300 ans d’imposture s’adresse-t-il au lecteur déjà averti ou au néophyte qui ignore tout du sujet ?
J. L. : Il s’adresse à tout le monde. Celui qui connaît déjà le sujet l’approfondira encore plus. Celui qui ne connaît rien apprendra tout. Quant aux francs-maçons, je leur en recommande vivement la lecture, afin de changer leur point de vue sur leur secte, de la quitter définitivement et de la faire découvrir à leur tour au grand public, comme l’avait fait le repenti Paul Copin-Albancelli en son temps.
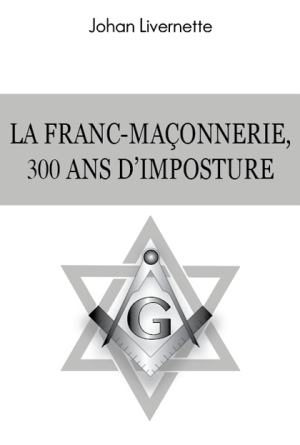
R. : Était-ce utile, selon vous, de remettre le couvert sur un sujet qui a déjà été traité ?
J. L. : C’est plus que jamais utile de remettre le couvert sur ce sujet qui a certes été déjà étudié, mais pas de manière aussi complète et approfondie que dans mon dernier livre ou alors il y a bien longtemps : en 1893, sous l’angle kabbalistique, avec Mgr Léon Meurin dans La franc-maçonnerie, synagogue de Satan (éditions Saint-Rémi). C’est la raison pour laquelle je me suis plongé, ces dernières années, dans la documentation maçonnique, tout en étudiant la vraie histoire et non celle des manuels scolaires de la république. Les gens sont friands d’informations sur ce que les media nous cachent. Sur les dessous de l’histoire, l’implication de lobbys, sectes et sociétés secrètes en lien avec la banque. C’est ce qui a fait le succès de mes trois derniers livres.
R. : Faites-vous le rapprochement entre la franc-maçonnerie et le pouvoir politique en France ?
J. L. : Oui. C’était déjà le cas dans Le complot contre Dieu d’ailleurs. C’est simple : pour être à la tête d’une entreprise importante à l’échelle locale ou régionale, il faut être affilié à une loge ou faire partie d’un club para-maçonnique comme le Rotary, le Kiwanis ou le Lion’s. Pour faire une carrière dans la politique sous une république, c’est pareil. C’est un passage obligé. À gauche par exemple, les politiciens de premier plan sont généralement affiliés au Grand Orient de France. Cela devrait interroger toute personne curieuse et désireuse de s’intéresser au vrai pouvoir, aux forces occultes qui dirigent réellement la France depuis 1789. S’informer et se positionner en politique sans prendre en compte la question maçonnique et ses faux principes, c’est passer à côté de l’essentiel.
R. : Sur quels livres, quels auteurs et quels documents vous êtes-vous appuyé dans cette étude ?
J. L. : Sur des francs-maçons qui, par le passé, se sont permis de dévoiler leur secte : le célèbre Albert Pike, le palladiste Domenico Margiotta, mais aussi François Clavel, Jean-Marie Ragon, Alexandre Lenoir, Oswald Wirth… Et puis surtout de nombreux auteurs antimaçonniques de référence comme Mgr Ernest Jouin, Mgr Henri Delassus, Mgr Léon Meurin, Léon de Poncins, AG Michel, l’abbé Barrruel, l’abbé Barbier, Henry Coston, Epiphanius, Jacques Ploncard d’Assac ou encore Jean-Claude Lozac’hmeur sur les origines de la franc-maçonnerie. Dans L’Église romaine en face de la révolution, l’historien Jacques Crétineau-Joly avait diffusé les documents de la Haute-Vente, à l’instar de Mgr Delassus dans Le problème de l’heure présente. Pour les compte-rendus du Grand Orient, il y a l’ecclésiastique AG Michel. Pour l’infiltration au sein de l’Église : l’abbé Emmanuel Barbier ; pour les illuminés de Bavière : l’abbé Barruel et la Britannique Nesta H. Webster ; pour l’initiation : Charles Nicoullaud ; et pour l’analyse de la gnose : Étienne Couvert. L’étude d’Emmanuel Ratier sur le B’naï B’rith est incontournable, tout comme celle d’Antony C. Sutton sur la Skull and Bones ou celle de l’Américain Craig Heimbichner sur l’Ordo Templi Orientis. Pour les francs-maçons décrits par eux-mêmes et les origines de l’ONU, le travail de Léon de Poncins est très précieux. Quant à l’action maçonnique durant l’histoire, il y a l’immense ouvrage du père Nicolas Deschamps intitulé Les sociétés secrètes et la société(éditions Saint-Rémi). Lors de mon étude, il m’a semblé nécessaire de rassembler un maximum d’informations et de documents, afin d’effectuer la synthèse de tous ces travaux.
R. : Pensez-vous avoir fait le tour de ce vaste sujet en 372 pages ?
J. L. : Oui je l’espère, dans un esprit de synthèse, afin de ne pas trop alourdir le livre en nombre de pages. Pour qu’il soit accessible, pas trop fastidieux à lire. Pour ne pas perdre le lecteur. Le but fut vraiment de faire le tour de la question maçonnique en développant suffisamment les sujets traités.
R. : La franc-maçonnerie est-elle, selon vous, la cause des problèmes de notre société ?
J. L. : Elle est d’abord un symptôme. De nombreux citoyens français y accourent. Et cela devrait nous interroger. Il y a un vide spirituel et les gens cherchent à le combler. Soit par le matériel, soit en se lançant dans toutes sortes de spiritualités. Entrer en franc-maçonnerie est synonyme d’ascension sociale pour ceux qui y rentrent. Ces gens-là la voient d’abord comme un réseau d’affaires. Sur le plan politique et religieux, la franc-maçonnerie est à l’origine de nombreuses lois et décisions gouvernementales qu’il serait long de toutes énumérer. Elle est donc aussi la cause de nos problèmes. La franc-maçonnerie, c’est le cœur du système. Chacun devrait raisonner en partant de ce constat et analyser les événements historiques en fonction de l’influence des loges, de leur projet, de leurs crimes, de leur état d’esprit.

R. : Cibler la franc-maçonnerie aide-t-il à mieux analyser les événements contemporains ?
J.L. : Cela nous amène à démystifier les faux clivages ressassés par les médias depuis des siècles (gauche-droite, riche-pauvre…), mais aussi à reconsidérer le clivage exploiteur-exploité. Aujourd’hui, il y a clairement la judéo-maçonnerie aux affaires et nous, les simples profanes qui subissons ce système démocratique — sous contrôle des loges — qui agit contrairement aux intérêts de la France et qui poursuit même la destruction de notre pays. Et si cette même France va de châtiment en châtiment depuis 1789, la secte maçonnique n’y est certainement pas étrangère ! Dénoncer l’œuvre satanique de la franc-maçonnerie permet de mieux comprendre les causes des événements de ce monde, leur fil conducteur. À l’inverse, s’intéresser à l’histoire en occultant l’action des sociétés secrètes, c’est passer à côté de la vraie histoire.
R. : Quel objectif vous êtes-vous fixé avec l’écriture de ce livre ?
J. L. : Je m’en suis fixé plusieurs. Tout d’abord informer du mieux possible, en suivant la recommandation du pape Léon XIII dans son encyclique antimaçonnique Humanum Genus. Le souverain pontife y recommandait d’« arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre » et de la « faire voir telle qu’elle est ». Deuxièmement, dans le combat des idées, se décrasser des faux principes maçonniques est primordial. Ensuite, j’espère avoir été suffisamment convaincant pour dissuader mes lecteurs de s’y affilier. Et enfin, persuader les francs-maçons d’en sortir. Ce livre est, selon moi, un antidote radical à toute initiation en loge. Dans un second temps, il faudrait espérer et même prier pour la conversion des francs-maçons.
R. : Abordez-vous systématiquement la question maçonnique dans les conférences que vous donnez un peu partout en France ?
J. L. : La question maçonnique est abordée dans quasiment toutes mes interventions. Qu’elles soient orales ou écrites. Qu’il s’agisse de livres, d’articles ou de conférences. Pour quelle raison ? Parce qu’elle est centrale lorsqu’il s’agit d’analyser la nature du système qui est précisément talmudo-maçonnique. La question juive est donc tout aussi importante et déterminante. Le 8 juin je devais traiter à Marseille le sujet suivant : « République maçonnique contre France catholique ». Mais à cause de pressions exercées par des politiques sur le restaurateur, ma conférence n’a hélas pas eu lieu. Je compte pouvoir la donner dans le sud-ouest le mardi 15 août. Il ne faut jamais perdre en effet une occasion d’informer le public sur la nature et les dangers de la maçonnerie.
Propos recueillis par Jérôme Bourbon
Vous pouvez commander La franc-maçonnerie, 300 ans d’imposture en envoyant un chèque de 23,80 € (19 + 4,80 € de frais de port) à l’ordre de Johan Livernette à l’adresse suivante :
Livernette Johan
BP 30042
83040 Toulon cedex 9
https://johanlivernette.wordpress.com/2017/07/06/rivarol-n3289-johan-livernette-la-franc-maconnerie-cest-le-coeur-du-systeme/#more-3690

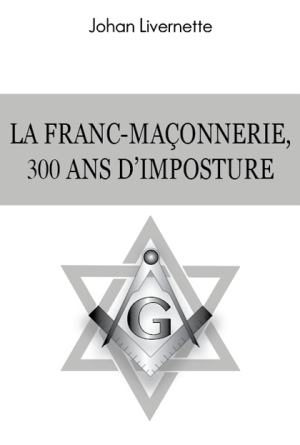

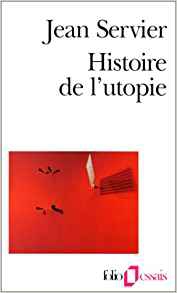 Ouvrir le débat sur l’origine des espèces n’est pas synonyme d’adhésion au « créationnisme ». Ne pas tomber dans ce piège sémantique, mais défendre « le point de vue religieux » : ainsi un professeur de religion islamique tint-il tête, il y a quelques années, sur un plateau de la télévision belge, à une meute de « libres-penseurs » adeptes du transformisme darwinien.
Ouvrir le débat sur l’origine des espèces n’est pas synonyme d’adhésion au « créationnisme ». Ne pas tomber dans ce piège sémantique, mais défendre « le point de vue religieux » : ainsi un professeur de religion islamique tint-il tête, il y a quelques années, sur un plateau de la télévision belge, à une meute de « libres-penseurs » adeptes du transformisme darwinien.