Bernard Plouvier
La menace en était agitée depuis des années. C’est désormais officiel : le gouvernement autrichien veut exproprier les possesseurs de la vieille (et superbe) bâtisse où naquit, le samedi-saint 20 avril 1889, vers 17 heures, Adolf Hitler, soit le site de l’hôtel-auberge Zum Pommer (au Poméranien) de Braunau sur Inn.
On comprendrait fort bien que des édiles veuillent démolir un bâtiment insalubre, menaçant ruine, gênant l’édification d’un beau projet d’urbanisme. Ce n’est absolument pas le cas. Officiellement, le but de cette destruction d’un monument historique, datant du XVIIIe siècle, est d’empêcher l’afflux de néo-nazis… soit un pèlerinage annuel d’une centaine d’individus sur une planète qui en compte plus de 7 milliards !
Pourtant, viennent surtout visiter les sites fréquentés par Adolf Hitler, à Linz, Vienne, Munich ou Berlin, des historiens, en plus des inévitables badauds, ceux-là mêmes qui en font autant avec les lieux hantés par n’importe quelle célébrité du show-business.
Depuis le début des années 1980, et de façon parallèle à une nouvelle campagne de réclamations tous azimuts d’indemnités-réparations-restitutions ou pour l’établissement (aux frais des contribuables) de multiples lieux de culte et d’entretien du devoir de mémoire, au titre de la Shoah, l’on constate une reprise d’activité du lobby de la haine.
C’est bien sûr un lobby « qui n’existe pas ». Pas plus qu’il n’a existé de « syndicat dreyfusard », de « judéo-bolchevisme », ou qu’il n’existe de lobby sioniste orientant la politique étrangère des USA (du moins avant l’arrivée aux apparences du Pouvoir du crypto-islamiste Barack-Hussein Obama).
On a donc relancé la campagne de haine vis-à-vis d’authentiques hommes de sciences qui furent des nazis, par l’effet de leur patriotisme : on pense à l’éthologue Konrad Lorenz, à l’épidémiologiste et infectiologue de grand talent Hans Reiter ou à l’anatomo-pathologiste mondialement connu en son temps Robert Roessle. La musique de Richard Strauss est toujours honnie en Israël et la mémoire de Karajan régulièrement insultée par des minables qui n’ont pas le quart du talent dont faisait preuve ce grand chef.
La haine se fait désormais destructrice. Après la maison natale du Führer, on en viendra à détruire l’aire des Congrès du NSDAP à Nuremberg, les brasseries munichoises où il a parlé, tel hôtel où il a séjourné.
Dans tout cela, qui s’intéresse aux générations futures ? Détruire des témoignages du passé, ce fut toujours et partout une absurdité. Les Talibans ont détruits les représentations géantes du Bouddha en Afghanistan.
De nos jours, en Europe danubienne, on va détruire une vieille demeure, admirablement restaurée et solide (au point que les vandales veulent en conserver les fondations), pour assouvir une haine de représentants autoproclamé d'un peuple qui se croyait et se proclamait seul « élu d’un dieu », la haine d’un peuple qui se proclame de « race pure et sainte »… c’est le genre de délire que l’historien des années 1919-1945 connaît fort bien, trop bien même pour comprendre qu’on puisse encore enseigner de telles inepties. C’est pourtant ce que l’on apprend aux jeunes et aux moins jeunes qui fréquentent (en stricte séparation des sexes) les Yechivot ou écoles talmudiques.
Le racisme débouche immanquablement sur l’endogamie et les génocides. N’importe quel lecteur de l’Ancien Testament peut aisément s’en rendre compte et nul ne doit l’ignorer. En revanche, détruire des vestiges historiques est pure absurdité. Ce n’est pas en vandalisant le patrimoine culturel de notre continent que l’on va lutter contre la bêtise, contre les conduites potentiellement criminelles.
On annihile les errements du passé par la compréhension du contexte, la réflexion éthique, enfin par la modification des comportements individuels et collectifs. Dans tout cela, il n’y a aucune place logique et raisonnable pour le vandalisme architectural.





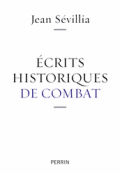 "On peut se retrouver assis face à Philippe de Villiers dans le cadre cossu de La Rotonde, brasserie germanopratine fréquentée par le Paris politique et littéraire, et l’écouter lire à voix haute des sourates du Coran. Le Vendéen, héraut de la droite catholique et identitaire, tient dans ses mains un exemplaire du livre saint, qu’il assure connaître, contrairement à beaucoup de personnalités qui s’expriment sur le sujet. L’ancien député européen veut démontrer à son interlocuteur que les « monstres djihadistes appliquent les prescriptions coraniques », et que cette religion, de manière plus générale, est « incompatible » avec la France. C’est le propos de son dernier livre, sorti le 12 octobre, Les cloches sonneront-elles encore demain ? (Albin Michel, 299 pages, 22,50 euros). Son éditeur a fait ajouter un bandeau avec sa photo et ce sous-titre : « La vérité sur l’histoire de l’islamisation de la France ».
"On peut se retrouver assis face à Philippe de Villiers dans le cadre cossu de La Rotonde, brasserie germanopratine fréquentée par le Paris politique et littéraire, et l’écouter lire à voix haute des sourates du Coran. Le Vendéen, héraut de la droite catholique et identitaire, tient dans ses mains un exemplaire du livre saint, qu’il assure connaître, contrairement à beaucoup de personnalités qui s’expriment sur le sujet. L’ancien député européen veut démontrer à son interlocuteur que les « monstres djihadistes appliquent les prescriptions coraniques », et que cette religion, de manière plus générale, est « incompatible » avec la France. C’est le propos de son dernier livre, sorti le 12 octobre, Les cloches sonneront-elles encore demain ? (Albin Michel, 299 pages, 22,50 euros). Son éditeur a fait ajouter un bandeau avec sa photo et ce sous-titre : « La vérité sur l’histoire de l’islamisation de la France ».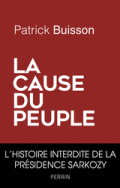 Un mois plus tôt, Albin Michel – le même éditeur, donc – publiait le dernier opus d’Eric Zemmour, Un quinquennat pour rien, chroniques de la guerre de civilisations. Un propos similaire parcourt la préface du livre. « L’islam est incompatible avec la laïcité, avec la démocratie, avec la République laïque. L’islam est incompatible avec la France », écrit le journaliste du Figaro.
Un mois plus tôt, Albin Michel – le même éditeur, donc – publiait le dernier opus d’Eric Zemmour, Un quinquennat pour rien, chroniques de la guerre de civilisations. Un propos similaire parcourt la préface du livre. « L’islam est incompatible avec la laïcité, avec la démocratie, avec la République laïque. L’islam est incompatible avec la France », écrit le journaliste du Figaro. Avec mon idéal de l'écrivain - une vie en discorde avec le siècle, une œuvre à peu près en harmonie avec la littérature - je ne pensais aucun risque. (Qui se serait targué de n'y pas souscrire ?) Sauf celui-ci : de ne pouvoir consentir à tous ceux qui s'en réclamaient, de bonne foi et avec une volonté droite, le même capital de sympathie. Sympathie au sens étymologique : sentir et même souffrir avec. Des souvenirs plus profonds, une mémoire plus proche commandaient en moi, prédestinant ce qui me donnait la meilleure impression d'y obéir, déshéritant le reste. Gracq et Cioran, monuments classés, points de repère pour touristes littéraires amateurs de curiosités archéologiques. C'était encore une chance d'un choix estimable ; ce n'en était déjà plus une de n'avoir raison qu'avec eux. J'avais des préférences qui me touchaient davantage ; mon instinct les appelait et je récitais leurs noms comme le poème des châteaux et des cités royales, Bernanos, Giono, Anouilh, Aymé.
Avec mon idéal de l'écrivain - une vie en discorde avec le siècle, une œuvre à peu près en harmonie avec la littérature - je ne pensais aucun risque. (Qui se serait targué de n'y pas souscrire ?) Sauf celui-ci : de ne pouvoir consentir à tous ceux qui s'en réclamaient, de bonne foi et avec une volonté droite, le même capital de sympathie. Sympathie au sens étymologique : sentir et même souffrir avec. Des souvenirs plus profonds, une mémoire plus proche commandaient en moi, prédestinant ce qui me donnait la meilleure impression d'y obéir, déshéritant le reste. Gracq et Cioran, monuments classés, points de repère pour touristes littéraires amateurs de curiosités archéologiques. C'était encore une chance d'un choix estimable ; ce n'en était déjà plus une de n'avoir raison qu'avec eux. J'avais des préférences qui me touchaient davantage ; mon instinct les appelait et je récitais leurs noms comme le poème des châteaux et des cités royales, Bernanos, Giono, Anouilh, Aymé.