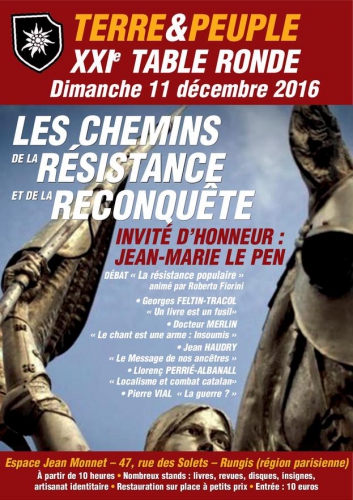Le présent article est une analyse synthétique et interdisciplinaire de l'histoire de longue durée, à rebours des analyses superficielles et compartimentées sur les causes profondes des crises politiques (au sens large), économiques et sociales que traverse une partie du monde, et tout particulièrement l'Europe.
Ces crises superposées sont la manifestation d'une crise civilisationnelle dont la cause principale est la quasi-disparition de la religion traditionnelle européenne, à savoir le Christianisme.
Rome sauvée par le christianisme
L'on ne s'est pas suffisamment penché sur le lien de causalité entre la décadence de Rome à partir du IIP siècle (crise socio-économique) et l'effondrement préalable des religions païennes romaines. D'ailleurs, ce « vide religieux » avait provoqué des tentatives d'élaboration philosophique d'un sens de la vie terrestre comme celle de Sénèque (4 av. J.C.- 65 ap. J.C.) ou de l'empereur stoïcien Marc-Aurèle (121-180)(1).
Sans exagération, le parallèle entre la période historique de déstructuration religieuse de Rome et de sa subséquente décadence et la présente séquence historique que traverse l'Europe qui est caractérisée par le vide religieux, doit être fait. D'autant plus que certains se prenant pour des Sénèque et des Marc-Aurèle modernes, à l'instar de Vincent Peillon ou dans un genre plus candide, le philosophe de bistrot Michel Onfray, proposent - dans la tradition maçonnique, républicaine et laïque - une religion mondaine de substitution au Christianisme (j'y reviendrai plus bas).
C'est bien grâce à l'Eglise catholique romaine (dont la liberté est garantie en 325 par l'Empereur Constantin) que l'Empire romain a survécu à la domination de l'Europe par les barbares à partir du IV siècle. Le grand historien médiéviste Henri Pirenne (1862-1935) écrit à propos de l'Europe dominée par les barbares Ostrogoths, Wisigoths, Vandales et Mérovingiens :
« La cour des Mérovingiens est un lupanar... Partout règne un manque de moralité presque incroyable... L'ivrognerie semble être la manière de tous. Des femmes font assassiner leur mari par leur amant. Tout le monde est à vendre pour de l'or. Et tout cela sans distinction de race, aussi bien chez les Romains que chez les Germains. Le clergé même - et jusqu'aux religieuses - est corrompu, encore que ce soit chez lui que la moralité se soit réfugiée... Le sol de la Remania a bu la vie barbare... Au milieu de la décadence, il n'y a qu'une force morale qui subsiste : l'Église, et pour l’Église, l'Empire subsiste encore... »(2).
L’Église va, par ailleurs, jouer un rôle central de stabilisateur de l'Europe à partir du Ve siècle pour remédier aux carences impériales durant la longue et tumultueuse période des invasions barbares. L'Eglise sera aussi l'institution indispensable au bon fonctionnement des royaumes européens ; c'est elle qui formera les hauts fonctionnaires. Sans elle, l'Europe aurait certainement sombré dans une anarchie durable.
Comme le souligne Henri Pirenne, à partir de la période carolingienne (en particulier sous Charlemagne à la fin du VIIIe siècle), avec l’Église, apparaît une grande communauté chrétienne aussi large que l’Ecclesia et l'Occident vit alors de sa vie propre. Dès lors, l'Europe existe en tant que civilisation dont le socle est indéniablement le Christianisme.
La Révolution de 1789 comme outil de destruction de la civilisation européenne
L'on ne peut s'empêcher de voir dans la Révolution française la redite et même la prolongation continentale de la révolution cromwellienne qui avait, entre autres choses, pour objet la disparition du Catholicisme par le massacre de masse des populations catholiques, la destruction des églises et le meurtre des prélats(3). L'anthropologue, et psycho-sociologue Gustave Le Bon (1841-1931) a parfaitement saisi la finalité de la Révolution française, à savoir l'instauration d'une nouvelle religion (occulte) et d'un nouvel ordre à vocation universelle :
« On ne comprend bien, je le répète encore, certains événements historiques - et ce sont précisément les plus importants - que lorsqu'on s'est rendu compte de cette forme religieuse que finissent toujours par prendre les convictions des foules. Il y a des phénomènes sociaux qu'il faut étudier en psychologue beaucoup plus qu'en naturaliste. Notre grand historien Taine n'a étudié la Révolution qu'en naturaliste, et c'est pourquoi la genèse réelle des événements lui a bien souvent échappé. Il a parfaitement observé les faits, mais, faute d'avoir étudié la psychologie des foules, il n'a pas toujours su remonter aux causes. Les faits l'ayant épouvanté par leur côté sanguinaire, anarchique et féroce, il n'a guère vu dans les héros de la grande épopée qu'une horde de sauvages épileptiques se livrant sans entraves à leurs instincts. Les violences de la Révolution, ses massacres, son besoin de propagande, ses déclarations de guerre à tous les rois, ne s'expliquent bien que si l'on réfléchit qu'elle fut simplement l'établissement d'une nouvelle croyance religieuse dans l'âmes des foules. »4 Gustave Le Bon avait compris le fond de l’histoire... et ceci a été admis récemment par Vincent Peillon, ancien chercheur et ministre, dont les travaux ont porté sur les origines de la laïcité, et qui écrit à ce propos :
« La laïcité elle-même peut alors apparaître comme cette religion de la République recherchée depuis la Révolution... On ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc on a laissé le moral et le spirituel à l’Église catholique... Il faut remplacer ça... Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle, de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque…»(5).
Ce que Vincent Peillon affirme, à savoir la volonté d'instaurer cette religion de substitution au Christianisme qu'est la laïcité, correspond - et ceci n'est pas une coïncidence - à la période de renforcement du Christianisme(6).
Conséquence sur la société contemporaine
Les conséquences générales de ce long processus commencé par la Révolution française ont été analysées en détail par l'historien, anthropologue et démographe Emmanuel Todd. Ses travaux mettent en évidence que le fond de la crise politique est la disparition de la religion qui structurait la société. Ainsi il écrit : « Républicanisme, socialisme, communisme se sont en pratique définis contre un catholicisme résiduel, qui les structurait pour ainsi dire négativement. La mort de cette religion a tué comme par ricochet les idéologies modernes.
Nous sommes ici tout proches de l'un des points nodaux de la crise qui, bien loin de n'affecter que la surface politique des choses, touche en réalité le socle métaphysique de la société, fonds de croyance irrationnelles et inconscientes venues d'une histoire très lointaine.
L'identification du fonds religieux de la crise nous permet d'éclairer certains aspects du malaise actuel, et en particulier la difficulté que peut avoir une société à vivre sans croyance religieuse.
L’athéisme a triomphé... L'histoire concrète de l'athéisme nous dit ; loin de mener au bien-être, l'émergence d'un monde sans Dieu conduit à l’anxiété, au sentiment d'un manque... Privé d'adversaire, l'athéisme doute, fléchit et s'effondre, La "déchristianisation conduit donc à une situation paradoxale : l'incroyant semble ne se sentir bien dans sa certitude que s'il y a encore dans la société une Eglise, minoritaire, mais porteuse d'une croyance positive en l'existence de Dieu, qu 'il peut critiquer et nier...
La disparition du dernier groupe solidement organisé de croyants donne le signal du mal être pour les vainqueurs, qui, libérés de tout, ne peuvent que constater qu'ils ne sont rien, rien qui ait un sens du moins. La mort de l’Église réactive la question de la mort de l'individu.
Au-delà de l'interrogation métaphysique de base, toutes les constructions idéologiques et politiques ayant pour fondement théorique l'inexistence du Ciel sont ébranlées. La disparition du paradis, de l'enfer et du purgatoire dévalorise bizarrement tous les paradis terrestres, qu'ils soient grandioses, de types stalinien, ou d'échelle plus modeste, républicain.
Alors commence la quête désespérée du sens qui, banalement, va se fixer sur la recherche de sensations extrêmes dans des domaines historiquement répertoriés : argent, sexualité, violence - tout ce que la religion contrôlait.
L'examen empirique de la réalité sociale montre la validité de cette séquence... L'argent, la sexualité et la violence sont désormais au centre de notre dispositif mental et médiatique. »(7).
L'examen empirique de la situation actuelle vérifie aussi par là même ce qu'anticipait Gustave Le Bon lorsqu'il affirmait dès 1895 que ce n'est pas l'évidente faiblesse des croyances socialistes actuelles (qu'on peut mettre dans la même catégorie que le républicanisme ou encore l'ultra-libéralisme) qui empêchera les religions de triompher dans l'âme des foules, puisque, affirmait-il, l'idéal de bonheur que promettaient ces dernières (les religions) ne devant être réalisé que dans une vie future, personne ne pouvait contester cette réalisation. Mais l'idéal de bonheur socialiste, disait Gustave Le Bon, devant être réalisé sur terre, dès les premières tentatives de réalisation, la vanité des promesses apparaîtra aussitôt, et la croyance nouvelle perdra du même coup tout prestige. L'Histoire, qui témoigne de l'échec de ces idéologies modernes, a donné raison à Gustave Le Bon(8).
Par conséquent, l'enjeu, dans un futur proche, sera de préparer le terrain, en France et en Europe, au retour du Christianisme. À moins qu'au point où en sont les choses il n'y ait plus qu'à attendre le retour du Christ en gloire et en majesté lors de la Parousie.
Jean Terrien. Rivarol du 22 septembre 2016
1. Voir : Emmanuel Todd, Après la démocratie, Gallimard, 2008, pp. 32-34.
2. Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne, Presses Universitaires de France, 1970, pp. 22-23,24.
3. Sur le rôle de Cromwell et l'implantation du messianisme juif en Angleterre voir : Youssef Hindi, Occident et Islam - Tome l ; Sources et genèse messianiques du sionisme, pp. 59-65.
4. Gustave Le Bon, La psychologie des foules, 1895, cité dans : Youssef Hindi, Les mythes fondateurs du Choc des civilisations, chap. V : Religion et modernité, souveraineté divine et laïcité, p. 183.
5. Vincent Peillon, La Révolution française n'est pas terminée, Seuil, 2008, cité dans : Youssef Hindi, op. cit., p. 176.
6. Voir : Emmanuel Todd, Après la Démocratie, p. 23.
7. Emmanuel Todd, op. cit., p. 32-34.
8. Youssef Hindi, Les mythes fondateurs du Choc des civilisations, chap. V ; Religion et modernité, souveraineté divine et laïcité.