culture et histoire - Page 1151
-
Herculanum, une bibliothèque sous les cendres (2009)
-
Le 4 octobre 1885, les royalistes reviennent… pour la dernière fois
Depuis les premières élections législatives de la IIIe république constitutionnellement installée, les rangs monarchistes, largement majoritaires cinq ans auparavant mais peu à peu érodés, s’étaient brutalement effondrés : au scrutin des 20 février et 5 mars 1876, ils n’obtenaient que 64 sièges (dont 40 orléanistes et 24 légitimistes) sur 533, quand les bonapartistes, relevant la tête, en comptaient 76. L’année suivante, consécutivement à la crise du 16 mai provoquée par le président Mac Mahon, ils n’étaient plus que 55 (mais 44 légitimistes et 11 orléanistes) et les bonapartistes 104. Rien d’étonnant à cela : comme l’expliqua fort bien en son temps (1891) le publiciste Louis Teste, « les royalistes, en célébrant la monarchie tout en faisant la république, se tenaient dans une équivoque qui troublait le pays ». En outre, le comte de Paris se rapprochant peu à peu des thèses autoritaires et plébiscitaires brouillait l’image des orléanistes, qui se distinguait de moins en moins de celle des bonapartistes, d’où la relative percée de ces derniers : l’électeur préfère toujours l’original à la copie. Enfin, aux élections de 1881, celles de la république triomphante et du premier gouvernement de Jules Ferry, demeuré fameux pour son « œuvre scolaire », on n’opéra même plus la distinction entre députés légitimistes et orléanistes, tous confondus sous l’étiquette « monarchiste » avec seulement 42 élus.
Puis le ciel de la république s’obscurcit sous l’apparition de deux nuages noirs aux noms exotiques : Tonkin et Panama. D’une part, un échec militaire cuisant dans la campagne d’Indochine, une de ces campagnes coloniales par lesquelles la république essayait de faire oublier son incapacité à reprendre l’Alsace et la Moselle. D’autre part, les signes avant-coureurs d’un énorme scandale financier où pots de vins, franc-maçonnerie, affairisme sans scrupules, mépris du peuple, des contribuables et des petits épargnants se mêleraient pour révéler aux électeurs un des aspects les plus caractéristiques du régime républicain.
De sorte que la campagne électorale commença dès l’été, après que les amis de Gambetta eurent obtenu une réforme du mode de scrutin : on revenait au scrutin de liste départementale, mais à deux tours, censé détacher l’électeur de l’influence des notables locaux, à laquelle les exposait davantage le scrutin uninominal d’arrondissement en vigueur depuis 1875. En réalité, enfermant les députés dans le jeu des partis. Mais, comme souvent, les réformes électorales mascagnées dans l’urgence aboutissent à l’inverse de l’objectif poursuivi. Il apparut très vite que ces élections s’engageaient mal pour les républicains, qui avaient aussi commis l’erreur, le premier juin, de politiser les funérailles de Victor Hugo.
Divisés en factions, chapelles, idéologies et rivalités de personnes, ils ne parvinrent pas à élaborer ne serait-ce qu’un embryon de programme gouvernemental commun et se présentaient devant les électeurs en ordre dispersé : presque partout, une liste radicale faisait face à une liste opportuniste et se laissait déborder sur sa gauche par une, parfois deux, liste socialiste. En revanche, monarchistes et bonapartistes parvenaient à faire taire, du moins à cacher, leurs dissensions et, dans tous les départements, présentaient une liste unique dite d’ « Union conservatrice ». Celle-ci ne disposait pas non plus de programme de gouvernement : son ciment tenait à la critique, sévère et tous azimuts, de la gestion républicaine, composée de défaite militaire outre mer, de scandale financier en perspective, d’instabilité ministérielle chronique, d’anticléricalisme hystérique qui effrayait les paysans et de réaction sociale qui dégoûtait les ouvriers.
Elle ne disposait pas davantage de leader emblématique ou charismatique : le comte de Chambord, mort depuis deux ans, n’avait d’autre successeur apparent que le comte de Paris, figure peu avenante, louvoyante et distante. Les anciens cadres royalistes s’étaient retirés sur la pointe des pieds et ceux qui se manifestaient encore, comme Albert de Mun, Eugène Veuillot et Lucien Brun, se consacraient à la défense du catholicisme. Avaient pris leur place des hommes issus de l’ancien personnel bonapartiste, de comportements agités mais de convictions élastiques, comme le baron Armand de Mackau et Paul de Cassagnac. Le premier, typique du notable local, député de l’Orne, était le fils d’un ancien ministre de la marine de Louis-Philippe. Le second, touche-à-tout comme l’époque en produisait beaucoup, avocat, publiciste, historien, journaliste, était notamment l’inventeur du surnom de « gueuse » pour qualifier la république, dont il avait aussi écrit l’histoire des débuts. Celle-ci, proclamaient-ils à tout va, « issue de la Révolution est, comme sa mère, génie de révolte et de discorde ; elle se déchire après avoir déchiré le pays ». Mais l’Union conservatrice, qui ne pouvait étaler ses divisions sur ce point, se gardait bien d’indiquer quel régime elle préconisait pour succéder à la république.
Les résultats du premier tour des élections, le 4 octobre 1885, surprirent les conservateurs eux-mêmes : 177 des leurs étaient élus, contre seulement 129 républicains de toutes tendances. Il s’agissait, d’évidence, d’un vote de mécontentement, d’un sévère avertissement envoyé aux républicains de gouvernement beaucoup plus que d’adhésion à un projet politique alternatif, qui n’existait pas. Et si, à droite, toujours incapable de dire ce qu’elle ferait du pouvoir une fois conquis, on vendait déjà la peau de l’ours, croyant revivre février 1871, allant plutôt à la chasse et à la messe que sur les tribunes, à gauche on serrait fébrilement les rangs. D’abord en formant partout des listes d’union pour le deuxième tour, y compris avec les socialistes les plus « extrémistes » de Jules Guesde. Ensuite en faisant campagne sur les thèmes de la peur : du retour à l’autoritarisme, au militarisme, au cléricalisme, à l’obscurantisme… Et le dégoût changea de camp.
Durant deux semaines de campagne particulièrement intense à gauche, la droite ne parvint pas à prouver sa crédibilité. N’osant évoquer ni la Restauration ni un IIIe Empire, et ne sachant parler ni de liberté ni de progrès, elle s’enferra dans un discours à la fois feutré et réactionnaire qui, tout à coup, émit un parfum de sacristie et de vieux grenier. La sanction du 18 octobre fut éclatante : le front républicain emportait 273 sièges, comptant au total 372 députés dans la nouvelle Chambre, tandis que les conservateurs n’en gagnaient que 25 de plus, totalisant 202 élus. Le plus gros retournement de l’histoire du suffrage universel !
Et une leçon à tirer : en démocratie, la politique n’est pas la guerre ; pour gagner, il ne suffit pas d’abattre l’adversaire ni de s’allier avec n’importe qui, il faut aussi proposer quelque chose au peuple, et quelque chose qui ne soit pas le simple retour au passé.
Daniel de Montplaisir
Ndlr : Article initialement publié le 04 octobre 2015
-
Pompei découvertes passées
-
HISTOIRE & TRADITIONS • TRESOR … TRESOR DES ARCHIVES FAMILIALES

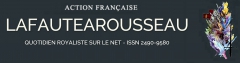 Le représentant d'une famille royaliste, de bonne roture haut-provençale, et qui demande à conserver l'anonymat, est venu récemment à Marseille nous montrer quelques petits « trésors » conservés dans le coffre de sa maisonnée. Au premier chef une pièce de monnaie en argent datée 1831, d'une valeur de 1 franc, à l'effigie du jeune Henri V (1821-1883), plus connu sous ses titres de duc de Bordeaux ou de comte de Chambord (le château de François 1er lui avait été offert par souscription nationale) car il ne régna jamais effectivement.
Le représentant d'une famille royaliste, de bonne roture haut-provençale, et qui demande à conserver l'anonymat, est venu récemment à Marseille nous montrer quelques petits « trésors » conservés dans le coffre de sa maisonnée. Au premier chef une pièce de monnaie en argent datée 1831, d'une valeur de 1 franc, à l'effigie du jeune Henri V (1821-1883), plus connu sous ses titres de duc de Bordeaux ou de comte de Chambord (le château de François 1er lui avait été offert par souscription nationale) car il ne régna jamais effectivement.De Charles X à Henri V
L'existence de cette pièce de monnaie qui n'eut jamais cours, s'explique par l'action de légitimistes au sein de la Monnaie royale, après la Révolution de 1830, laquelle avait chassé de France le roi Charles X et sa famille, dont le petit Henri V, en faveur duquel le vieux monarque avait abdiqué. Lesdits légitimistes croyaient à une restauration bourbonienne, et il y eut d'ailleurs, en 1832, l'héroïque et malheureuse expédition de la duchesse de Berry, mère d'Henri V, expédition commencée dans une crique à l'ouest de Marseille.
Fidèles Henriquinquistes
Ces espoirs ne se concrétisèrent pas et la branche Orléans des Bourbons resta sur le trône, en la personne de Louis-Philippe 1er, jusqu'à la Révolution de 1848. Beaucoup de fidèles henriquinquistes, dont, dit-on, les parents de Jean Jaurès, conservèrent précieusement une de ces pièces qui n'eurent jamais cours. La collection de Raymond JANVROT (1884-1966), entièrement consacrée à Henri V, et toujours montrée à Bordeaux, au Musée des Arts décoratifs, dans une section à part, comprend plusieurs de ces monnaies « illégales ». Cette section vaut la visite.
Héritier légitime
Autre petit trésor politico-sentimental dans les tiroirs de la même famille haut-provençale, cette médaille en cuivre rouge, à l'effigie du roi Louis-Philippe mais donnée par son petit-fils, le comte de Paris (1838-1894), qui faillit régner en 1848, dans le cadre d'une régence et qui, plus tard, fut reconnu comme héritier unique et légitime, par Henri V, qui n'avait pas de postérité.

Orphéon : un mot du XVIIIème siècle
Ladite médaille fut donnée par le jeune prince le 21 mars 1847, moins d'un an avant la date fatidique du 24 février 1848; donnée à un orphéon, c'est-à-dire une fanfare qui s'était produite devant lui. Le mot « orphéon », apparu en France en 1767, fut très en vogue au XIXème siècle, par référence à la figure de la mythologie grecque, Orphée, dont la voix et la lyre charmèrent aussi bien les Sirènes que Cerbère.
-
Pour le dimanche 2 octobre : PRENEZ DÈS MAINTENANT VOTRE BILLET !
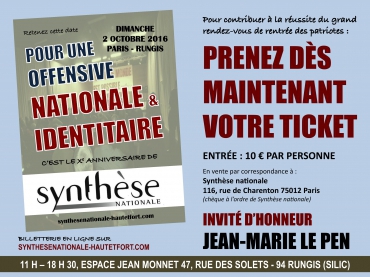
-
Livres • Le nouveau Zemmour++
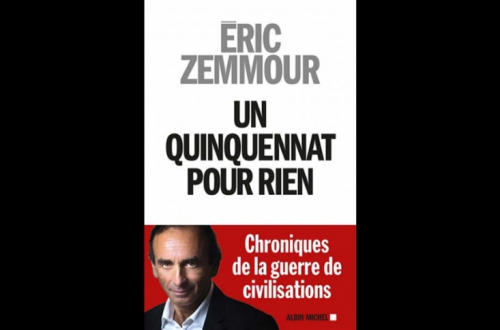 Cela fait quelques temps qu'un nouveau livre d'Eric Zemmour est toujours un événement. Nous n'avons pas encore lu, ni vu de critiques d'Un quinquennat pour rien, qui paraît chez Albin Michel. Voici, en tout cas, pour l'instant, la présentation qui en est faite par l'éditeur. En attendant la suite. LFAR
Cela fait quelques temps qu'un nouveau livre d'Eric Zemmour est toujours un événement. Nous n'avons pas encore lu, ni vu de critiques d'Un quinquennat pour rien, qui paraît chez Albin Michel. Voici, en tout cas, pour l'instant, la présentation qui en est faite par l'éditeur. En attendant la suite. LFAR Le quinquennat hollandais a glissé dans le sang. Avec une tache rouge vif indélébile. Les attentats contre Charlie, l'Hyper Cacher de Vincennes, et la tuerie du Bataclan annoncent le début d'une guerre civile française, voire européenne, et le grand défi lancé par l'Islam à la civilisation européenne sur sa propre terre d'élection.
Ce retour du tragique tranche avec la débonnaireté présidentielle qui confine à la vacuité. Comme si l'Histoire avait attendu, ironique, que s'installât à l'Elysée le président le plus médiocre de la Ve République, pour faire son retour en force. Comme si le destin funeste de notre pays devait une nouvelle fois donner corps à la célèbre formule du général de Gaulle après sa visite au pauvre président Lebrun, égaré dans la débâcle de 1940 : « Au fond, comme chef de l'Etat, deux choses lui avaient manqué : qu'il fût un chef et qu'il y eût un Etat ». Comme si la dégringolade n'avait pas été suffisante, pas assez humiliante, de Pompidou à Sarkozy. Ce dernier avait été élu président pour devenir premier ministre; son successeur serait élu président pour devenir ministre du budget. Un quinquennat pour rien. •
Éric Zemmour est un des éditorialistes français les plus redoutés et les plus lus ou écoutés (RTL, Le Figaro Magazine et Le Figaro). Il conduit le talk-show « Zemmour & Naulleau » chaque mercredi soir sur Paris Première. Il est également l'auteur de plusieurs romans et de nombreux essais polémiques. Son dernier livre, Le suicide français, s'est vendu à 500 000 exemplaires.
http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2016/08/26/livres-le-nouveau-zemmour-5840237.html
-
Le concept de Base Autonome Durable | Par Michel Drac
Michel Drac nous présente son concept de BAD, où une forme de communauté visant à la création d’une contre-société. (Rébellion, n° 49, juillet/août 2011). Même si nous n’avons pas la même approche, plusieurs éléments sont particulièrement utiles dans une réflexion sur les Communautés Autonomes et Offensives.
Le concept de Base Autonome Durable (BAD) est dérivé d’une proposition initialement formulée par Hakim Bey : la Temporary Autonomous Zone (TAZ). L’idée fut à la fois retenue et critiquée par les principaux courants autonomes. Retenue, parce que la TAZ fournissait la possibilité d’une action, même incomplète, même symbolique, face à un ordre devenu trop puissant pour ses opposants. Critiquée, parce le caractère temporaire d’une base autonome sous-entendait que l’autonomie était ici réduite à un simulacre. Par définition, une autonomie temporaire est toujours une autonomie trompeuse. Pour dépasser la TAZ, on inventa donc la BAD : la même chose, mais sous la forme de base, « en dur », « durable ».
De plus en plus de « militants » se transforment en « résistants » sous l’influence du courant survivaliste américain, et ces « résistants » glissent tout doucement vers la conclusion que résistance rime avec résilience, puisqu’au fond, tout commence avec l’autonomie : on ne résiste à un système que si on ne dépend pas de lui. A l’action politique telle qu’on la pense traditionnellement en France, on adjoint ainsi une autre façon de penser le combat : une méthode non-politique servant des fins politiques. Il s’agit non de peser directement sur la vie de la Cité, mais au contraire de s’en abstraire pour la conditionner indirectement, ou plutôt pour en contester le conditionnement par le Pouvoir. « Je ne dis pas que je veux changer les lois de la Cité, je dis que je veux suivre les lois de ma propre cité, hors la Cité » : tel est le slogan. J’avoue que pour ma part, je me reconnais tout à fait dans cette sensibilité.
Ici, nous devons admettre que nous avons affaire, une fois n’est pas coutume, à une forme positive d’américanisation. Et après tout, pourquoi pas ? Depuis des décennies, la France importe pour son malheur toutes les pathologies du modèle américain. Il est justice qu’elle importe aussi quelques-uns des antidotes partiels que l’Amérique réelle a fini par inventer, pour se défendre contre ses démons. A une époque où le Pouvoir se nourrit de la dislocation de la Cité, se mettre à l’avant-garde de ce mouvement de dislocation peut être, pour les résistants, un moyen de battre le Prince à son propre jeu. Il faut considérer l’hypothèse, à tout le moins.
Mais la raison pour laquelle la mode « autonome » peut durer, la raison pour laquelle il faut s’y intéresser, est ailleurs : elle tient au contexte. Le grand effondrement a commencé.
Accrochez-vous, ça va tanguer !
Passons aux choses sérieuses : de plus en plus de gens réalisent que le conte de fées consumériste/productiviste contemporain est un château de cartes, et que le château de cartes peut s’écrouler du jour au lendemain. Il y a quelques années, quand vous expliquiez que la « prospérité » occidentale reposait sur un incroyable trou noir de dettes, que cette économie de casino pouvait s’effondrer comme l’URSS en son temps, et qu’en outre, vu le très haut niveau d’intégration de toutes les chaînes logistiques, il en résulterait une destruction de valeurs et des troubles bien pires que lors de la chute du système soviétique, on vous riait au nez. Aujourd’hui, plus personne ne ricane quand vous tenez ce genre de propos.Que s’est-il passé entretemps ? C’est simple : les gens ont entraperçu le gouffre au bord duquel ils marchaient jusque là en toute inconscience. La crise des subprimes, les évènements de Grèce, la faillite quasi-avérée de nombreux Etats fédérés américains, la menace d’une cessation de paiement de l’Etat fédéral US même : les occidentaux en général, et les Français aussi donc, viennent de réaliser que le malheur, ça n’arrive pas forcément qu’aux autres. La psychologie collective évolue. Le désastre soudain réintègre le champ des possibles. Même la catastrophe globale devient pensable.
Et il y a d’excellentes raisons de penser que cette évolution va se poursuivre et s’accentuer.
Les dirigeants américains et européens peuvent gesticuler : en réalité, on voit bien qu’ils n’ont aucune réponse adaptée aux défis contemporains. C’est particulièrement sensible aux USA – un Empire global qui rappelle de plus en plus l’Empire espagnol dans ces dernières années, rongé par la corruption, affaibli par des guerres ingagnables, drogué par l’abondance d’une monnaie de pillage, une monnaie si abondante qu’elle avait fini par vampiriser toutes les forces productives authentiques. Mais l’effondrement est presque aussi sensible en Europe, ou plutôt dans l’Eurozone et dans ce qui reste du Royaume-Uni, transformé en base financière offshore. Londres achève en ce moment de sacrifier le peuple anglais pour sauver temporairement la City. Paris et Rome sombrent dans le ridicule, avec des chefs d’Etat tout juste capables d’organiser des partouzes (le sympathique Berlusconi) ou de contester à la famille Grimaldi les pages People de Paris-Match (le même-pas-sympathique Sarkozy). La seule capitale occidentale qui semble encore capable de penser l’avenir est Berlin, mais l’avenir qu’on pense là-bas est pour l’instant limité à la vision faussement rassurante d’une épicerie bien gérée. C’est évidemment mieux que Sarkozy ; mais c’est très, très loin de constituer une réponse à la hauteur des défis contemporains.
Pendant ce temps-là, contraste dramatique, l’hémisphère occidental sombre lentement dans le chaos, tandis que l’Asie poursuit une croissance rapide mais malsaine. L’amoncellement de dettes privées et publiques est devenu tel que la simple évocation de son remboursement intégral provoque l’hilarité. La combinaison des produits dérivés et des politiques de taux aberrantes a fini par créer une situation inextricable, dont il est de plus en plus évident qu’on ne pourra sortir que par une faillite globale pure et simple – autant dire que la crise financière en gestation fera passer le 1923 allemand pour une simple péripétie. Personne n’a de réponse satisfaisante à apporter aux questions énergétiques soulevées par les défaillances du nucléaire, la déplétion pétrolière, la déception probable sur l’énergie de fusion. Personne ne sait vraiment comment conjuguer les perspectives démographiques à l’horizon 2030/2040 (+ 2 milliards d’hommes) et les risques que la crise énergétique fera peser sur une production agricole mondiale largement dépendante de l’économie pétrole (engrais, acheminement, mécanisation). Personne ne sait comment, dans ce contexte, réguler les flux migratoires potentiels venant d’Afrique ou du sous-continent indien. Bref, personne n’a de réponse globale à proposer.
La conjonction d’une carte financière ingérable et d’un territoire politique, économique et social réel fragilisé laisse craindre un effondrement pur et simple de toute l’économie contemporaine – quelque chose qui pourrait ressembler à la dislocation de l’espace économique méditerranéen de la chute de Rome à la conquête musulmane, mais à une vitesse bien plus rapide, comme un film passé en accéléré. Il s’agirait alors d’un de ces ajustements brutaux, que l’humanité a déjà connu jadis, et qui viennent sanctionner l’excès de croissance à la fin d’une phase ascendante – la Peste Noire à la fin des grands défrichages en Europe, l’effondrement cataclysmique d’une Chine surpeuplée manquant la révolution industrielle, au XIX° siècle… L’originalité serait que, cette fois, mondialisation oblige, l’ajustement pourrait bien être planétaire.
Bien sûr, ces scénarios noirs ne sont pas les plus probables. Les instruments technologiques contemporains peuvent rendre possible la gestion d’une décroissance harmonieuse, dans certaines limites. On ne peut ni ne doit exclure par hypothèse un atterrissage progressif, une sortie raisonnée de la société de consommation et l’émergence d’une conception plus juste des richesses, des sociétés, des fins mêmes du politique – devant l’imminence de la catastrophe, peut-être l’humanité saura-t-elle se sublimer. Mais le simple fait que la catastrophe globale ait cessé de constituer un scénario absurde, le simple fait qu’il faille prendre en considération la possibilité avérée d’une évolution cataclysmique à moyen terme, suffit à changer radicalement la psychologie collective.
Il va en résulter, en fait il en résulte déjà partiellement, une réévaluation des critères de la décision dans la plupart des domaines susceptibles d’impacter nos vies. A la logique de maximisation du rendement moyen dans un cadre général stable, logique actuellement dominante, va progressivement se substituer une logique de minimisation de la perte latente dans un cadre général dégradé. La robustesse d’une solution sera jugée plus précieuse que sa performance « quand tout va bien ». Seules les très grandes entreprises multinationales n’ont pas encore modifié la hiérarchie de leurs critères de décision, parce que leur fonctionnement est si parfaitement adapté à la mondialisation tous azimuts que la remise en cause du mode de production délocalisé/intégré constitue une révolution mentale difficile pour elles. Les autres acteurs de l’économie, eux, ne s’y trompent pas – particuliers qui recherchent l’autonomie de leur approvisionnement énergétique, même avec des solutions à faible rentabilité, PME s’évadant d’une situation de sous-traitance qui les place en grande vulnérabilité face à des donneurs d’ordre eux-mêmes fragilisés, etc. Dans l’ensemble, un mouvement de raccourcissement des chaînes logistique s’enclenche discrètement.
Dans ce contexte, la BAD est plus qu’une simple alternative impolitique au conditionnement politique. Elle est aussi une idée tendance – et pour de bonnes raisons. C’est pourquoi les dissidences vont vraisemblablement s’en emparer de plus en plus : non seulement c’est un bon moyen de prendre à revers le système tant qu’il fonctionne, mais c’est aussi une garantie de survie s’il s’écroule. Bref, c’est un concept polyvalent, dans une période de grande incertitude sur les ruptures de contexte possibles à court et moyen terme.
On vit ensemble, on meurt ensemble
Au-delà de ces constats sur l’évidente opportunité de la BAD, la vraie question, pour qui tente d’enclencher une démarche en ce sens, est sa faisabilité –les conditions pour rendre faisable un projet de BAD. Et c’est là que les choses deviennent compliquées. Comprendre que la BAD est une bonne idée n’est rien ; le vrai sujet, c’est : comment mettre cette idée en pratique ?
Pour l’instant, la mouvance dissidente et les divers projets survivalistes en sont encore au stade des premières expérimentations. Le concept est de toute manière très polyvalent, et il est probable, souhaitable même, que diverses solutions seront élaborées, adaptées aux situations particulières de tel ou tel sous-groupe. Pour l’instant, l’avancement des expérimentations permet tout au plus de lister les questions-clefs, de les hiérarchiser – on ne peut répondre à tout, mais on commence à avoir une idée précise des domaines où la réponse ne sera pas simple à élaborer. C’est un début.
Les trois enseignements principaux, à ce stade, sont : la complexité de la solution organisationnelle, la nécessité du réseau, l’importance de la préparation psychologique.
Trouver le lieu d’une BAD n’est pas difficile. Dégager le financement peut être plus compliqué, mais finalement, si la motivation est là, on se débrouille toujours. Le vrai problème, c’est d’organiser cette motivation, de lui donner le cadre à l’intérieur duquel les individus se coordonnent.
Ce sont d’abord des questions très concrètes. Par exemple : faut-il acheter le lieu en SCI ? En indivision ? Diviser le bien ou acheter des biens mitoyens ou en tout cas proches ? A combien ? Quel statut pour les membres du projet ? N’y a-t-il qu’un seul type de membre ? Faut-il distinguer des membres permanents et des membres associés ? Quelle fonction exacte pour les uns et les autres ? Comment répartit-on les tâches ? Qui est chargé de contrôler quoi ?
Mais à l’expérience, on s’aperçoit vite que ce dont il est question ici, ce n’est pas simplement de gérer quelques points d’intendance. Il s’agit potentiellement d’inventer la structure de base d’une nouvelle société. Tout simplement parce que derrière la gestion des choses, il y a celle des gens qui vont construire, entretenir et utiliser ces choses.
Or, édifier cette structure de base est un projet à la fois indispensable et très difficile.
Indispensable, parce que toutes les expérimentations en cours confirment la nécessité impérieuse de ne pas penser la BAD comme une monade isolée, mais comme un nœud au sein d’un réseau. Très vite, dès qu’on commence à sortir du « système », on mesure sa vulnérabilité. Certains rêveurs s’imaginent pouvoir déconstruire la matrice qui enserrait leur vie par leurs seules forces. Ce qu’il faut dire à ceux qui nourrissent semblables illusions, c’est qu’il est temps de grandir et de regarder les réalités en face. Un individu isolé, même un petit groupe sans liens avec d’autres groupes, est parfaitement démuni en face des menaces qui peuvent peser sur lui.
Vous n’affrontez pas l’Etat tout seul – au mieux, il prendra le temps de vous manipuler sournoisement avant de vous écraser. Seul, vous ne pouvez même pas assurer votre propre sécurité : les gens qui viendraient armés de mauvaises intentions ne vont pas les afficher à la porte de votre BAD pour que vous puissiez les reconnaître et les repousser aisément. Même contre un autre individu, un individu ne peut pas se protéger seul si son adversaire a l’initiative du lieu et de la méthode. En fait, un individu isolé ne peut même pas se défendre contre lui-même ; il est très vulnérable à toutes les tentatives de manipulation d’un réseau qui voudrait l’inclure pour l’utiliser. Il est d’ailleurs probable que les récents attentats en Norvège fournissent une belle illustration de ce cas de figure.
Si vous êtes seul, vous pouvez avoir l’illusion d’une forme d’indépendance, mais puisque votre sûreté dépend des juges et des policiers de la machine d’Etat, ce n’est, précisément, qu’une illusion. Si vous voulez être réellement indépendant, il faut constituer un réseau d’une taille suffisante pour qu’un adversaire, n’importe quel adversaire, soit paralysé par la menace des mesures de rétorsion que le groupe, soudé, solidaire, prend si l’on attaque un de ses membres. C’est pourquoi la réalité de l’indépendance, de l’autonomie, de la souveraineté, commence toujours par la fabrication d’un collectif.
Prenez la mafia. Evidemment, pas en exemple : moralement, c’est indéfendable. Mais à titre d’illustration du principe d’organisation contre la machine d’Etat. Comme adversaire, pour l’Etat, la mafia, c’est un peu plus sérieux que n’importe quel individu isolé. Il est certain qu’un champion de boxe thaïe est beaucoup plus fort physiquement qu’un quadragénaire fatigué d’1 mètre 70 – le portrait type du soldat dans la mafia italo-américaine. Mais, n’en déplaise aux amateurs de boxe thaïe, comme défi lancé à l’Etat, la mafia, c’est un peu plus sérieux qu’un club de boxe thaïe. Pourquoi ? Parce que nos mafieux à physique al-pacinesque savent se coordonner ; ils ne sont pas une réunion d’individus, ils sont une organisation. Ce ne sont pas des bandits sans foi ni loi. A tout le moins, ils ont une loi : la leur. Eh bien, donnez-moi quelques dizaines de ces types aptes à conduire des manœuvres invisibles coordonnées, et même si ces gars-là sont individuellement inoffensifs, je vous garantis qu’ils formeront collectivement une force redoutable.
Voilà pourquoi la BAD doit d’abord être pensée comme le lieu d’incubation des structures de base d’une nouvelle société, ou plutôt d’une contre-société. Parce que la seule chose qui peut triompher d’un système social, c’est un autre système social.
Le problème, c’est que cette tâche indispensable est rendue aujourd’hui très difficile par la psychologie que les réseaux du système en place ont su instiller aux individus qu’ils entendent dominer. Voilà le principal obstacle qui se dressera concrètement sur le trajet de tous ceux qui tenteront de constituer une BAD : nos contemporains ont désappris à se penser comme parties d’un tout. Chaque individu est enfermé dans la perception de son existence propre comme devant nécessairement être justifiée par elle-même.
Quand vous construisez un projet de BAD, vous réalisez vite que la première ligne de défense du système d’hétéronomie est implantée à l’intérieur même de vous : c’est votre héritage psychologique, modelé par la culture du narcissisme et la dégénérescence pathologique du modèle de la famille nucléaire, devenu anti-modèle de la famille décomposée et mal recomposée. Ne nous attardons pas à multiplier les exemples. Juste une observation : combien de temps faut-il à nos contemporains pour employer sincèrement le pronom « nous » quand ils forment un groupe ? Réponse : ils n’emploient jamais ce pronom – jamais sincèrement, en tout cas.
C’est précisément cette incapacité à penser le collectif qui explique ce syndrome très répandu : le fantasme de toute-puissance. La proportion de personnalités borderline parmi nos contemporains, et particulièrement parmi les personnes encore dotées d’un minimum d’esprit critique, est probablement très supérieure à ce qu’elle était jadis. Cela vient du fait que les individus, se sachant en fait parfaitement impuissants mais, en même temps, restant incapables de sortir de leur individuation radicale, se réfugient dans une posture, voire dans un univers semi-onirique. D’où la multiplication, dans les milieux non conformistes, de survivalistes du dimanche capables d’arrêter une armée à eux tout seuls, de boxeurs de rue imaginaires, etc. Il n’est pas évident de constituer un réseau de BAD à partir d’une population constituée majoritairement d’individus atteints par ce type de pathologies.
La vraie question
En synthèse, la BAD apparaît aujourd’hui comme un concept polyvalent, adapté à un contexte instable. Ce concept séduit parce qu’il propose une voie d’action accessible. Plus profondément, l’esprit du temps entre spontanément en résonnance avec l’idée d’autonomie, à un instant de l’Histoire ou un très grand système fédérateur totalement intégré menace de se disloquer. Mais la réussite ou l’échec de ce concept, dans la pratique et au sein des divers courants de la dissidence, dépendra non de son opportunité, évidente, mais de sa faisabilité. Et cette faisabilité dépend elle-même de la capacité qu’auront les groupes concernés à inventer, pour s’opposer au système qu’ils combattent, la brique de base d’un contre-système – une nouvelle manière d’insuffler une dynamique collective à une masse d’individus atomisés.
Le premier territoire à libérer, avant même celui de nos futures BAD, est donc l’espace mental constitué par l’interconnexion de nos cerveaux. En ce sens, la première BAD est mentale, à l’intérieur de nous. Si l’esprit n’est pas au rendez-vous, la matière ne suivra pas. Au reste, le véritable enjeu du combat a-t-il jamais été ailleurs ?
Par l'OSRE (Organisation socialiste révolutionnaire européenne) -
Piero San Giorgio - Dmitry Orlov : les 5 stades de l'effondrement
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -
COSAQUES : L’ORIGINE DES « GUERRIERS LIBRES » suite et fin
Les pirates cosaques payèrent parfois très cher leurs prises. En 1614, 2.000 d’entre eux rentraient de Sinope où ils avaient incendié l’arsenal quand ils furent surpris par la flotte turque; beaucoup périrent ou, chargés de chaînes, furent conduits à Constantinople et exécutés. Mais leurs camarades ne se découragèrent pas pour autant. L’année suivante, ils partirent à quatre mille sur leurs « mouettes » pour une expédition encore plus audacieuse afin d’aller incendier le port de Constantinople ; une flottille turque les rattrapa en 1616 après qu’ils eurent réussi à brûler le marché d’esclaves de Keffa en Crimée, mais les Cosaques se défendirent avec acharnement et obligèrent leurs ennemis à rebrousser chemin tant ils leur avaient infligé de pertes sévères. Le grand vizir fut mis à mort pour n’avoir pas pris les mesures de défense qui convenaient, et la Porte réunit une conférence en mai 1618 en vue de trouver un antidote efficace aux Cosaques. Ce fut une conférence pour rien. Les raids continuèrent de plus belle. En 1633, 6.000 Cosaques revinrent dans les environs immédiats de Constantinople; en 1634, des Zaporogues et des Cosaques du Don s’embarquèrent sur 150 « mouettes » et, malgré une flotte de 500 galères turques et une garnison de 10.000 soldats, ils réussirent à incendier toutes les installations du Bosphore ; cette fois-ci, la note à payer fut lourde : ils perdirent plus de 100 « mouettes », 2.000 Cosaques périrent et près d’un millier tombèrent aux mains des Turcs. Ce revers ne parut point les affecter. Leur haine solidement implantée contre les Turcs et les Tatars s’ajoutant à leur soif inextinguible de rapines, ils ne se laissaient décourager par rien, et vers 1630 le Sultan, qui était le monarque le plus puissant du monde, se trouva réduit à demander aux Polonais de les exterminer.
Les Turcs, tout puissants qu’ils étaient, avaient fini par apprécier les qualités des Cosaques. Najim, chroniqueur turc du XVIIe siècle, écrivit : « On peut affirmer sans crainte d’être démenti qu’il est impossible de trouver sur cette terre des hommes plus audacieux qui se soucient aussi peu de la vie… et qui redoutent moins la mort. Des experts des affaires maritimes disent que… leur habileté et leur intrépidité dans des batailles navales en font des ennemis plus redoutables que n’importe qui ».
Les vertus militaires des Cosaques étaient aussi élevées sur terre que sur mer. Il le fallait. Les Tatars et les Turcs représentaient une menace constante même pour leurs plus gros établissements et, en 1643 encore, plusieurs villages de Cosaques du Don furent rasés par le feu, tandis que des centaines d’habitants étaient tués ou faits prisonniers. La surveillance ne pouvait pas se relâcher une minute. Des éclaireurs sortaient des postes de guet pour sonder la steppe, prêts à allumer des signaux à la moindre alerte et, s’ils apercevaient l’ennemi qui approchait, à rentrer au galop afin de se réfugier derrière les palissades et les fossés de leur village. Les femmes et les enfants étaient exercés à se joindre aux hommes pour participer à la défense de leurs foyers.
Un Cosaque était toujours prêt à l’action, et il ne sortait jamais sans ses armes. Dès qu’il savait marcher, on lui apprenait à se battre. Un garçonnet était instruit à pratiquer le galop, à faire franchir, à la nage, des rivières à son cheval, à chasser le gibier avec un arc et des flèches. Au XVIIIe siècle, un observateur des Cosaques du Yaïk notait que « depuis leur plus tendre enfance, ils étaient accoutumés à toutes sortes d’équipements difficiles, habitués au maniement des armes à feu, de la lance, et à tirer avec l’arc des hommes d’armes ». Les Cosaques étaient adroits au mousquet, au pistolet, au sabre, à la lance, à la pique et même dans l’emploi de l’artillerie. Comme ils préféraient l’attaque à la défensive, ils portaient rarement des cuirasses et, exercés à l’école de guerre tatare, ils étaient enclins à sortir pour écraser l’ennemi plutôt qu’à l’attendre chez eux pour le repousser. La surprise était l’élément fondamental de leur méthode. Pour surprendre, la mobilité représentait l’atout maître, et le cheval était sur terre leur moyen de mobilité par excellence.
Le serviteur convenait parfaitement à son maître. Pour des Occidentaux, le cheval non ferré de la steppe avait tout l’air d’un cheval sauvage, mais il était robuste et il pouvait partager la vie rude de son cavalier. Petit, léger, ardent, il était résistant, il avait un dos solide et il mangeait n’importe quoi. Il était capable de survivre à un hiver rigoureux sur la steppe sans abri, car il trouvait sa propre subsistance (pas grand-chose) sous la neige ; quand il le fallait cependant, il pouvait franchir sous son cavalier quatre-vingts kilomètres par jour pendant deux semaines successives. « Propre, excellent, endurant, rapide, jamais méchant, commode pour supporter de grandes épreuves », voilà comment le définit un voyageur de l’époque.
Les Cosaques étaient de splendides cavaliers ; audacieux, ils rivalisaient avec les Mongols dans l’amour de l’équitation. Seuls les Zaporogues passaient pour meilleurs fantassins que cavaliers, et ils étaient des marins incomparables. Leur activité se manifesta pourtant aussi bien sur terre que sur mer, car ils maintenaient une pression constante sur les Tatars de Crimée, et ils exécutaient souvent des expéditions en Moldavie et sur les territoires polonais.
Les Cosaques mirent au point des formations et des tactiques spéciales, conformes aux conditions dans lesquelles ils devaient se battre. Ils partaient en campagne en une colonne que flanquaient leurs chariots de bagages et leur artillerie qui avançaient en une ligne parallèle ; cette formation était conçue pour procurer une rapide protection d’ensemble sur la steppe dégagée contre l’attaque subite d’une force tatare plus importante. Lorsqu’ils se heurtaient à l’ennemi, les deux files opéraient leur jonction en tête pour former une pointe, pendant qu’à l’arrière les chariots se déployaient et constituaient la base d’un triangle. Les Cosaques se dépêchaient alors d’enchaîner les chariots les uns aux autres ; s’ils en avaient le temps, ils les retournaient et les enfonçaient dans le sol. En quelques minutes, ils improvisaient un système de défense sans la moindre fissure sur toute la ligne ; ils l’appelaient le tabor ; ce système était plus facile à constituer qu’une défense en carré ou en cercle ; semblable par sa conception au corral de chariots du Far West, il avait pour but de faire face à des situations analogues, car les cavaliers tatars pratiquaient à peu près la même tactique que les Indiens de l’Amérique du Nord : sans trop s’approcher de l’obstacle, ils décrivaient de grands cercles tout autour en l’arrosant de flèches dans l’espoir d’user les Cosaques avant de lancer une charge finale dévastatrice. Les Cosaques, quant à eux, utilisaient leurs meilleurs tireurs pour abattre le plus de Tatars possible, les moins bons les approvisionnant sans défaillance en fusils à pierre chargés ; lorsque les Cosaques estimaient que l’ennemi commençait à perdre de son agressivité, ou s’ils se trouvaient à court de munitions, ils effectuaient une sortie en brandissant piques et sabres. Un millier de Zaporogues en formation de tabor pouvaient maintenir à distance 6.000 cavaliers tatars et constituer un obstacle formidable même pour des soldats instruits à l’école occidentale.
La formation habituelle de la cavalerie cosaque était la lava, c’est-à-dire une ligne incurvée à l’intérieur et, de préférence, assez longue pour s’étendre au-delà des flancs de l’ennemi. Trois lignes chargeaient successivement ; les cavaliers se détournaient vite des points forts du front ennemi pour s’infiltrer par les points faibles comme de l’eau s’écoulant d’une citerne percée. Les Cosaques se rendirent célèbres pour leurs embuscades, pour l’impétuosité bruyante de leurs assauts sur les flancs ou l’arrière de l’adversaire, pour leur maîtrise dans les pratiques les plus perfides de l’art de la ouerre. Si, dans l’ensemble, ils préféraient l’attaque fougueuse à une défense passive, ils étaient néanmoins capables le cas échéant de faire montre d’une patience suffisante pour soutenir un siège prolongé.
Les talents guerriers des Cosaques, sur l’eau comme sur la terre ferme, étaient si reconnus qu’on les recherchait beaucoup pour en faire des soldats payés. Leur habileté à se retrancher et à organiser une défense mobile, leur courage, leur esprit jamais à court de ressources, leur aptitude à supporter des privations sans se plaindre devinrent proverbiaux et, dès qu’ils se furent établis, ils reçurent de multiples invitations à combattre pour d’autres peuples ; les magnats, les barons des marches, des princes et des rois les employèrent en qualité de mercenaires.
Les Polonais les engagèrent toujours individuellement, car ils ne reconnurent jamais une communauté cosaque comme un ensemble, et ils les enrôlaient pour un service permanent, ce qui était un moyen de les intégrer dans la texture générale de l’État. Une loi de recrutement des Cosaques ukrainiens pour l’armée polonaise fut promulguée dès 1524 et, en 1572, le roi Étienne Bathory leva tout un régiment en remettant à chaque Cosaque un coupon d’étoffe et 14 zlotys par an. De temps à autre, lorsque les événements laissaient prévoir d’importantes opérations militaires, les Polonais enrôlaient aussi des Cosaques à titre temporaire. C’est ainsi qu’en 1574 ils en engagèrent un certain nombre pour une campagne en Moldavie et qu’en 1578-1579 ils en recrutèrent davantage encore pour la guerre contre la Russie ; chaque Cosaque reçut 15 florins et du tissu pour deux uniformes. Lorsque la trésorerie de la Couronne le permit, les rois de Pologne immatriculèrent beaucoup plus de Cosaques pour du service permanent, et ils les organisèrent en s’inspirant des méthodes des nouvelles armées de l’Europe occidentale. En 1625, il y avait 6.000 « Polonais » inscrits comme Cosaques, organisés en 6 régiments de 1.000 hommes ; chaque régiment était commandé par un colonel et subdivisé en centuries sous les ordres d’un centurion.
L’immatriculation (ou l’enregistrement) n’était pas seulement un moyen de lever des soldats ; en nommant les officiers et en offrant aux plus courageux des récompenses sous forme de terres, de titres et de privilèges spéciaux, les rois de Pologne pouvaient apprivoiser la masse indisciplinée de la communauté cosaque de l’Ukraine. Les 6.000 Cosaques inscrits sur les registres de l’armée ne représentaient que le dixième de tous les Cosaques aptes à servir, et l’érosion progressive des libertés des neuf autres dixièmes — ou de ceux qui ne fuirent pas pour rejoindre leurs camarades de la Sitch zaporogue — n’allait pas tarder à créer un foyer de révolte en Ukraine.
La Moscovie elle aussi employa des Cosaques « de ville » à titre individuel, mais elle recruta également des soldats parmi les Cosaques libres. En 1552, un certain nombre de ces derniers — sans doute les mêmes « brigands » qui avaient causé tant d’embarras à la Moscovie dans ses relations pacifiques avec les Tatars — avaient aidé Ivan le Terrible à s’emparer de Kazan. Ils servirent le Tsar à Astrakhan et pendant la campagne livonienne de 1579. La Moscovie recruta aussi des Cosaques ukrainiens, dont 500 d’entre eux combattirent pour elle contre le roi de Pologne à Pskov en 1581.
Le gouvernement moscovite négociait les conditions de service par l’intermédiaire des atamans cosaques; il traitait avec eux tout à fait comme un industriel traite avec des délégués syndicaux. En échange de ces services, les communautés cosaques recevaient du salpêtre et du plomb, de l’argent, du grain, de la vodka et d’autres approvisionnements. Plusieurs accords de ce genre furent conclus avec les Cosaques du Don ou du Yaïk entre 1571 et 1600, et l’engagement de Cosaques par les Tsars pour des campagnes particulières devint bientôt une pratique courante qui procurait à diverses communautés libres une source régulière de revenus. Mais il n’y eut pas d’immatriculation comme celle que les Polonais avaient instaurée auprès de leurs Cosaques en Ukraine. L’ambassadeur de Moscovie en Turquie qui alla voir les Cosaques du Don en se rendant à Constantinople en 1592 leur demanda, plus qu’il leur commanda, de vivre en paix avec la garnison turque d’Azov ; lorsque le Tsar essaya de mettre à la tête de leur contingent militaire un homme à lui, Pierre Khrouchtchev, les Cosaques répliquèrent : « Nous avons déjà servi le Tsar, mais jamais sous un autre chef que l’un des nôtres. Nous serons heureux de servir sous les ordres de nos propres chefs, mais pas sous les ordres de Khrouchtchev ».
Philip LONGWORTH
http://www.theatrum-belli.com/cosaques-lorigine-des-guerriers-libres/
-
COSAQUES : L’ORIGINE DES « GUERRIERS LIBRES » partie 3
Bien que l’élevage encourût moins de critiques, il connut des débuts difficiles à cause des raids des pillards. Si l’on avait besoin d’un cheval, il était tellement plus simple d’en voler un aux nomades que de l’élever ! Mais la passion du cheval fit au XVIIIe siècle de nombreux adeptes, notamment au bord du Don, et les Cosaques zaporogues comme ceux du Yaïk finirent par pratiquer sur une grande échelle l’élevage du mouton dans les pâturages riverains.
C’est le poisson qui constitua l’aliment essentiel des Cosaques, ainsi que la principale source de leurs revenus dans les premières années de leur existence. De temps à autre ils pouvaient manger de la viande, du pain de seigle quand il y avait du grain pour le confectionner, mais presque toujours c’était du poisson, frais ou fumé. Au XIXe siècle encore, les Cosaques du Kouban se nourrissaient surtout de poissons séchés ou salés, et la pêche demeura la principale industrie des Cosaques du Yaïk jusque vers 1760. Elle était aussi très importante sur le Don et, si la glace d’hiver sur le fleuve était trop épaisse, comme cela se produisit en 1640-1641, la diminution des prises avait des conséquences fatales pour de nombreux Cosaques qui mouraient de faim .
Pour les premiers pêcheurs cosaques, les rivières étaient pratiquement vierges. Même le Terek, où les tribus Tchétchènes et koumyk avaient pêché avant eux, recelait dans ses eaux des harengs géants, des carpes, des barbeaux, des saumons ; trois espèces d’esturgeons, des sterlets, des carpes et un nombre incroyable d’autres poissons demeuraient tapis dans les rivières et les lacs du Don, et l’on retira du Yak des esturgeons géants qui mesuraient dix mètres de long et pesaient 200 kilos. Les pêcheurs peuvent être enclins à l’exagération, mais un ambassadeur d’Angleterre au XVIIe nous garantit que des Cosaques zaporogues prirent dans le Dniepr des bélougas « longs de trois brasses, dont l’un pouvait à peine être porté par 30 hommes ».
La pêche prit progressivement le caractère d’une industrie organisée, en particulier sur le Yaïk où un ataman spécial supervisait trois grandes expéditions par an. En janvier et février, il prenait la tête d’une caravane de traîneaux portant des Cosaques bien emmitouflés contre le froid. Chaque jour, il délimitait des étendues de la rivière réservées à des équipes de quatre ou cinq hommes qui se mettaient aussitôt au travail, c’est-à-dire qu’ils creusaient des trous dans la glace et hissaient sur la rive leurs énormes prises qui se débattaient. Au printemps, l’ataman de la pêche dirigeait une campagne de trois mois : cette fois, les Cosaques partaient à bord d’embarcations, éperonnaient des esturgeons avec leurs lances, attrapaient des sterlets ; des glanes, des carpes, des brochets, des perches, des brèmes, des chevesnes et d’autres poissons dans leurs filets. Ils prenaient beaucoup plus qu’ils n’en pouvaient consommer et, pendant l’été, ils se mettaient en route avec des charrettes en direction de lacs lointains où ils allaient chercher les énormes quantités de sel qu’il leur fallait pour conserver le surplus. Enfin, en automne, il y avait une saison libre de 3 à 6 semaines, pendant laquelle les Cosaques sortaient par embarcations accouplées pour utiliser des seines pouvant atteindre trois cents mètres de long.
Les poissons pêchés par les Cosaques étaient très demandés dans le monde extérieur, surtout en Moscovie. Un autre voyageur anglais a chanté les louanges de l’esturgeon bélouga : il était, écrivit-il, « plus blanc que du veau et plus délicieux que de la moelle… C’est l’une des plus grandes friandises qui proviennent de l’élément liquide, en particulier son ventre qui surpasse en excellence la moelle du bœuf ». Au terme de chaque saison, des marchands venaient de loin pour acheter des poissons et du caviar qu’ils vendaient sur les marchés de la Russie centrale.
Le Cosaque était obligé de commercer. Il pouvait avoir un surplus de poissons, des fourrures, des peaux, du miel et de la cire, il pouvait même fabriquer pour lui de l’hydromel et de la vodka, mais il lui manquait le grain, les tissus, les clous, le plomb, la graisse, la poudre et les armes qui étaient nécessaires à sa survivance. Même lorsque les Cosaques édifiaient des communautés permanentes, elles ne pouvaient jamais se suffire à elles- mêmes sur le plan économique. Lorsque les villes frontalières russes et polonaises (dont ils dépendaient pour vivre) leur furent fermées, les Cosaques transportèrent parfois leurs marchandises jusqu’à des villes turques comme Azov afin d’obtenir en échange du grain, des étoffes et des produits artisanaux. Plus souvent les marchands allaient les trouver. Des négociants russes, grecs, arméniens et persans furent bientôt des personnages familiers dans les établissements cosaques et ils devenaient quelquefois une particularité permanente dans la vie d’une communauté. Une sorte de banlieue se développa à l’extérieur de la Sitch zaporogue, où des marchands vendaient de la viande, du sel, diverses denrées alimentaires, et où des tailleurs, des bottiers, des boulangers et des brasseurs exerçaient leurs professions. Comme le nombre des fugitifs en terres cosaques augmentait, des communautés acquirent leurs propres artisans : tonneliers, forgerons, armuriers, charpentiers, voire des chapeliers et des orfèvres ; les femmes cosaques apportaient leur contribution à l’économie primitive en filant, en tissant, en faisant pousser des fruits et des légumes devant leurs huttes. Mais dans presque toutes les communautés, les non-Cosaques devaient subvenir aux besoins que les Cosaques ne pouvaient ou ne voulaient pas satisfaire tout seuls.
Si le poisson procurait un excédent commercialisable que les Cosaques pouvaient négocier avec des étrangers, les premiers Cosaques disposèrent de deux autres grandes sources de revenus : la flibuste et le mercenariat. Ils avaient appris des Tatars les techniques du pillage et des rapts ; peu à peu ils ne se contentèrent plus de pourchasser des proies faciles comme des voyageurs égarés en pays sauvage ou des marchands remontant les rivières : ils cherchèrent à soutirer de l’argent aux Turcs et aux Tatars, et leurs opérations pouvaient se révéler très profitables. Les Turcs allaient jusqu’à verser une rançon de 30.000 pièces d’or pour un pacha enlevé, et un marché d’esclaves se développa sur le Don, avec un roulement de deux mille personnes par an, chacune étant vendue de vingt à quarante roubles. Voilà pourquoi les Cosaques, grandissant en nombre et en expérience, se lancèrent dans des expéditions de piraterie en haute mer. La flibuste devint même une spécialité des Zaporogues, terreur des navires marchands ; les grandes galères turques sur la mer Noire les redoutaient plus que les tempêtes et, vers 1600, il n’était pas une ville ou un village sur ces côtes jusqu’à Constantinople même qui pouvait se sentir à l’abri de leurs raids soudains.
Les embarcations des pirates zaporogues n’étaient pas beaucoup plus que des canots de rivière ; elles étaient faites de planches ou creusées dans un tronc d’arbre. Mesurant 20 mètres de long et quatre de large avec un faible tirant d’eau, elles se tenaient très bas sur l’eau, et il fallait les soutenir avec des liasses de roseaux pour qu’elles pussent résister aux vagues de la mer. La voile n’était hissée que par beau temps. Elles étaient habituellement propulsées par des avirons — de 20 à 30 par embarcation, avec deux hommes par aviron — et de grandes pagaies de direction à l’avant et à l’arrière. Un bateau de ce genre pouvait être construit par 60 Cosaques en une quinzaine de jours. On les appelait des tchaiki, c’est-à-dire des mouettes.
Malgré leur petite taille et leur construction fruste, elles étaient assez rapides pour atteindre la côte de l’Anatolie, distante de 500 cinquante kilomètres de l’embouchure du Dniepr, en moins de deux jours; d’autre part, elles présentaient d’importants avantages par rapport aux bateaux beaucoup plus gros qui naviguaient sur la mer Noire : leur maniabilité était supérieure, et elles pouvaient virer de bord avec une facilité plus grande que les galères turques ; enfin, grâce à leur faible tirant d’eau, elles pouvaient pénétrer dans des hauts-fonds inaccessibles à leurs lourds adversaires. Les marins cosaques savaient profiter de tous ces avantages.
Une bonne centaine de tchaiki, bourrées d’hommes et d’approvisionnements, quittaient la Sitch pour une expédition d’importance; les vivres consistaient en biscuits et en millet bouilli, en poissons séchés, en eau potable, mais il n’y avait jamais à bord « d’Aqua vitae ni d’autres boissons fortes car, bien qu’ils fussent aussi prompts à s’enivrer que n’importe quelle nation nordique, ils étaient d’une sobriété miraculeuse quand ils faisaient la guerre », et un Cosaque qui enfreignait cette discipline risquait d’être jeté par-dessus bord par ses camarades. Ils étaient tous bien armés de pistolets, de mousquets, de sabres, et chaque embarcation disposait d’un fauconneau. Mais ils avaient pour armes essentielles le secret et la surprise, et l’obscurité était leur meilleur allié.
La flottille descendait en silence le Dniepr pour émerger parmi les roseaux de l’estuaire dans la mer Noire, à la nuit, en général lorsque la lune en était à son dernier quartier. Lorsque les Cosaques avaient repéré un objectif vulnérable, ils le filaient sous le couvert de la nuit, ou du bord de l’horizon pendant le jour, et ils passaient à l’attaque à l’aube ou au crépuscule quand le soleil ne les gênait pas. Si leur victime choisie se révélait trop coriace, ce qui arrivait parfois, ils rompaient le combat et se réfugiaient dans des eaux peu profondes, à moins qu’ils ne remontassent un cours d’eau propice. Mais dès qu’ils avaient ramassé autant de butin qu’en pouvaient transporter leurs embarcations, ils regagnaient la Sitch avec la même rapidité et la même discrétion qu’ils en avaient mis pour partir.
Pendant tout le XVIIe siècle, les Zaporogues, qu’accompagnaient souvent les Cosaques du Don, furent un véritable fléau pour les navires et les villes côtières de la Turquie et de ses vassaux. Leurs expéditions avaient lieu avec une ampleur et une régularité qui en faisaient presque des actes de guerre, mais ils songeaient bien plus à un profit économique qu’à des avantages politiques. Vers 1600, leurs fréquents succès et la pagaille qui en découlait préoccupaient beaucoup les Turcs, mais aussi les rois de Pologne qui étaient tenus pour responsables de leurs agissements et qui n’en souhaitaient pas moins établir de bonnes relations avec la Porte. En 1604, les Zaporogues attaquèrent les villes lointaines de Trébizonde et de Sinope ; deux ans plus tard, ils descendirent sur Kilia et détruisirent pratiquement le port important de Varna sur la mer Noire. En désespoir de cause, les Turcs lancèrent une grande chaîne en travers de l’embouchure du Dniepr afin de les cantonner sur le fleuve, mais les Cosaques passèrent quand même. Lorsqu’ils ne pouvaient faire autrement, ils suivaient une route détournée par le Savim et transportaient par voie de terre leurs bateaux vers le Mious qu’ils descendaient jusqu’au Don, puis ils débouchaient dans la mer. Les Turcs semblaient tout à fait incapables de les empêcher d’opérer. En 1609, ce fut au tour des trois citadelles du Danube d’être mises à sac et, quatre ans après, les Zaporogues auxquels s’étaient joints des Cosaques appartenant à d’autres communautés se livrèrent à deux attaques d’envergure contre la Crimée dont le khan était un vassal des Turcs.
À suivre
http://www.theatrum-belli.com/cosaques-lorigine-des-guerriers-libres/