
Abonnez-vous cliquez ici
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Abonnez-vous cliquez ici
« Tel que Lénine le voyait, le genre humain se trouvait divisé en deux espèces par un plan horizontal : les exploiteurs ou repus et les exploités ou déshérités. Le seul motif de cette séparation résidait dans le ventre et il n’y avait pas de place pour l’esprit, pas plus d’inspiration divine que satanique (…) L’erreur spécifiquement matérialiste et darwiniste de Lénine fut d’avoir ignoré que si le corps humain est le frère des bêtes, l’âme, dont il ne voulait rien savoir, est la sœur des anges bons ou mauvais. A cause de cela, en opposition à ce qui se passe dans le monde animal et conformément à ce que l’Écriture laisse sous-entendre, l’élément spirituel a la primauté, et ce qui divise véritablement la postérité d’Adam depuis Caïn et Abel, ce n’est pas la lutte pour la vie ou la lutte des classes, mais c’est la guerre des bons et des mauvais anges qui se poursuit depuis le commencement et qui se poursuivra inlassablement jusqu’à la consommation des siècles ».
Ces phrases du comte Emmanuel Malynski, si l’on met à part leur côté mystique, mériteraient d’être méditées, non seulement pour pénétrer l’essence du matérialisme judéo-communiste, mais pour « rectifier » des tendances qui, opportunément masquées, apparaissent souvent dans des théories et mouvements pourtant d’un tout autre type.
On parle trop, par exemple, de la « justice sociale », et rares sont ceux qui ont le courage de mettre en lumière le contenu disparate et souvent de contrebande, que possède cette formule dans les différents cas. Que la « justice sociale », avec la « liberté », soit un des termes dont abuse le plus le jargon démocratique, à des fins, et à des fins seulement, de subversion et d’instauration de formes de tyrannie nouvelles et pires que les précédentes (comme l’enseigne la « dictature » du prolétariat), tout le monde le sait, et c’est une chose qui déjà devrait faire réfléchir. Qu’on ne s’illusionne pas : depuis longtemps, partout où l’on parle de « justice », ce n’est pas l’aequitas, mais l’aequalitas qu’on entend : non la vraie justice, exprimée par le principe classique et romain suum cuique, à chacun son dû ─ naturellement, selon les différences de nature, de dignité, de fonction, mais l’opposé, la prétention prévaricatrice que tout soit mis dans une mesure égale à la disposition de tous.
Or, nous l’avons déjà dit, l’égalitarisme n’est qu’une phase transitoire et un instrument de subversion : il sert à aplanir les voies. Une fois détruits au nom de la « justice » les fondements d’un ordre hiérarchique précédent, une fois éliminées les barrières, se forme un autre ordre, qui est la contrefaçon et l’inversion du premier, comme une pyramide dont la pointe serait en bas. Outre ce qu’on a déjà indiqué sur la « dictature du prolétariat », exprimant un pouvoir qui ne s’est en rien « socialisé » mais qui est devenu le monopole des couches les plus basses, le cas du judaïsme est éloquent. Le Juif a demandé et obtenu l’émancipation ─ lui aussi ─ au nom de la « justice » et de l’« égalité ». Une fois devenu libre, loin de s’assimiler et de travailler « d’égal à égal » à côté du non-Juif, il est passé sur son dos et a occupé, dans de nombreux pays, fût-ce sous une forme parfois invisible, les postes de commande sociaux, politiques et culturels les plus importants.
De toute façon, il est aisé de se convaincre que, même dans les cas les plus favorables, la formule de la « justice sociale » a d’indéniables relations avec les prémisses matérialistes marxistes dénoncées par Malynski dans l’extrait cité plus haut. Naturellement, il est juste ─ juste au sens humain et sous le mode le plus élémentaire ─ que personne ne souffre de la faim, tandis que d’autres seraient nourris et rassasiés par le produit de leur travail. Mais il est difficile que ceux qui visent à la réalisation de telles exigences n’aient pas en propre une autre idéologie, inavouée et d’autant plus importante pour eux : la volonté de la masse de conquérir des positions enviées, de s’emparer des mêmes biens, méprisés dans la personne d’une autre classe, mais convoités, considérés comme tout aussi essentiels et décisifs.
On a beaucoup parlé, en relation précisément avec la formule de la « justice sociale », de « déprolétariser » l’ouvrier et le paysan. Mais, dans ce domaine, on fait presque toujours fausse route. La véritable « déprolétarisation » consisterait à reconduire l’ouvrier et le paysan à eux-mêmes, à les désintoxiquer de l’envie, de la soif, des ambitions et des besoins artificiels et antinaturels excités en eux par l’idéologie classiste. Cela reviendrait à les aider à retrouver leurs voies et la dignité de leurs fonctions dans le tout d’un organisme hiérarchique bien différencié. Au contraire, dans de nombreux cas, la justice sociale consiste à accueillir ─ tantôt par peur, tantôt par inconscience, parfois encore par compromis ─ les aspirations antinaturelles et « modernes », inoculées dans les masses par le socialisme et par des idéologies subversives analogues : la « déprolétarisation » signifie alors aider les masses ouvrières à « s’embourgeoiser », à atteindre le plus possible un niveau de vie « bourgeois », avec ses commodités, ses distractions, sa médiocrité ─ pour ne pas dire carrément sa platitude spirituelle. On fait le procès de la bourgeoisie, mais c’est pour que le prolétariat puisse devenir lui-même bourgeoisie, pour qu’il adopte, fatalement, les défauts et les vices mêmes de la bourgeoisie.
Le facteur spirituel n’entre pas le moins du monde dans tout cela. Salaires, estomacs vides ou estomacs pleins, « droits » ou non droits sur le plan, toujours, de la matière et de l’économie, tels sont les seuls facteurs de la question. Et l’on arrive très difficilement, aujourd’hui, à concevoir ce que l’on considérait comme normal en des temps précédents : à savoir que la richesse et la puissance n’ont rien à voir avec les valeurs et la supériorité ; et puisque les premières ne créent pas les secondes, elles ne les détruisent ou ne les compromettent pas non plus. C’est un fait, d’ailleurs, que l’élément « déprolétarisé », embourgeoisé et urbain de l’Europe centrale, malgré son vernis extérieur « civil », son impertinence envahissante, la conscience de ses « droits » et de sa « fonction sociale », représente un type humain nettement inférieur, du point de vue du caractère et des valeurs intérieures, à l’artisan tyrolien, au paysan calabrais, au berger sarde ou hongrois, quelles que soient l’indigence et les conditions de vie et de culture souvent tristes de ces derniers, quel que soit aussi leur faible désir de « s’élever ». Ceux-là sont encore des hommes et se trompent rarement dans le jugement qu’ils portent sur qui est différent d’eux et vraiment supérieur à eux. Les autres sont de la sciure humaine, un élément informe, tout à la fois impertinent et encombrant.
Il serait donc opportun de ne pas jouer avec des formules ambiguës et d’appeler chaque chose par son juste nom. Même dans le cadre de la polémique contre la bourgeoisie, on a presque toujours négligé l’essentiel, à savoir la référence aux valeurs et aux motivations qui transcendent le domaine de l’économie et en faveur desquelles le fascisme s’est déclaré explicitement. Le fait d’aller vers le peuple, la justice sociale, l’antibourgeoisie, etc., ne doivent pas servir à une circulation des élites au sens parétien le plus banal, celui d’une classe qui passe sur le dos d’une autre, la remplace, tout en perdant ses qualités originelles et naturelles pour acquérir toutes les caractéristiques et tous les vices de l’autre classe.
Et il faudrait être encore plus prudent lorsqu’on parle de « justice sociale » sur le plan international, afin que la même équivoque ne se reproduise pas et afin, que une fois, que la motivation matérialiste n’en vienne pas à constituer l’ultima ratio. Le droit des peuples qui « n’ont pas d’espace » est un droit humain. Mais qu’on ne confonde pas les choses, qu’on ne confonde pas un droit avec un autre et qu’on ne ramène pas la dialectique des nations à un échange, mutatis mutandis, de rôles. Ni le fait d’avoir plus, ni a fortiori le fait de ne pas avoir ou d’avoir peu, tant dans l’ordre d’une race particulière que dans l’ordre d’un groupe de races.
Le seul titre légitime pour le pouvoir et la suprématie, c’est la supériorité.
Julius Evola
Essais politiques
Deuxième partie : Économie et critique sociale
Article IV : Les limites de la « justice sociale » (1940)
Édition Pardès, 1988, p. 195-199
Source : Front de la Contre-Subversion
https://la-dissidence.org/2016/08/12/julius-evola-les-limites-de-la-justice-sociale/
♦ Pierre Le Vigan, est architecte, urbaniste, diplômé en psychopathologie et en histoire ; il est l’auteur de plusieurs livres et a participé à plusieurs ouvrages collectifs dont le Liber amicorum Alain de Benoist (2003 et 2014). Il a notamment publié «L’Effacement du politique / La philosophie politique et la genèse de l’impuissance de l’Europe».
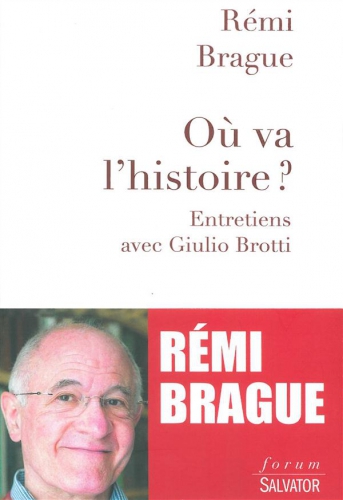 Il n’y a qu’une chose qui ne soit pas très pertinente dans le livre d’entretien du professeur Rémi Brague avec Giulio Brotti, c’est le titre. Il ne s’agit pas de savoir « où va l’histoire ». Car l’histoire n’est pas un véhicule, c’est le réseau même des routes possibles. C’est la carte. Il s’agit de savoir, non où va l’histoire, mais où va l’homme.
Il n’y a qu’une chose qui ne soit pas très pertinente dans le livre d’entretien du professeur Rémi Brague avec Giulio Brotti, c’est le titre. Il ne s’agit pas de savoir « où va l’histoire ». Car l’histoire n’est pas un véhicule, c’est le réseau même des routes possibles. C’est la carte. Il s’agit de savoir, non où va l’histoire, mais où va l’homme.
Il s’agit de savoir où nous allons, juchés sur le véhicule que nous avons-nous même construit, et sur lequel nous avons décidé de nous arrimer, et qui est la modernité. Une modernité « tardive », comme disait Friedrich Schiller, mais qui tarde en tout cas à se terminer. Elle se retourne sur elle-même pour mieux reprendre de l’élan, et ne cesse de détruire ses propres fondements : la croyance en l’homme, au progrès, en l’universalisme. La modernité, tardive ou hyper, est une machine en apparence folle. Mais est-elle si folle ? Elle a sa logique. Elle est en fait autophage.
Dans les lignes qui suivent, nous serons moins dans la digestion, c’est-à- dire la paraphrase, que dans l’inclusion, c’est à dire le commentaire, que Rémi Brague qualifie comme « le modèle européen de l’appropriation culturelle ».
L’entretien avec Rémi Brague porte sur l’esprit de notre temps. Il déroule la question : pouvons-nous continuer l’homme si nous ne croyons plus en l’homme ? En d’autres termes, si nous ne savons plus quelle est la place que nous avons à tenir sur terre, si nous ne croyons plus à notre part de responsabilité, si notre présence au monde ne relève plus que du ludique, à quoi bon poursuivre l’homme ? On objectera que, justement, les hommes sont de plus en plus nombreux. Mais l’humanité est par là même de plus en plus fragile, et de plus en plus menacée de perdre son humanité.
Il y a de plus en plus d’hommes ? Mais ne seront-ils pas de moins en moins humains ? On peut appeler cela « oubli de l’être ». Il ne s’agit pas d’un énième « c’était mieux avant » ou de quelque chose comme « l’oubli de son parapluie », comme dit plaisamment R. Brague. Il s’agit de l’oubli de ce que l’être peut manifester. De ce qu’il peut dévoiler. D’abord lui-même. La question est : qu’est-ce que nous avons oublié ? Et nous pouvons déjà avancer quelques éléments de réponse. Que l’historicité de l’homme n’est pas seulement le « tout passe ». Qu’il y a des permanences, celles que les religions et les philosophies explorent, chacune à leur façon.
Pour comprendre la place de l’homme dans le monde, il faut tenter de comprendre le sens de l’histoire humaine. « Le sens de l’histoire » est le titre d’un livre de Nicolas Berdiaev. Cela ne veut pas dire que l’histoire n’a qu’une direction mais cela signifie qu’elle n’est pas absurde, insensée. Il nous arrive ce qui nous ressemble. Comprendre le sens de l’histoire nécessite de comprendre l’histoire de la pensée. Rémi Brague souligne que nous avons longtemps sous-estimé intellectuellement le Moyen Age. Nous sommes passés des Antiques aux Renaissants, directement. Or, comprendre la pensée nécessite de comprendre le moment central du Moyen Age. Au moins dix siècles. Car, comme le remarquait Etienne Gilson, la Renaissance est toute entière dans la continuité du Moyen Age. C’est « le Moyen Age sans Dieu », disait encore Gilson. Ce qui, à la manière de Hegel, doit, du reste, être compris non comme un manque mais comme l’intégration d’une négativité.
Justement, sans Dieu, comment fonder la morale ? « Que dois-je faire ? » s’interroge Rémi Brague à la suite de Kant. L’idée du « bien faisable », idée d’Aristote, suffit pour cela. Mais comment hisser les hommes au niveau nécessaire pour que l’humanité ait un sens ? En d’autres termes, la morale n’est pas qu’une question de pratique. Il est besoin de ce que Kant appelait une raison pure pratique. Sa forme moderne pourrait sans doute être définie comme une esthétique de la morale, telle qu’on la trouva chez Nietzsche, ou encore, très récemment, avec Dominique Venner.
Pour cela, c’est l’idée platonicienne du Bien (difficile ici d’éviter la majuscule) qui est nécessaire. Cette idée du Bien rejoint celle du Vrai, du Beau et celle de l’Un : c’est la convertibilité des transcendances, expliquée par Philippe Le Chancelier et d’autres théologiens du Moyen Age. C’est leur équivalence, qui n’est pas leur identité mais est leur correspondance (l’analogie avec les correspondances de métro serait ici à la fois triviale et parfaitement adaptée). Le Bien, le Beau, le Vrai sont différentes formes d’une même hypostase, telle est l’idée néo-platonicienne que l’on trouve chez Flavius Saloustios, un des « intellectuels d’État » de Julien l’Apostat, le rénovateur du paganisme. N’ayant précisément pas eu lieu durablement, la restauration du paganisme laisse dissociés le beau, le vrai, le bien (ou encore le bon). D’où un malaise dans l’homme.
On rencontre parfois l’idée que la genèse de la modernité vient, avec Copernic, de la fin de la position centrale de l’homme. Ce n’est pourtant pas la même chose que la fin du géocentrisme et la fin de l’anthropocentrisme. Mais Brague soutient qu’il n’y a pas eu de fin de l’anthropocentrisme car il n’y avait pas d’anthropocentrisme. L’homme antique ne se voyait pas dans une position centrale, mais au sein d’un système du vivant. Voilà la thèse de Brague.
Est-ce si sûr ? « Mais que l’homme soit un animal politique à un plus haut degré qu’une abeille quelconque ou tout autre animal vivant à l’état grégaire, cela est évident. La nature en effet, selon nous, ne fait rien en vain, et l’homme de tous les animaux possède la parole. Or tandis que la voix sert à indiquer la joie et la peine, et appartient pour ce motif aux autres animaux également (car leur nature va jusqu’à éprouver les sensations de plaisir et de douleur, et à se les signifier les uns aux autres), le discours sert à exprimer l’utile et le nuisible et, par suite aussi le juste et l’injuste. Car c’est le caractère propre de l’homme par rapport aux autres animaux, d’être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l’injuste, et des autres notions morales, et c’est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité » (Politiques I, 2).
A partir d’Aristote, n’y a-t- il pas anthropocentrisme même si l’homme n’est pas en surplomb, même s’il ne lui est pas demandé d’agir « comme maître et possesseur de la nature », comme régisseur du vivant, mais bien plutôt de le ménager, d’en prendre soin ? (le christianisme de François d’Assise ne sera d’ailleurs pas loin de cette vision). L’anthropocentrisme n’est pas la dévoration du monde par l’homme, tant que la modernité ne se déchaîne pas. Tant qu’elle reste « modérément moderne ».
Le contraire de l’anthropocentrisme, c’est l’homme dans le flux du vivant. Nous sommes d’ailleurs revenus à cela avec Michel Foucault et la fin de la sacralisation de l’homme et de sa centralité. Le paradoxe est que nous sommes dans une société du contrat au moment où notre sociologie et le structuralisme tardif nous expliquent que le sujet n’en est pas vraiment un et que, somme toute, l’homme n’existe pas mais est « agi » par des forces et structures qui le dépassent. Dès lors, nous quittons la modernité classique pour autre chose. Ce que met à mal la culture post-moderne (ne faudrait-il pas plutôt parler d’idéologie, terme nullement dépréciateur dureste ?) c’est, nous dit Rémi Brague, trois choses : l’historicité, la subjectivité de l’homme, la vérité.
Nous avons aboli le monde vrai et la distinction entre vrai et faux, nous avons aboli le sujet et nous avons aboli le propre de l’homme qui est d’être un être historique. En d’autres termes, « l’homme est mort » – et pas seulement « Dieu est mort » (ce que Nietzsche constatait avec déploration, craignant que nous ne soyons pas à la hauteur du défi)). Dieu est mort et l’homme est mort. Et l’un est peut-être la conséquence de l’autre, suggèreRémi Brague. La sociobiologie a pris la place de l’histoire, la sociologie a pris la place du sujet (« les sciences humaines naturalisent l’histoire » explique Brague), la sophistique postmoderne a pris la place de la vérité, ou tout du moins de sa recherche. Les Anciens (on est Anciens jusqu’à la Révolution française, hantée elle-même par l’Antiquité) voulaient améliorer l’homme. Nous voulons maintenant le changer. Nous oscillons entre le rêve transhumaniste, qui n’est autre qu’un posthumanisme, et une postmodernité liquide qui relève d’un pur vitalisme dont l’une des formes fut, disons-le sans tomber dans le point Godwin ou reductio ad hitlerum, le national-socialisme. ( comme le montre très bien la confrontation des textes de Werner Best, doctrinaire nazi du droit, et de Carl Schmitt, in Carl Schmitt, Guerre discriminatoire et logique des grands espaces, éditions Krisis, 2011, préface de Danilo Zolo, notes et commentaires de Günter Maschke, traduction de François Poncet. On y voit que Best critique Schmitt au nom d’un vitalisme que Schmitt refuse d’adopter. Dont acte. Face à ce double risque de liquéfaction ou de fuite en avant transhumaniste, Rémi Brague rappelle le besoin de fondements qui nomme métaphysiques mais qui ne viennent pas forcément « après » la physique, dans la mesure où ils donnent sens àl’horizon même du monde physique. Rémi Brague appelle cela des « ancres dans le ciel » (titre d’un de ses précédents ouvrages).
L’image est belle. Elle contient par la même une vérité. Elle va au-delà de la révélation chrétienne, qui peut sans doute en être une des formes. Mais certainement pas la seule. Heidegger parlait de « marcher à l’étoile ». Une autre façon d’avoir une ancre dans le ciel.
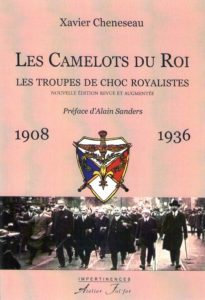 Xavier Cheneseau est journaliste et écrivain.
Xavier Cheneseau est journaliste et écrivain.
Les Camelots du Roi, fondés en 1908 à l’initiative de Maxime Real del Sarte, doivent leur nom au motif qu’ils étaient célèbres pour vendre le journal quotidien de l’Action Française à la criée.
A travers ce livre, Xavier Cheneseau nous raconte la geste de cette cohorte de militants royalistes qui ne ménagea jamais sa peine. Pour se défendre – et rendre les coups -, ils n’avaient que leurs cannes plombées. Et, pour se protéger des mauvais coups, ils bourraient leur chapeau de papier journal. Face à eux, ils avaient tour à tour les communistes, les anarchistes et les nervis de la police politique. Ce vaste mouvement national et populaire s’était donné pour mission de défendre la France contre vents et marées. La République ne leur épargna aucun coup bas. Et, en 1936, le gouvernement de Front Populaire fit prononcer la dissolution de la Ligue d’Action française et des Camelots du Roi. Durant près de vingt ans de lutte, les Camelots du Roi ont servi la France à leur manière, insolente et déterminée.
Les Camelots du Roi, Xavier Cheneseau, préface d’Alain Sanders, éditions Atelier Fol’fer, 180 pages, 21 euros (prix franco)
A commander en ligne sur le site de l’éditeur


La Semaine de MAGISTRO - Adossée à des fondamentaux politiques avérés, Magistro, une tribune critique de bon sens, raisonnée et libre, d'information civique et politique.
A tout un chacun
• Mezri HADDAD Philosophe, ancien Ambassadeur à l’UNESCO La sécurité est le premier des droits de l'homme !
• Chantal DELSOL Professeur de philosophie politique, Membre de l'Institut La vertu du courage
Du côté des élites
• Aude de KERROS Sculpteur, graveur, Essayiste Le maire de Londres chasse Vénus de la publicité : iconoclasme moderne ?
En France
• Yves GAZZO Ambassadeur - Vice-président de l'Académie des sciences d'Outremer De la guerre d'Algérie à la guerre en France ?
• Renaud GIRARD Journaliste, reporter de guerre, géopoliticien Le combat essentiel contre le djihadisme ne se livre pas en Syrie, mais en France
• Dominique REY Evêque de Fréjus-Toulon "Un prêtre a été égorgé pendant la messe"
Avec l'Europe
• Christopha GEFFROY Directeur fondateur de la revue La Nef Une leçon de démocratie
• François JOURDIER Officier, amiral (2S) Et Donald Trump est arrivé
De par le monde
• Roland HUREAUX Essayiste L'Occident et l'islamisme
Faites suivre à vos amis, dans votre famille et partagez ... MAGISTROvous invite aussi à vous rendre sur son site et y (re)lire tous les écrits depuis son origine (2008). MERCI.