Ce texte est un extrait de la préface à La notion du politique, Carl Schmitt, éd. Flammarion, 2009, pp. 14-17
Quel est le centre de gravité de sa philosophie politique ? Je crois l’avoir saisi, un jour que je me promenais avec lui à Plettenberg et que je l’interrogeais sur sa position à l’égard de la République de Weimar. « La Constitution de Weimar, me dit-il, fut belle, presque parfaite juridiquement, mais trop belle pour être encore politique. Elle a évacué la politique au profit d’une constitution idéale, abstraitement idéale. Par la nature des choses une constitution doit être politique. Que faire politiquement d’un texte qui élimine d’emblée la politique, c’est-à-dire le plein exercice du pouvoir ? » Pour avoir longuement réfléchi à ces paroles, j’avance à titre d’hypothèse une interprétation de la pensée de C. Schmitt qui montre son actualité. Il est impossible d’exprimer une volonté réellement politique si d’avance on renonce à utiliser les moyens normaux de la politique, à savoir la puissance, la contrainte et, dans les cas exceptionnels, la violence. Agir politiquement, c’est exercer l’autorité, manifester de la puissance, sinon on risque d’être emporté par une puissance rivale qui entend agir pleinement du point de vue politique. Autrement dit, toute politique implique la puissance ; elle constitue un de ses impératifs. Par conséquent, c’est agir contre la loi même de la politique que d’exclure d’emblée l’exercice de la puissance, en faisant par exemple d’un gouvernement un simple lieu de concertation ou une simple instance d’arbitrage à l’image d’un tribunal civil. La logique même de la puissance veut qu’elle soit puissance et non pas impuissance. Et, puisque par essence la politique exige de la puissance, toute politique qui y renonce par faiblesse ou par juridisme cesse aussi d’être réellement de la politique, parce qu’elle cesse de remplir sa fonction normale du fait qu’elle devient incapable de protéger les membres de la collectivité dont elle a la charge. Le problème n’est donc pas pour un pays de posséder une constitution juridiquement parfaite ni non plus d’être en quête d’une démocratie idéale, mais de se donner un régime capable de répondre aux difficultés concrètes, de maintenir l’ordre en suscitant un consensus favorable aux innovations susceptibles de résoudre les conflits qui surgissent inévitablement dans toute société. De ce point de vue, la critique de la République de Weimar faite par Carl Schmitt ne procède pas du tout d’une intention hostile à ce régime, mais du souci de lui donner l’autorité suffisante pour mener une politique efficace. C’est ce qui ressort clairement de l’ouvrage Legalität und Legitimität publié à peine quelques mois avant la venue au pouvoir de Hitler. Il s’agissait comme Schmitt le déclare lui-même d’une « tentative désespérée pour sauver le système présidentiel, la dernière chance de la République de Weimar, face à une jurisprudence qui refusait de poser le problème de la constitution en termes d’amis et d’ennemis ». Au fond, c’est au nom d’une fausse conception de la légalité que les défenseurs attitrés de la Constitution de Weimar ont finalement permis à Hitler de venir de venir légalement au pouvoir.
Pour comprendre les conceptions de Carl Schmitt il faut donc se replacer à l’époque où sa pensée politique s’est formée, au contact de Max Weber1, et où il a publié ses premiers ouvrages d’analyse politique. C’était justement le temps où le gouvernement allemand, faute de se donner les moyens de la politique, était à la merci de putschs successifs et de pressions extérieures qui ont conduit à l’occupation de la Ruhr. Le pouvoir essayait de compenser l’impuissance à laquelle il s’était lui-même condamné en multipliant les vagues promesses tendant à substituer à la démocratie politique la démocratie sociale, , celle-ci étant présentée comme la démocratie idéale, celle qui devrait exister et dans laquelle l’éthique réglerait mieux les difficultés que l’autorité et la puissance. Pour Carl Schmitt, une démocratie ne pouvait être sociale que si d’abord elle était politique, c’est-à-dire si elle acceptait pleinement les impératifs et les servitudes de la politique. Il n’a cependant jamais été partisan d’une puissance illimitée – il était trop juriste et spécialiste du droit constitutionnel pour soutenir une pareille aberration – mais il refusait une politique qui excluait le vrai jeu politique et espérait s’en tirer avec des mots d’ordre creux concernant la paix, le progrès social ou l’avenir du socialisme. Il s’agissait d’une politique de la non politique (Politik des Unpolitischen) qui ne pouvait que conduire à la pire des politiques, faute de prendre ses responsabilités. La problématique de la politique, C. Schmitt l’a posé dans les catégories de Hobbes, comme le montre de façon caractéristique le texte suivant : « Pourquoi les hommes donnent-ils leur consentement à la puissance ? Dans certains cas par confiance, dans d’autres par crainte, parfois par espoir, parfois par désespoir. Toujours cependant ils ont besoin de protection et ils cherchent cette protection auprès de la puissance. Vue du côté de l’homme, la liaison entre protection et puissance est la seule explication de la puissance. Celui qui ne possède pas la puissance de protéger quelqu’un n’a pas non plus le droit d’exiger l’obéissance. Et inversement, celui qui cherche et accepte la puissance n’a pas le droit de refuser l’obéissance2 ». Cette façon de poser le problème de la politique suscite évidemment d’autres problèmes que nous ne soulèverons pas ici, puisque notre objet est de présenter la pensée de Carl Schmit.
…
1 Il n’y a pas de doute que C. Schmitt est le véritable fils spirituel de Max Weber. Même ses adversaires le reconnaisse, malgré leur ironie, par exemple J. Habermas lors du congrès Weber à Heidelberg en 1964.
2 C. Schmitt, Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber, Pfullingen, 1954, p. 11.
http://www.voxnr.com/3311/carl-schmitt-politique-puissance-julien-freund
 Notre ami et collaborateur Jean-Claude Rolinat sera l'invité de Philippe Conrad dans l'émission Passé/Présent sur TV Libertés le mardi 6 septembre pour, notamment, évoquer ses derniers ouvrages
Notre ami et collaborateur Jean-Claude Rolinat sera l'invité de Philippe Conrad dans l'émission Passé/Présent sur TV Libertés le mardi 6 septembre pour, notamment, évoquer ses derniers ouvrages 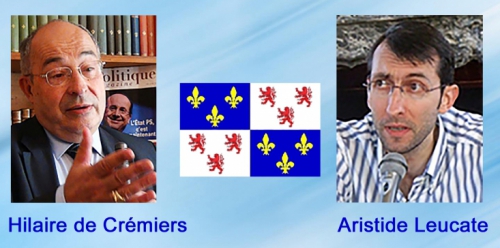

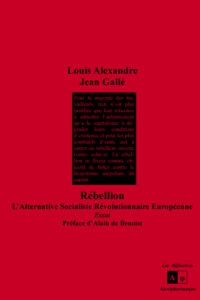 Ce serait une grave erreur de croire que le socialisme (terme employé pour la première fois, dans son sens moderne, par Pierre Leroux en 1831) n’avait pour but, à l’origine, que de réagir contre l’abominable exploitation des masses prolétariennes que la révolution industrielle avait jetées dans les grandes villes et soumises à des conditions de travail bien souvent inhumaines. Les premiers socialistes dénonçaient bien entendu cette exploitation, protestaient contre leurs conditions de travail et exigeaient l’instauration de la justice sociale. Mais en se dressant contre la classe bourgeoise, ils se dressaient aussi contre le système des valeurs dont celle-ci était porteuse.
Ce serait une grave erreur de croire que le socialisme (terme employé pour la première fois, dans son sens moderne, par Pierre Leroux en 1831) n’avait pour but, à l’origine, que de réagir contre l’abominable exploitation des masses prolétariennes que la révolution industrielle avait jetées dans les grandes villes et soumises à des conditions de travail bien souvent inhumaines. Les premiers socialistes dénonçaient bien entendu cette exploitation, protestaient contre leurs conditions de travail et exigeaient l’instauration de la justice sociale. Mais en se dressant contre la classe bourgeoise, ils se dressaient aussi contre le système des valeurs dont celle-ci était porteuse.