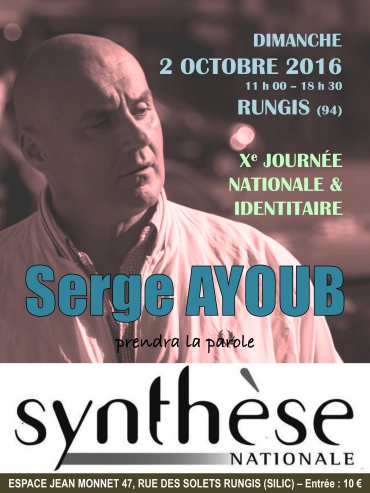Caroline Alamachère Riposte laïque cliquez ici
Ce week-end se tenait à Chiré-en-Montreuil le 50e anniversaire des éditions de Chiré durant ces 46e Journées Chouannes.
Tandis qu’un coq ponctuait les différentes interventions de son chant retentissant et que les enfants s’inventaient des jeux simples à base de bouts de bois et d’un nécessaire sens de l’imagination dangereusement absent de la masse enfantine, les sessions s’égrenaient entre critiques de la République, des francs-maçons, de l’islam, des destructeurs de la société, de la cellule familiale, de l’identité, de la France.
La première journée a débuté par le thème de la République, avec notamment la présence de Jean-Pax Méfret.
La session suivante évoquait « l’homme dénaturé ». L’écrivain Yvan Blot y a dénoncé les droits de l’Homme, redoutable invention révolutionnaire dont il a expliqué qu’ils « sont une imposture majeure et qui conduit souvent au crime ».
L’historienne Marion Sigaut, laquelle a eu un échange virulent avec le fondateur de RL venu la saluer un peu plus tard alors qu’elle dédicaçait ses ouvrages, a parlé de ce nouveau droit à la santé par la sexualité. En effet, d’après un rapport de l’ONU disant que tout individu doit avoir le droit à jouir dans la sexualité sans reproduction, Ban Ki Moon lui-même y étant favorable, il ressort que ce droit vaudrait également pour les enfants dès l’âge de… 10 ans ! Najat Vallaud-Belkacem serait d’ailleurs sur le coup pour la mise en œuvre de ce texte. Si un tel projet est appliqué, il sera dès lors interdit à des parents de s’opposer à toute forme de sexualité de leurs petits, avec toutes les dérives monstrueuses que cela implique. Ce qui fait aujourd’hui le fondement de la moralité publique, sociétale, se transformera alors en délit de discrimination en cas de contestation des parents, avec la disparition, de fait, de l’autorité parentale.
On repensera à cette funeste phrase de Vincent Peillon disant qu’il fallait « arracher l’enfant au déterminisme familial ».
Marion Sigaut a rappelé l’histoire récente de cet enfant violé dans une piscine municipale par un « migrant », lequel, une fois appréhendé par la police, avait justifié son acte par l’urgence de son désir… Avec une telle loi, le viol, au sens large, sera donc dorénavant un droit légal. Elle a ensuite évoqué le cas du sexologue Alfred Kinsey, celui qui s’enfonçait plein d’objets hétéroclites dans l’urètre, et dont les travaux ont été très suivis jusqu’à mener à de telles dérives.
La pause déjeuner a été l’occasion de rencontrer nombre d’auteurs et d’échanger avec eux dans une ambiance bon enfant et conviviale. Dans les allées au milieu des livres déambulaient des abbés en soutane, des Dominicaines, des vieilles dames, des jeunes parents avec leur bébé, des gens venus de toute la France, à en juger par les plaques minéralogiques des voitures.
Chaque journée a compté 900 personnes, avec une logistique remarquable. Nombre de jeunes étaient au service des visiteurs, sourire aux lèvres et bienveillance au cœur. Et nulle part de détritus par terre. On est bien éduqués chez les cathos, on apprend à respecter les autres, à respecter la terre. On est naturellement écologique et on rend service. Quand on vient, comme moi, de la banlieue parisienne où chaque mètre carré se transforme en poubelle naturelle, le contraste n’en est que plus saisissant.
Tout au long de ces journées, l’identité et le fléau islamique ont été des sujets centraux, récurrents, revenant tant dans les conversations des uns et des autres et sans le moindre complexe, que chez les intervenants aux sessions. L’islam, l’un des sujets de l’après-midi, a d’ailleurs été un thème fortement apprécié de l’auditoire parfaitement et unanimement conscient de sa dangerosité pour notre civilisation, d’autant plus que nombre de personnes dans ce milieu connaît l’Histoire de France et de l’Europe et sait donc parfaitement quels méfaits au cours des siècles a pu produire cette idéologie, à commencer les des siècles d’esclavage des chrétiens par les Arabo-musulmans.
Le début de l’après-midi a été consacré au Droit, avec notamment le rappel des iniques lois mémorielles Pleven et Gayssot, la première votée en 1972 à l’unanimité dans un hémicycle aux trois-quarts vides, ces lois qui jugent non pas des faits mais des sentiments. La loi Pleven a supprimé la primauté du droit national, aujourd’hui déclassé, pour lui substituer la primauté du droit des étrangers, une notion qui prend naissance dans la Révolution pour laquelle tous les êtres humains se valent sans distinction. Les « droits de l’Homme » ont été transformés en droits positifs en devenant « les droits humains ». Une nouvelle religion est née. Avec ces nouveaux droits pour tous sauf pour l’individu de souche, la destruction de notre peuple n’a plus qu’à se faire de l’intérieur.
Sont intervenus ensuite Jean-Yves Le Gallou et Hubert Lemaire sur le thème de l’immigration et de l’islam. Jean-Yves Le Gallou a fait remarquer que l’islam refusait la notion de vivre ensemble : si j’invite un musulman chez moi, je ne pourrai pas lui servir du vin et du porc, mais si je suis invité chez un musulman, je devrais manger du halal. Il n’y a pas de réciprocité, donc il n’y a pas de vivre ensemble. Si une musulmane ou un musulman épouse un non musulman, le compagnon non musulman aura l’obligation de se convertir à l’islam, alors qu’un chrétien n’a rien à exiger de tel. Il n’y a pas de réciprocité, donc il n’y a pas de vivre ensemble.
Les responsables des éditions de Chiré ont montré leur absence de sectarisme en invitant des orateurs tels qu’Hubert Lemaire dont l’ouvrage «Musulmans, vous nous mentez » est publié par RL connu pourtant pour ses penchants laïques et généralement républicains, bien que toutes les tendances y soient représentées. Certains propos d’ailleurs ont parfois fait tiquer, notamment lorsqu’ils invoquaient l’intervention divine pour sauver la France, mais cependant, chacun avait conscience qu’il y aurait sans doute lieu d’aider un peu à la chose avec des méthodes plus terrestres.
Il était évident pour tous que nous ne pouvons combattre l’islamisme qu’au prix d’une union patriote, quelles que soient les divergences, car nous sommes tous français et nous avons tous la volonté de garder nos valeurs, notre identité, notre pays, notre civilisation.
Hubert Lemaire a remporté un franc succès lorsqu’il a débuté par ces mots « il n’y a pas d’islam modéré ! » et « l’islam n’est pas une religion ». L’évocation d’un islam qui serait « paix, amour et tolérance » a soulevé des rires narquois. Il était clair que le public était averti sur le sujet. D’ailleurs, lorsqu’il a évoqué le chiffre habituel de 6 ou 7 millions de musulmans, des grognements désapprobateurs se sont fait entendre. Bien sûr, ils sont au moins le double et tout le monde ici le savait.
Puis Benjamin Blanchard, le directeur de SOS Chrétiens d’Orient, a ensuite parlé de son association. Un stand leur était d’ailleurs dédié avec divers objets fabriqués par des Syriens.
La session suivante encourageait à être contrerévolutionnaire. Après tout, nous étions en pays chouan, comme le rappelaient les nombreuses fleurs de lys visibles partout.
En fin de journée, un curé a fait une allocution dans laquelle il a copieusement fustigé l’islam mortifère, ajoutant toutefois que la riposte ne saurait être laïque mais catholique… Il a également condamné la République « judéo-maçonnique » sans que personne n’émette la moindre protestation.
Au cours du dîner, les intervenants de la journée se sont joints aux diverses tables pour échanger. C’est ainsi que j’ai clôturé cette riche journée aux côtés d’un abbé en soutane fort sympathique, qui n’a pas hésité à réclamer du vin. Je lui ai parlé de Riposte Laïque et il ne s’est même pas sauvé, allant même jusqu’à me faire une petite dédicace ! A notre table se trouvait également un Dominicain, tandis qu’à d’autres se trouvaient Roland Hélie, Marion Sigaut ou encore Reynald Secher.
Un hommage vibrant a bien sûr été rendu au fondateur Jean Auguy par son gendre François-Xavier d’Hautefeuille, lequel a pris sa suite dans la direction des éditions.
Le dimanche matin a été consacré à la famille avec notamment Gabrielle Cluzel, puis l’après-midi à l’histoire des éditions de Chiré. Mais le clou du spectacle a bien évidemment été Philippe de Villiers venu parler du Puy-du-Fou avec sa verve habituelle, réjouissant la foule qui buvait ses paroles, riait de ses imitations, ou essuyait une larme à ses démonstrations d’amour pour la Vendée, d’amour pour la France.
Il a été fortement applaudi, debout. Avec simplicité et gentillesse, il a serré quelques mains, remercié pour les témoignages de sympathie.
Ces deux journées ont été fort revigorantes, tant par l’énergie positive du lieu que par la bienveillance et la belle éducation des personnes présentes. Les enfants étaient charmants, souriants, joyeux, frais, beaux. Les adolescents serviables et respectueux. Les plus âgés enfin étaient tout simplement heureux de se retrouver, l’espace d’un moment enfin, en France.