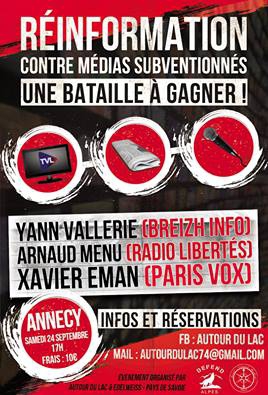L’auteur de cette biographie de RA.C, le frère du fameux commandant Cousteau, est le fils de Pierre-Antoine Cousteau (que tout le monde surnomme PAC, qui écrivit dans Rivarol de sa libération de prison en 1953 jusqu'à sa mort fin 1958), le professeur Jean-Pierre Cousteau, qui est cardiologue. On comprend à la première page du livre que, contrairement à tant de fils et filles de "collabos", lui n'a pas renié son père. Il dédie l'ouvrage notamment à Bardèche, Benoist-Méchin, Robert Brasillach, Henry Coston, Lucien Rebatet, Henri Lèbre, Saint-Paulien. Nous pouvons nous engager dans la lecture de ce formidable livre de près de 400 pages, paru chez Via Romana, en toute confiance... Dans une préface mi-figue, mi-raisin, Franz-Olivier Giesbert (étonnant que le directeur du Point ait accepté d'écrire cette préface) rappelle, plutôt horrifié, que PAC avait déclaré qu'à n'avait pas collaboré pour « limiter les dégâts » ou « sauver les meubles » mais parce qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne qui luttait à l'époque, « avec tous ses crimes » pour la survie de « l'homme blanc », les démocraties travaillant, selon lui, à sa fin. Difficile de le contredire quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. PAC avait dit : « J'ai continué, jusqu'à mon dernier souffle, à déplorer la défaite de l'Allemagne ».
Sa jeunesse
PAC naquit à Paris le 18 mars 1906. Il naît dans une famille bourgeoise. Son père est fils de notaire, sa mère fille de pharmacien. Mais le père, Daniel, est un flambeur qui entamera une carrière d'aventurier collectionnant les faillites. Quant au frère aîné de Daniel, avant de se suicider sur les marches du casino de Monte-Carlo, il s'était contenté de perdre au jeu la maison et les biens de son notaire de père. Le père de PAC voyage à travers le monde. PAC est quant à lui ballotté d'un lycée à un autre. Ses résultats sont excellents. Il a droit régulièrement à des remarques telles que : « Très bon élève ». Scolarisé en 6e au lycée Corneille de Rouen, il ail ans en 1917.D affiche un patriotisme sans failles. Il écrit à sa tante : « Delenda est Germania ! Hélas, que ne puis-je suivre l'exemple de mes aînés et aller les aider à repousser le Boche loin de nos Provinces de France qu'il martyrise. » Il écrit à un oncle : « Je donnerais tout pour que papa aille au front. Je dis que c'est un affront d'avoir son père pas à la guerre quand la Patrie est en danger. » Lors de son adolescence, il se définira « catholique et français ». Ces bonnes dispositions ne dureront pas. Il raconte : « Dès mon entrée en classe de seconde à Louis-le-Grand, tout changea. Je découvris le libre examen et je m'installai avec une remarquable aisance dans la négation. » Il notera cependant : « Le conformisme du non-conformisme est un des ridicules permanents de l'adolescence », ajoutant : « Pourtant, il serait fâcheux de ne point en passer par là. Les garçons qui ne se rebellent jamais parviennent peut-être avec plus d'aisance que d'autres à l'inspection des finances et à la Légion d'honneur, mais ils traînent jusqu'à leur trépas une existence grisâtre vouée à des digestions insipides. » La philo l'ennuie et il travaille peu. Il préfère s'adonner aux sports et sera même finaliste du championnat inter-lycées du 1 500 mètres. La politique ne le passionne pas (pas encore) mais il se définit comme antimilitariste et anti-belliciste, ce qui permet de le classer à gauche, et même très à gauche. La victoire du bloc des gauches en 1924 le ravit. Il raconte : « J'exulte. La tête des types d'Action française est tordante. »
1924-1928: Les années perdues
Il décide d'arrêter des études qui l'ennuient et de se consacrer à des activités autrement plus passionnantes : les copains, le rugby, les jeunes filles, le charleston... Mais il faut bien vivre. En novembre 1924, son père lui trouve un poste de scribouillard. Il s'ennuie à mourir. Pendant ce temps, son frère Jacques-Yves (le futur commandant Cousteau), âgé de 14 ans, fait lui aussi des siennes. Il se fait ainsi renvoyer de Buffon où, à l'occasion d'un après-midi de colle, il avait voulu démontrer à un camarade que des noix lancées sur des vitres rebondissaient sans les casser. Vingt vitres volèrent en éclats et Jacques-Yves fut expédié manu militari par ses parents en Alsace où il fut pris en charge par un précepteur musclé qui lui permit d'intégrer in extremis Navale juste avant la limite d'âge. Quant à PAC, il devance l'appel. L'auteur raconte avec humour : « Il fera une brillante carrière dans la météo, à Mourmelon, jalonnée de permes illicites, de corvées de pluches et de séjours en prison (déjà !) » Libéré en mai (du service militaire, pas de prison !), il ne trouve pas vraiment de travail et note en janvier : « Profession : indigent. La situation financière est désespérée, je suis harassé et sans un sou. » PAC va passer quelques mois aux États-Unis, où il survit avec un travail abrutissant. Il écrit : « Je lutte toujours pour la vie et c'est loin d'être facile. Il faut que je revienne en France ou c'est l'asile à brève échéance. Je n 'ai plus qu 'une idée, revenir, et vite. »
Les débuts de PAC dans le journalisme
De retour en France le 3 avril 1930, il va bénéficier d'une chance inouïe. Rares sont à l'époque les Français maîtrisant parfaitement l'anglais, et encore moins l'argot américain. Un ami le recommande à Titayna (un article lui a été consacré dans un récent Rivarol). Titayna est écrivain, grand reporter à Paris-Soir, aventurière, pilote de chasse, de motos, de voitures de sport et est admirée par le Tout-Paris. Elle a accepté, on se demande pourquoi, alors qu'elle est débordée et ne maîtrise pas très bien l'anglais, de traduire en français le best-seller de l'Américain Jim Tully, Shadows of men. PAC s'attelle à la tâche. Satisfaite, Titayna lui remet une lettre de recommandation pour Jacques de Marsillac, rédacteur en chef du Journal, qui l'embauche. C'est le début de sa carrière de journaliste. Chaque nuit, PAC est au Journal. Le jour, il fait des piges pour Le Figaro de François Coty, L'Echo de Paris et même pour la presse communiste L'Humanité et Regards. PAC ne tardera pas à être nommé secrétaire de rédaction du Journal. C'est le début de son ascension. À Rome il assiste à un défilé de troupes fascistes. Son commentaire : « C'est le comble de la bêtise humaine ». Il ne va cependant pas tarder à être confronté à des journalistes très à droite, dont Claude Jeantet, André Algarron et leur maître à penser, Pierre Gaxotte. Sa tante le complimente de sa réussite. Il répond, avec ce « pessimisme souriant » qui le caractérise selon Brasillach : « Au fond nous sommes de pauvres bougres qui pissons de la copie en plats valets que nous sommes et qui nous disputons les os jetés par les riches messieurs dont nous défendons les ambitions ou la fortune. »
Je Suis Partout
C'est en avril 1932 que Gaxotte lui commande son premier papier pour Je Suis Partout. PAC est conquis par les idées de Gaxotte et son intelligence et abandonne les idées et les postures de gauche. Il racontera : « Ce petit bonhomme blême et malingre exerçait sur nous une véritable fascination. Et nous écoutions ses moindres propos avec ravissement. Parfois il nous scandalisait en déplorant que la France n'eût pas perdu la guerre de 1914. Puis il nous scandalisait tout autant en bouffant du Boche à la manière maurrassienne. Gaxotte façonnait littéralement nos esprits incertains, il faisait de nous des fascistes "conscients et organisés". Nous avions en lui une confiance totale. Nous étions prêts à le suivre en enfer. En fait, nous y allâmes sans lui. Le jour où il ne s'agit plus seulement de jeux de l'esprit, mais de conformer nos actes à nos idées, de mettre en pratique ses enseignements et de vivre dangereusement, Gaxotte partit sur la pointe des pieds en proclamant qu'il n'avait pas voulu cela. Ce devait être la plus cruelle déception de ma vie politique. » PAC va réaliser un grand nombre d'interviews pour Je Suis Partout, de Montherlant à Giraudoux en passant par Philippe Henriot et Jean Rostand. Il monta avec Claude Jeantet un canular qui fonctionna à merveille. Ils firent croire que le député-maire de Lyon, Edouard Herriot, en visite en URSS, avait été nommé colonel de l'armée rouge. Toute la presse et la France politique y crurent. Fureur de l'intéressé et gigantesque rigolade... Le lecteur lira dans le livre un épisode hilarant, à ne pas manquer, concernant Otto Abetz et bien sûr notre supposé colonel... PAC fera de nombreux reportages, se rendant plusieurs fois aux Etats-Unis où il dénoncera notamment la mascarade de la prohibition et le haut degré de corruption. Interviewant Roosevelt et quelques autres politiciens, il évoqua dans Je Suis Partout « Les Crétins solennels de la Démocratie ».
PAC va cependant se spécialiser dans l'analyse des régimes totalitaires. Il se rend en Italie où il interviewe Mussolini, en Allemagne, aux frontières de la Russie, en Finlande, en Estonie, en Angleterre, etc. Il y rencontre les organisations fascistes. En 1936 il devient actionnaire de Je Suis Partout qui est devenu la propriété de ses rédacteurs. En septembre 1937, PAC assiste au congrès de Nuremberg. Il dîne avec Degrelle, Gaxotte, Rebatet, Brasillach, Doriot et dit : « La France est foutue. » L'année suivante, il se rendra à Madrid pendant la guerre civile, accompagné de Brasillach et de Bardèche. La guerre ne va pas tarder à éclater...
La guerre
Le 23 août 1939, PAC est mobilisé. Suivront dix mois d'ennui durant la drôle de guerre. Gaxotte, qui finira académicien, qui fut l'inspirateur du fascisme de toute l'équipe de Je Suis Partout, écrit des lettres d'amour politique à PAC. Evoquant Candide où il dispose d'une influence certaine, Gaxotte explique à PAC : « J'essaie de refouler les larves qui s'y étaient installées en grande masse »... Le même Gaxotte abandonnera honteusement, quelques mois plus tard, ses amis qu'il avait pourtant menés lui-même sur la voie du fascisme. Jean-Pierre Cousteau, le fils de PAC, l'auteur de ce magnifique livre, précise dans sa contre-dédicace au début du livre : « Ces pages ne sont pas dédiées à Charles De Gaulle, etc., ni à Pierre Gaxotte, ni à ceux qui refusèrent la demande de grâce pour Robert Brasillach. » Et puis, le 13 juin 1940, c'est la retraite dans une pagaille indescriptible : pillages par les soldats français exangues des fermiers et des villageois, et puis, direction la Thuringe en wagons à bestiaux. PAC restera quatorze mois en stalag à décharger du charbon avant d'être libéré "prématurément" : une libération due aux interventions de son épouse Fernande et de ses amis de Je Suis Partout, Alain Laubreaux et Charles Lesca ainsi que de l'ambassadeur d'Espagne José Félix de Lequerica qui, après avoir été ambassadeur d'Espagne à Vichy, le fut en 1945 à Washington. Cette libération, qui n'avait pourtant rien de scandaleux, lui fut évidemment lourdement reprochée lors de son procès.
PAC persiste et signe
Retour à la maison, PAC n'entre absolument pas dans la voie de le modération. Il publie plusieurs ouvrages, dont L'Amérique juive et polémique d'importance, écrivant en février 1942 : « Les Anglais bombardent Brest et Boulogne-Billancourt et la radio anglaise annonce que ce sont les Allemands. Salauds d'Anglais. » Il fuit certains journalistes (« tous des cons ») et dîne avec Rebatet qui, modéré comme d'habitude, vitupère à la fois contre Céline et « l'imbécillité des gens de Vichy ». Et puis, à l'approche de l'inexorable défaite allemande, les articles de PAC dans Je Suis Partout sont de plus en plus radicaux ; antisoviétiques, anticapitalistes, antisémites, favorables à la victoire allemande, seul obstacle à l'ennemi bolchevique. De plus, il méprise profondément Vichy et Laval. Il dira, lors de son procès : « Laval était le type même du politicien pour lequel les gens de Je Suis Partout ne pouvaient avoir que du mépris. Gangster de la politique, combinard, maquignon, instaurant à Vichy les méthodes les plus déshonorantes de l'affairisme politicien, ne s'entourant que de louches fripouilles de l'affairisme politicien, ou d'imbéciles, il nous inspirait une véritable horreur physique. » Il est vrai que PAC et Je Suis Partout cognent dur. Une manchette du journal commença tout de même à énerver Abetz et les Allemands qui interdirent la parution de l'hebdomadaire durant un mois : « Napoléon disait de Talleyrand son ministre des Affaires étrangères : c'est de la merde dans un bas de soie. Nous n'avons plus de bas de soie. »
Crise grave à Je Suis Partout
Mussolini venait d'être chassé du pouvoir en Italie en juillet 1943 par un coup d’État où le Grand Conseil fasciste le mit honteusement en minorité et le fit arrêter par les sbires du petit roi. On connaît l'incroyable trahison de son gendre, Ciano, qui fut son ministre des Affaires étrangères, qui fut fusillé. On sait que Skorzeny avait délivré Mussolini de sa prison au Gran Sasso avec une opération commando incroyable. Il y eut un violent conflit à Je Suis partout. Brasillach, qui était le patron, très déprimé par les événements, démissionna, disant : « Nous n'avons pas le droit d'engager nos compatriotes dans une lutte sans issue ». Réplique de PAC et des "fascistes" de Je Suis Partout : « Ceux de nos compatriotes qui ont pris parti se sont déjà engagés et si nous nous éclipsons nous serons à leurs yeux de misérables déserteurs. » Et puis, c'est la fin. Il reçoit chaque jour des menaces de mort anonymes. Il quitte Paris avec son épouse Fernande, une semaine avant l'entrée des Alliés dans Paris, dans un camion évacuant les derniers partisans de Doriot.
PAC en Allemagne la fin
Pierre-Antoine Cousteau va errer durant huit mois en Allemagne sans toutefois mettre les pieds à Sigmaringen, ce qui, dit l'auteur, lui épargnera sans doute les sarcasmes de Céline dans D'un château l'autre auxquels eurent droit les pensionnaires de cette étrange principauté collaborationniste. Céline raconte ainsi que, lors de l'offensive des Ardennes, tout ce beau monde préparait ses bagages dans la perspective de rentrer à Paris en triomphateurs ! PAC, cependant, ne se dégonfle pas. Il parle à Radio Paris, repliée en Allemagne. Comme on le sait, tout cela finira mal. Il y eut une tentative de fuite vers l'Italie, vouée à l'échec du fait de la débâcle fasciste, puis une tentative suisse qui échoua. Et puis, une invraisemblable saga autrichienne que les lecteurs découvriront. PAC sera bien sûr arrêté. Un épisode incroyable : la visite clandestine de son frère, Jacques-Yves (le futur commandant Cousteau, officier de marine, médaillé militaire, médaillé de la résistance qui avait rejoint De Gaulle) qui lui propose un plan d'évasion vers l'Espagne ou l'Angleterre, faux papiers à l'appui. Stupeur : PAC refuse. Il avait donné sa parole de ne pas s'évader. Le 20 décembre 1945 sera le premier jour officiel de son emprisonnement. Le dernier sera le 18 juillet 1953...
PAC à Fresnes
PAC est incarcéré à Fresnes le 12 janvier 1946. Il fait un froid sibérien et il ignore ce qu'est devenue son épouse Fernande (elle est en prison mais ne sera pas, comme le note son fils - l'auteur du livre - tondue...) Ce dernier rappelle cette phrase d'Einstein, pour « se calmer », dit-il : « Deux choses sont infinies, l'Univers et la bêtise humaine, mais en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas la certitude absolue. » On lira avec émotion dans ce livre quelques lettres magnifiques de PAC, notamment à son petit frère (le futur commandant), pleines d'amour fraternel (et réciproquement). Il retrouve à Fresnes Lucien Rebatet qui, dit PAC, « comme il ne peut plus faire de politique, polémique avec Dieu ». N'ayant aucune illusion sur leur sort (un article du Globe leur donne cent jours à vivre), ils lisent à voix haute les poèmes de Robert Brasillach, dont cette ode à Chénier : « Tu t'en allais vers l'échafaud, Oh mon frère au col dégrafé. » PAC écrit : « Il faut avoir été en prison pour savoir à quel point ils ont de sales gueules, de misérables gueules, les honnêtes gens. » C'est du Brassens... Et il ajoute : « Il n'y a guère qu'à Fresnes que je sois dans mon élément, avec des gens qui peuvent me lancer sans incongruité le mot dépasse du Livre de la Jungle : "Nous sommes du même sang ". Douceur de cette fraternité ». Il écrit au sujet des gens « de l'extérieur » : « Ils ne sont pas prisonniers à Fresnes. Ils sont prisonniers d'autre chose. Et souvent beaucoup plus prisonniers que moi. Prisonniers des préjugés religieux par exemple, ou prisonniers d'un étroit conformisme social dont je me sens merveilleusement affranchi, prisonniers du joujou patriotisme, des préséances, des hochets de la vanité. Tant que j'aurai la lucidité nécessaire pour réchauffer mon orgueil au brasier d'un mépris colossal, je ne crois pas que je pourrai être réellement malheureux. » Le procès est imminent. Comme le dit PAC, « Demain, ça n'existe pas ». Il n'a pas peur de ces « fantoches sanglants » et ne perd « ni le sommeil, ni l'appétit ». Il écrit : « Dans mon éthique, il n'est pas douteux que c'est l'orgueil qui est la base de toutes les actions pas trop moches que les misérables humains réussissent tout de même à accomplir par-ci par-là. L'orgueil de ne pas flancher devant tes copains, devant l'ennemi. Le courage, par exemple, ça n'existe pas. »
Le procès
La mascarade sanglante va débuter. Le verdict est connu d'avance : la mort. La boucherie de l'épuration a fait entre 30 et 40 000 morts (Robert Aron), et même 105 000 selon le ministre socialiste de l'Intérieur Tixier. Le procès de Je Suis Partout se déroule du 20 au 23 novembre 1946. Les trois accusés sont PAC, Rebatet et Claude Jeantet. Le frère de PAC, Jacques-Yves, se présente en uniforme d'officier de marine et décorations. Sa hiérarchie, qui lui avait intimé l'ordre de ne pas déposer en uniforme, et encore plus De Gaulle, ne lui pardonneront jamais. Sa carrière était définitivement compromise. Il ne sera jamais amiral. Et c'est ainsi que Jacques-Yves devint le fameux commandant Cousteau qui nous fit entendre le Silence de la Mer. Comme témoin à décharge, il y eut aussi le grand écrivain Jacques Perret (Le caporal épingle). Et puis... Jacques Yonnet, écrivain communiste, que j'évoquerai dans une prochaine rubrique littéraire. Il déclara devant la Cour : « Il a toujours joué franc jeu. C'était un ennemi loyal. Je lui conserve la même estime qu'il avait pour des gens d'en face. C'était un homme d'honneur ». Yonnet sera derechef exclu du Parti et traité dans l'Humanité d'espion hitléro-trotskiste... Il faut lire, dans le livre, cette admirable lettre de Yonnet à PAC. Extrait : « Je continue d'être en guerre contre une certaine espèce d'hommes. Les larves, les gluants, les pleutres. L'espèce d'en face. Un jour, Cousteau, il n'y aura plus de barricades entre nous. » Et Yonnet de conclure : « Vous êtes le gibier, je le serai un jour. Courage, et dites leur merde ». Cousteau se révèle, et de loin, le plus courageux des trois. (Cousteau, Rebatet, Jeantet) . Le journal communiste Franc-Tireur écrira : « Cousteau est un drôle dans toute l'acceptation du terme. » Ces « bouffons minutieux », ainsi qu'il l'écrira, le condamneront évidemment à mort, ainsi que Lucien Rebatet. Le 24 novembre 1946, après le verdict, direction le quartier des condamnés à mort et les chaînes de 7kg aux pieds qu'ils garderont 141 jours.
Les chaînes, puis la grâce
Des centaines de signatures pour réclamer la grâce de PAC : Bernanos, Galtier-Boissière, Jean Paulhan, le général de Lattre de Tasssigny, Colette, Thierry Maulnier, François Mauriac, le Père Bruckberger, et tant d'autres dont... la journaliste sympathisante communiste Geneviève Tabouis que les plus jeunes ne connaissent pas, mais dont se souviennent les anciens. Une voix radio inimitable ! Le président Auriol hésite (le vampire De Gaulle ne l'aurait pas fait) mais il gracie PAC et Rebatet. Quelques temps plus tard, PAC reçoit cette lettre de son frère, le futur commandant : « Tu as été admirable de sérénité, tu as dominé les débats de très haut, je suis, sans réserve, fier de toi ». PAC ne croit rigoureusement en rien : « La religion révélée ? Ça ne résiste pas à cinq minutes d'examen. La Patrie ? C'est un mythe pour cannibales. Le Progrès ? C'est une foutaise. L'homme des cavernes reste l'homme des cavernes malgré son fragile vernis de "civilisation". La révolution ? Elle ne fait que substituer des oppresseurs à d'autres oppresseurs. Non, on ne peut plus croire en rien, en aucun "isme" ». Donc, ajoute-t-il, pessimiste souriant, « tout cela est rigolo et, lorsque l'on a le sens de l'humour, il y a dans les
circonstances les plus tragiques de quoi se marrer ». PAC écrira cette phrase que je ne commenterai pas : « Eh bien, il faut me rendre à l'évidence : l'imposture historique n'est pas seulement possible par le fait d'un narrateur unique. Elle est encore plus aisée grâce à l'établissement d'un mythe collectif... » PAC déclare : « Mon pays me fait mal, écrivait Robert (Brasillach). Lui au moins il n'a pas vécu pour voir cette dégringolade dans l'ignominie, dans l'abjection ». Le 10 avril 1947, PAC est gracié de même que Rebatet, mais Brinon, qui était un grand monsieur, sera massacré le 16. Il fallait bien que la hyène se repaisse... Le 30 mai 1947, PAC est transféré à Clairvaux.
Clairvaux, une nouvelle prison
PAC aura de nombreux moments de bonheur à Clairvaux. Il lit abondamment et découvre Rivarol, Proust, Aymé, Wilde, Shaw, Huxley, Nietzsche, Dostoïevski, Machiavel, Hemingway, Anouilh, Nimier, Jacques Laurent et tant d'autres écrivains. Il est en revanche totalement allergique à la « scatologie célinienne ». Et il n'est, c'est le moins que l'on puisse dire, pas un admirateur de Maurras pour lequel il a des mots très durs : il évoque au sujet d'un des livres du maître de Martigues un « chef-d'œuvre de la connerie transcendantale. Il y est dit que la Bastille fut prise par "une bande de malfaiteurs et d'étrangers, la plupart Allemands". Voila qui est sublime comme l'antique ». PAC, qui, comme on le sait, n'est pas « un modéré modérément courageux » (Abel Bonnard, dans Les Modérés), sulfate à tout va. Il fusille Hugo (« Il est impossible de donner à l'imbécillité une forme plus tonitruante »). Mais il lit et relit Marcel Aymé et son extraordinaire livre, Uranus, qui évoque les horreurs de la "Libération". À noter que le film, inspiré du livre, avec Depardieu et Fabrice Lucchini, est remarquable. Et puis, il se plonge dans La Volonté de puissance de Nietzsche, « s'émerveillant d'avoir pu vivre jusqu'à près de quarante-trois ans sans avoir lu ça ».
Les années passent. Il écrit. Prisonnier mais libre : « Bien se pénétrer de cette vérité de base qu'il n'existe pas de liberté politique, qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura jamais et que ce qu'on appelle ainsi est une affabulation grossière, un mythe absurde et dégradant, tout juste bon pour camoufler aux yeux des débiles mentaux d'inévitables tyrannies ». Il s'autorise aussi quelques considérations audacieuses, telle : « L'oisiveté est la mère de tous les arts alors que le travail (loin d'être noble comme le prétendent les abrutis) est une malédiction qui conduit à l'appauvrissement de la personnalité et tarit le génie créateur. » Autre considération : « Ne jamais oublier qu'avant d'accéder au pouvoir, Robespierre et Lénine avaient consacré leur vie à combattre la peine de mort. » Et puis aussi, cette cruelle remarque : « Le 14 juillet 1789, Louis XVI était à la chasse. Le 27 juillet 1830 (première des Trois Glorieuses), Charles X était à la chasse. Lorsque la canaille se soulève, les Bourbons tirent sur les lapins. L'étonnant serait qu'ils n'eussent pas expié cette erreur de tir. » Autre considération, si formidablement juste : « Par tempérament on appartient à l'une des deux espèces (les fascistes et les anti-fascistes, les Blancs et les Rouges, les démocrates et les totalitaires). Hemingway, antifasciste en littérature est, morphologiquement, un fasciste authentique. Ces choses là ne se démontrent pas, elles se sentent... » et Cousteau d'ajouter : « Je sais bien quels sont les gens à qui j'aurai pu dire, tout au long de l'histoire : Nous sommes du même sang, toi et moi ». Et puis PAC continue de se lâcher contre Céline, que décidément, il n'aime pas : « C'est vraiment un accident que Céline se soit trouvé de notre côté à cause de ses malheureux pamphlets. Son œuvre est destinée à être le chantre des crasseux, des médiocres, des lâches, des ratés, bref de tous ceux vers qui va la tendresse de la conscience universelle et de Jean-Paul Sartre ». Cousteau ne pardonne pas à Céline ces propos, pas très glorieux, il est vrai : « Je n'ai jamais été antisémite (pas assez con). Je n'ai jamais fait d'antisémitisme pendant la guerre; je n'ai jamais foutu les pieds à l'ambassade allemande...»
Et voici que le cinéma fait son entrée à Clairveaux ! Laurel et Hardy ! PAC et Re-batet n'apprécient guère : « Alors c'est ça qui amuse les "hommes libres ? " Lucien et moi étions suffoqués. Il est évident que plus un "art" a un public étendu et plus il est condamné à la stupidité. Apres sept ans de Stendhal et de Voltaire on a le souffle coupé : ça n'est pas possible ! On n'en croit pas ses yeux... » Lucien Rebatet va être libéré en 1952, un an avant PAC. Immense joie mais aussi déchirement de voir partir son ami, son complice... Excellente formule de Lucien : « Les dictatures emprisonnent leurs adversaires au nom de l'ordre, les Démocraties les emprisonnent au nom de la liberté. » On ne peut pas dire que Cousteau, ce « pessimiste hilare » soit d'un formidable optimisme. Il écrit, le 18 décembre 1952 : « Devant le comportement de l'espèce humaine, le pessimisme n'est pas seulement la seule attitude tonique, la seule qui préserve des déceptions et des duperies. Et comme la vie est jalonnée de gros malheurs qui ne sauraient affecter le pessimiste puisqu'il les juge inévitables, et de petites joies qui ne manquent jamais de le surprendre, le véritable pessimiste est essentiellement un homme gai. » 1953 sera en juillet l'année de sa libération...
Les dernières années de PAC. RIVAROL...
PAC collabore à diverses revues, dont RIVAROL. Il y écrit notamment un article « D'un râtelier à l'autre », suite à l'interview de Céline, parue en juin 1957 dans L'Express, qui suscite la fureur de ce dernier : « Le Cousteau, tout aussi ordure, tout aussi enragé que le Sartre ». On aura compris que les deux ne s'aimaient guère. Il prédit dans RIVAROL non seulement le retour aux affaires de De Gaulle (il appelle à voter non au référendum sur la nouvelle Constitution) mais annonce aussi de manière prophétique le largage par l'homme de Colombey de l'Algérie française. Toujours dans notre hebdomadaire il annonce dans un article visionnaire, le 2 octobre 1958, l'invasion de l'Europe et de la France par des masses exotiques et évoque le risque de submersion de la race blanche.
Cousteau est au bord de la misère et pour vivre doit reprendre son « métier carcéral » : les traductions. Ses amis, Henry Charbonneau et Henry Coston éditèrent, avant sa mort, plusieurs de ses livres, dont Hugothérapie, Les Lois de l'Hospitalité et Après le déluge. PAC découvrira, émerveillé, les chansons de Brassens avant de mourir, dont « La Tondue » et « Mourir pour des idées » (à redécouvrir d'urgence !). Il mourra le 17 décembre 1958 d'un cancer du colon déjà métastasé. La veille de sa mort, il confie son fils (l'auteur de ce livre) à son frère, le commandant Cousteau (qui a été admirable durant toutes ces années), dicte à Rebatet pour RIVAROL un "testament" que le lecteur découvrira dans le livre, et charge Henry Coston de ses publications posthumes. Le Monde titrera : « Fidèle à ses idées, à ses amitiés, à son passé, il avait conservé tout son talent de polémiste. » Galtier-Boissière dira : « Cousteau fut le plus grand journaliste de la collaboration; une droiture et un courage qui m'avaient vivement impressionnés. C'était un des derniers journalistes qui refusait de se coucher et de demander pardon » ; Paul Morand dira, quant à lui : « J'ai admiré sa vaillance et son talent » et Henri Lèbre dira : « Cousteau était un seigneur ». Quant à François Brigneau, il écrira : « Avec Joseph Darnand, c'est l'homme le plus courageux (physiquement et moralement) que j'aie connu ». Une foule immense l'accompagna au cimetière Montmartre où il repose.
Robert SPIELER. Rivarol du 28 juillet au 31 août 2016
Pierre-Antoine, l'autre Cousteau, de Jean-Pierre Cousteau, 390 pages, éditions Via Romana, 24 euros.