Jamais le monde n’a produit autant de richesses qu’à l’heure actuelle. Si cette richesse était répartie de manière égale entre tous et partout dans le monde, une famille avec trois enfants disposerait d’un revenu de 2.870 euros par mois et d’un patrimoine (épargne, valeur du logement…) de 125.000 euros.
Nous parlons bien ici de tous les gens sur la planète : Africains, Asiatiques, Européens, Américains, etc. 2.870 euros par mois et un patrimoine de 125.000 euros, voilà qui est étonnamment élevé. Ce n’est certes pas assez pour vivre dans le luxe, mais bien suffisant pour que tous les êtres humains disposent d’un logement confortable, d’électricité, d’eau potable et de sanitaires, également via des méthodes écologiques.
Il y a donc assez pour que tout le monde puisse mener une vie plus que décente. Et, pourtant, dans le monde, un être humain sur trois ne dispose pas de dispositif sanitaire de base, et un sur quatre n’a pas accès à l’électricité. Un sur sept vit dans un bidonville, un sur huit a faim et un sur neuf n’a pas accès à l’eau potable.[1] Autre manière d’expliquer les choses : avec une répartition égale de la richesse, tout le monde disposerait de 23 dollars par jour. Et, pourtant, 2,4 milliards de gens doivent vivre avec moins de 2 dollars par jour et 1,2 milliard même avec moins de 1,25 dollar.[2]
Le problème n’est donc pas qu’il n’y a pas assez de richesse, mais que celle-ci est répartie de manière scandaleusement inégale. Aujourd’hui, 85 personnes possèdent autant que 3,6 milliards de gens ensemble.[3] Le 1% le plus riche possède près de la moitié de toute la richesse du monde alors que 70% les plus pauvres en possèdent 3%. Les très riches possèdent chacun une fortune moyenne d’1,6 million de dollars, soit 700 fois plus que la plus grande partie de la population mondiale.[4]
Un bon 32.000 milliards de dollars sont à l’abri dans les paradis fiscaux.[5] C’est 130 fois plus que ce qui est annuellement nécessaire pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) des Nations unies et éradiquer la pauvreté la plus forte dans le monde. Jamais auparavant le contraste entre ce que l’économie mondiale a à offrir et ce qu’elle donne effectivement pour répondre aux besoins de base n’avait été aussi grand, aussi criant qu’à l’heure actuelle.
Prospère Belgique
En Belgique, ou j’habite, le revenu moyen disponible pour une famille avec deux enfants est de 8.000 euros par mois, et le patrimoine moyen d’une telle famille est un petit 800.000 euros.[6] Des chiffres qui paraissent également étonnamment élevés mais, à nouveau, il s’agit de moyennes qui cachent une répartition extrêmement inégale.
D’un côté, le 1% des Belges les plus riches possèdent 40 fois autant que le Belge moyen. Les dix familles les plus riches de notre pays disposent ensemble d’un patrimoine de 42 milliards d’euros, environ autant que les 2 millions de Belges les plus pauvres. Le patrimoine des familles De Spoelberch, De Mévius et Vandamme correspond exactement au budget total de l’assurance maladie en 2012.[7]
De l’autre côté, 1 Belge sur 5 court le risque de tomber dans la pauvreté ou dans l’exclusion sociale.[8] Une famille sur 5 avec un bas revenu doit reporter des soins médicaux pour des raisons financières.[9] Et il n’est pas du tout rare que des gens doivent travailler à un rythme inhumain pour à peine 1.300 euros par mois. Au vu de la haute prospérité de la richesse de notre pays, c’est inacceptable.
Le fossé entre riches et pauvres en Belgique n’a jamais été aussi grand, et il continue de se creuser. Les dernières vingt années, les revenus des 30% les plus pauvres ont baissé de 10% alors que le pourcent le plus riche a vu son revenu augmenter de 30%.[10] Durant cette période, le nombre de pauvres a doublé.[11] C’est la conséquence de deux éléments : d’abord, les allocations et salaires ont été gelés ou augmentent moins vite que la prospérité ; ensuite, le capital bénéficie de toujours plus d’avantages fiscaux. Ces dernières trente années, la part salariale dans le PNB (la richesse nationale) a baissé de 67 à 62%, alors que la part du capital a presque doublé, passant de 6 à 10%.[12]
Pas la crise pour tout le monde
C’est la crise qui est ici le grand malfaiteur. Dans le capitalisme, une crise revient à un grand nettoyage brutal et chaotique de l’économie. La facture est invariablement imposée aux travailleurs et aux plus faibles de la société. En d’autres termes, une crise économique est un excellent moyen pour organiser un transfert du travail au capital, des pauvres vers les riches. Les réductions des salaires dans les années 1980 en sont un bon exemple. Si, aujourd’hui, les salaires constituaient une part aussi grande du PIB qu’en 1981, chaque travailleur gagnerait environ 950 euros de plus par mois.[13]
Le krach financier de 2008 est la répétition du même phénomène. Rien qu’en Europe, 4 millions d’emplois ont disparu à cause de la crise.[14] Dans le monde, 64 millions de gens ont été poussés dans l’extrême pauvreté.[15] Dans presque tous les pays européens, le fossé entre riches et pauvres a augmenté, et même particulièrement fort en Irlande et en Espagne.[16] Actuellement, l’Europe compte 120 millions de pauvres, et 100 à 150 millions de personnes vivent sur le fil du rasoir. Il s’agit donc au total de 43 à 53% de la population ! En outre, avoir un emploi n’est plus suffisant. En Europe, une personne qui travaille sur 10 vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté.[17]
Surtout dans les pays périphériques, la politique d’économies menée depuis 2008 a causé de véritables ravages. Les revenus moyens n’ont pas non plus été épargnés. En Italie, le pouvoir d’achat a baissé de 12%, en Espagne et en Grande-Bretagne (!), de 22%, et en Grèce, même de 33%.[18] Au Portugal, les salaires ont baissé de 12% ;[19] en Grèce, les salaires des fonctionnaires ont même dégringolé de 35%.[20] Aujourd’hui, 31% des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté et 27% risquent d’y tomber.[21] En Espagne, la pauvreté pourra atteindre 40% d’ici 2022.[22]
En Belgique aussi, la pauvreté continue à augmenter. Aujourd’hui, dans ce pays prospère, 24.000 personnes ont besoin de l’aide alimentaire de la Croix-Rouge.[23] Certes, le rythme de cette augmentation a été moins rapide que dans les pays périphériques, parce que nous sommes restés 541 jours sans gouvernement et que des économies n’ont pu être décidées durant cette période. Deuxièmement, chez nous, les syndicats sont plus forts que dans la plupart des pays voisins.
Pour les super-riches, la crise a en tout cas été une bénédiction. Jamais auparavant il n’y a eu autant de super-riches (fortune de plus de 22 millions d’euros) dans le monde. En Europe, 4.500 ont rejoint la liste, en Belgique, 60.[24] Les « individus très riches » (high-net-worth individual, avec des moyens d’investissements de plus d’un million de dollars) ont vu leur richesse croître d’au moins 41% depuis 2008.[25] Clairement, ce n’est pas la crise pour tout le monde.
Une question de civilisation
Ce fossé est un véritable scandale. Pour l’économiste internationalement renommé Jeffrey Sachs, une redistribution fondamentale de la richesse est une question de « civilisation ».[26] Mais il y a aussi des raisons sociales, économiques et même politiques pour entamer la lutte contre ce fossé. En premier lieu, l’inégalité dans un pays entraîne toute une série d’effets néfastes. Cela raccourcit la vie des gens, les rend plus malheureux, augmente la criminalité, le nombre de grossesses d’adolescentes et d’addictions aux drogues, et cela stimule la consommation excessive.[27]
Economiquement, une grande inégalité aggrave la crise, puisque des bas revenus signifient moins de pouvoir d’achat, ce qui est néfaste pour la consommation globale et donc aussi pour les investissements.
Il y existe un important parallèle entre notre époque et la Grande Dépression des années 1930. Entre 1920 et 1928, la part des 5% les plus riches est montée de 24 à 33%. Un an plus tard, c’était l’explosion. En 1983, cette part était de 22% et, en 2008, de 33%, soit précisément le niveau de l’année avant le grand krach.[28] Pour les mêmes raisons, les économies ne sont pas une bonne idée. Elles augmentent le fossé, rallongeant et empirant donc la crise. Mais peut-être est-ce bien le but ?[29]
Pour finir, un fossé trop grand entre riches et pauvres crée également un danger politique, davantage dissimulé. L’inégalité économique croissante et le recul des revenus bas et moyens suscite le mécontentement et l’agitation dans une large couche de la population. Selon The Economist, dans au moins 65 pays, il existe une possibilité haute à très haute d’agitation et de révolte, comparable avec celles du Printemps arabe.[30] Il n’est donc guère étonnant qu’à Davos, l’élite des riches décideurs, tout comme le président Obama et le chef du FMI, commencent à vraiment s’en inquiéter.[31]
Ils n’ont pas encore réalisé qu’il ne s’agit pas ici d’un excès ou d’un débordement, mais bien d’une erreur-système ou d’un vice de construction. Il est grand temps pour quelque chose de nouveau.
Lire la suite
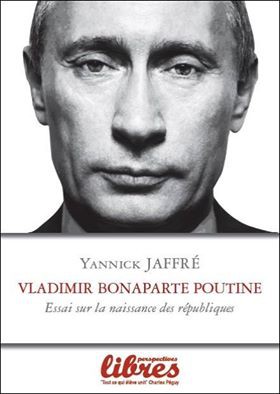
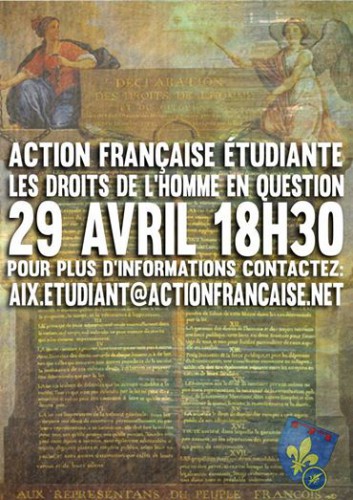
 Un royaliste qui se présente à des élections, européennes de surcroît : voilà qui en surprend quelques uns, y compris dans les rangs monarchistes. Pourtant, ce n’est pas la première fois ni la dernière sous la Cinquième République que des royalistes affrontent le suffrage universel,de Bertrand Renouvin à l’élection présidentielle de 1974 à la trentaine de candidats de l’Alliance Royale aux législatives de 2012. Certes, les résultats quantitatifs restent modestes, et Renouvin, il y a quarante ans, n’avait attiré qu’un peu plus de 43.700 électeurs, tandis que les candidats de l’Union Royaliste de Touraine, dans les années 1980, atteignaient parfois les 2 ou 3 % de suffrages exprimés... Cela n’est pas le plus important, en définitive, mais bien plutôt la présence de royalistes sur la scène politique, et ce qu’ils ont dit et ce qu’ils ont à dire.
Un royaliste qui se présente à des élections, européennes de surcroît : voilà qui en surprend quelques uns, y compris dans les rangs monarchistes. Pourtant, ce n’est pas la première fois ni la dernière sous la Cinquième République que des royalistes affrontent le suffrage universel,de Bertrand Renouvin à l’élection présidentielle de 1974 à la trentaine de candidats de l’Alliance Royale aux législatives de 2012. Certes, les résultats quantitatifs restent modestes, et Renouvin, il y a quarante ans, n’avait attiré qu’un peu plus de 43.700 électeurs, tandis que les candidats de l’Union Royaliste de Touraine, dans les années 1980, atteignaient parfois les 2 ou 3 % de suffrages exprimés... Cela n’est pas le plus important, en définitive, mais bien plutôt la présence de royalistes sur la scène politique, et ce qu’ils ont dit et ce qu’ils ont à dire.