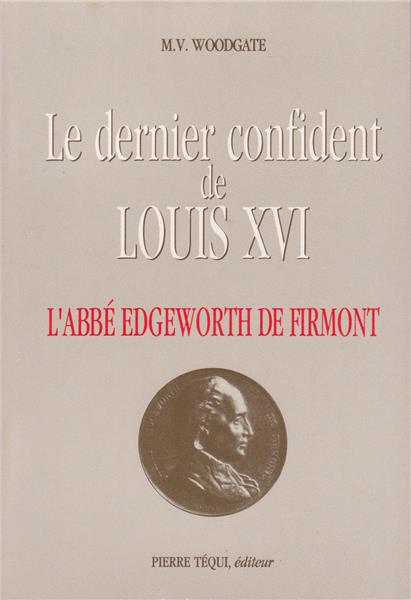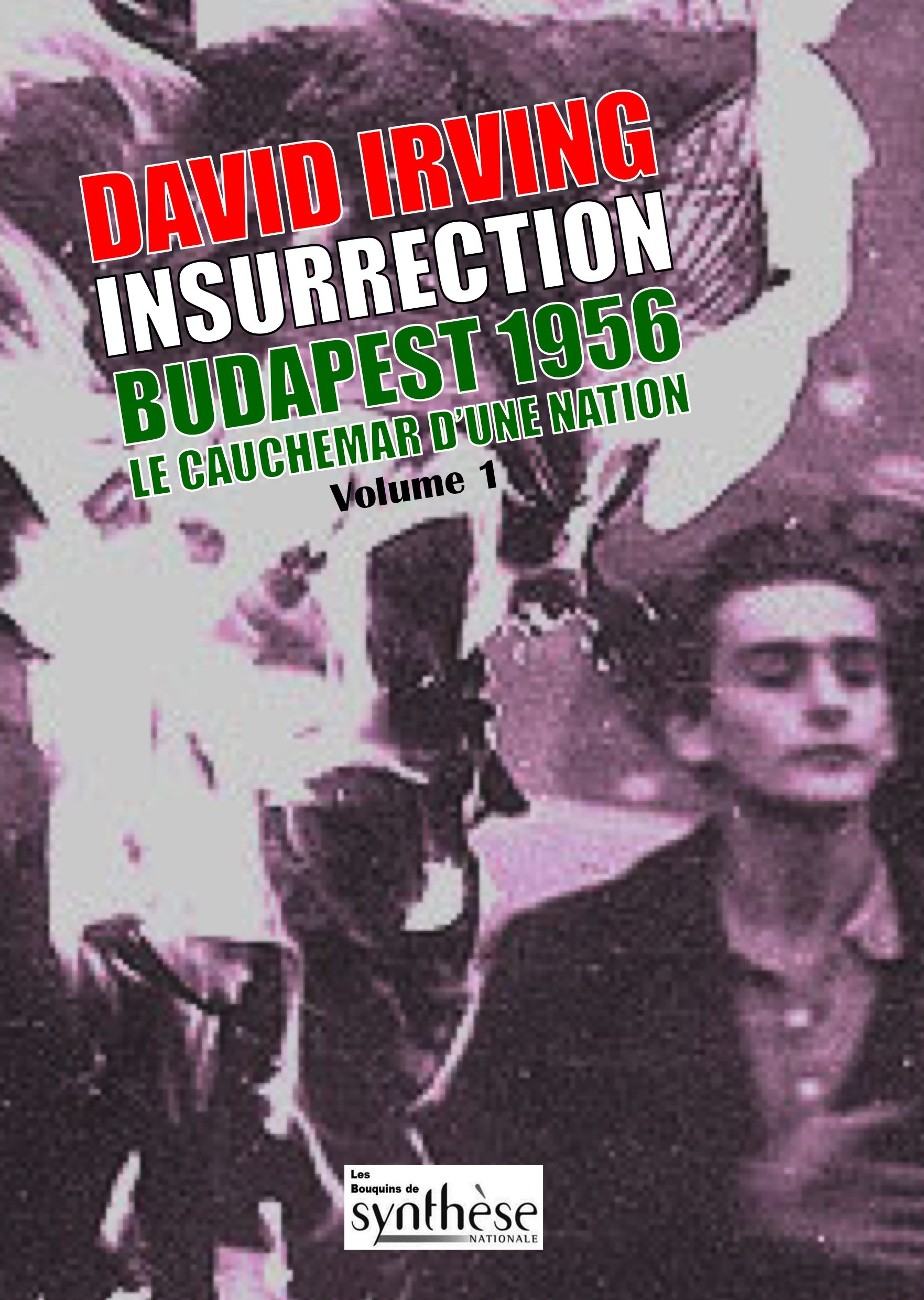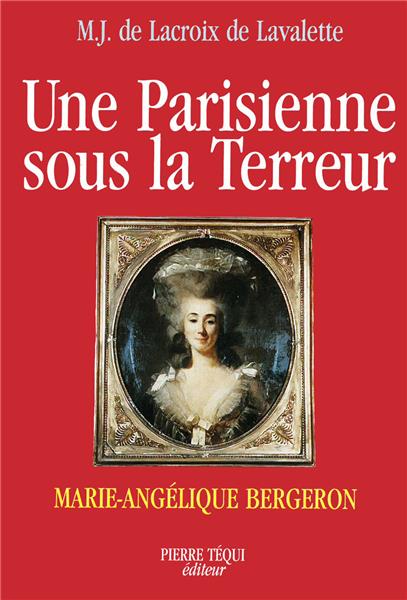Le Who's Who du fascisme européen est paru en Norvège depuis 6 ans déjà, grâce aux travaux de 3 universitaires d'Oslo, Stein Ugelvik Larsen, Bernt Hagtvet et Jan Petter Myklebust. Le bilan de leurs travaux est paru aux éditions universitaires d'Oslo en langue anglaise, ce qui nous en facilite la lecture, même si l'on serait tenté de déplorer l'anglicisation systématique des travaux académiques. L'intérêt pour le fascisme n'a cessé de croître depuis une quinzaine d'années. On a essentiellement retenu les noms de Nolte en RFA, de son compatriote Reinhard Kühnl, de l'Italien Renzo de Felice, de l'Américain Stanley G. Payne et, plus récemment, de l'Israëlien Zeev Sternhell. Mis à part Nolte, tous ces “fascistologues” figurent dans la table des matières de cette encyclopédie du fascisme de 816 pages. C'est dire le sérieux de l'entreprise et la rigueur historique qu'on acquerra en se livrant à une lecture critique de ces éclairages divers.
Lire la suite