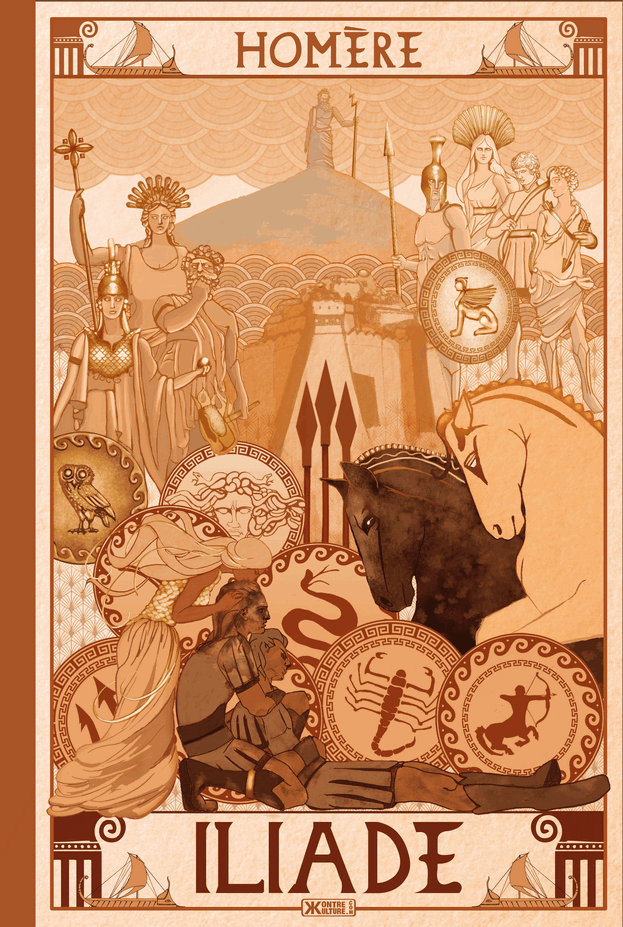François Mitterrand aurait dû profiter de sa jeunesse réactionnaire pour lire les « Réflexions politiques » de Jacques Bainville. Il y aurait appris à mesurer pleinement les conséquences de ses actes.
Il y a plus d'un demi-siècle que Jacques Bainville a quitté ce monde et la chape d'un profond silence a progressivement été jetée sur son œuvre. Bainville est quelqu'un dont il ne faut aujourd'hui plus parler, dont il ne faut pas citer le nom, et pratiquement jamais ce nom n'est plus prononcé ni dans les discours des politiciens, ni dans les bavardages des media. Bien rarement l'est-il, sinon même plus rarement encore, dans les savants travaux des universitaires.
C'est dire quelle heureuse surprise est la réédition de ses Réflexions politiques que vient de publier la maison belge DISMAS (1). Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais elle peut l'annoncer.