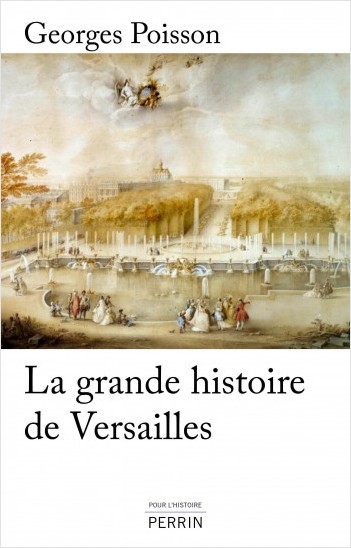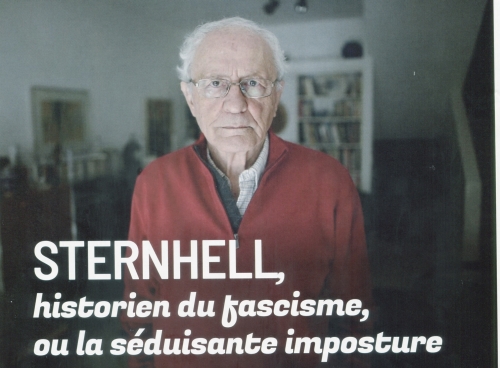Dans les années 60, lorsque des millions de travailleurs étrangers ont été attirés dans notre pays, nous avons, surtout dans les rangs du SDS, critiqué cette politique, non pas sous l’aspect de l’aliénation culturelle, mais sous celui de l’économie, en constatant que cette politique d’immigration permettait aux capitalistes de compresser les salaires. Ensuite, nous, les militants du SDS, pensions que les étrangers qui venaient dans notre pays et y acquéraient des qualifications professionnelles particulières, allaient retourner dans leurs patries pour apporter leurs compétences et leurs capacités à leur propre peuple. Pour les personnes ressortissant des pays en voie de développement, nous considérions que c’était de la “désertion”, dans le chef des cadres, de ne pas demeurer fidèles à leur peuple et de rester ici en Allemagne pour mener une vie de confort en tant que médecins, architectes ou ingénieurs.