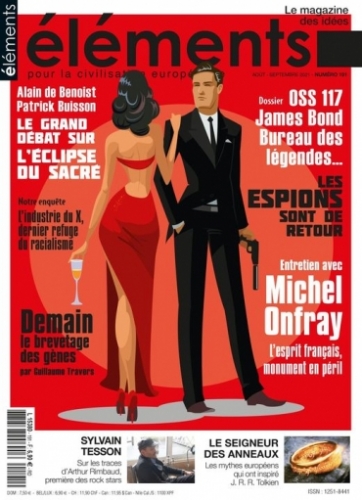Une histoire politique et culturelle de la genèse de l’Europe moderne. Où l’espace carolingien apparaît comme l’un des berceaux de la civilisation européenne.
Revenir sur le récit d’une France et d’une Allemagne dont la naissance en Europe consisterait en une opposition fondamentale, c’est l’idée qui sous-tend Allemagne et France au cœur du Moyen Âge. L’ouvrage, dirigé par Dominique Barthélémy, membre de l’Institut, professeur à la Sorbonne, directeur d’étude à l’École pratique des hautes-études, et Rolf Große, directeur des études médiévales à l’Institut historique allemand de Paris, professeur à l’université de Heidelberg, réunit des textes d’histoire politique et culturelle qui se distinguent notamment par une lecture renouvelée des sources de cette période capitale pour la genèse de l’Europe moderne.