L’actualité récente sert de support à Philippe Conrad pour nous conter – de l’Egypte ancienne jusqu’à la période contemporaine – l’histoire de cette bande de terre entre Méditerranée et Mer Rouge, trait d’union entre Orient et Occident. Très tôt, l’intérêt d’établir une voie d’eau dans l’isthme de Suez se fit jour. Intérêt commandé par la géopolitique et l’économie puisque l’aboutissement du projet devait permettre de raccourcir considérablement l’acheminement des marchandises d’un continent à l’autre. Ce n’est qu’au milieu du XIXème siècle, sous l’impulsion du diplomate français Ferdinand de Lesseps (1805-1894), que ce dessein d’unir sur 174 km les deux mers se concrétisera, et ce malgré l’hostilité britannique.
culture et histoire - Page 507
-
Passé-Présent n°301 : L’histoire du canal de Suez
-
L’AFRIQUE SOUFFRE SURTOUT D’UNE DÉCOLONISATION PRÉCIPITÉE. (2)

De 1945 à la chute de mur de Berlin, deux empires coloniaux ont survécu : les Etats-Unis, bâtis sur la conquête de territoires dont les habitants ont été éliminés ou marginalisés, sont la chauve-souris de la décolonisation. Côté rats, c’est une colonie de peuplement où les colons ont le pouvoir et se sont émancipés de la métropole, mais en maintenant longtemps l’esclavage et la soumission des non-blancs ; côté oiseau, c’est la colonie qui a arraché son indépendance et indique aux autres la voie de la liberté. La seconde face permettra d’assumer l’esprit colonisateur lié à la première mais de manière douce : peu de possessions directes, avec des îles, des bases, mais une influence économique, politique et quand il le faut militaire sur une partie grandissante du monde, à commencer par les Etats issus du démembrement de l’Empire espagnol.
-
Laurent Lasne : De Gaulle et la Participation (colloque - hommage au GDG)
-
François Ier, roi chevaleresque, gouvernant moderne

(Marignan par Alexandre-Evariste Fragonard, 1836)
Cet article a été initialement publié sur l’excellent site de Liberté politique. N’hésitez pas à le visiter et le soutenir.
15 juillet 1515 : François Ier s’élance vers l’Italie. Les soixante-dix ans de la fin du second conflit mondial et le bicentenaire de la chute de l’Aigle ont éclipsé un autre anniversaire, plus glorieux et moins morbide pourtant, celui des cinq cent ans de l’avènement d’un roi de gloire, sur le trône depuis le 1er janvier de la mythique année 1515.
CE 15 JUILLET, à Lyon, le jeune souverain de vingt ans signait l’ordonnance confiant la régence du royaume à sa mère, Louise de Savoie, son épouse Claude de France n’ayant pas été couronnée reine pour l’heure. Une armée formidable se réunissait autour de la ville, le roi prenait la route de l’Italie pour reconquérir Milan.
-
A la recherche des dieux celtes du Donon
Pays : France
Région : Alsace, Vosges.
Thématique générale du parcours : Partir à la découverte des sites gallo-romains et de leurs dieux au cœur des Vosges. Parcourir un massif, où les traces des combats de la Grande Guerre sont encore visibles en de nombreux endroits.
Mode de déplacement : Se déplacer à pied est ici le plus adapté pour avancer dans les étroits sentiers et se faufiler dans les bunkers.
Durée du parcours : La durée du parcours est adaptable. D’une demi-journée à une journée et demie en fonction des boucles choisies. Le parcours décrit ci-dessous s’accomplit en 7 à 8 heures de marche.
Difficulté du parcours : Les quelques routes qui sillonnent le massif du Donon permettent de s’approcher des différents points remarquables en moins d’une heure de marche. Les chemins sont bien entretenus, une balade en famille est donc tout à fait possible. Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de partir du fond de la vallée de la Bruche, le dénivelé est alors plus conséquent (de 400 m à 1000 m d’altitude pour le Donon) et il faut savoir s’orienter parmi les innombrables sentiers qui se croisent.
Un conseil : faites confiance au balisage du Club Vosgien, qui fait un travail remarquable dans ce massif. -
Journal du chaos
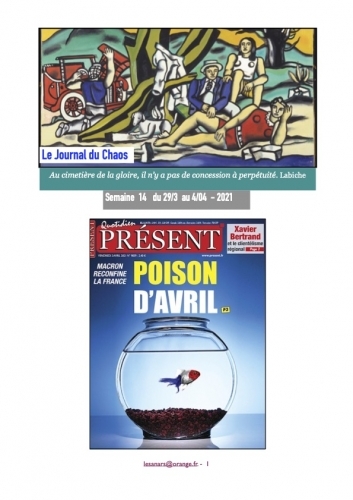
Pour télécharger, cliquez ICI
-
LE SIÈCLE CHRÉTIEN (1200/1205) - Philippe Auguste / 4e croisade
-
Les Cosaques de la liberté : l'expérience de l'anarchisme de Nestor Makhno en Ukraine

Présenter en 475 pages la vie et l'action de Nestor lvanovitch Makhno (1889-1934), inspirateur et réalisateur de la seule expérience de communisme libertaire pendant la période de la révolution russe (entre 1917 et 1921) est un pari réussi par Alexandre Skirda. Spécialiste de la Russie Soviétique, l'auteur exprime sans aucun doute sa sympathie politique pour l'anarchisme makhnoviste au travers d'une étude aussi complète que variée.
Un travail d'apologie
En dépit de tout l'intérêt des analyses historiques de l'expérience originale accomplie par Makhno et ses partisans, le plan choisi par Skirda nous apparaît peu significatif. Après avoir étudié son sujet d'un point de vue chronologique et événementiel (de l'enfance de Makhno à sa mort en exil à Paris en 1934), il revient sur une recherche plus psycho-historique dans un second temps, achevant son ouvrage par une revue très critique des livres consacrés à l'anarchisme ukrainien et à son fondateur. On suit alors assez péniblement ces mouvements assez "anarchiques". Au fond, on lit ici trois ouvrages différents : l'un est un livre d'histoire, fort brillant au demeurant, consacré à l'histoire de l'expérience anarchiste en Ukraine dans ses rapports avec le phénomène global de la Révolution russe. Le second est une monographie de N. Makhno, fondateur et "Batko" ("petit père" en quelque sorte) de ce mouvement de "communisme libertaire". Le troisième enfin est une recension critique des textes (brochures, articles de presse, romans, etc.), ayant pour thème principal ou quelquefois secondaire l'expérience makhnoviste. C'est cet "éclatement" qui. sans remettre en cause la richesse et le sérieux de ce travail historique, rend peut-être mal à l'aise le lecteur que je suis.
-
1832. Le choléra s’abat sur Paris
Dans la France de Louis-Philippe, Paris, alors l’une des plus grandes villes d’Europe, fut la principale victime d’une épidémie qui n’en eut pas moins des répliques en province.
En 1832, la capitale française compte 785 000 habitants. Elle est alors divisée en douze arrondissements eux-mêmes partagés en quartiers qu’habitait une population composée à 70% de pauvres. Sur le plan social, la ville apparaît en effet très inégalitaire et les contrastes sont très marqués entre les nouveaux quartiers bourgeois, modernes et aérés, et les zones populaires combinant l’absence d’hygiène, l’insalubrité, la difficulté d’accès à l’eau et l’exigüité de logements misérables. C’est sur ce terrain propice que va se développer l’épidémie importée d’Inde où le mal était alors endémique.
-
Brejnev : dictateur et antihéros.

