culture et histoire - Page 1009
-
Marie-Antoinette et la Révolution française (1789 – 1793) | Au cœur de l’histoire | Europe 1
-
Le Journal du chaos de cette semaine

Le lire cliquez ici
-
Pour sortir de l'impasse du libéralisme
Dialogue avec Guilhem Golfin
 Guilhem Golfin, docteur en philosophie, nous montre comment toute la modernité politique, sous apparence de démocratie et de participation au pouvoir, repose sur l'affirmation originaire d'un pouvoir absolu, face auquel Antigone a toujours tort et... Macron ou Créon toujours raison…
Guilhem Golfin, docteur en philosophie, nous montre comment toute la modernité politique, sous apparence de démocratie et de participation au pouvoir, repose sur l'affirmation originaire d'un pouvoir absolu, face auquel Antigone a toujours tort et... Macron ou Créon toujours raison…L'opposition entre patriotes (ou souverainistes) et mondialistes ne trouve pas grâce à vos yeux ?
Il faudrait d'abord que l'on parle toujours des mêmes gens quand on évoque les « patriotes » et les « souverainistes ». Or, ces deux termes renvoient à des ordres de choses différents.
Le patriotisme est lamour profond pour la terre de ses pères pas seulement le territoire et ses paysages, mais aussi l'héritage religieux et spirituel, intellectuel et moral dans toute sa richesse historique, linguistique et symbolique. C'est l'insertion dans une filiation familiale, locale, régionale et nationale. Le patriotisme est à la fois complexe et simple et, comme tout amour, se traduit spontanément par la défense de l'être aimé lorsqu'il est menacé.
Ainsi entendu, comment ne pas être patriote ? L'homme sans patrie, tel que l'envisageait Tocqueville, est un damné de la Terre. Il serait l'incarnation de cette fiction dangereuse qui voudrait que nous soyons individuellement des êtres radicalement autarciques, sans aucun lien, ainsi que le rêvent tous les Jacques Attali de notre temps. S'efforcer de le faire croire, c'est paver la voie au plus atroce des despotismes, un homme ainsi démuni étant une proie trop facile pour tous les tyrans.
Et le souverainisme ?
C'est une doctrine politique précise, qui voit dans la souveraineté populaire le fondement du politique, et dans l'État-nation la forme naturelle de la société politique. C'est très exactement la forme que la Révolution française met en place dans les faits, après que les "philosophes" l'aient élaborée de manière théorique. Les souverainistes d'aujourd'hui, remplis de bonnes intentions, voient dans cet État-nation un recours, contre le supranationalisme qui s'est développé au XXe.
Mais ce recours a peu à voir avec le véritable patriotisme, car en réalité, dans sa réflexion, le souverainisme s'inscrit dans le cadre même de la subversion de la notion de patrie. En fait, ce que ne voient manifestement pas les défenseurs actuels de la souveraineté, c'est que celle-ci procède exactement de la même tentation idéologique et démiurgique que celle que l'on associe de nos jours - à juste titre - à la mondialisation libérale. À l'origine de la doctrine moderne de la souveraineté, on trouve l'affirmation que le pouvoir est le point de départ absolu de l'ordre politique, qui surgit donc d'une pure volonté, sans attache dans un quelconque ordre naturel, ou même culturel, traditionnel.
Vous êtes en train de nous dire que le souverainisme est un avatar du libéralisme ?
L'origine historique du libéralisme n'est pas l'origine historique du souverainisme. Rien à voir apparemment entre Hobbes et Mandeville. Historiquement, la doctrine de la souveraineté de l'État précède l'invention du libéralisme politique. Il n'en reste pas moins que le libéralisme a servi de vecteur à la doctrine de la souveraineté à travers le dogme politique de la souveraineté populaire. Mais aujourd'hui, dans une version libérale renouvelée, la souveraineté populaire est dépassée. Deux raisons sont avancées d'une part la forme étatique est considérée comme révolue, et d'autre part, le politique, lui est considéré comme intrinsèquement porteur de violences. Pourtant, l'anthropologie fondamentale du souverainisme reste la même que celle du libéralisme. C'est l'individualisme. En cela, leur opposition revêt un caractère pour une part illusoire.
Qu'avez-vous contre la théorie de la souveraineté politique ?
La souveraineté (telle qu'on l'entend communément) n'a de sens qu'en fonction de l'individualisme, comme représentant l’imposition d'un ordre extrinsèque, reconstruit par haut, face au nihilisme, face à l'anomie, cette absence de loi qui fait le fond de l'individualisme moderne. Ce que j'affirme dans ce livre, c'est qu'une pratique de la souveraineté politique est en soi impuissante à contrer le pouvoir de dissolution de ce nihilisme individualiste, qui a vampirisé l'ordre social, et abâtardi la culture. Il faut avant tout se dégager de ce piège dans lequel nous maintient l’anthropologie moderne.
Vous prônez aussi l'« autarcie » : n'est-ce pas un autre mot pour « souveraineté » ?
La question de l'autarcie est délicate. On associe spontanément l'autarcie au « repli sur soi », donc à quelque chose de négatif, quand l’autarcie au sens aristotélicien signifie à l'inverse le fait d'être apte à se suffire et à faire quelque chose par soi-même. Il s'agit d'une capacité qui suppose le développement des vertus. Avant d'être une question d'indépendance, l'autarcie est de l'ordre d'un accomplissement, celui d'une communauté qui est venue à un épanouissement suffisant pour former une cité. L'autarcie aristotélicienne n’est pas seulement économique une cité, pays, doit, par exemple, être capable de développer le savoir. Et ne dit-on pas des sociétés qui ne sont plus capables de produire du savoir qu'elles stagnent, sinon qu'elles sont dans un processus de décadence ? Il est également insuffisant de réduire l'autarcie à une pure indépendance de décision de l'autorité politique. Au fond, ce qui se joue avec l’autarcie, c'est la définition même de l’ordre politique et du bien qui lui est propre.
L'autarcie, c'est donc le bien commun, mais comment réaliser le bien commun dans un peuple qui nie ses racines ?
C'est le cœur du problème. Il n'y a bien commun que s'il y a une communauté pour le mettre en œuvre, et en même temps la communauté advient pleinement lorsqu'il y a un amour des mêmes choses, selon le mot de saint Augustin. Cet amour des mêmes choses, c’est ce qui fait, pour le dire en termes plus contemporains, une même culture. L'affaissement de la culture commune est signe de l’affaiblissement de la communauté, et réciproquement. Ainsi, supposer qu'il faille un « peuple enraciné » pour retrouver le bien commun, c'est supposer le problème résolu.
Comment une société peut-elle s'affaiblir elle-même ?
Il faut d'abord accepter le fait que si la communauté s'est ainsi affaiblie, jusqu'à éventuellement se mettre à terme en danger, ce n'est pas en vertu d'un processus de dégradation spontanée, mais parce qu'elle a eu et qu'elle a encore des ennemis, qu'il faut accepter de nommer, dénoncer et combattre selon les moyens appropriés, et qui ne sont pas qu'extérieurs. On ne combat efficacement des ombres, et même les idées sont toujours portées par des hommes.
Ceci étant dit, la solution du problème, si elle doit advenir, passera nécessairement par le fait qu'une force sociale, quelle qu'elle soit, sera à même de susciter à nouveau un amour suffisamment fort des vertus intellectuelles et morales pour unifier les énergies. Cela suppose un vigoureux effort intellectuel, à même de combattre efficacement Terreur et le mensonge. La philosophie a ici une place de choix, mais pas seulement elle.
Justement, vous en appelez à la subsidiarité politique, est-ce faire primer le combat métapolitique ou local sur la politique nationale ?
Pas nécessairement. L'appel à la subsidiarité, c'est l'appel à l'effort de chacun et des communautés (au sens droit du terme) afin de retrouver le sens de l'action, et de se réapproprier ce que l'État n'a eu que trop tendance à vampiriser. C'est un appel à retrouver le sens de l'initiative bien comprise.
Il reste que, dans le contexte qui est le nôtre, nous devrons sans doute nous passer encore longtemps du niveau "architectonique", c'est-à-dire du pouvoir de décision proprement politique. Et donc de fait, il va falloir, nolens volens, partir d'initiatives (d’abord locales, qui ne sont pas "métapolitiques", mais infra-politiques, au sens où elles ne touchent pas directement et immédiatement la communauté entière. Mais ceci sans tomber dans le piège d'un repli dans des communautés de base, ou choses équivalentes. Il faut toujours garder en vue que Ton travaille pour le bien commun.
Quel rôle pour les chrétiens ?
Il est à l'évidence essentiel. Parce que les chrétiens sont détenteurs par excellence des moyens spirituels indispensables, et qu'ils peuvent redevenir, s'ils le veulent, les détenteurs de la culture classique, de la culture tout court. Ce ne sont pas ses destructeurs qui pourront la faire renaître, sauf conversion radicale. Mais en tant que chrétien, nous avons tout le patrimoine nécessaire pour faire revivre le savoir et les vertus. « Tout ce qui est vrai et bon est nôtre », disait encore saint Augustin. C'est une grande grâce. Mais c'est aussi une redoutable responsabilité.
Propos recueillis par François La Choüe monde&vie 29 juin 2017Guilhem Golfin, Souveraineté et désordre politique, Cerf, 208 p., 19 €.
-
Gauvain le Chevalier Solaire - Le Cycle arthurien #6
-
Enquête sur l’édition française (2) : « Il fallait passer au livre, s’incarner »
L’Action Française 2000 se penche sur l’état de l’édition en France. Lit-on encore ? Publie-t-on trop ? L’édition électronique a-t-elle un avenir ? Panorama d’une culture en profonde transformation, avec des témoignages d’éditeurs, dans toute leur diversité.Entretien avec Maximilien Friche, directeur des éditions Nouvelle Marge.
Pouvez-vous nous raconter l’histoire de votre jeune maison d’édition ?
Nouvelle Marge vient de Mauvaise Nouvelle, une revue en ligne que je dirige depuis 2013. Cette revue publie chaque semaine aussi bien des tribunes de combat du politiquement correct que des recensions littéraires en laissant une place importante aux arts et à la poésie. À force de publier en ligne, je me suis dit que j’étais, de fait, un éditeur. Il fallait passer au livre, s’incarner. Le premier roman publié fut le cinquième roman de Sarah Vajda, Jaroslav et Djamila, et je fus ravi d’entrer en littérature avec un roman d’amour d’un auteur dont je suis fan. Cette année, Nouvelle Marge se lance dans les essais, avant d’ouvrir la voie vers d’autres écrits : recueils de nouvelles, poèmes épiques… Rien ne nous est interdit puisque nous avons pris la marge dès notre naissance ; nous allons donc bien nous amuser.
Quelle est la philosophie générale de Nouvelle Marge ?
Comme tout s’échine à nier la personne humaine dans ce monde, Nouvelle Marge a un combat : l’existence. En littérature, nous voulons d’abord rétablir la vocation héroïque du lecteur et, en ce sens, nous nous opposons à toute la culture de l’autofiction où les auteurs nous racontent la vie de leurs entrailles en se croyant profonds et en nous incitant à prendre des vessies pour des lanternes. Nouvelle Marge veut également allier l’amour de la langue avec sa passion de la modernité. C’est sans doute dans ce mariage qu’émerge le style dans le principe d’individuation de la langue. L’écrivain est cette gargouille qui se laisse traverser par le Verbe. Il rend ce qu’il reçoit, il traduit sa chair en paroles. Si les initiales s’inversent entre Nouvelle Marge et Mauvaise Nouvelle, c’est pour symboliser l’ambition d’être le lieu où l’être fait sa propre révolution, sa conversion. Nouvelle Marge souhaite apporter l’écrit qui modifie l’être, qui le rétablit dans sa dimension tragique. En guise de philosophie générale, finalement, je me demande si ce ne serait pas une volonté non pas d’échapper au monde en allant à sa marge, mais plutôt de le reconstruire à sa marge, de construire une arche peut-être.
Vous avez ouvert récemment une « zone d’essais » (collection « Mauvaise Nouvelle »). C’est une petite révolution puisque Nouvelle Marge était à l’origine vouée aux genres narratifs. Comment abordez-vous cette nouvelle étape ?
Je ne voulais publier effectivement que des œuvres narratives et puis, une controverse littéraire avec un ami ayant écrit un essai sur Dantec m’a amené à descendre de mon snobisme germanopratin. En fait, des écrits peuvent modifier un être au-delà de la forme narrative, notamment par la langue, comme en poésie notamment, par la transmission avec les essais qui nous placent dans une aventure de la pensée. Un autre élément a concouru à la création de cette zone d’essais : la richesse des textes publiés dans Mauvaise Nouvelle et la volonté de donner aux plus beaux d’entre eux un corps. Il me fallait donc une collection dédiée aux essais et pour continuer de laisser les univers d’Internet et du livre s’entremêler, cette zone est la collection “Mauvaise Nouvelle”. Cette dernière se veut fidèle à l’esprit de la revue, au sens où l’outrance ne nous fait pas peur pour parvenir à désarçonner le politiquement correct, et que, dans le même temps, nous refuserons toujours d’être réduits à la pensée militante. Je ne crée pas une marge pour finir dans une niche. J’aborde donc cette collection d’essais avec beaucoup d’enthousiasme car je sais qu’il s’agit d’un lieu où l’intelligence va jouir de sa liberté.
Vous éditez le Petit dictionnaire maurrassien de Stéphane Blanchonnet (sortie ironique le 14 juillet 2017). Que représente pour vous l’école d’Action française ?
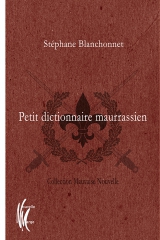 Voilà encore de quoi s’enthousiasmer ! Et les rodomontades ou autres procès staliniens que je subis depuis que j’ai annoncé la parution de cet essai sur Maurras ne font que conforter ma décision de lancer une série politique. À l’heure où les Français choisissent les députés sur CV et que la France est dirigée par un algorithme, il me semble essentiel d’apporter quelques précis politiques aux lecteurs et électeurs. Et comme je préfère être en marge qu’en marche, Maurras inaugure cette série. D’autres suivront : Marx, De Gaulle, Jaurès… Pour l’heure, nous publions le Petit dictionnaire maurassien de Stéphane Blanchonnet, et commencer une série politique par un ouvrage consacré à l’auteur de la formule «
Voilà encore de quoi s’enthousiasmer ! Et les rodomontades ou autres procès staliniens que je subis depuis que j’ai annoncé la parution de cet essai sur Maurras ne font que conforter ma décision de lancer une série politique. À l’heure où les Français choisissent les députés sur CV et que la France est dirigée par un algorithme, il me semble essentiel d’apporter quelques précis politiques aux lecteurs et électeurs. Et comme je préfère être en marge qu’en marche, Maurras inaugure cette série. D’autres suivront : Marx, De Gaulle, Jaurès… Pour l’heure, nous publions le Petit dictionnaire maurassien de Stéphane Blanchonnet, et commencer une série politique par un ouvrage consacré à l’auteur de la formule « Politique d’abord !
» me semble tout à fait à propos. J’ai toujours été fasciné par la longévité et le dynamisme de l’AF, sa faculté à renouveler ses forces militantes. Le point essentiel pour moi reste de croiser très souvent des intellectuels, des journalistes, des écrivains, des professeurs… qui se réclament de ce mouvement qui les a formés intellectuellement et leur a permis d’irriguer le monde des idées de l’AF. J’oserais dire que l’on ne peut pas s’intéresser à la politique sans s’arrêter un temps sur l’AF, son histoire et son actualité. •L'Action Française - 25 juillet 2017.
-
Combattre pour la vraie France
-
Rudyard Kipling
Rudyard Kipling est né à Bombay, alors en Inde britannique, le 30 décembre 1865. Son père est sculpteur. Ses parents se considèrent comme "Anglo-Indiens", ce qui sera aussi le cas, plus tard, de Rudyard, même s'il ne vivra que peu en Inde. Il gardera de cette période heureuse de sa vie, une grande nostalgie qu'il exprimera dans ses livres. Il aima ces « Journées de ténèbres et de lumière crue » qu'offre Bombay.
Enfance : le paradis, puis l’enfer
Et puis, direction l'enfer. La tradition voulait que les enfants fussent envoyés en Angleterre. Les parents craignaient l'influence délétère que pouvaient avoir les employés indigènes sur leur progéniture. Rudyard, âgé de six ans et sa jeune soeur Alice, âgée de trois ans, prirent le bateau pour l'Angleterre. Direction une famille d'accueil. Les six années qui suivirent furent horribles. L'épouse du capitaine Holloway était une marâtre épouvantable qui martyrisait les enfants. Kipling racontera, soixante ans plus tard :« Si vous faites subir un interrogatoire à un enfant de sept ou huit ans sur ses activités de la journée (surtout lorsqu'il tombe de sommeil), il se contredira d'une façon tout à fait satisfaisante. Si chaque contradiction est épinglée comme mensonge et rapportée au petit déjeuner, la vie n'est pas facile, j’ai dû subir pas mal de brimades, mais il s'agissait là de torture délibérée, appliquée religieusement et scientifiquement. Par contre cela m'obligea à faire très attention aux mensonges que je dus bientôt concocter et je suppose qu'il s'agit d'une bonne base pour une carrière littéraire. » Si c'est le prix à payer pour devenir un génie de la littérature… Alice fut moins martyrisée que Rudyard, ce qui explique peut-être pourquoi elle ne brilla pas en littérature. Les enfants eurent tout de même des moments de bonheur, notamment ces Noëls chez leur tante, qui était l’épouse du merveilleux peintre préraphaélite Edward Burne-Jones « un paradis auquel je dois en vérité d'avoir été sauvé » dira Kipling. Les enfants ne tardèrent pas d'être enfin retirés de l'enfer qu'ils vivaient. Mais pourquoi n'avaient-ils rien dit à leur tante bien-aimée ? Kipling aura, plus tard, cette réflexion terrible « Les enfants ne parlent pas plus que les animaux car ils acceptent ce qui leur arrive comme étant décidé de toute éternité. De plus, les enfants maltraités savent très exactement ce qui les attend s’ils révèlent les secrets d'une prison avant d'en être bel et bien sortis ». Et puis, Rudyard entra dans une école destinée à préparer les garçons à la carrière militaire. Ce ne fut pas un franc succès. Il fut décidé qu'il n'avait pas les aptitudes nécessaires pour obtenir une bourse d'études qui lui aurait permis d'aller à l'université d'Oxford. Retour en Inde. Nous étions en 1882.
Ses débuts en littérature
Son père lui procura un emploi à Lahore. Il allait travailler comme assistant dans une petite feuille locale. Une expérience qu'il ne regrettera pas puisqu'il appellera plus tard la Civil and Military Gazette de Lahore, « ma première maîtresse, mon premier amour ». Il adorait écrire. Le rédacteur en chef lui proposa de composer des nouvelles pour son journal. Kipling publia une quarantaine de nouvelles dans la Gazette entre novembre 1886 et juin 1887. Il sillonna l'Inde. Ses soirées, aux distractions bien limitées, étaient passées au club, en compagnie d'officiers et d'ingénieurs qui noyaient leur ennui dans l'alcool. Mais, raconte Bruno de Cessole dans son beau livre L'Internationale des francs-tireurs, que de compensations « La saveur de l'aube, l'éblouissement de la lumière et de la couleur, le parfum entêtant du bois de santal et du jasmin, les promenades matinales aux marché aux fruits de Bombay et celles du soir, près de la mer, à l'ombre des palmeraies, la voix des vents nocturnes à travers feuilles des bananiers et le chant des grenouilles arboricoles, les errances jusqu'à l'aube dans les tavernes de jeu et d'opium »... Rudyard et sa famille passaient leurs vacances tous les ans de 1885 à 1888 à Shimla, station de montagne célèbre qui servait de capitale d'été officielle du Raj britannique et la ville figura régulièrement dans les récits qu'il publiait dans la Gazette. Il décrira, avec un regard critique et ironique, les mondanités et les jeux amoureux perpétuels que déployait toute cette colonie qui s'ennuyait ferme. Kipling écrivait à un rythme endiablé. Il publia six recueils de nouvelles en 1887. Il était âgé de vingt-deux ans ! Et puis, en Angleterre en 1889, après toutefois un long-voyage via Singapour, Hong Kong, le Japon, les Etats-Unis où il rencontrera Mark Twain, qui l'impressionna beaucoup. Il allait faire des débuts littéraires remarqués et remarquables à Londres.
Le chemin de la gloire
Ses ouvrages pour la jeunesse ont connu dès leur parution un succès qui ne s'est jamais démenti, notamment Le livre de la jungle (1894), Le Second livre de la jungle (1895), qu'il prit un plaisir immense à écrire, et qui suscitèrent un grand nombre de lettres de jeunes lecteurs, auxquels il se fit un devoir de répondre. Il écrivit aussi Histoires comme ça (1902), Puck, lutin de la colline (1906). Il est également l'auteur des romans Kim (1901), Capitaines courageux, de poèmes Mandalay (1890), Gunga Din (1865) et Tu seras un homme, mon fils (1910, le poème le plus célèbre d'Angleterre) sont parmi les plus connus, et de nouvelles, dont L’Homme qui voulait être roi (1888). Voici ce qu'écrit Jack London, l'auteur de Martin Eden, surnommé le Kipling du Nord, qui l'admirait, à l'annonce de sa mort et de son enterrement en 1901, sauf que l'information, parue dans les journaux américains, était fausse ! Il lui restera encore trente-cinq ans à vivre... « Cet homme a rendu ce siècle impérissable et lui-même impérissable. Cet homme sera notre porte-parole dans les siècles à venir restera tant qu'il y aura des oreilles pour l’entendre ». Jack London, qui l'a magnifiquement honoré, portait aux nues le chantre du peuple anglo-saxon, avec son goût de l'aventure, de la piraterie, du combat entêté, son amour de la liberté, son énergie opiniâtre. Il célèbre aussi, raconte Cessole, celui qui, imprégné du sens des réalités, avait prêché l'évangile du travail, encouragé chacun à remplir la tâche qui est à sa portée, et glorifié, contre les rêveurs et les bavards, l'homme d'action, « qui va de l’avant et abat la besogne, le dos courbé, le front en sueur et les mains calleuses ». Kipling va être, durant des décennies, l'un des auteurs les plus populaires de la langue anglaise. L'écrivain Henry James écrit à son sujet « Kipling me touche personnellement, comme l'homme de génie le plus complet que j'aie jamais connu. » Marcel Proust, quant à lui, dira que le Livre de la Jungle aura été « une des plus grandes joies littéraires » qu'il aura éprouvées. En 1907, il est le premier auteur de langue anglaise à recevoir le Prix Nobel de littérature, et le plus jeune à l'avoir reçu (à 42 ans) « en raison », proclamera l'Académie, « de la puissance d'observation, de l’originalité d’invention, de la vigueur des idées et du remarquable talent narratif qui caractérisent les œuvres de cet écrivain mondialement célèbre. » L'Académie suédoise entendait ainsi rendre hommage « à la littérature anglaise si riche de gloires diverses, ainsi qu'au plus grand génie que ce pays ait jamais produit dans le domaine de la narration. » Par la suite, Kipling a refusé d'être anobli.
La guerre puis les dernières années
L'une des premières contributions de Kipling à la Grande Guerre fut de participer au Bureau de la Propagande de Guerre. Il vécut le drame d'y perdre son fils, le lieutenant John Kipling, tué à la bataille de Loos en 1915, et écrivit ces lignes « Si quelqu'un veut savoir pourquoi nous sommes morts, / Dites-leur parce que nos pères ont menti. ». Il est probable que Kipling ait éprouvé un profond sentiment de culpabilité il avait encouragé son fils à entrer dans la garde irlandaise de la British Army alors que le jeune homme avait été réformé à cause de sa myopie. Kipling va rejoindre la Commission impériales des sépultures militaires et choisira la phrase tirée de la Bible, « Leur nom vivra à jamais » qui sera inscrit sur les sépultures ou encore « Connu de Dieu » sur la tombe des soldats inconnus. Et puis Kipling, débordant d'activité, se prit de passion pour l'automobile. Il devint chroniqueur et s'enthousiasma pour la voiture, racontant ses voyages, généralement en compagnie d'un chauffeur. Il continuera à écrire jusqu'au début des années 1930, avec, certes un succès moindre. Il fut une des premières victimes du « politiquement correct ». Il eut à subir de violentes attaques de 1910 à sa mort, accusé d'être un « versificateur à gages », un « prophète de sang et de vulgarité » ou encore un « propagandiste réactionnaire, vaniteux et aigri », ayant compromis son talent dans la défense des « causes les plus vulgaires » entendez le patriotisme et le militarisme -. La gauche ne lui pardonnait pas de dénoncer l'évolution du monde et des mentalités modernes, qu'il assimilait à une irrémédiable décadence. Et puis, il dénonçait le socialisme dans lequel il voyait une brèche par laquelle s'engouffreraient les ennemis de l'Angleterre. Et puis, horreur, n'avait-il pas brandi l'étendard de l'impérialisme et du patriotisme, n'évoquait-il pas la supériorité de la race blanche en général, et anglo-saxonne en particulier, vis-à-vis des peuples de couleur ?
L’annonce de sa mort, puis sa mort
On se souvient de l’information erronée de sa mort, parue en 1901, dans les journaux américains. Et voici qu'une revue anglaise annonça son décès en 1935. Il y répondit avec humour « Je viens de lire que j'étais décédé. N'oubliez pas de me rayer de la liste des abonnés. » Une hémorragie due à un ulcère finit cependant par l'emporter le 18 janvier 1936. Ses cendres reposent au Poets'Corner de l'abbaye de Westminster. Une anecdote que nous rapporte Wikipédia amoureux de l'Inde, Kipling avait demandé à son éditeur d'orner les pages de garde de ses livres de swastikas, symbole indien de vie. Les svastikas furent retirés pour éviter toute ambiguïté au moment de la montée du nazisme en Allemagne, bien que leurs branches fussent sinistrogyres et non dextrogyres.
R.S. Rivarol 27 juillet 2017
-
Les racines de la France à quelques centimètres sous terre
Extraordinaire découverte à Vienne :
 "Une cité antique de 7 000 m² a été mise au jour, à Sainte-Colombe-lès-Vienne, dans le Rhône, en bordure du fleuve. Composée de luxueuses demeures et d’espaces publics en remarquable état de conservation, elle a été classée “découverte exceptionnelle” par le ministère de la Culture. Les fouilles s’étendront jusqu’en décembre.
"Une cité antique de 7 000 m² a été mise au jour, à Sainte-Colombe-lès-Vienne, dans le Rhône, en bordure du fleuve. Composée de luxueuses demeures et d’espaces publics en remarquable état de conservation, elle a été classée “découverte exceptionnelle” par le ministère de la Culture. Les fouilles s’étendront jusqu’en décembre.En avril, une équipe, envoyée sur le site pour une opération archéologique en prévision de la construction d’un immeuble, a exhumé 7 000 m² d’un faubourg de la Vienne romaine, en pleine ville. “Il s’agit sans doute de la fouille la plus exceptionnelle de l’époque romaine depuis 40 ou 50 ans. Nous avons une chance inouïe”, a déclaré un des archéologues de l’association Archeodunum, Benjamin Clément".
-
Thomas d'Aquin et la quête du divin - Thierry-Dominique Humbrecht
-
Du nouveau sur Louis XVII (Au Coeur de l'Histoire)