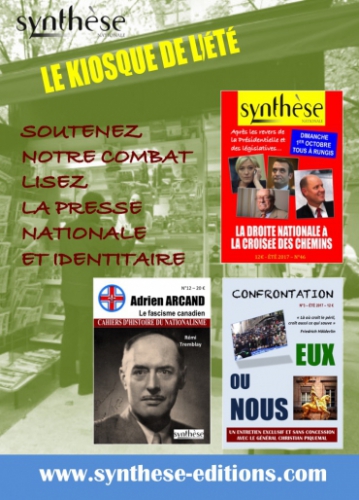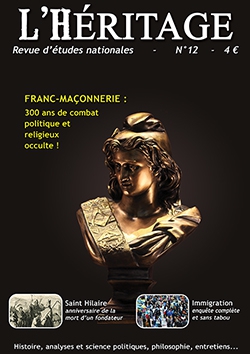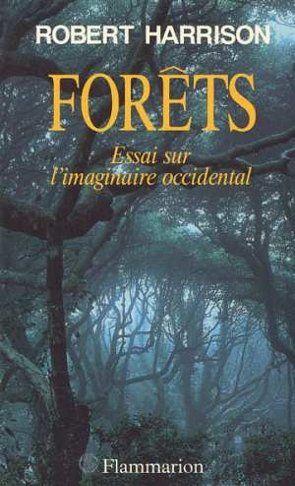 [Ci-contre : couverture de l'étude de R. Harrison, reparue en poche (Champs-Flammarion, 1994). « Le mot “forêt” est à l’origine un terme juridique. Tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes (foresta, forest,forst...), il vient du latin foresta. Le mot latin n’apparait pas avant la période mérovingienne. Dans les documents romains et les premiers actes du Moyen Âge le terme usuel pour désigner les bois et les régions boisées était nemus. Le mot foresta apparaît pour la première fois dans les lois des Lombards et les capitulaires de Charlemagne, pour désigner non tant les régions boisées en général que les réserves de chasse royale. L’origine du mot est incertaine. Selon toute vraisemblance, il viendrait du latin foris, en dehors. L’obscur verbe latin forestare signifiait retenir en dehors, mettre à l’écart, exclure. En effet, pendant la période mérovingienne où le mot foresta fit son entrée dans le lexique, les rois s’étaient octroyé le droit d’exclure du domaine public de vastes étendues boisées, afin d’y préserver la vie sauvage qui, en retour, devait assurer le maintien d’un rituel royal fondamental : la chasse »]
[Ci-contre : couverture de l'étude de R. Harrison, reparue en poche (Champs-Flammarion, 1994). « Le mot “forêt” est à l’origine un terme juridique. Tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes (foresta, forest,forst...), il vient du latin foresta. Le mot latin n’apparait pas avant la période mérovingienne. Dans les documents romains et les premiers actes du Moyen Âge le terme usuel pour désigner les bois et les régions boisées était nemus. Le mot foresta apparaît pour la première fois dans les lois des Lombards et les capitulaires de Charlemagne, pour désigner non tant les régions boisées en général que les réserves de chasse royale. L’origine du mot est incertaine. Selon toute vraisemblance, il viendrait du latin foris, en dehors. L’obscur verbe latin forestare signifiait retenir en dehors, mettre à l’écart, exclure. En effet, pendant la période mérovingienne où le mot foresta fit son entrée dans le lexique, les rois s’étaient octroyé le droit d’exclure du domaine public de vastes étendues boisées, afin d’y préserver la vie sauvage qui, en retour, devait assurer le maintien d’un rituel royal fondamental : la chasse »]
« Détruire des forêts ne signifie pas seulement réduire en cendres des siècles de croissance naturelle. C'est aussi un fonds de mémoire culturelle qui s'en va » : Robert Harrison résume bien, ainsi, l'enjeu plurimillénaire, le choix de civilisation que représente la forêt, avec ses mythes et ses réalités (Forêts : Essai sur l'imaginaire occidental, Flammarion, 1992). Une forêt omniprésente dans l'imaginaire européen.
L'inconscient collectif est aujourd'hui frappé par la destruction des forêts, due à l'incendie, aux pluies acides, à une exploitation excessive. Un être normal — c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore totalement conditionné par la société marchande — ressent, quelque part au fond de lui-même, quelle vitale vérité exprime Jean Giono lorsqu'il écrit de l'un de ses personnages : « Il pense : il tue quand il coupe un arbre ! »
Le rapport de l'homme à la forêt est primordial. Il traduit une vision du monde, le choix d'un système de valeurs. Car la forêt, symbole fort, porte en elle des références fondamentales. « Une époque historique — écrit Harrison — livre des révélations essentielles sur son idéologie, ses institutions et ses lois, ou son tempérament culturel, à travers les différentes manières dont elle traite ou considère ses forêts ». Dans la longue mémoire culturelle des peuples, la place donnée — ou non — aux forêts est un repère qui ne trompe pas.
Pour étudier la place des forêts dans les cultures et les civilisations, depuis qu'il existe à la surface de la terre des sociétés humaines, Harrison prend pour guide une grille d'analyse forgée par un Napolitain du XVIIIe siècle, Giambattisto Vico, qui résume ainsi l'évolution de l'humanité : « Les choses se sont succédé dans l'ordre suivant : d'abord les forêts, puis les cabanes, les villages, les cités et enfin les académies savantes » (La Science nouvelle, 1744).
Ainsi, les forêts seraient à l'origine la matrice naturelle d'où seraient sortis les premiers hommes. Lesquels, en s'affranchissant du milieu forestier pour ouvrir des clairières, en se regroupant pour construire des cabanes, auraient planté les premiers jalons de la civilisation, c'est-à-dire de la conquête de l'homme sur la nature. Puis, d'étape en étape, de la ruralité au phénomène urbain, de la rusticité à la culture savante, de la glèbe aux salons intellectuels, l'humanité aurait réalisé son ascension. On voit bien, ici, s'exprimer crûment cette conception tout à la fois linéaire et progressiste de l'histoire, qui triomphe au XVIIIe siècle avec la philosophie libérale des Lumières pour nourrir, successivement, l'idéologie libérale et l'idéologie marxiste. Mais cette vision de l'histoire plonge ses racines très loin, dans cette région du monde qui, entre Méditerranée et Mésopotamie, a donné successivement naissance au judaïsme, au christianisme et à l'islam, ces 3 monothéismes qui sont définis, à juste titre, comme les religions du Livre.
TU NE PLANTERAS PAS...
Religions du Livre, de la Loi, du désert. C'est-à-dire religions ennemies de la forêt, car celle-ci constitue un univers à tous égards incompatible avec le message des fils d' Abraham. La Bible, est, à ce sujet, sans ambiguïté. Dans le Deutéronome, Moïse ordonne à ses errants dont il veut faire le Peuple élu de brûler, sur leur passage, les bois sacrés que vénèrent les païens, de détruire ces piliers de bois qui se veulent image de l'arbre de vie : « Mais voici comment vous devez agir à leur égard : vous démolirez leurs autels, briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux sacrés, et vous brûlerez leurs idoles ». L'affirmation du Dieu unique implique l'anéantissement des symboles qui lui sont étrangers : « Tu ne planteras pas de pieu sacré, de quelque bois que ce soit, à côté de l'autel de Yahvé ton Dieu que tu auras bâti ».
Cet impératif sera perpétué par le christianisme, du moins en ses débuts lorsqu'il rencontre sur son chemin, comme principal obstacle, la forêt et ses mythes. Très vite, l'Église pose en principe un face à face entre les notions de paganisme, sauvagerie et forêt (sauvage vient de sylva), d'un côté, et christianisme, civilisation et ville, de l'autre. Quand Charlemagne entreprend. pour se faire bien voir d'une Église dont il attend la couronne impériale, une guerre sainte en Saxe, bastion du paganisme, il donne pour première consigne à ses armées de détruire l'lrminsul, ce monument qui représente l'arbre de vie et qui est le point de ralliement des Saxons. Le message est clair : pour détruire la capacité de résistance militaire des païens, il faut d'abord éliminer ce qui donne sens à leur combat. Calcul erroné, puisqu'il faudra, après la destruction de l'lrminsul, encore trente ans de massacres et de déportations systématiques pour imposer la croix. Les clercs entourant Charlemagne n'avaient pas compris que pour les Saxons comme pour tout païen, les dieux vivent au cœur des forêts, comme le constatait déjà Tacite chez les Germains de son temps. Autrement dit, tant qu'il reste un arbre debout, le divin est présent.
LA FORÊT-CATHÉDRALE
La soumission forcée des Saxons n'aura pas fait disparaître pour autant la spiritualité liée aux forêts. Car le christianisme a dû, contraint et forcé, s'adapter à la mentalité européenne, récupérer et intégrer les vieux mythes qui parlaient encore si fort, au cœur des hommes. Cette récupération s'exprime à travers l'architecture religieuse : « La cathédrale gothique — note Harrison — reproduit visiblement les anciens lieux de culte dans son intérieur majestueux qui s'élève verticalement vers le ciel et s'arrondit de tous côtés en une voûte semblable à celle des arbres rejoignant leurs cimes. Comme des ouvertures dans le feuillage, les fenêtres laissent pénétrer la lumière de l'extérieur. En d'autres termes, l'expression forêt-cathédrale recouvre davantage qu'une simple analogie, car cette analogie repose sur la correspondance ancienne entre les forêts et la résidence d'un dieu » (cf. aussi Les Racines des cathédrales, Roland Bechmann, Payot, 1981).
L'Église s'est trouvée, au Moyen Âge, confrontée à un dilemme : contre le panthéisme inhérent au paganisme, et qui voit le divin partout immergé dans la nature, il fallait décider d'une stratégie de lutte. Réprimer, pour extirper, éradiquer ? C'est la solution que préconisent de pieuses âmes, comme le moine bourguignon Raoul Glaber : « Qu'on prenne garde aux formes si variées des supercheries diaboliques et humaines qui abondent de par le monde et qui ont notamment une prédilection pour ces sources et ces arbres que les malades vénèrent sans discernement ». En favorisant les grands défrichements des Xlle et XIlle siècles, les moines ont un objectif qui dépasse de beaucoup le simple intérêt économique, le gain de nouvelles surfaces cultivables : il s'agit avant tout, de faire reculer ce monde dangereux, car magique, qui abrite fées et nymphes, sylves et sorcières, enchanteurs et ermites (dont beaucoup trop ont des allures rappelant fâcheusement les hommes des chênes, les anciens druides). Brocéliande est, comme Merlin, « un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres ».
Faut-il, donc, détruire les forêts ? Les plus intelligents des hommes d'Église comprennent, au Moyen Âge, qu'il y a mieux à faire. Le culte de saint Hubert est chargé de faire accepter la croix par les chasseurs. Les “chênes de saint Jean” doivent, sous leur nouveau vocable, fixer une étiquette chrétienne sur les vieux cultes du solstice qui se pratiquent à leur pied. On creuse une niche dans l'arbre sacré pour y loger une statuette de la Vierge (nouvelle image de l'éternelle Terre-Mère). Devant “l'arbre aux fées” où se retrouvent à Domrémy Jeanne d'Arc et les enfants de son âge, on célèbre des messes. La plantation du Mai, conservée, sera compensée par la fête des Rameaux ( qui vient remplacer la Fête de l'arbre que célébraient, dans le monde romain, les compagnons charpentiers pour marquer le cyclique et éternel retour du printemps).
Saint Bernard, qui a su si bien, comme le rappelle Henri Vincenot [in : Les Étoiles de Compostelle, Denoël, 1984, repris en Folio, 1987], perpétuer les traditions celtiques, assure tranquillement devant un auditoire d'étudiants : « Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira ». Cet accueil et cette intégration, par le syncrétisme, d'une nature longtemps perçue, par la tendance dualiste présente dans le christianisme, comme le monde du mal, du péché, sont poursuivis par un saint François d'Assise. « C'était en accueillant la nature — constate Georges Duby —, les bêtes sauvages, la fraîcheur de l'aube et les vignes mûrissantes que l'Église des cathédrales pouvait espérer attirer les chevaliers chasseurs, les troubadours, les vieilles croyances païennes dans la puissance des forces agrestes » (Le temps des cathédrales, Gal., 1976).
La perpétuation du symbole de l'arbre et de la forêt se fera, à l'époque moderne, par la plantation d'arbres de la Liberté (1), les sapins de NoëI, la branche verte placée par les compagnons charpentiers sur le faîtage terminé de la maison...
L'ARBRE COMME SOURCE DE VIE
Mais, référence culturelle par excellence, la forêt reste, jusqu'à nos jours, un enjeu idéologique et l'illustration d'un choix de valeurs. Quand Descartes, dans son Discours de la méthode, compare l'autorité de la tradition à une forêt d'erreurs, il prend la forêt comme symbole d'un réel, foisonnant et touffu, dont il faut s'abstraire, en lui opposant la froide mécanique Raison. « Si Descartes se perd dans la forêt — le monde historique, matériel —, ne nous étonnons pas qu'il se sente chez lui dans le désert (...) C'est l'esprit désincarné qui se retire de l'histoire, qui s'abstrait de sa matière et de sa culture » (R. Harrison,op. cit.). Ajoutons : de son peuple.
Inversement, en publiant leurs célèbres Contes et légendes du foyer, les frères Grimm, au XIXe siècle, entendent redonner, par le biais de la langue, un terreau culturel, un enracinement à la communauté nationale et populaire allemande. Or, significativement, la forêt est omniprésente dans leurs contes, en tant que lieu par excellence de ressourcement.
L'arbre comme source de vie. Présent encore parmi nous grâce à une reuvre qui a, par bien des aspects, valeur initiatique, Henri Vincenot me confiait un jour : « II y a dans la nature des courants de forces. Pour reprendre des forces, c'est vrai que mon grand-père s'adossait à un arbre, de préférence un chêne, et se pressait contre lui. En plaquant son dos, ses talons, ses mains contre un tronc d'arbre, il ne faisait rien d'autre que de capter les forces qui vivent et cornmontent en l'arbre. Il ne faisait qu'invoquer, pour y puiser une nouvelle énergie les puissances de la terre, du ciel, de l'eau, des rochers, de la mer... » (éléments n°53).
► Pierre Vial, Le Choc du Mois n°53, 1992.
(1) cf. Jérémie Benoit, « L'Arbre de la Liberté : résurgence d'une mentalité indo-européenne », in Études indo-européennes, 1991.
http://vouloir.hautetfort.com/archives/category/tradition/index-35.html

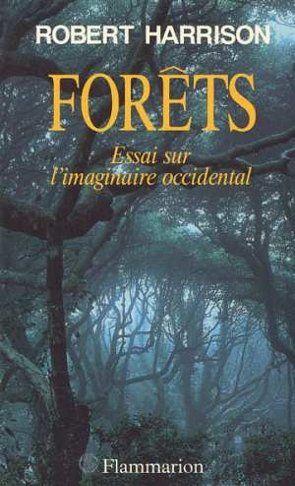 [Ci-contre : couverture de l'étude de R. Harrison, reparue en poche (Champs-Flammarion, 1994). « Le mot “forêt” est à l’origine un terme juridique. Tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes (foresta, forest,forst...), il vient du latin foresta. Le mot latin n’apparait pas avant la période mérovingienne. Dans les documents romains et les premiers actes du Moyen Âge le terme usuel pour désigner les bois et les régions boisées était nemus. Le mot foresta apparaît pour la première fois dans les lois des Lombards et les capitulaires de Charlemagne, pour désigner non tant les régions boisées en général que les réserves de chasse royale. L’origine du mot est incertaine. Selon toute vraisemblance, il viendrait du latin foris, en dehors. L’obscur verbe latin forestare signifiait retenir en dehors, mettre à l’écart, exclure. En effet, pendant la période mérovingienne où le mot foresta fit son entrée dans le lexique, les rois s’étaient octroyé le droit d’exclure du domaine public de vastes étendues boisées, afin d’y préserver la vie sauvage qui, en retour, devait assurer le maintien d’un rituel royal fondamental : la chasse »]
[Ci-contre : couverture de l'étude de R. Harrison, reparue en poche (Champs-Flammarion, 1994). « Le mot “forêt” est à l’origine un terme juridique. Tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes (foresta, forest,forst...), il vient du latin foresta. Le mot latin n’apparait pas avant la période mérovingienne. Dans les documents romains et les premiers actes du Moyen Âge le terme usuel pour désigner les bois et les régions boisées était nemus. Le mot foresta apparaît pour la première fois dans les lois des Lombards et les capitulaires de Charlemagne, pour désigner non tant les régions boisées en général que les réserves de chasse royale. L’origine du mot est incertaine. Selon toute vraisemblance, il viendrait du latin foris, en dehors. L’obscur verbe latin forestare signifiait retenir en dehors, mettre à l’écart, exclure. En effet, pendant la période mérovingienne où le mot foresta fit son entrée dans le lexique, les rois s’étaient octroyé le droit d’exclure du domaine public de vastes étendues boisées, afin d’y préserver la vie sauvage qui, en retour, devait assurer le maintien d’un rituel royal fondamental : la chasse »]