Quand le traditionaliste séduit par la pensée royaliste a suffisamment parcouru l'œuvre de l'incontournable Charles Maurras, son arrêt suivant se situe généralement sur les sentiers du tout aussi grand Maurice Barrès. Présentons-le en quelques lignes hautes en couleur, pour les non-initiés : Barrès est un écrivain et homme politique français né en 1862, qualifiable de pendant mélancolique de Maurras, et autre figure de proue du nationalisme traditionaliste français. Orateur virulent, funestement antidreyfusard, boulangiste convaincu, nationaliste attaché un temps aux idées socialistes, ennemi absolu du marché absolu, figure fluctuante d'un patriotisme se cherchant un peu, tanguant entre la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède (antiparlementaire et nationaliste) et le royalisme positif de son ami Maurras, dont il se distinguait par un rapport aux idées politiques bien plus distancié. Il ne cèdera jamais au monarchisme, ni au républicanisme, ni à aucun autre dogme que celui de la terre et du sang. Tout en tenant à l'"équilibre du Moi" en ces temps où moult idéologies veulent transformer la personne en individu, l'homme donne une importance capitale au respect de ce qui a précédé, les ancêtres et leur héritage, et à ce qui transcende les êtres, le sacré. "Nous sommes les instants d'une chose immortelle", dira-t-il vers la fin de sa vie.
Félix Croissant, pour le SOCLE
La critique positive des Déracinés au format .pdf
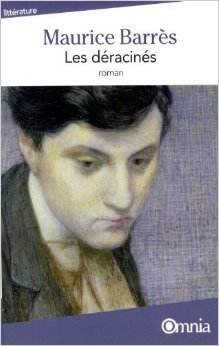 Alors que Barrès est surtout un essayiste, un chroniqueur et un journaliste, son livre le plus connu est un roman publié en 1897, Les Déracinés. Bien que la bibliographie du Socle tiennent également à distance la fiction, s'arrêter attentivement sur cet ouvrage n'aura pas manqué de nourrir notre pensée politique.
Alors que Barrès est surtout un essayiste, un chroniqueur et un journaliste, son livre le plus connu est un roman publié en 1897, Les Déracinés. Bien que la bibliographie du Socle tiennent également à distance la fiction, s'arrêter attentivement sur cet ouvrage n'aura pas manqué de nourrir notre pensée politique.
L'action se déroule dans l'atmosphère dépressive engendrée par la débâcle militaire de 1871 face à la Prusse, cadre où les institutions, jusqu'à la République même, se trouvent en péril, et dans le contexte de la crise économique qui accable le monde depuis 1873, et a provoqué une forte montée du chômage chez les paysans et ouvriers.
Disons-le d'entrée : Les Déracinés est un grand roman dans la lignée de l'œuvre d'un Balzac ou d'un Stendhal, ample et foisonnant, aussi stimulant intellectuellement que passionnant dans son récit. L'écriture de Barrès est un peu solennelle, parfois exagérément verbieuse, mais surtout massive, et lyrique (la description des funérailles de Victor Hugo, sur laquelle se conclura le roman, est d'une puissance inégalée), et d'une précision parfois intimidante dans ses descriptions des tourments psychologiques de ses personnages.
Nancy, 1879
L'action des Déracinés démarre dans un lycée de Nancy, en 1879 (on est dans de la quasi-autobiographie, à ce stade), où sept lycéens, Sturel, Suret-Lefort, Saint-Phlin, Roemerspacher, Racadot, Renaudin et Mouchefrin, pages blanches ne demandant qu'à être remplies, voient leur monde retourné à 670 degrés par un professeur de philosophie jeune et dynamique, Bouteiller, à la fois professeur plein d'idéaux et petit commissaire politique en puissance. Son éloquence, sa verve, et sa conviction monolithique d'appartenir au camp de l'avenir et du juste va convertir sans mal ces gamins à une vision du monde républicaine (Bouteiller est un gambettiste convaincu, soit de la gauche républicaine modérée) et kantienne (sa devise : toujours agir en désirant que son action serve de règle universelle). Cette vision du monde a un corollaire : l'idée que l'avenir se joue à Paris, centre du monde d'alors… où ces jeunes hommes joueront, précisément, leur avenir. On percevra rapidement l'amour de Barrès pour la province et sa méfiance envers la cité. L'ascension des jeunots sur la capitale survient au bout d'une petite cinquantaine de pages au-delà desquelles rien n'ira plus : ivres d'espoirs et de fierté mal placée, naïvement confiants en la solidité de leurs liens face à la gargantuesque machine citadine, le groupe de jeunes hommes est déjà, sans s'en rendre compte, victime du déracinement lorrain que leur a fait subir Bouteiller, théoricien plus obsédé par sa grande idée de la France que par les âmes qui la forment. Le déniaisement parisien suivra, et se conclura cinq ans plus tard par le sacrifice sous la guillotine d'un des sept protagonistes, présenté comme le dommage collatéral de leur entreprise trop grande qui se sera brisée sur l'impitoyable réalité de cette fin de siècle comme des vagues sur un rocher.
Sans s'ouvrir dessus, l'action des Déracinés prend vraiment son envol lorsque les sept jeunes Lorrains se retrouvent autour du tombeau de Napoléon 1er pour lancer leur grand projet de journal "différent", La Vraie République. Napoléon, figure du grandiose et de l'accomplissement personnel, source de l'imagination condensée du siècle. Un modèle. À la fin du livre, les ex-gamins auront remplacé ces aspirations à un horizon supérieur par une place dans le système, vie faite de concessions qu'ils auraient méprisées quelques années plus tôt. La cité corruptrice… air connu.
Nous avons donc Sturel, fils de la grande bourgeoisie provinciale et rêveur à la sensibilité maladive ; Roemerspacher, animal social cartésien et équilibré ; Gallant de Saint-Phlin, de famille monarchiste et catholique, grand optimiste ; Suret-Lefort, pur produit de Science Po, avocat anticlérical et antiromantique ; Renaudin, journaleux arriviste et avare, futur traître au boulangisme ; Racadot, petit-fils de serf et ambitieux matérialiste ; Moucherin, sans-le-sou malingre et laid trouvant sa raison d'être dans l'ombre de Racadot. Quelques uns des personnages ont de sérieux airs de Rastignac - l'œuvre de Balzac n'ayant pas échappé à Barrès. Mais l'élévation dans la société des personnages de Barrès se distingue de celle des personnages de Balzac par sa différence de ton : là où Balzac épousait le cynisme blasé de son antihéros, Barrès habite ses personnages les plus prospères et carriéristes d'un certain fatalisme stendhalien (certains rappelant davantage le Julien Sorel du Rouge & Le Noir). Par ailleurs, le mélancolique et indécis François Sturel, qui ressemble le plus à Barrès, a davantage de temps d'antenne que des personnages comme l'opportuniste Suret-Lefort. Sturel et quelques autres finiront par réaliser, trop tard, l'erreur de leur voie individualiste et de la réalité du déracinement.
Un puissant écho dans le présent
Se distinguant de l'œuvre d'un Zola de par son aptitude à bouleverser les idées, Les Déracinés n'offre rien de moins qu'un témoignage historique et politique d'une époque à la fois proche de la nôtre sur la frise historique, et séparée par le gouffre béant du 20ème siècle. C'est une fiction certes, mais nourrie à l'expérience barrésienne du monde, détail qui confère au romanesque une légitimité de document officiel, et une épaisseur d'ouvrage documentaire. Documentaire étonnant d'actualité : Barrès décrit un monde en connaissance de cause, et cela donne lieu à des scènes de la vie politique et sociale de Paris d'une authenticité impressionnante, et effroyablement proches de celles que l'on connait aujourd'hui. Barrès invite rétrospectivement à une mise en perspective de l'Histoire française d'après-1793, réduisant le gouffre du 20ème siècle à quelques coups de canons bien bruyants et deux-trois charniers fort regrettables : en le lisant, le patriote d'aujourd'hui, fût-il pleinement conscient que le désastre civilisationnel contemporain n'a pas surgi du néant au mois de mai 68, ne manquera pas de penser : "ventre-saint-gris, c'était exactement la même chienlit en 1880 !" Exactement, cent ans avant l'arrivée d'Attali à l'Élysée en tant que conseiller spécial de l'homme à l'écharpe rouge - non, pas Christophe Barbier. La même chienlit : le déracinement. Une société sans repère. Les Déracinés est un manifeste presque philosophique sur ses dangers, et, bien naturellement, politique (on peut y deviner, par exemple, l'antidreyfusisme de son auteur et son hostilité générale envers les Juifs non-assimilés…).
Trouvons, page 240, un exemple illustrant le puissant écho du roman avec notre réalité : "La France débilitée n'a plus l'énergie de faire de la matière française avec des éléments étrangers. Je l'ai vu dans l'Est, où sont les principaux laboratoires de Français. C'est pourtant une condition nécessaire à la vie de ce pays : à toutes les époques, la France fut une route, un chemin pour le Nord émigrant vers le Sud ; elle ramassait ces étrangers pour s'en fortifier. Aujourd'hui, ces vagabonds nous transforment à leur ressemblance." Le caractère prophétique des Déracinés est un autre de ses joyaux : dès 1880, il aura diagnostiqué un ébranlement fondamental des valeurs annonçant un "ordre nouveau".
La cité mortifère
Au-delà même de sa nature de récit initiatique, Les déracinés est surtout une radioscopie de l'univers intellectuel Parisien dans la troisième république naissante, aux institutions menacées par les calculs politiques et les ambitions personnelles. Barrès connaissant le monde du journalisme parisien, on a droit à des pages entières de description des relations perverses qui lient temporairement politiciens et journalistes, et du carnaval des subventions d'état à la presse. On retrouve Bouteiller, anciennement professeur de philosophie plein de formules pompeuses, présentement boursier et aspirant-député ne reniant pas le moindre calcul, et le gotha parisien qu'il fréquente, comprenant des personnages historiques comme le banquier juif Jacques de Reinach. On passe de la haute bourgeoisie vivant dans des hôtels particuliers de l'ouest parisien, incarnée par la jeune Mademoiselle Alison, qui épousera plus tard un jeune baron un peu crétin, au Paris populaire du nord-est, où subsistent deux de nos jeunes Lorrains les moins fortunés. Barrès juxtapose l'univers érudit et ouaté du Bel-Ami de Maupassant à celui, étouffant et suintant, des Misérables d'Hugo, dimensions interdépendantes d'un Paris hypertrophié et articulé par le seul chaos, au cœur duquel fermente le tumulte à venir, cadre de la monstrueuse mosaïque de l'auteur.
On s'évade aussi de cet imposant foutoir à travers les récits rocambolesques et mystiques de la belle aristocrate ottomane Astiné Aravian, venue de Constantinople et de passage à Paris, dont le jeune Sturel tombe vite amoureux. Elle l'aidera à prendre en partie conscience de l'ampleur du monde, et à déceler - un peu - l'absurdité certaine du petit théâtre parisien.
En guise de parenthèse, on rappellera que Barrès était un grand voyageur. Lorsqu'André Gide, pas son plus grand partisan, lui écrit, après lecture des Déracinés : "né à Paris d'un père uzétien (d'Uzes, située dans le Gard) et d'une mère normande, où voulez-vous que je m'enracine ? J'ai donc pris le parti de voyager", Barrès a l'autorisation de lui rire à la figure. Il faut préciser que Gide le comparera plus tard à Adolf Hitler. CQFD.
La République, l'universalisme, Kant, et leur "nouveau monde"
Qui dit Paris dit république. La position de Barrès à son égard est ambigüe ; jamais vraiment antirépublicain comme un Maurras, mais conscient de ses tares inéluctables, il se fend d'une critique en demi-teinte de ce régime incandescent. Il prend lui aussi un recul saisissant pour observer cette dernière, inspiré par l'œuvre du grand historien Hippolyte Taine, à qui l'on doit le monumental livre-fleuve Origines de la France contemporaine. Ce dernier, auquel Barrès dédiera un chapitre entier de son livre, compare l'internat à de "grosses boites de pierre", machines égalitaires où la personne est réduite à l'état d'individu. Barrès n'exprimera rien de moins dans son livre avec ses sept jeunes protagonistes à la fois produits et victimes de cette machine.
Face au niveau de langage et de réflexion de ces jeunes Lorrains, sans commune mesure avec celui des jeunes têtes plus ou moins blondes qui garnissent nos lycées, certains de nos contemporains seront tentés de relativiser les failles de l'internat. Ce point n'échappera pas à l'esprit lucide traversant nos âges sombres et subissant les excentricités funestes du monde moderne, son néolibéralisme suintant, son progressisme vindicatif, son vivrensemble, sa discrimination positive, son relativisme culturel, sa LGBT-friendliness, son Aymeric Caron à l'incomparable chouinage poivre et sel, sa Belkacem à mini-jupe rétractable, son sapin de Noël anal, son art moderne tout autant, et son absence regrettable de Dominique Wolton. C'était déjà la chienlit en 1880, mais en lisant Les Déracinés, on mesure l'ampleur de la dégringolade pluridisciplinaire que connait la France. Pour paraphraser Orwell, à l'époque d'Entre les murs, embrasser le monde de Barrès devient un acte révolutionnaire.
À suivre
http://lesocle.hautetfort.com/archive/2016/03/20/les-deracines-de-maurice-barres-5777117.html
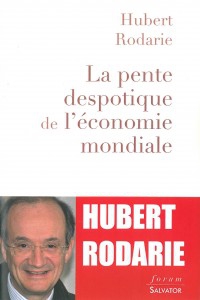 Hubert Rodarie est directeur général délégué du groupe d’assurance SMABTP et auteur de plusieurs ouvrages traitant de la situation économique et financière.
Hubert Rodarie est directeur général délégué du groupe d’assurance SMABTP et auteur de plusieurs ouvrages traitant de la situation économique et financière.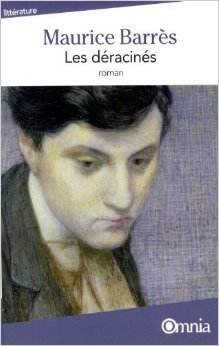 Alors que Barrès est surtout un essayiste, un chroniqueur et un journaliste, son livre le plus connu est un roman publié en 1897, Les Déracinés. Bien que la bibliographie du Socle tiennent également à distance la fiction, s'arrêter attentivement sur cet ouvrage n'aura pas manqué de nourrir notre pensée politique.
Alors que Barrès est surtout un essayiste, un chroniqueur et un journaliste, son livre le plus connu est un roman publié en 1897, Les Déracinés. Bien que la bibliographie du Socle tiennent également à distance la fiction, s'arrêter attentivement sur cet ouvrage n'aura pas manqué de nourrir notre pensée politique.  Quand le traditionaliste séduit par la pensée royaliste a suffisamment parcouru l'œuvre de l'incontournable Charles Maurras, son arrêt suivant se situe généralement sur les sentiers du tout aussi grand Maurice Barrès. Présentons-le en quelques lignes hautes en couleur, pour les non-initiés : Barrès est un écrivain et homme politique français né en 1862, qualifiable de pendant mélancolique de Maurras, et autre figure de proue du nationalisme traditionaliste français. Orateur virulent, funestement antidreyfusard, boulangiste convaincu, nationaliste attaché un temps aux idées socialistes, ennemi absolu du marché absolu, figure fluctuante d'un patriotisme se cherchant un peu, tanguant entre la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède (antiparlementaire et nationaliste) et le royalisme positif de son ami Maurras, dont il se distinguait par un rapport aux idées politiques bien plus distancié. Il ne cèdera jamais au monarchisme, ni au républicanisme, ni à aucun autre dogme que celui de la terre et du sang. Tout en tenant à l'"équilibre du Moi" en ces temps où moult idéologies veulent transformer la personne en individu, l'homme donne une importance capitale au respect de ce qui a précédé, les ancêtres et leur héritage, et à ce qui transcende les êtres, le sacré. "Nous sommes les instants d'une chose immortelle", dira-t-il vers la fin de sa vie.
Quand le traditionaliste séduit par la pensée royaliste a suffisamment parcouru l'œuvre de l'incontournable Charles Maurras, son arrêt suivant se situe généralement sur les sentiers du tout aussi grand Maurice Barrès. Présentons-le en quelques lignes hautes en couleur, pour les non-initiés : Barrès est un écrivain et homme politique français né en 1862, qualifiable de pendant mélancolique de Maurras, et autre figure de proue du nationalisme traditionaliste français. Orateur virulent, funestement antidreyfusard, boulangiste convaincu, nationaliste attaché un temps aux idées socialistes, ennemi absolu du marché absolu, figure fluctuante d'un patriotisme se cherchant un peu, tanguant entre la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède (antiparlementaire et nationaliste) et le royalisme positif de son ami Maurras, dont il se distinguait par un rapport aux idées politiques bien plus distancié. Il ne cèdera jamais au monarchisme, ni au républicanisme, ni à aucun autre dogme que celui de la terre et du sang. Tout en tenant à l'"équilibre du Moi" en ces temps où moult idéologies veulent transformer la personne en individu, l'homme donne une importance capitale au respect de ce qui a précédé, les ancêtres et leur héritage, et à ce qui transcende les êtres, le sacré. "Nous sommes les instants d'une chose immortelle", dira-t-il vers la fin de sa vie.